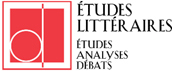Résumés
Résumé
Chrétien de Troyes ouvre son Conte du Graal sur une étonnante métaphore de l’écrivain semeur en train de répandre ses graines romanesques. Cette représentation paysanne d’un auteur qui travaille le texte comme on travaillerait la terre permet alors de légitimer une écriture littéraire toujours susceptible, au Moyen Âge, de constituer un affront aux Écritures. En se peignant dans l’effort rustique, Chrétien de Troyes choisit donc de reconduire sa soumission, tant à l’ordre divin (le labeur est bien le destin de tout bon chrétien depuis le péché originel) qu’à la hiérarchie féodale où le fruit de l’activité n’est qu’une exigence du fief que le travailleur ne saurait réclamer.
Abstract
Chrétien de Troyes’ Le Conte du Graal opens with a surprising metaphor of the writer depicting himself in the country, sowing his narrative seeds. This rustic figuration of a novel being worked on just as if tilling the soil seems to be a subtle way to legitimise the author. Indeed, medieval society was typically wary of the act of creation : only God was viewed as a powerful demiurge. Posing as a hardworking peasant, Chrétien de Troyes manages to avoid blasphemy : not only does he accept the fate of any good Christian, doomed to toil ever since the original sin, but he also reclaims the feudal system in which the worker has no rights to the fruit of his labour.
Corps de l’article
À bien des égards, parler de travail au Moyen Âge n’est pas chose aisée. Si l’on reconduit les bornes communément admises pour délimiter la période, il est, d’une part, impossible d’embrasser presque dix siècles d’histoire en une seule et même pensée sociale. D’autre part, nous sommes, bon gré mal gré, confronté à la rareté des documents. Non seulement le primat de l’oral caractérisant la société médiévale génère un blanc de l’écrit souvent difficile à combler, mais, plus l’on cherche à remonter le temps, plus les traces susceptibles de nous renseigner s’exposent à une usure matérielle qui les rend parfois proprement muettes. Comment dès lors suivre et comprendre la réflexion qui a pu se nouer autour de la notion de travail, sans être confronté à une part d’hypothèse ? S’il est vrai que l’entreprise requiert une infinie précaution, elle n’est pas impossible à mener : les recherches de Jacques Le Goff ou de Georges Duby en témoignent. Il ne s’agira pourtant pas ici d’apporter de nouveaux éléments de réponse, ni de faire l’état de la recherche sur ce point, mais de lire, à la lumière de quelques travaux de médiévistique, une représentation littéraire de l’homme au travail. À partir du prologue du Conte du Graal[1] de Chrétien de Troyes, nous voudrions montrer comment le texte concentre et problématise certaines questions relatives au labeur, tel qu’il a pu être conçu au Moyen Âge. Le roman s’ouvre, en effet, sur une étonnante métaphore de l’auteur semeur en train de répandre ses graines romanesques. L’image, développée sur quelques vers, invite à penser l’écriture sur le mode du travail au champ. Cette mise en scène paysanne de l’écrivain retiendra notre attention en ce qu’elle permet, semble-t-il, de légitimer un geste créateur qui ne va pas de soi au XIIe siècle.
Travail et ascèse : le labeur chrétien
Dans un monde qui n’accorde le pouvoir démiurgique qu’à Dieu, la création littéraire, qui plus est en langue vulgaire, est toujours susceptible de constituer un blasphème, puisqu’elle ose faire concurrence à celle, parfaite, du Créateur. Chrétien de Troyes, à l’instar de tous ses pairs, se voit donc engagé dans un délicat projet de justification, qu’il met d’ailleurs en branle dès les premiers vers de son roman :
Qui petit seime petit quiaut
Et qui auques recoillir viaut
En tel leu sa semence espande
Que fruit a cent doble li rande.
[…]
Crestiens seime et fait semence
D’un romanz que il encommence
Et si lo seime en sin bon leu
Qu’il ne puet estre sanz grant preu[2].
L’ouverture reprend presque littéralement la deuxième épître de Paul aux Corinthiens : « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment[3] ». Dans cet univers des lettres, sur lequel règnent en maîtres les clercs, c’est un passage obligé que de rattacher une oeuvre en langue vernaculaire à la Bible. Par le truchement de la référence sacrée, l’auteur résorbe non seulement le hiatus qui éloigne la production romane des autorités latines, mais, ce faisant, formule aussi la promesse d’un récit édifiant qui perpétue les Écritures. Cette sentence biblique, à partir de laquelle se fondera la métaphore du romancier paysan, fait en outre un étonnant écho à la célèbre parabole du semeur expliquée par saint Matthieu : « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente[4] ». Ce n’est pas innocemment que Chrétien de Troyes récupère à son compte un geste de semaison manifestement lourd de sens : il se donne à voir dans l’accomplissement impeccable du devoir religieux, puisqu’il accueille, au coeur même de son texte, le message divin, et se charge, à son tour, de le répandre.
La métaphore est d’autant plus intéressante qu’elle opère un glissement social qui participe encore de cette entreprise de légitimation. Le clerc, s’il est un homme d’esprit, reste avant tout un homme de Dieu et doit consacrer la plupart de son temps à la prière : dans la société médiévale tripartite[5], il appartient en ce sens au groupe des oratores. Chrétien choisit donc par l’image de transiter dans la sphère rustique des laboratores, ceux qui travaillent de leurs mains nues. En réinvestissant virtuellement l’effort physique, il recharge l’écriture de connotations beaucoup plus douloureuses. Dans cette perspective, il n’est pas étonnant de l’entendre déclarer à la fin de son prologue que sa tâche de romancier n’est pas de tout repos :
Crestïens qui entant et poine
Par lo commandemant lo comte
A arimer lo meillor conte
Qui soit en cort reial[6].
Le champ lexical du labeur témoigne d’une activité qui, pour toute intellectuelle qu’elle soit, ne semble pas moins mettre la chair à rude épreuve. L’argument d’un travail soutenu qui imprime au corps la fatigue s’inscrit alors dans un discours de l’ascèse. Parce qu’elle est aussi éprouvante que le geste paysan, l’écriture permet non seulement de rabaisser l’orgueil[7], mais constitue de facto une voie louable pour se rapprocher de Dieu. En effet, si le travail physique est originellement rivé au châtiment divin[8], et fut par là même considéré comme maudit, il sera progressivement réhabilité au point de constituer, pour la société féodale qui émerge au IXe siècle, le destin naturel du chrétien[9]. La règle de saint Benoît, sur laquelle se fonde l’organisation des premières communautés religieuses à partir du VIe siècle, est en ce sens explicite :
L’oisiveté est ennemie de l’âme.
Aussi, à certains moments,
Les frères doivent être occupés à travailler de leurs mains.
À d’autres moments,
Ils doivent être occupés à la lecture de la Parole de Dieu[10].
La prière et le travail font partie d’un même programme ascétique pour échapper à ce péché capital qu’est la paresse : mettre le corps à rude épreuve, c’est entretenir la pureté de son âme. De même, et comme le montrera Robert Fossier, les plus anciennes traces de calendriers peints ou sculptés abandonnent peu à peu les symboles antiques des mois au profit de figures d’hommes aux champs : le laboureur, le vendangeur ou le bêcheur sont autant d’images significatives d’une activité physique résolument inscrite dans le quotidien médiéval[11]. La scène du labour, étymologiquement lié au labeur, offre donc à Chrétien une résonance toute trouvée pour entériner de nouveau sa soumission à Dieu et offrir à son oeuvre une réception immunisée de toute accusation de blasphème.
Travail et redevance : le labeur féodal
La justification de l’écriture ne se fait pas seulement dans une perspective chrétienne : le monde paysan convoqué par l’auteur permet de faire émerger un univers féodal tout aussi chargé de sens. Dans ce nouveau paradigme se dessine alors un rapport singulier à la terre puisque, conformément au fonctionnement du fief, celui qui la possède n’est pas celui qui la travaille, et inversement :
Les travailleurs ont sur la terre des droits d’usages et d’occupation mais la propriété appartient à une hiérarchie de seigneurs, dont aucun n’a la disposition absolue du sol, mais dont chacun a, sur le produit ou sur les héritages de ses inférieurs, des droits de prélèvement fixés par la coutume[12].
Chrétien de Troyes, en empruntant le masque du serf médiéval, réitère une mise à distance de son oeuvre, car il refuse, en apparence, d’en réclamer l’entière propriété : son roman, comme toute production agricole, ne fait que répondre aux impératifs du seigneur sous la protection duquel il mène ses activités. Son prologue est en ce sens parfaitement révélateur d’un texte non seulement commandé, mais aussi destiné à un supérieur hiérarchique :
Il le fait por lo plus prodome
Qui soit en l’empire de Rome,
C’est li cuens Felipes de Flandres.
[…]
Or oez commant s’an délivre[13].
De la même façon que l’écriture est un travail au champ, l’univers courtois, dans lequel le récit apparaît, récupère le fonctionnement du domaine seigneurial. Ainsi, le succès attendu par l’auteur n’est plus à remettre sur le compte d’un quelconque talent artistique, mais se voit étonnamment expliqué par une demande royale qui ne peut être que de bon goût. C’est à cet égard le sens du proverbe initial : la meilleure des semences ne vaut rien si la terre dans laquelle elle est plantée n’est pas riche. Le prologue du Chevalier à la charrette ne fonctionne pas autrement que sur la réactualisation de cette hiérarchie seigneuriale :
Puis que ma dame de Chanpaigne
Vialt que romans a feire anpraigne,
Je l’aprandrai mout volentiers,
Comme cil qui est suens antiers
De quanqu’il puet el monde feire
Sanz rien de losange avant treire.
[…]
Del Chevalier de la Charrete
Comance Crestïens son livre
Matiere et san li done et livre
La Contesse, et il s’antremet
De panser, si que rien n’i met
Fors sa painne et s’antancïon[14].
Malgré l’absence de métaphore paysanne, l’auteur ne justifie pas moins le geste scriptural par les mêmes procédés. L’effort littéraire est bien présent, mais bien plus encore, l’impulsion créatrice n’est pas une initiative personnelle : elle incombe explicitement à la Dame de Champagne. Chrétien de Troyes, qu’il soit serf ou serviteur, cherche donc toujours à s’abriter sous le bouclier du mécénat.
Afin de réaffirmer cette distance prise avec son oeuvre, l’écrivain précise en outre que la matière sur laquelle il travaille lui a été imposée. Pour en revenir plus précisément au prologue du Conte du Graal, on notera la mention faite d’un livre source que Philippe de Flandres aurait donné à l’auteur pour l’inspirer, interdisant de ce fait l’idée d’une création ex nihilo[15]. Ce don originel qui lance l’écriture ne va d’ailleurs pas sans rappeler le protocole féodal par lequel le seigneur autorise à son serf l’exploitation de sa terre :
La concession du fief par le seigneur au vassal se fait au cours d’une cérémonie, l’investiture consistant, en un acte symbolique, en la remise d’un objet (étendard, sceptre, verge, anneau, couteau, gant, morceau de paille, etc.). Elle suivait en général la foi et l’hommage[16].
Le rapprochement est éclairant : le livre donné pour modèle, détail anodin s’il en est, à tout le moins topique, permet à l’imagerie du fief de se déployer à nouveau, confirmant ainsi l’inscription de Chrétien de Troyes dans un espace littéraire sur lequel il n’a pas, en apparence, les pleins pouvoirs. Son travail, aussi brillant soit-il, échappe alors subtilement à toute controverse, puisqu’il n’est pas l’expression d’une subjectivité libre, chose impensable au Moyen Âge, mais bien celle d’un génie[17] sous contrainte et, en ce sens, acceptable aux yeux de la société.
Du travail romanesque : les marques de l’autorité
Le travail de l’écriture, à l’instar du labeur au champ, concourt somme toute à l’effacement d’un auteur paysan qui voue son existence entière aussi bien au Seigneur qu’à son seigneur. Véritable scénario d’aliénation ici joué par Chrétien de Troyes, puisqu’il n’apparaît pas autrement dans son prologue que par le biais de la troisième personne. Apparemment dépossédé de son texte et de son autorité, l’écrivain n’en cherche pas moins à récupérer discrètement le masque du démiurge. En effet, la figure du semeur par laquelle il se met en scène reste ambiguë. L’auteur convoque un cadre paysan, mais semble refuser de tomber pour autant dans le monde du vilain, dont il connaît l’image peu reluisante que l’intelligentsia médiévale lui associe volontiers[18]. Giovanni Cherubini rappelle, à cet égard, la tradition d’un regard méprisant fréquemment jeté sur l’homme rustique :
La satire met souvent en relief, avec sa saleté, la pauvreté des vêtements et la grossièreté de ses aliments, une sorte de sauvagerie du paysan, qui semble parfois se placer à un niveau presque intermédiaire entre la bête et l’homme[19].
La métaphore paysanne permet une dérobade de l’autorité, mais Chrétien n’est cependant pas décidé à quitter complètement l’univers des lettrés pour celui des idioti ou des rudes[20]. L’imagerie du semeur, précisément parce qu’elle réfère à un geste d’une haute technicité, ne condamne donc pas l’auteur aux tâches élémentaires que l’on relèguerait plus facilement aux simples d’esprit. Robert Fossier évoque, à ce propos, la rigueur du travail de semaison :
Le geste auguste du semeur demande beaucoup d’expérience, afin d’obtenir la régularité indispensable à une bonne prise en terre ; c’est donc l’affaire d’un homme d’âge, un sac en bandoulière d’une dizaine de litres, et marchant lentement, environ 8 kilos ; avec une moyenne de 2 à 3 hectolitres à l’hectare, […] il faudra au semeur trente fois changer son sac et parcourir 15 kilomètres par jour[21].
Outre les conditions que l’on s’imagine proprement harassantes, l’activité doit être assurée par une personne largement qualifiée pour une étape aussi décisive dans le cycle agricole. Ce n’est pas incidemment que Chrétien de Troyes choisit un métier qui non seulement requiert une certaine virtuosité, mais qui constitue de plus l’activité première à toute culture : il faut planter pour récolter.
En effet, en se faisant métaphoriquement dépositaire du blé, qui au Moyen Âge englobe toutes les céréales panifiables[22], l’écrivain devient celui sur lequel repose l’alimentation de toute une société : il est bien un auteur, au sens le plus étymologique du terme[23], principe fertilisant qui permet de faire croître les choses. À l’époque médiévale, la semaison est une étape fondamentale, nécessaire au bon fonctionnement du fief. Tout un cortège de croyances et de rituels païens s’est d’ailleurs développé dans le folklore paysan afin que les grains tiennent leurs promesses de belle récolte :
Avant de semer, on passait les semences dans un crible, fait d’une peau de loup, comportant trente trous — ou bien, on les touchait avec l’épaule d’une taupe. Pour écarter les oiseaux, il était conseillé ou bien d’arroser le champ d’une eau où avaient trempé une écrevisse et une corne de cerf — ou bien d’écrire sur le champ « Raphaë », ou bien d’enfermer un crapaud dans un vase et de l’enterrer au milieu du champ (en ce cas, ne pas oublier de le retirer avant la récolte, sinon la récolte serait perdue)[24].
Ces pratiques, qui nous paraissent aujourd’hui farfelues, témoignent néanmoins avec force du caractère sacré que l’on attribuait aux semailles, geste primordial qui lance le cycle de la vie. Jusque-là dernier maillon des hiérarchies divine et seigneuriale, l’écrivain se place donc désormais en initiateur qui féconde la terre et par là même le texte. L’ambiguïté de la semence, à la fois graine végétale mais aussi sperme, laisse en outre l’occasion à l’auteur de marquer très subtilement son oeuvre du sceau de son identité. En définitive, au commencement était… le verbe de Chrétien de Troyes ! C’est — semble-t-il — ce détournement de la formule évangélique[25] qui affleure ici : la référence biblique faisait apparemment office de bouclier à l’oeuvre ; c’est maintenant le texte qui se joue d’elle, affirmant sa singulière autonomie au sein du champ littéraire.
Au terme de ce parcours, on s’étonnera de la force avec laquelle le prologue concentre, en quelques vers seulement, les faisceaux conceptuels qu’une époque a pu formuler autour de la notion de travail. Le labeur, qu’il s’inscrive dans la sphère chrétienne ou dans l’univers plus particulièrement féodal, constitue pour Chrétien de Troyes un argument solide pour échapper aux susceptibles détracteurs que son roman pourrait provoquer. Par la métaphore paysanne, l’écriture se donne alors un droit à l’existence dans et par l’effort, sans jamais pourtant accepter de s’aliéner à la tâche, ni d’être réduite à une simple redevance. La figure ambivalente du semeur est, en ce sens, révélatrice d’une entreprise complexe de justification, puisqu’il s’agit toujours d’osciller entre la soumission et l’affirmation de soi. La perspective du travail pour aborder le texte médiéval permet somme toute de poser la question d’une subjectivité manifestement en mutation. Il faudra aussi noter que l’imagerie du travailleur ne participe pas seulement de cette légitimation de l’oeuvre : elle engage aussi plus largement une conception de la création à rebours de l’idée pythique que les Anciens pouvaient s’en faire. Le texte n’est pas ici le fruit d’une inspiration, au sens le plus mystique du terme, mais consacre bien une action uniquement humaine et soutenue en vue d’un résultat. De ce fait, le récit de Chrétien de Troyes est proprement efficace, car il verra, dès le siècle suivant, l’accomplissement de l’effet voulu par l’auteur : on récoltera les fruits du Conte du Graal au centuple, puisque jamais un roman médiéval n’aura fait plus d’émules que celui-ci. À la cyclicité du calendrier paysan répond donc celle des aventures de Perceval : belle métaphore germinative d’une littérature arthurienne qui n’a jamais fini de se ramifier, et qui produit, encore aujourd’hui, quelques fleurs au parfum chevaleresque.
Parties annexes
Note biographique
Baptiste Franceschini
Après avoir travaillé en maîtrise sur les phénomènes intertextuels au sein de la littérature romanesque courtoise du XIIe siècle, Baptiste Franceschini prépare actuellement en cotutelle, entre Bordeaux III et l’Université de Montréal, une thèse portant sur la mémoire du Moyen Âge dans l’oeuvre de Jacques Roubaud. Ses intérêts de recherche se situent dans ce champ de la médiévistique qui tente d’analyser et de comprendre la résurgence des lettres romanes dans la production contemporaine.
Notes
-
[1]
Chrétien de Troyes, Le conte du Graal, 1990.
-
[2]
Chrétien de Troyes, op. cit., v. 1-4 et v. 7-10, p. 26 : « Qui sème peu récolte peu, et qui veut avoir belle récolte, qu’il répande sa semence en un lieu qui lui rende au centuple ! […] Chrétien sème et fait semence d’un roman qu’il commence, et il le sème en si bon lieu qu’il ne peut être sans grand profit. »
-
[3]
2Co, 9, 6.
-
[4]
Mt, 13, 23.
-
[5]
À ce propos, nous renvoyons à de nombreux travaux, parmi lesquels ceux de Georges Dumézil (Idéologie tripartite des Indo-Européens, Bruxelles, Latomus, 1958), Georges Duby (Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978), ou encore Jacques Le Goff (« La société chrétienne », La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Flammarion (Champs), 1964, p. 243-297).
-
[6]
Chrétien de Troyes, Le conte du Graal, op. cit., v. 60-63, p. 30 : « Chrétien n’aura donc pas perdu sa peine, lui qui, sur l’ordre du comte, s’applique et s’évertue à rimer le meilleur conte jamais conté en cour royale. »
-
[7]
On notera, à ce propos, que c’est précisément cet aveu du labeur qui autorise Chrétien à déclarer que son conte est, à ce jour, le meilleur que l’on ait jamais entendu. Il ne s’agit pas pour lui d’encenser un talent inné, mais bien d’insister sur le mérite qu’il peut tirer de ses efforts. Il échappe ainsi très subtilement aux accusations de péché d’orgueil que la société médiévale a tôt fait de formuler.
-
[8]
Cette punition est celle affligée à Adam pour avoir commis le péché originel : « C’est à la sueur de ton front que tu gagneras le pain » (Gn, 3, 19). C’est le passage qui, semble-t-il, a été le plus glosé par les clercs médiévaux (Jacques Le Goff, « Le travail dans les systèmes de valeur de l’occident médiéval » 1990, p. 10).
-
[9]
Puisqu’il est impossible de rendre ici compte des évolutions diverses du concept de travail au cours du Moyen Âge, nous renvoyons à l’article de Jacques Le Goff cité précédemment et à l’ouvrage éclairant de Robert Fossier, Le travail au Moyen Âge, 2000.
-
[10]
La règle de saint Benoît, 1992, p. 80.
-
[11]
Robert Fossier, op. cit., p. 20.
-
[12]
Charles Parain, « Caractères généraux du féodalisme », 1971, p. 13.
-
[13]
Chrétien de Troyes, Le conte du Graal, op. cit., v. 11-13, p. 26 et v. 66, p. 30 : « Il le fait [son roman] pour le meilleur homme qui soit dans l’empire de Rome, c’est le comte Philippe de Flandres. […] Écoutez comment il s’en acquitte. »
-
[14]
Chrétien de Troyes, Le chevalier à la charrette, 1991, v. 1-6 et v. 24-29, p. 52 : « Puisque ma Dame de Champagne veut que j’entreprenne un roman, je l’entreprendrai volontiers comme le peut faire un homme qui est sien tout entier pour tout ce que je puis faire au monde, sans recourir à la moindre flatterie. […] Chrétien commence donc à rimer son livre du Chevalier à la Charrette. La comtesse lui en donne la matière et le sens et il s’entremet de penser, n’y dépensant guère que son travail et son attention. »
-
[15]
C’est un topos récurrent de la littérature médiévale que de justifier l’invention par le biais d’une oeuvre, orale ou écrite, préexistante dont on ne ferait finalement que la redite ou la translation du latin vers la langue vernaculaire. De ce fait, le critère d’originalité au Moyen Âge repose sur ce que Chrétien appelera la conjointure, c’est-à-dire l’agencement d’éléments reçus en héritage. On comprend, à cet égard, les a priori parfois persistants que génère cette littérature qui semble ressasser ses objets à l’infini.
-
[16]
Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, 1964, p. 71.
-
[17]
Entendons ici « génie » au sens le plus étymologique de « singularité ».
-
[18]
On pense notamment à certains personnages des fabliaux caractérisés par l’ignorance, la bêtise ou la grossièreté.
-
[19]
Giovanni Cherubini, « Le paysan et le travail des champs », 1989, p. 155.
-
[20]
Maria Teresa Fumagalli, « L’intellectuel », dans Jacques Le Goff, L’homme médiéval, Paris, Seuil (Point / Histoire), p. 203.
-
[21]
Robert Fossier, op. cit., p. 186.
-
[22]
Georges Le Franc, Histoire du travail et des travailleurs, 1975, p. 101.
-
[23]
Le terme vient en effet du latin augere, « faire grandir, augmenter ».
-
[24]
Georges Le Franc, op. cit., p. 103-104.
-
[25]
Nous faisons référence à Jn, 1, 1.
Références
- La règle de saint Benoît, Paris, Sodec / AIM (Témoins du Christ), 1992 (trad. L. Rivière).
- Cherubini, Giovanni, « Le paysan et le travail des champs », dans Jacques Le Goff (dir.), L’homme médiéval, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 129-158.
- Fossier, Robert, Le travail au Moyen Âge, Paris, Hachette (La vie quotidienne), 2000.
- Fumagalli, Maria Teresa, « L’intellectuel », dans Jacques Le Goff, (dir.), L’homme médiéval, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 201-232.
- Le Franc, Georges, Histoire du travail et des travailleurs, Paris, Flammarion, 1975.
- Le Goff, Jacques, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Flammarion (Champs), 1964.
- Le Goff, Jacques, « Le travail dans les systèmes de valeur de l’occident médiéval », dans Jacqueline Hammesse et Colette Muraille-Samaran (dir.), Le travail au Moyen Âge, Louvain, Institut d’études médiévales (Textes, études, congrès), 1990, vol. X, p. 7-22.
- Parain, Charles, « Caractères généraux du féodalisme », dans Sur le féodalisme, actes de la journée d’études du C.E.R.M. du 27 avril 1968, Paris, Éditions sociales, 1971, p. 13-17.
- Troyes, Chrétien de, Le chevalier à la charrette, Paris, Garnier-Flammarion (Bilingue), 1991 (trad. J.-Cl. Aubailly).
- Troyes, Chrétien de, Le conte du Graal, Paris, Le livre de poche (Lettres gothiques), 1990 (trad. et éd. Ch. Méla).