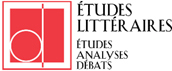Article body
À ceux qui passent devant.
Été 1978. Un village de campagne. Tu as bu du sable, comme d’autres le champagne, pour fêter quelque chose de particulier, que tu ignores. Tu as bu le sable de la cour, là où rien ne pousse, à part l’ennui. De cette fête improvisée, tu retiens les larmes et le souvenir d’une guitare, immense, sur le toit d’un corbillard. Tu ne comprends rien aux choses de la vie : il te suffit de compter les nuages, de polir les pierres, de capturer quelques insectes. Le reste importe peu. Et la douleur de la mort, s’il en est une, sommeille au loin, dans l’écho des montagnes.
Qui donc est parti sans faire de bruit, léger comme la peau morte d’un pissenlit, vers la rivière que l’on ne remonte pas ? Un jeune homme au sourire édenté, à la chevelure sombre. Tu aurais pu deviner qu’il s’en irait, même si tôt dans sa vie, rien qu’à voir les deux pierres noires tombées dans ses yeux. Tu aurais pu deviner, car il buvait toutes les bouteilles de bière comme le lait des seins qu’il n’osait pas aimer.
Il venait parfois, par delà la route meurtrière, dans sa voiture multicolore. Il venait à ta hauteur, alors que tu marchais entre l’asphalte et le fossé. Il t’appelait mademoiselle. Tu avais pour lui des rougeurs brûlantes et des rêves complètement fous que tu repliais dans leurs tiroirs, la nuit tombée.
Tu caresses une pierre comme un visage aimé, dans la hauteur des herbes folles. Genoux contre terre, coeur étouffé. Ce visage, tu l’as perdu tant de fois, glissant entre tes tempes, fuyant dans l’air tiédi d’après-souper. Tu l’as cru rejoignant la meute hurlante des loups. Car nul doute, mourir de cette façon, à dix-neuf ans, ne peut se faire sans crier longtemps, très longtemps, avec la voix des autres.
Que reste-t-il de ce visage, qui revient parfois, tout doucement, en pleine nuit ou au petit matin, dans l’eau de la rivière ou au coeur des prés ? Un sourire, interminable. Immortel. Tu répètes ce mot, immortel, des dizaines de fois, le front blessé sur la roche brûlante, et le mot lui-même n’arrive pas à brûler, et il persiste, inaltérable, comme le sourire, tandis que le visage refond dans la terre.
Bien sûr, les femmes du village ont pleuré. Les jeunes et les moins jeunes, portant leur ventre endolori sous leur tablier. Puis elles ont gratté la terre des jardins longtemps, tripotant la vie à pleines mains. Elles disaient : il n’était pas tout à fait homme encore, se peut-il qu’on nous l’ait repris si tôt, un enfant, oui, un enfant qu’on nous a volé… Et les femmes allaient des jardins au cimetière, pour retourner la terre. Quelques fois, un chant s’échappait de leur gorge et tu voyais les montagnes, là-bas, se coucher à leurs pieds.
Toi, tu ne portes ni tablier ni douleur au ventre, mais une brûlure à faire fondre le soleil dans tes yeux. Rien ne vient sous tes pas et cela t’inquiète parfois ou bien te soulage. Tu n’aimes pas toujours les voyages. Et celui que tu sais disparu de l’autre côté du palpable, ne les a pas aimés suffisamment non plus. Et pourtant il avait un sourire si vaste que le monde entier aurait pu y tenir. Mademoiselle. C’est ainsi qu’il t’appelait, alors que tu marchais entre le dépanneur et la psychose.
On te racontait des histoires, le soir, dans la petite cuisine d’été. Avec pour seul feu celui du soleil couchant et des lucioles. Tu grattais la peau de tes genoux, puis celle de ton nez, tu cultivais des peurs étranges, sorties tout droit de ces pages jaunies encore imprégnées de l’odeur de la vieille grange. C’était un livre pourri et des histoires d’un autre siècle, celles d’une petite fille emprisonnée dans une forêt de lilas. Tu pleurais de cette chose à la fois magnifique et cruelle : une prison de fleurs. Et celui-là, au sourire interminable, qui reposait au cimetière, dans une prison si semblable, tu le savais bordé par les louves et la trop courte histoire de sa vie, répétée des milliers de fois avec la chute des larmes et des soupirs. Et même s’il avait aimé les voyages, tu comprenais que personne au village ne le laissait partir. C’était un enfant sacré, au cou cassé, au coeur éteint. Et c’est vrai, n’est-ce pas, tu as entendu plus d’une fois dire que tout comme le Christ, il allait renaître parmi les femmes qui l’adoraient, rapiécé par leur amour, ébloui par leurs âmes mises à nu. Tu grattais la peau de tes genoux, cherchant dessous la lumière qu’il fallait encore pour participer à ce grand déracinement de la mort.
Qu’aurait-il fallu pour le retenir ici, si près de toi, de ces femmes aussi, les amoureuses de cinquante, trente ou quinze ans ? Voilà ce qu’elles ont toutes sur les lèvres, ce goût acide des regrets, des baisers jamais donnés, jamais reçus. Et leurs mains, encore pleines de colère, caressent l’enfant mort, le transportent dans les prairies imaginaires, le baignent dans l’huile des fleurs. Tu regardes tes propres mains, si petites, trop petites pour soutenir la colère. Tu n’arriveras jamais à faire comme les autres amoureuses, tu ne caresseras jamais l’enfant mort, toujours tu iras te blottir contre son corps, écouter la musique qu’il jouait, entendre les rires qu’il échappait et les mots aussi : bonjour mademoiselle, comment allez-vous ? Voulez-vous monter dans mon char ? Entre l’asphalte et le fossé, le dépanneur et la psychose, il venait sans t’avertir, pour des rendez-vous d’amour toujours manqués.
On te dit sauvage et capricieuse, comme une mauvaise herbe. Et c’est vrai que tu pousses de travers, le coeur un peu trop sorti dans les brumes, la tête couchée dans les astres, le corps à la fois frêle et fort, avec des idées de t’enraciner là où personne ne le voudrait. Mais tu sais qu’un jour tu partiras toi aussi. Tu rêves peut-être de le rejoindre, cet enfant qui n’en n’était plus un, qui riait et qui chantait, qui buvait et conduisait sa voiture folle au milieu de la nuit, là, sur la route du petit pont, si près d’ici, de son lit et de sa mère. C’est bien ça aussi : l’enfant est mort à quelques mètres de sa maison, tout juste assez loin pour que les bras de sa mère ne puissent l’atteindre et le retenir dans la lumière. À la seconde précise où l’enfant a basculé de l’autre côté du monde, les yeux de sa mère se sont ouverts, sa poitrine aussi : elle s’éveillait pour ne plus jamais se rendormir. Depuis, tu la vois marcher, le corps de marbre et le visage cireux. Le regard et la voix vidés jusqu’à la plus pure transparence, laissant deviner les lointains horizons qu’elle tricotait pour lui, bien avant sa naissance.
La vérité, c’est que tu n’y crois pas. Voilà aussi pourquoi tu ne caresses ni ne pleures cet enfant de dix-neuf ans, parti pour un unique voyage. Il vient encore te rejoindre parfois, sur la route du dépanneur, et il parle et rit même plus qu’avant et ses doigts glissent le long de ta taille pour la chatouiller, son souffle se perd derrière tes oreilles, et tu deviens femme en quelques secondes. Tu pousses des petits hoquets de bonheur, quelque chose de chaud et d’ample s’étend dans ton corps. Tu prononces son nom et c’est comme si tu nommais tout l’univers. C’est alors qu’on te regarde de partout, sur les galeries, par les fenêtres, avec le mauvais sang des yeux. Ton corps dansant au milieu du trottoir, les mains tendues vers celui que plus personne d’autre ne voit, met les âmes en lambeaux. Ce qu’il leur faut recoudre alors, en buvant la bière et le vin souvent trop acide, les amoureuses n’en viennent jamais à bout.
Il t’appelait mademoiselle. Tu n’avais pas l’âge de l’aimer sans pudeur, comme les autres filles aux lèvres arrondies pour d’interminables baisers dans le stationnement du dépanneur. Tu connaissais l’existence de ces baisers et de celles qui s’en gavaient, tu connaissais même l’heure exacte où ils s’échangeaient, quelqu’un, un petit copain, venait t’en informer. L’eau de ton coeur alors tournait et devenait âcre comme du vinaigre. Tu montais à ta chambre, te fondre sous les couvertures. Là, ton corps brûlait les mouvements, répétait l’inlassable danse du désir offensé, tes propres lèvres embrassant tes propres bras. Tu n’avais ni seins, ni hanches, aucune démesure dans la chair pour le séduire. Pauvre, voilà ce que tu étais : trop peu de corps, trop peu de peau, trop peu de gestes pour éblouir celui que toutes aimaient déjà, chacune leur tour ou toutes à la fois.
N’est-ce pas là le secret le plus étourdissant et le plus douloureux à la fois ? Cet amour trouble que ses yeux perdaient tout autour de lui, parfois dans les tiens, parfois dans ceux d’une autre ? Tu menais ton corps frêle de gamine par delà les champs de fraises sauvages, ta poitrine bombant et soufflant des petits martyrs jaloux, des envies dévastatrices, des spasmes cruels, remplis de honte. N’avais-tu pas honte, oui, de n’avoir aucune chair de femme à déposer, frémissante, dans le creux de ses mains ? Tu voyais ces filles, chaque jour maudit, pavaner leurs promesses sur la route principale, errer dans leur robe étroite et pourtant cathédrale, qui magnifiait leur corps et les fruits qu’il portait. Et toi, tu demeurais crispée derrière la fenêtre, dans un corps trop petit où l’amour s’affolait, se jetant d’un os à l’autre, d’une veine à l’autre, cherchant le chemin où s’enfuir.
Ainsi l’amour est-il un animal en cage, nerveux et blessé. Il t’arrivait de le sentir ramper dans le creux de ton ventre ou encore lécher les parois de ton coeur. Une petite bête craintive, haletante, affamée. Frissonnante. Tu étais si jeune que jamais tu n’as pensé à la tuer, même si elle grugeait ta moelle et buvait ton sang. Tu ne voyais pas les traces de ta disparition, la pâleur de ta peau et de ton regard, la faiblesse de tes pas, l’agonie de ta voix, tout cela qui advenait lorsque celui qui t’appelait mademoiselle passait devant chez toi sans cogner à ta porte. L’âme froissée en boule, tu n’absorbais plus le monde. L’hiver s’étendait, ça et là, à travers tes os, un vent mortel martelait tes tempes, tu n’entendais plus l’appel de ton nom lorsque la soupe fumait au centre de la table. L’espace de quelques secondes, tu n’étais plus rien d’autre qu’un amas de douleur, dur, intense, insupportable. Un caillou brûlant collé à la fenêtre de la cuisine.
Un quart de siècle s’est écoulé depuis. Loin de ce village et de cet enfant de dix-neuf ans enterré à la lisière du cimetière. Pourtant, tu n’as pas hésité un seul instant, en descendant de la voiture. Tu as posé tous les bons pas dans la bonne direction, jusqu’à sa pierre tombale. Tu savais exactement où la trouver, toujours aussi sobre et grise, si muette. Tu as glissé les fleurs et le livre le long de la pierre. Puis, tu as constaté avec effroi que plus personne ne venait remplir cette mort avec d’autres fleurs, d’autres larmes, quelques soupirs encore amoureux.
Tu avais dix ans lorsque tu as quitté le village. Emportant au loin, dans la froideur et l’épaisseur de la ville, des arômes de pissenlits et de pommes sauvages. Partout, le nom de l’enfant mort se glissait encore sur les lèvres, et les mains se souvenaient, lourdes et tristes, de toutes les caresses offertes, les yeux se fermaient à la lumière du jour pour faire venir celles de son visage et de son rire, certains corps de femme bouillaient toujours au fond des lits ; sa mort, après deux étés, était encore chaude et tenace. Maintenant que tu es devant les seules lèvres de pierre grise où son nom subsiste, tu comprends que la mort entreprend un voyage de longue haleine, et qu’il ne suffit pas de mourir pour mourir.
Est-ce possible en fait, voilà ce que tu te demandes, qu’il faille à la mort plus que le corps de celui qu’elle prend entre ses griffes, plus que son esprit, plus que lui-même ? La mort doit s’immiscer dans toutes les mémoires, longer les couloirs de souvenirs, les arracher un à un, polir les coeurs jusqu’à réduire l’amour en poussières, paralyser les corps au fidèle désir, laver toute trace du passage. Mais finalement, elle est là. La mort entière au bout des doigts, devant tes yeux, à deux pas de toi à peine. La mort entière, vaporeuse, glissant sur les toits, dévalant la rue principale. Vingt-cinq ans plus tard, tu comprends enfin pourquoi tu n’avais pas pleuré à la veillée funèbre, ni devant le cercueil, ni sur le banc d’église. Tu te rappelles avoir trouvé les larmes des autres, toutes les larmes, les hoquets, les soupirs, d’une indécence particulièrement dérangeante. Tu n’avais d’yeux que pour la beauté des fleurs, le lustre du bois, les icônes de verre coloré. L’enfant de dix-neuf ans était entouré de lumière. De miettes de coeur brisé. De souvenirs violents et répétitifs. Mais il n’avait jamais été aussi vivant qu’en ce moment même où on pleurait sa mort.
Tu ne peux que t’incliner devant une telle victoire. Devant cette pierre tombale que plus personne ne vient caresser, devant ces maigres lettres, ce nom chétif qui ne connaît plus de résonance dans ce village. La mort est patiente, sournoise et infaillible. Elle prend tout, petit à petit. Elle gruge ici, lèche là, savoure longuement son repas. Mais cet enfant de dix-neuf ans que tu as tant aimé dans les replis lumineux de ton enfance, il était encore si vivant lorsque tu as quitté ce bout de campagne, oui, si vivant qu’on sentait encore la chaleur de ses bras autour des épaules et des tailles, on entendait encore son rire claquer entre les murs, et ses paroles flottaient toujours, précises, vers l’embrasure des âmes.
Il faut donc à la mort un mariage certain avec le temps. Arracher un être à la vie, à toute vie, lui demande plus que l’instant d’avaler le dernier souffle, le dernier battement de coeur. Tu regardes, aussi froide que la pierre elle-même, l’épitaphe devant toi. Légèrement affolée, tu cherches au fond de toi, refais le chemin de tes os et de tes veines, plusieurs fois, dans tous les sens. Rien. Pas une seule trace d’amour ni de chagrin. Tout a disparu. C’est comme si cet enfant de dix-neuf ans n’avait jamais existé. Tout de lui a été balayé, retiré du monde. Un nettoyage méticuleux et parfait. Il n’y a, entre la mort et l’oubli, aucune différence, parce que « le sang qui ne coule plus dans les veines des morts, ce sont les vivants alentour qui le perdent[1]».
Appendices
Note biographique
Isabelle Forest
Isabelle Forest est romancière, poète et animatrice d’ateliers d’écriture. Elle a publié un roman, La crevasse (Outremont, Lanctôt Éditeur, 2004) et de la poésie, dont Les chambres orphelines (Trois-Rivières, Les Écrits des Forges, 2003). Ses textes ont aussi été édités dans de nombreux collectifs au Québec, en France et en Belgique, ainsi que dans deux anthologies. Son travail en poésie a été récompensé par les Prix Alphonse-Piché (1998 et 2001), le Prix Félix-Leclerc (2003) et les Prix littéraires de Radio-Canada (2007). Au printemps 2006, elle était l’invitée de la Ville de Paris dans le cadre de la résidence d’écriture Québec-Paris. Elle est également directrice littéraire et administrative d’EXMURO arts publics, un organisme culturel voué à la diffusion et à la promotion des arts et de la littérature dans l’espace public urbain.
Note
-
[1]
Christian Bobin, La plus que vive, Paris, Gallimard, 1996.