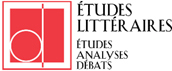Article body
La question de la « communauté » est au travail en philosophie depuis le début des années 1980 — ouverte alors par la « fin du communisme ». Posant cette question dans un article intitulé « La communauté désoeuvrée », en 1983[1], Jean-Luc Nancy lançait en quelque sorte une bouteille à la mer, et il n’est pas indifférent d’observer qu’elle n’a cessé depuis lors d’atteindre et de toucher divers destinataires, comme en témoigne le nombre croissant de réponses que son appel a reçues : de Maurice Blanchot à Roberto Esposito en passant par Giorgio Agamben et d’autres — et en repassant par Jean-Luc Nancy[2] —, c’est un dialogue à plusieurs voix qui se nourrit et se relance constamment, dans le souci de penser ce qui reste de l’idée de « communauté », dans un temps où « l’histoire, les mécomptes grandioses de l’histoire nous […] font connaître [les mots de “communauté” et de “communisme”] sur un fond de désastre qui va bien au-delà de la ruine[3] ».
Cette question de la « communauté » est également au travail en littérature, cependant, et si les auteurs que nous venons de citer y sont spécialement sensibles, c’est qu’elle est même au travail là d’abord et qu’ils sont bien les derniers à l’ignorer : que, depuis le premier romantisme, la littérature s’est déterminée comme le lieu — ou le non-lieu — de cette question, et que donc, elle a de facto toujours un temps d’avance. Or, c’est sur cette détermination de la littérature — et sur son temps d’avance — que nous voudrions nous interroger dans ce dossier.
Le problème qui nous apparaît est le suivant : si la littérature est par définition le lieu qui met en jeu l’idée de « communauté », qu’advient-il de la littérature quand l’histoire nous fait connaître ce mot de « communauté » sur un fond de désastre ?
On peut estimer à cet égard qu’historiquement, le verdict d’Adorno suivant lequel,
[a]près que la philosophie eut manqué à la promesse de ne faire qu’un avec la réalité ou de se trouver sur le point de la produire, elle est contrainte de se critiquer elle-même sans ménagement […][4],
— ce verdict a valu spécialement pour la littérature. Car, suivant la détermination de la littérature par le romantisme d’Iéna, être le lieu où se trouve mise en jeu l’idée de « communauté », c’est précisément être le lieu où doit se réaliser la communauté. Il faut se rappeler ce qu’indiquait Walter Benjamin quand il parlait du « messianisme » comme du « coeur du romantisme » et même comme son « essence historique[5] » ; la littérature s’invente dans une visée de l’âge d’or, c’est-à-dire que, contre les divisions et autres scissions du monde moderne, elle doit faire advenir une nouvelle époque ontologique, comprise comme un âge de l’unité et de l’harmonie universelle, un règne de la belle totalité. Tel est le mode de réalisation de la communauté, et c’est dans ce sens que Friedrich Schlegel en appelle à une « nouvelle mythologie » : l’exemple de l’Antiquité montrant que « mythologie et poésie, toutes deux, ne sont qu’un et sont inséparables », seule une nouvelle mythologie en littérature peut faire que, comme chez les Anciens, « [t]out se tien[ne] étroitement et [que] partout règne un seul et même esprit, dont seule diffère l’expression[6] » ; ainsi, précise-t-il, « tous les livres de la littérature accomplie doivent n’être qu’un seul livre, et c’est dans un tel livre, éternellement en devenir, que se révélera l’évangile de l’humanité et de la culture[7] » — la littérature doit être l’oeuvre de la communauté pour la communauté. Or, au XXe siècle, il est apparu que le projet, inédit en politique, de faire advenir une nouvelle époque ontologique — par et pour une entité mythique (le peuple, le prolétariat) — a produit des régimes totalitaires : « Nazisme et communisme annoncent la résolution des conflits qui déchirent le monde moderne et ont toujours déchiré, sous une autre forme, l’humanité[8] ».
Loin de nous l’idée de suggérer qu’il y aurait une relation causale entre la théorie littéraire du romantisme et les pratiques totalitaires ; traiter l’histoire en termes de nécessité procède d’ailleurs d’un mode de légitimation lui-même totalitaire. Au demeurant, il n’y a jamais dans le premier romantisme de réification de la communauté dans une entité mythique, de sorte que la communauté ne prend jamais la forme d’un grand corps collectif homogène, contrairement à ce que vise la domination totalitaire. Reste que, étant donné sa récupération totalitaire, le fantasme romantique d’une fin de l’histoire dans la paix perpétuelle devient problématique : c’est ce qui apparaît symptomatiquement dans le roman anti-utopique Nous autres de Evgueni Zamiatine, au début des années 1920, où, contre l’idéal d’un monde où « rien n’arrivera plus[9] », d’un nous communautaire qui serait « le dernier chiffre[10] », un argument antitotalitaire consiste à dire que, de même qu’il n’y a pas de dernier chiffre, « [i]l n’y a pas de dernière révolution, [que] le nombre des révolutions est infini », que « [l]a dernière, c’est pour les enfants [que l’infini effraie][11] ».
Quand la littérature en vient à se critiquer elle-même au XXe siècle, c’est alors essentiellement son pouvoir poïétique qui est mis en cause — cette idée que « l’art doit pouvoir » inscrite suivant Wagner dans l’allemand — « car, très justement, l’Art [die Kunst], dans [cette] langue, tire son nom de pouvoir [können][12] » — et que ce pouvoir est celui de poiein, c’est-à-dire de « produire », au sens de « porter à l’être ». Comme le souligne Hannah Arendt, « [i]l a fallu l’âge moderne, convaincu que l’homme ne peut connaître que ce qu’il fait, […] pour mettre en évidence la violence inhérente depuis très longtemps à toutes les interprétations du domaine des affaires humaines comme sphère de fabrication[13] », et c’est pourquoi, au regard du volontarisme et du constructivisme totalitaires — puisque l’interprétation de l’action en termes de fabrication a engendré des régimes de terreur —, l’idée de Novalis « selon laquelle nous ne connaissons une chose que dans la mesure où nous la faisons[14] » se trouve contestée : pour les écrivains qui produisent une oeuvre en fonction de la domination totalitaire, il n’est plus question d’une ontologie esthétique telle que, par la magie du langage poétique, la communauté se forme dans l’oeuvre, et, se formant, se fasse.
Cela ne signifie pas une fin de la littérature comme lieu de la question de la « communauté », cependant — d’une part, parce que la littérature ne s’affronte pas forcément au verdict suivant lequel, après la domination totalitaire, il est impossible de mettre en pratique strictement la théorie romantique ; d’autre part, parce que s’affronter à ce verdict est une opération dialectique. C’est ici que la lecture littéraire entre en jeu, dans notre analyse : parce qu’il s’agit encore par-delà le romantisme de réaliser une communauté, non plus par sa formation dans l’oeuvre comme fragment d’un dire poétique infini, mais par une transmission grâce à l’oeuvre entre l’auteur et le lecteur. La théorie romantique se fondait sur une conception de l’écrivain comme médiateur (ce qu’on oublie souvent, par une méprise courante sur le concept de génie) ; ainsi la capacité de celui-ci à former la communauté vient-elle de ce qu’il romantise en s’identifiant à un moi supérieur qui embrasse la totalité et dont il se fait le porte-parole. Or, on peut parler d’une théorie postromantique suivant laquelle ce n’est plus selon un axe paradigmatique l’écrivain qui est médiateur, mais selon un axe syntagmatique l’oeuvre qui est médiatrice : c’est toute la force selon nous de l’image de l’oeuvre comme « bouteille à la mer », dans l’essai d’Ossip Mandelstam sur « l’interlocuteur » en 1913[15], car, mettant l’accent sur la destination de l’oeuvre — sur son cap « vers une terre, Terre-Coeur peut-être[16] », comme l’écrit Paul Celan —, cette image permet de concevoir que la possibilité de la communauté dépend désormais de la rencontre (espérée mais inattendue) d’un auteur et d’un lecteur[17].
Voilà précisément le parti pris de notre dossier : à la question de savoir ce qu’il advient de la littérature quand l’histoire nous fait connaître le mot de « communauté » sur un fond de désastre, nous proposons de répondre que la littérature concernée par l’histoire devient une bouteille à la mer — et ce, dès la première moitié du XXe siècle. À cet égard, le changement d’approche de la littérature qui s’opère chez Walter Benjamin des années 1920 aux années 1930 nous apparaît exemplaire : après sa thèse consacrée au « concept de critique dans le romantisme allemand », il écrivait en 1923 qu’« [e]n aucun cas, devant une oeuvre d’art ou une forme d’art, la référence au récepteur ne se révèle fructueuse pour la connaissance de cette oeuvre ou de cette forme[18] » ; or, rattrapé par l’histoire, exilé, il lance vers 1936 un appel à renouer avec l’art de conter, c’est-à-dire que la valeur du récit devient alors pour lui fonction de sa capacité à transmettre l’expérience « de bouche en bouche[19] ». C’est dans la lignée de ce changement de perspective que l’on peut inscrire les oeuvres des philosophes que nous avons mentionnées au début de cette introduction, car, que la communauté soit dite « désoeuvrée » (Nancy), « inavouable » (Blanchot) ou « à venir » (Agamben), par exemple, elle apparaît singulièrement et toujours problématisée à partir de la question de la lecture : c’est à travers le lecteur présent, futur, incertain, que ces philosophes questionnent la communauté, et notamment parce que, lisant les textes d’autres philosophes, chacun s’interroge sur le fait de pouvoir leur donner un sens et que ces textes lui fussent, en définitive, destinés[20]. Et c’est dans la lignée de ce changement de perspective que nous entendons pour notre part inscrire notre dossier, en tâchant de reconnaître, dans la façon dont des oeuvres littéraires des XXe et XXIe siècles sont écrites vers les lecteurs, la recherche d’un sens commun, d’une expérience commune, d’une communauté — la communauté dût-elle être celle de « ceux qui n’ont pas de communauté ».
Sur le plan de la démarche, les travaux sur la lecture littéraire, en particulier les théories de l’effet esthétique de l’école de Constance[21], constituent un présupposé épistémologique partagé par les auteurs de notre dossier. Ainsi, la question de départ étant toujours celle de savoir à qui une oeuvre est adressée, on opère un déplacement de la lecture vers la scène d’écriture : on ne s’intéresse pas au lecteur empirique, au public, mais à la figure du lecteur produite implicitement dans les oeuvres ; on se demande ce qui distingue ce lecteur « ami » ; on interroge cette adresse, ce lien imaginaire à l’autre qui, en un paradoxe apparent, en vient d’une manière ou d’une autre à dicter le texte, à infléchir sa forme, à conditionner aussi sa représentation de l’auteur-destinateur. Mais c’est sans perdre de vue que le lecteur est convoqué sur la scène intime de l’écriture en vue d’une communauté de partage, et que c’est donc cette question de la « communauté » — cette utopie d’une communauté — qui est le véritable enjeu.
On comprend que la possibilité de la communauté est conditionnée par une transmission, mais elle ne peut, pour les raisons invoquées plus haut, procéder d’un partage du sens relevant de la norme ou du consensus[22]. Que l’oeuvre soit le théâtre d’une communication anticipée entre auteur et lecteur et qu’il s’agisse alors pour ces deux-là de trouver un accord, c’est une chose, mais cet accord se fonde dans le dissensus : en aucun cas il n’est fonction d’un savoir ou d’une vérité absolus et contraignants. C’est pourquoi, dans les oeuvres étudiées ci-après, il apparaîtra que la transmission passe par une expérience de lecture singulière, parce que ce n’est pas le savoir ou la vérité qui est en jeu, mais plutôt le jugement et la décision, et que ce jugement et cette décision consistent d’abord à choisir avec qui on désire partager quelque chose[23]. Ainsi peut advenir ce que Jean-Luc Nancy appelle « partage du sens », d’un sens dont personne, ni l’auteur ni le lecteur, ne dispose, mais qui les fait naître ensemble comme sujets dans la mesure où il les partage et les dispose l’un par rapport à l’autre : on ne peut s’approprier ce sens, il ne préexiste pas à l’hermeneia, pas plus qu’il n’y advient à la fin, car « nous sommes le sens, dans le partage de nos voix[24] ».
Comme le montre Annie Epelboin, c’est la leçon de Mandelstam sur l’interlocution en poésie. Si, suivant l’image du poème comme bouteille à la mer, c’est le lien du poète au lecteur qui fonde l’acte de poésie lui-même, encore importe-t-il d’observer que le lecteur interpellé est, dans la distance, un inconnu : pour Mandelstam, en effet, c’est la condition pour exprimer autre chose que du connu, grâce à la « reconnaissance » de celui qui se sent visé par le texte, puis à son « interprétation » qui donne son « envol » au texte. Quant aux mécomptes de l’histoire qui nous font connaître le mot de « communauté » sur un fond de désastre, Mandelstam, victime du stalinisme, sait ce qu’il en est, mais, comme Benjamin le fait à propos du récit, il puise dans l’exil la conception d’une chaîne de parole poétique par-delà les frontières spatiales et temporelles : le poète lui-même est un lecteur qui accueille les poèmes du passé, et qui reçoit donc autant qu’il émet les poèmes qu’il transmet au lecteur à venir — et ainsi de suite : la réception de l’oeuvre de Mandelstam par Celan donne tout son sens à cette utopie de communauté poétique.
Chez Mandelstam, la communauté est rendue possible moyennant un rapport de réciprocité amicale, les positions du poète et du lecteur étant interchangeables (bien que non identiques) ; or, cette thématique du double, qui est selon Christine Servais « l’un des paradigmes de la communication littéraire », est l’un des fils conducteurs de notre dossier. L’étude que propose celle-ci de L’abbé C. de Georges Bataille est exemplaire à cet égard. Car c’est à la lumière de cette thématique du double inscrite au coeur du roman que l’on peut analyser le rapport qu’entretient le « scripteur » Bataille à cet « autre de lui » qu’est le lecteur — tous les rapports dans et hors de la fiction étant comme contaminés par la relation des deux protagonistes du roman, Robert et Charles, frères jumeaux. Qu’un rapport d’identité et de différence impossible à relever par une résolution dialectique induise de la fausseté est une nécessité, mais c’est qu’il y a encore de la vérité dans cette fausseté, paradoxalement — et qu’en somme, la vérité dernière n’existant pas plus que le dernier chiffre, l’essentiel est de s’y exposer sans limites (dans la feinte de la fiction, spécialement), persuadé qu’il n’y a pas d’autre « expérience » à même de transmettre ce qui se dérobe. Telle est l’expérience, dans l’urgence, à laquelle se et nous livre Bataille, qui suppose de reconnaître en soi le plus étranger et de se reconnaître, soi, dans le plus étranger, à la fois de répéter et de trahir l’autre ; seule la présence de l’autre permet à l’expérience d’être, et c’est pourquoi, bien qu’intérieure et « à hauteur de mort », l’expérience est toujours offerte en partage, « chance » d’une communauté pour les ébranlés.
Le roman de Bataille est publié en 1950, et il n’est pas indifférent que la question de la « communauté » s’y pose à partir de la mort de Robert, résistant victime du nazisme, et de la survie — quelque temps après-guerre — de son frère Charles. Que cette question soit dans ce moment d’une brûlante actualité, c’est ce dont témoignent également les études respectives de Céline Pardo et Frédérik Detue. Céline Pardo s’intéresse au moment, en 1949, où Paul Éluard prend conscience du « pouvoir énorme de communication » de la radio — moment qui coïncide, sur le plan poétique, avec le désir du poète communiste de « fonder un nouveau rapport entre l’écrivain et la société » et, sur le plan politique, avec son engagement pour la paix (il est alors délégué du Conseil mondial de la paix). Se trouve ici remis en jeu l’idéal romantique d’une littérature par tous (par le fait de livrer une anthologie poétique de la façon la plus impersonnelle) et pour tous (par le fait de vouloir toucher le plus grand nombre), suivant un projet démocratique d’unité poétique dans la diversité infinie et d’égalité de l’auditoire devant l’art du langage. Cependant, s’il s’agit bien de produire une oeuvre collective (par la multiplicité des auteurs convoqués puis par celle des voix durant les émissions) et si cette oeuvre doit apparaître dans l’ensemble populaire, la question qui préoccupe Éluard après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale est avant tout humaniste : elle est celle du legs d’une culture qui puisse être le gage d’une paix durable ; aussi les auditeurs doivent-ils se reconnaître dans la communauté créatrice de l’oeuvre de façon à se saisir à leur tour, chacun à sa manière, de ce « bien commun » (de l’oeuvre ici comme res publica), et à refonder ce faisant un vivre-ensemble pour l’avenir.
Les témoignages des camps de concentration dont traite Frédérik Detue offrent un grand contraste avec l’exercice d’enthousiasme d’Éluard. Le « nous » que vise celui-ci doit pour une part à l’expérience de la Résistance et à sa glorification rétrospective ; or, l’aspiration à l’unité nationale et à la paix dans la France d’après-guerre dont participe la mythification de la Résistance a pour revers un oubli massif de l’expérience des camps. Ce n’est pas une seule problématique française, du reste, car au fond, face à une telle expérience « intégralement négative », les mécanismes de défense sont presque systématiques : on ne veut pas être affecté par ça. Pour des témoins comme Robert Antelme, Jean Améry ou encore Varlam Chalamov, un sauvetage de la culture à la façon d’Éluard est ainsi problématique, parce que, de leur point de vue de rescapés, c’est précisément l’humanisme de la culture héritée que met en cause la négation de l’homme dans les camps. Ils oeuvrent bien de façon à « rendre possible une transmission humaine, et par là, […] une communauté viable », mais le parti de ne pas mettre entre parenthèses leur expérience implique donc néanmoins de heurter les lecteurs, en décevant toute attente de réconciliation : l’utopie de ces témoins, en effet, c’est que, dans le sens inverse, en s’affrontant à l’inhumain, en considérant si c’est un homme, celui qui a vécu ça et qui en témoigne, ce soient les lecteurs qui se destinent à « être le prochain de leur semblable ».
Ce qui fait notamment la difficulté du témoignage, c’est le sentiment d’une césure anthropologique : il peut sembler vain de vouloir transmettre l’expérience concentrationnaire à celui qui ne l’a pas vécue dans son corps, dont la peau est comme « d’un homme vierge » — et il peut par conséquent sembler nécessaire, pour assurer malgré tout cette transmission, de blesser le lecteur physiquement. C’est important de le noter, tandis que, selon Élise Vandeninden, « [l]e corps est la plupart du temps absent des théories de la réception ». Prenant le contre-pied de cette tendance, celle-ci s’intéresse aux réflexions théoriques de Roland Barthes et de Jean-Luc Nancy ; or, au demeurant, ces réflexions entrent en résonance avec la problématique du témoignage : tout en étant un « espace de séduction » où le désir du corps de l’autre s’échange entre l’auteur et le lecteur, le « texte de jouissance » barthésien « ne ressemble en rien au lecteur », en effet, ne le conforte pas dans sa culture et ses valeurs et, de ce fait, ne le laisse pas intact, le rend étranger à lui-même. Suivant Frédérik Detue, « l’hétéro-affection » par le témoignage fait expérimenter que « l’homme a lieu dans le non-lieu de l’homme » ; celle que produit le « texte de jouissance » mène à une autre expérience, dans le propos d’Élise Vandeninden : la perte et la dissémination de soi en lisant et en écrivant font éprouver que l’homme est phénoménologiquement un « être en commun », ou « être-avec », qu’il n’a pas de « corps propre » et que ni le soi ni l’autre ne peuvent faire l’objet d’une saisie. La proposition est donc ici de concevoir, avec Nancy, une communauté « constitutiv[e] de l’individualité plutôt que le contraire », dont la littérature serait un lieu d’apparition exemplaire.
Élise Vandeninden reconnaît dans l’oeuvre de Nancy la pensée d’une « communauté sans communion », et c’est une vision de la communauté qui ressort de toutes les oeuvres présentées jusqu’ici, celle d’Éluard y comprise — comme si la passion totalitaire de l’homogénéité servait de même repoussoir aux auteurs concernés. Chez Gérard Macé comme chez Bataille, dans le même sens, la thématique du double dans le lien entre auteur et lecteur s’inscrit dans l’ouverture de l’identité à l’altérité, dans la différence plutôt que la répétition. Comme le montre Adeline Liébert, le corps de nouveau participe de ce lien, spécialement les mains, mais — pas plus que chez Nancy — il n’est question d’« intercorporéité » au sens de Merleau-Ponty[25] ; le lecteur est pour Macé un « frère de lait » qui partage avec lui le sein de la langue-mère, qui se nourrit à « la mamelle de la littérature » ; or, cette fraternité prend la forme d’un compagnonnage qui n’entraîne pas de confusion : le lecteur peut rejoindre l’auteur sur le terrain de l’imagination, de l’onirisme et de la mémoire parce que cet espace littéraire se situe « entre les deux mains de celui qui écrit », et qu’il peut donc glisser ses mains à lui dans cet interstice comme dans une « ouverture de l’un à l’autre », mais cette hospitalité de l’auteur est comme une invitation, « d’Ulysse qu’on était [écoutant le chant des sirènes], [à] devenir Homère » ; Macé propose de transmettre l’expérience non plus « de bouche en bouche » (comme Benjamin), mais de mains en mains.
Jorge Luis Borges insistait sur le fait que la Bibliothèque de Babel issue de son imagination était une vision de cauchemar, et en faisant de la bibliothèque un « royaume des morts, où des âmes errantes continuent de nous hanter », Macé l’a bien entendu ; si le compagnonnage de l’auteur et du lecteur forme une chaîne solidaire qui construit une bibliothèque en expansion infinie, loin s’en faut que ce soit sur le mode d’un jeu postmoderne. Sylvie Ducas s’intéresse cependant à « la littérature dite “postmoderne” » au travers de l’oeuvre de Jean Rouaud ; or, si l’on voit bien ce que la répartition des rôles incertaine entre l’auteur et le lecteur produit de sens indécidable, on observe dans le même temps que cet échange fonctionne comme un dispositif d’exclusion : l’adresse au lecteur prend ici la forme d’un jeu d’adresse où le lecteur et l’auteur doivent être « suffisamment bons » l’un pour l’autre, de sorte que, contre « le lecteur devenu foule » et méprisé, la « communauté élective » s’instaure grâce à des signes d’appartenance et de reconnaissance culturelles. Cela permet pour conclure de mettre en garde contre la fausseté de la vulgate postmoderne sur la fin de l’articulation entre l’art et le politique ; car la thématique du double marquée par le même (ce que Sylvie Ducas appelle « identification spéculaire ») plutôt que par l’autre apparaît à contre-courant de la tradition antitotalitaire que nous tâchons de faire apparaître.
Appendices
Notes
-
[1]
Voir la « Note » de Jean-Luc Nancy dans son livre La communauté désoeuvrée : « “La communauté désoeuvrée”, dans sa première version, avait été publiée au printemps de 1983 dans le numéro 4 de Aléa, que Jean-Christophe Bailly avait consacré au thème de la communauté » (1986, p. 103).
-
[2]
Nous n’entendons pas ici établir une bibliographie exhaustive sur la question, mais voici quelques jalons de ce dialogue : Maurice Blanchot, La communauté inavouable, 1983 ; Giorgio Agamben, La communauté qui vient.Théorie de la singularité quelconque, Paris, Éditions du Seuil (Librairie du XXe siècle), 1990 (trad. de l’italien par Marilène Raiola) ; Roberto Esposito, Communitas. Origine et destin de la communauté, précédé de Conloquium de Jean-Luc Nancy, Paris, Presses universitaires de France (Les essais du Collège international de philosophie), 2000 (trad. de l’italien par Nadine Le Lirzin) ; Jean-Luc Nancy, La communauté affrontée, Paris, Galilée (La philosophie en effet), 2001. Mentionnons également Jacques Derrida, qui à plusieurs reprises (notamment dans Politiques de l’amitié, 1994) aura fait écho à ce dialogue autour d’un mot, « communauté », qu’il disait lui-même ne saisir qu’avec défiance.
-
[3]
Maurice Blanchot, « La communauté négative », La communauté inavouable,op. cit., p. 10.
-
[4]
Theodor W. Adorno, Dialectique négative, 2003, p. 11-12.
-
[5]
Correspondance de Walter Benjamin citée par Philippe Lacoue-Labarthe dans son « Avant-propos » à Walter Benjamin, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, 2002, p. 14-15.
-
[6]
Friedrich Schlegel, « Entretien sur la poésie » [1800], dans Philippe Lacoue-Labarthe et al., L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, 1978, p. 312.
-
[7]
Friedrich Schlegel, « Idées » [1800], dans ibid., p. 216.
-
[8]
Claude Lefort, La complication. Retour sur le communisme, 1999, p. 199-200.
-
[9]
Evgueni Zamiatine, Nous autres [My], 2002, p. 36. Voir Claude Lefort, La complication : Lefort reconnaît précisément « l’essence du totalitarisme » dans sa « négation de l’imprévisible et de l’inconnaissable » ; selon lui, le régime totalitaire se définit fondamentalement par sa façon de « s’agenc[er] sous le signe du refus de l’histoire » (op. cit., p. 203-204).
-
[10]
Evgueni Zamiatine, Nous autres,op. cit., p. 178.
-
[11]
Ibid., p. 177.
-
[12]
Richard Wagner, L’oeuvre d’art de l’avenir. Oeuvres en prose, 1976, t. 3, p. 105.
-
[13]
Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, 1993, p. 256.
-
[14]
Cité par Olivier Schefer dans sa « Préface » à Novalis, Art et utopie.Les derniers fragments (1799-1800), 2005, p. 11.
-
[15]
Ossip Mandelstam, « De l’interlocuteur », De la poésie, 1990, p. 58-68.
-
[16]
Paul Celan, « Allocution de Brême », Le méridien & autres proses, 2002, p. 57.
-
[17]
Le projet de penser la portée de l’image de la bouteille à la mer, que Celan emprunte à Mandelstam, a formé l’argument du colloque « Mettre le cap vers un lecteur : l’utopie d’une “Terre-Coeur” en littérature », à l’Université de Nantes en avril 2007. Le dossier présenté ici recueille quelques-unes des réflexions qui ont animé ce colloque organisé en partenariat par les universités de Nantes et de Paris 8 — Saint-Denis, sous la direction de Frédérik Detue et Maëlle Levacher. Nous voudrions remercier tout spécialement Maëlle Levacher pour sa générosité et son soutien.
-
[18]
Walter Benjamin, « La tâche du traducteur », Oeuvres, 2000, t. 1, p. 245.
-
[19]
Walter Benjamin, « Le conteur : réflexions sur l’oeuvre de Nicolas Leskov », dans ibid., t. 3, p. 116.
-
[20]
Si l’on devait d’un trait résumer le travail de Derrida et de Nancy sur cette question, on pourrait ainsi avancer cette formule : le sens, c’est l’adresse. Suivant Derrida, c’est déjà chez Nietzsche que la question de la « communauté » se pose à partir de celle de la lecture : voir les chapitres deux et trois de Politiques de l’amitié, op. cit., p. 43-92. On pourrait alors déterminer que Bataille, lui-même destinataire posthume de Blanchot, adresse à Nietzsche son oeuvre « à rebours », selon le renversement que Derrida nomme téléiopoétique. Pour qui parle et écrit, la responsabilité est toujours double, en effet : « Je dois répondre de moi ou devant moi en répondant de nous et devant nous, du nous présent pour et devant le nous de l’avenir ; cela même en m’adressant présentement à vous, et en vous invitant à vous joindre à ce “nous” dont vous faites déjà mais ne faites pas encore partie, bien que, au bout de la phrase téléiopoétique, vous soyez peut-être, lecteurs, devenus les cosignataires de l’adresse qui vous est adressée » ; « Car le “je” […] se trouve d’avance compris et déterminé par son appartenance au nous le plus suspendu de cette contemporanéité supposée » (ibid., p. 57 et 95).
-
[21]
Voir en particulier Wolfgang Iser, L’acte de lecture, Liège, Mardaga (Philosophie et langage), 1997 (trad. de l’allemand par Évelyne Sznycer).
-
[22]
Auquel cas la perspective la plus pertinente serait soit celle de la sémiologie alliée à une encyclopédie — voir Umberto Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset (Figures), 1985 (trad. de l’italien par Myriem Bouzaher), ou Interprétation et surinterprétation, Paris, Presses universitaires de France (Formes sémiotiques), 1996 (trad. de l’anglais par Jean-Pierre Cometti — , soit celle de la psychosociologie. Dans notre perspective, il s’agit plutôt de penser, avec Derrida par exemple, que, « [s]’il y avait une communauté, voire un communisme de l’écriture, ce serait d’abord à la condition de faire la guerre à ceux qui, le plus grand nombre, les plus forts et les plus faibles à la fois, forgent et s’approprient les usages dominants de la langue » (Politiques de l’amitié,op. cit., p. 90). Ces questions sont également discutées dans Herman Parret (dir.), La communauté en paroles : communication, consensus, ruptures, Liège, Mardaga (Philosophie et langage), 1991.
-
[23]
Sur ce point, voir Hannah Arendt, « La crise de la culture : sa portée sociale et politique », dans La crise de la culture.Huit exercices de pensée politique, Paris, Gallimard (Folio / Essais), 1997 (trad. de l’anglais sous la direction de Patrick Lévy), notamment p. 280-288.
-
[24]
Jean-Luc Nancy, Le partage des voix, 1982, p. 83. C’est dans ce sens que nous pouvons entendre la proposition de Valère Novarina de voir dans le lecteur et l’écrivain « deux voyageurs arrachés à un monde, départis, l’un et l’autre vêtus de langues, toute leur chair n’étant que de mots. Entre les deux [précise-t-il], en lisant, en écrivant, il [le sens] se produit de l’homme, il naît de l’homme en parlant » (V. Novarina, « Chaos », Le théâtre des paroles, 1989, p. 154).
-
[25]
Voir l’analyse par Élise Vandeninden de la célèbre expérience du touchant-touché menée philosophiquement par Merleau-Ponty et de sa réception critique dans les oeuvres de Derrida et de Nancy.
Références
- Adorno, Theodor W., Dialectique négative, Paris, Éditions Payot & Rivages (Petite bibliothèque Payot), 2003 (trad. de l’allemand par G. Coffin et al.).
- Arendt, Hannah, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy (Liberté de l’esprit), 1993 (trad. de l’anglais par Georges Fradier).
- Benjamin, Walter, Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand, Paris, Flammarion (Champs), 2002 (trad. de l’allemand par Philippe Lacoue-Labarthe et Anne-Marie Lang).
- Benjamin, Walter, Oeuvres, Paris, Gallimard (Folio / Essais), 3 vol., 2000 (trad. de l’allemand par M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch).
- Blanchot, Maurice, La communauté inavouable, Paris, Éditions de Minuit, 1983.
- Celan, Paul, Le méridien & autres proses, Paris, Éditions du Seuil (Librairie du XXIe siècle), 2002 (trad. de l’allemand par J. Launay).
- Derrida, Jacques, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée (La philosophie en effet), 1994.
- Lacoue-Labarthe, Philippe et Jean-Luc Nancy (dir.), avec la collaboration d’Anne-Marie Lang, L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Éditions du Seuil (Poétique), 1978.
- Lefort, Claude, La complication. Retour sur le communisme, Paris, Fayard, 1999.
- Mandelstam, Ossip « De l’interlocuteur », De la poésie, Paris, Gallimard, 1990 (trad., présenté et annoté par Mayelasveta), p. 58-68.
- Nancy, Jean-Luc, La communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois Éditeur (Détroits), 1986.
- Nancy, Jean-Luc, Le partage des voix, Paris, Galilée, 1982.
- Novarina, Valère, Le théâtre des paroles, Paris, P.O.L., 1989.
- Schefer, Olivier, « Préface », dans Novalis, Art et utopie. Les derniers fragments (1799-1800), Paris, Éditions Rue d’Ulm / Presses de l’École normale supérieure (Aesthetica), 2005, p. 5-38.
- Wagner, Richard, L’oeuvre d’art de l’avenir. Oeuvres en prose, Plan de la Tour, Éditions d’Aujourd’hui (Les introuvables), 1976 (trad. de l’allemand par J.-G. Prod’homme et F. Holl), t. 3, p. 59-254.
- Zamiatine, Evgueni, Nous autres [My], Paris, Gallimard (L’imaginaire), 2002 (trad. du russe par B. Cauvet-Duhamel).