Corps de l’article
Le pôle de l’Université du Québec en Outaouais du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA-UQO) organisait, en collaboration avec l’Amicale Autochtone de l’UQO (AA-UQO)[1], les 29 et 30 avril 2020, un colloque d’échanges et de réflexion intitulé La pertinence des épistémologies autochtones face à la crise climatique actuelle : enjeux de protection et de préservation du territoire. Eu égard de la pandémie de coronavirus (SARS-CoV-2) et afin de respecter les mesures sanitaires de distanciation sociale imposées par l’état d’urgence au Québec, ailleurs au Canada et à l’échelle mondiale, ce colloque, qui devait initialement se tenir en présentiel au campus principal de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), situé à Gatineau, fut transformé par le comité organisateur en un espace d’échanges et de communication sur Zoom. L’espace numérique du colloque a permis d’ouvrir la réflexion, d’une part sur les ontologies autochtones relatives à la nature ainsi que les solutions et les approches (alternatives) à la crise climatique actuelle qu’elles mettent en avant et, d’autre part, sur l’intégration de ces épistémologies autochtones dans les actions pour lutter contre les changements climatiques et pour la protection de la nature et, enfin, sur l’espace qui est laissé ou offert aux Autochtones dans le débat actuel. En décidant d’aborder ladite thématique et ses questions connexes dans le cadre de ce colloque, les organisateurs n’imaginaient pas que les changements climatiques et l’urgente nécessité de revisiter les rapports de l’humanité à son environnement naturel tout en interrogeant la pertinence des solutions adoptées serait, quelques mois après l’événement, au coeur des discussions engagées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour freiner la propagation rapide du SARS-CoV-2 à l’échelle mondiale (García-Vinuesa et al. 2022; OXFAM International 2020). À l’heure où l’approche des solutions climatiques basées sur la nature est présentée par plusieurs gouvernements et organisations environnementales comme la panacée pour résorber la double crise du climat et de la biodiversité, il est important qu’une réflexion plus large sur la pertinence des systèmes de savoir locaux et autochtones soutenant les rapports et les modèles d’action de l’humanité sur l’environnement soit menée en amont, comme le rappellent Graeme Reed et al. (2022). Il ne fait aucun doute que les contributions du présent numéro se nourrissent aussi cette ambition.
Si les changements climatiques sont considérés communément comme des modifications à long terme des conditions météorologiques et des variations persistantes du climat causées soit par sa variabilité naturelle, soit par l’effet de serre anthropique découlant des émissions de gaz à effet de serre (GES)[2] (GIEC 2007), ils sont aussi, comme le souligne Steve Yearly (2016), une construction sociale. Partant de cette approche constructiviste, les changements climatiques reposent non seulement sur les projections climatiques produites par la technoscience, mais également sur les projections fondées sur les connaissances et les solutions pratiques en matière d’action climatique, lesquelles sont alimentées par un ensemble d’institutions sociales et politiques. Ce positionnement a le mérite de mettre en avant un aspect fondamental des changements climatiques qui a longtemps été un argument écarté des actions pour y répondre, c’est-à-dire le rôle et l’importance cruciale que jouent les systèmes de savoirs et connaissances autochtones en tant que corpus dynamique contribuant à l’atteinte des objectifs climatiques mondiaux[3]. Depuis son émergence en 1980, la rhétorique sur les changements climatiques et les solutions qui lui sont proposées se sont forgées sur une perspective portée par des leadeurs occidentaux qui reposait quasi exclusivement sur une représentation occidentalocentriste de la nature et de l’environnement. Pour plusieurs auteurs, cette représentation hégémonique de l’environnement s’est historiquement imposée, au gré de l’entreprise coloniale occidentale, à différents peuples à travers le monde, notamment autochtones (Farget 2016; Hitchcock 2019). C’est à partir de ce postulat que des modes de pensées qui appréhendent la nature et l’environnement sans le filtre de l’extractivisme et du capitalisme ont été discrédités. Les épistémologies autochtones sur la nature, quant à elles, se sont construites graduellement suite aux interactions que les groupes autochtones[4] avaient avec leur environnement. Dynamiques, ces épistémologies se sont également adaptées avec l’expérience que ces groupes ont tiré des différents changements dans l’environnement naturel qu’ils ont observés par le passé et qui se poursuivent encore. D’ailleurs, les épistémologies de différents groupes autochtones à travers le monde partagent des caractéristiques plus ou moins similaires telles qu’une connexion fondamentale à un territoire fluide et pluriel qui s’inscrit au-delà des canons matérialistes de la territorialité euclidienne (Abanda 2022). Cette territorialité duale transfigure leurs systèmes de savoirs et de connaissances, qui reposent généralement sur une ontologie holistique, relationnelle, écocentrique et spirituelle portée par une vision de l’espace et des êtres qui y vivent sous le prisme de l’interconnexion entre les êtres humains, les animaux, les végétaux et entre les mondes visibles et invisibles, souvent égaux et complémentaires (Ellington 2019). Ces systèmes de savoirs et connaissances sur l’environnement ont permis à des groupes autochtones à travers le monde de conserver l’intégrité de différents écosystèmes et de maintenir l’équilibre biologique.
La pensée occidentale, depuis le 18e siècle, quant à elle, est caractérisée par un raisonnement anthropocentrique reposant sur une ontologie naturaliste qui déploie l’idée que l’humain est la forme de vie la plus importante sur Terre. Comme l’explique Isabelle Côté :
[…] cette conception vient du siècle des Lumières où il y a eu une séparation entre les humains et les autres formes de vie, ce qui a abouti à une hiérarchisation du vivant dans laquelle les humains se trouvent maîtres des autres formes vivantes (animales et végétales) et doivent les dominer, une hiérarchisation qui n’existe pas du côté des perspectives autochtones.
Côté 2021 : 20
La réflexion sur les systèmes de savoirs et de connaissances traditionnels[5] autochtones est relativement récente, mais prend plus de place dans le contexte de la crise environnementale actuelle. La linguiste José Mailhot propose une définition du Savoir Écologique Traditionnel (son équivalent anglais étant Traditional Ecological Knowledge ou TEK) comme « l’ensemble des connaissances et idées que possède un groupe humain sur son environnement, lesquelles ont été acquises, construites et transmises par suite de l’utilisation et de l’occupation d’une région sur de très nombreuses générations » (Mailhot 1993 : 11). Pour sa part, l’anthropologue Mélanie Chaplier, à l’instar d’autres spécialistes, souligne l’exemple des Cris[6] au Québec pour illustrer le potentiel que peuvent comporter ces dits systèmes de savoirs et de connaissances, et ce, dans une perspective d’émergence tournée vers une « éthique environnementale nouvelle et plus appropriée » (Chaplier 2006 : 111), en tenant compte de la variabilité des systèmes de connaissance et de gestion de l’environnement. Le colonialisme et l’injustice sociale et climatique proviennent tous deux du discrédit historique de certaines visions du monde. Ils sont fondés sur l’imposition d’un récit du progrès et de la modernité qui a invalidé les modes de pensées qui s’en éloignaient. Les politiques d’exploitation des ressources naturelles s’y sont inspirées d’où leurs effets multiplicateurs des inégalités. De même, les politiques de régulations et de protection de l’environnement qui s’en inspirent prolongent parfois les effets du colonialisme et reproduisent, dans certains cas, les inégalités sociales (Farget 2016 : 99). C’est le cas, par exemple, du marché des crédits carbone, qui, bien qu’étant un outil important de l’action climatique internationale, peut également reproduire des stratégies extractivistes et d’accaparement qui renforcent la vulnérabilité des peuples autochtones (Heemeryck 2022).
Du fait de leur mode de vie et de leur relation à la terre et à l’environnement, ce sont les peuples autochtones à travers le globe qui subissent de façon disproportionnée les impacts des changements climatiques. Ce sont eux qui ont été les premiers à alerter le monde de la perte de diversité biologique et de l’extinction des espèces, incluant les impacts qui pourraient survenir au cours des prochaines années (Nakashima et al. 2012; Royer 2012). Malgré la vulnérabilité extrême des peuples autochtones face aux changements climatiques, ces derniers continuent d’être évincés ou déplacés de leurs territoires sous prétexte qu’ils mettent en péril l’équilibre faunique et écosystémique de certains milieux (Dowie 2009; Hitchcock 2019). De larges espaces de leurs territoires sont déclarés dangereux et, au motif d’agir pour le bien commun, des mesures sont mises en place pour exproprier les groupes autochtones de leurs territoires au profit des États ou d’autres organisations. En réponse, et dans une perspective d’autodétermination, certains groupes ou individus qui se portent à la défense de leur environnement ou de leurs terres en dénonçant des activités industrielles perturbatrices des écosystèmes polluantes et destructrices voient leurs actions criminalisées et leurs vies menacées du fait de cette contestation (Schmidt et Paterson 2009). Leur volonté de protéger leurs territoires est présentée comme allant à l’encontre du développement économique (États et/ou multinationales).
Pourtant, un consensus international reconnaît que les peuples autochtones, qui ont un lien privilégié avec le territoire, détiennent des systèmes de connaissances qui mettent en valeur protection de l’environnement[7]. Dans certains pays, dont le Canada, par exemple, les scientifiques et organisations publiques sont davantage interpellés pour collaborer avec les peuples autochtones, valoriser leurs savoirs et leurs connaissances dans la protection de l’environnement et pour lutter contre les changements climatiques du fait de processus nationaux de réconciliation et de décolonisation (Nakashima etal. 2012).
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est le traité qui institue un cadre global d’action intergouvernemental pour faire face aux défis posés par les changements climatiques. Adoptée en 1992 au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, elle est entrée en vigueur en 1994. Elle est désormais le cadre à partir duquel les gouvernements partagent et diffusent les informations sur les gaz à effet de serre et les solutions à apporter pour les réduire. Les avancées de la convention sont mesurées chaque année lors de la Conférence des Parties (COP) qui réunit les différentes parties prenantes qui proposent l’état de la situation et les moyens pour l’amenuiser.
Prenant acte du manque de considération accordée aux autochtones dans l’action climatique internationale, plusieurs leaders autochtones ont organisé, en 2000, 8 ans après la CCNUCC, une rencontre internationale qui visait à démontrer le rôle fondamental que pouvaient jouer les peuples autochtones dans la prévention des changements climatiques et la protection de l’environnement. La reconnaissance de l’importance des connaissances et des savoirs autochtones pour répondre aux défis que posaient les changements climatiques et la nécessité d’inclure dans les discussions et la gouvernance climatique mondiale figuraient parmi les recommandations issues de cette conférence. Plus de deux décennies plus tard, force est de constater qu’il reste encore beaucoup à faire. La place des Autochtones dans l’action climatique avance avec « un pas en avant, mais deux pas en arrière » pour emprunter les mots de l’Inuk Lisa Koperqualuk, Présidente du Conseil circumpolaire inuit (CCI) au sortir de sa participation à la Conférence des Parties sur les changements climatiques, la COP 27, tenue à Sharm El-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022.
Depuis la Conférence de Paris (COP 21, 2015), on observe qu’une place de plus en plus importante est accordée aux peuples autochtones lors des discussions et des évènements portant sur les changements climatiques. Si certains leaders qui y ont participé[8] soulignent avec enthousiasme une intégration plus manifeste des peuples autochtones dans les processus de négociations climatiques, ils évoquent toutefois l’attente d’une véritable décolonisation des référents sur les changements climatiques et une meilleure prise en compte des savoirs et perspectives autochtones dans les solutions pour faire face aux changements climatiques. Si plusieurs groupes et organisations autochtones orientent leurs actions en ce sens, d’autres revendiquent une rupture, ce qui amène plusieurs questions : qu’en est-il aussi des groupes autochtones qui ne revendiquent pas ces épistémologies et qui occupent leurs territoires en fonction de critères qui sont perçus comme renforçant les changements climatiques en détériorant l’environnement ? Quel espace est laissé à ces perspectives qui vont à l’encontre des luttes environnementales ? Quel espace est également laissé aux pratiques alternatives de développement économique dans le contexte des luttes environnementales ? Est-il possible de prôner une approche différente et non consensuelle si l’on est issu d’un groupe autochtone ? Ces questionnements soulèvent non seulement un point clé de toute la pertinence des épistémologies autochtones, mais font également ressortir celui de l’ouverture de ces dernières au dialogue et à l’imbrication (Abanda 2022) des systèmes de savoirs autochtones. De Sousa Santos (2011) considère ainsi la mise en oeuvre d’une écologie des savoirs, c’est-à-dire la coexistence, sans hiérarchie, de savoirs de diverses natures et horizons, puis leur dialogue et enrichissement mutuel par un processus de traduction interculturelle. Nous pensons, comme lui, que « une telle approche apparaît comme particulièrement pertinente dans le cadre de domaines aussi complexes que ceux de la recherche et de la gestion de la biodiversité » (De Sousa Santos 2011 : 83).
Tout en élargissant les espaces de discussions, le fil conducteur de ce numéro thématique, qui résulte du colloque, guide le lecteur à travers l’importance du rôle des épistémologies autochtones au regard des enjeux environnementaux actuels et de leur mobilisation. Ce numéro met aussi l’accent sur les enjeux et les défis auxquels font actuellement face les groupes autochtones dans l’expression de leur épistémologie de la nature. Ainsi, Otilia del Carmen Puiggròs et Denis Y. Charlebois présentent comment le concept du Buen Vivir, à l’exemple de l’Équateur, peut être considéré comme un levier stratégique pour un mode de vie alternatif où la reconnaissance des droits culturels et territoriaux des nationalités autochtones devrait assurer leur épanouissement selon leurs cosmologies dans la préservation de leurs cultures et en respect de leurs territoires ancestraux. Axé davantage sur les besoins de l’humain et ceux de la Terre, le Buen Vivir représente un changement de valeurs en faveur de ce que les peuples autochtones des Andes considèrent « comme une belle vie et un niveau de vie convenable en tenant compte d’autrui et de la biodiversité qui les entoure » (del Carmen Puiggròs et Charlebois. L’idée d’une « belle vie » en ce sens résonne avec le concept anishinaabe de mino-mnaamodzawin ou Minobimaatasiiwin (McGregor 2020) qui peut être traduit par « la bonne manière de vivre » ou « la bonne vie » et dont l’équivalent peut être retrouvé dans toutes les langues algonquiennes. Or, cette vision de bien-être est fondamentalement reliée à la préservation des langues et savoirs issus et dépendants de la préservation des territoires ancestraux, comme le souligne la chercheuse anishinaabe Deborah McGregor (2004). Elle met de l’avant l’urgence de préserver l’intégralité des systèmes de savoirs traditionnels, ce qui comprend notamment la protection de la diversité biologique qui conditionne la diversité culturelle et linguistique de la planète, les deux étant inextricablement liées (UNESCO 2021b). La prise en compte des épistémologies autochtones devient alors, pour les groupes autochtones dans le monde, une condition clé dans leur capacité à développer une résilience face aux changements climatiques.
Différentes contributions illustrent cette nécessité exprimée par les groupes autochtones autant au Canada qu’à l’échelle internationale. En effet, Noémie Gonzalez Bautista met de l’avant le rôle des épistémologies autochtones dans la gestion des feux de forêt en contexte boréal et Megan Hébert-Lefebvre et Edgar Blanchet présentent une étude démontrant l’importance des savoirs et connaissances des femmes w8banakiiak en lien avec le territoire. Au niveau des perspectives africaines qui enrichissent ce numéro thématique, notons l’article de Claudette Soubane Diatta, Barnabé Ephrem A. Dieme et Yaya Mansour Diedhiou portant sur la contribution des coutumes et pratiques diola de la Basse Casamance au Sénégal dans la conservation de la mangrove, tout autant que l’analyse critique des chercheurs Patrice Bigombe Logo et Dieudonné Toukéa qui, en toute conscience de l’importance des savoirs autochtones comme ressource importante pour la lutte contre les changements climatiques, constatent la lenteur de la reconnaissance de ces savoirs et leur intégration dans les politiques climatiques des états en Afrique centrale, notamment à travers leur regard critique tourné vers le Cameroun, de la République du Congo, du Gabon et du Tchad.
À l’échelle des instances internationales, la militante écologiste Hindou Oumarou Ibrahim, Abanda met l’accent sur le leadership dans le rapprochement entre les savoirs et connaissances traditionnels des peuples autochtones et la science afin de combattre les changements climatiques et de protéger la biodiversité avec un accent sur le rôle des femmes. Le juriste expert en droits des peuples autochtones Alexandre Sommer- Schaechtelé pose, pour sa part, le constat que les peuples autochtones en Guyane française font face à un développement industriel croissant sans véritables moyens juridiques ou institutionnels pour participer aux décisions et exprimer leurs voix, ne leur laissant que les voies du militantisme associatif et le plaidoyer à l’international, notamment aux Nations Unies, pour influencer l’opinion publique.
En somme, la majorité des contributions mettent en avant des perspectives empiriques, locales, fortement ancrées dans l’expérience terrain des autrices et auteurs et confirment toute leur légitimité pour répondre à la crise climatique. Ce numéro thématique permet ainsi d’explorer les positions articulées par les groupes autochtones quant à la mise en oeuvre des épistémologies autochtones en lien avec la protection de l’environnement, la biodiversité, la conservation des ressources et les changements climatiques, tout en dirigeant le projecteur sur les discours des différents groupes autochtones dans différentes régions du monde (Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud) en ce qui concerne le maintien de la biodiversité et de la protection de l’environnement face aux changements climatiques ainsi que les cadres étatiques régulant le pouvoir d’agir des acteurs locaux.
Parties annexes
Notes biographiques
Dr Fernande Abanda Ngono est juriste spécialisée en droit comparé de l’environnement, docteure en sciences sociales appliquées à l’Université du Québec en Outaouais depuis décembre 2022, et membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherche autochtones. Elle se consacre depuis quinze ans à la compréhension des enjeux sociaux de la conservation de la nature, de l’accaparement des terres et des ressources et à l’étude des mouvements sociaux environnementaux qui en émergent. Elle s’intéresse particulièrement à leur portée sur les femmes et les communautés autochtones, ainsi qu’aux dynamiques qui en ressortent sur le plan de la territorialité, de la gouvernance et de la normativité avec un accent sur l’anthropologie du droit et la sociologie de l’action. Fernande est actuellement cogestionnaire de programmes à Inter Pares, un organisme canadien qui oeuvre pour la justice sociale au Canada et à l’international.
Şükran Tipi est linguiste de formation et candidate au doctorat au Département d’anthropologie de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche portent sur les enjeux reliés à la revitalisation et la mise en valeur des langues et systèmes de savoirs autochtones, avec une attention particulière sur l’expression du lien entre langue et territoire dans les pratiques langagières intergénérationnelles actuelles en contexte autochtone. Ses différentes implications professionnelles en milieu communautaire et institutionnel autochtone depuis quinze ans l’amène à se questionner sur les défis ontologiques et épistémologiques de la décolonisation, dans une perspective d’autodétermination des peuples autochtones au Canada et à l’international.
Notes
-
[1]
Pour plus de détails concernant cette association autochtone à l’UQO, veuillez consulter le lien URL suivant : https://sites.uqo.ca/savoir/articles/a0231.html
-
[2]
Les gaz à effet de serre (GES) sont composés notamment de vapeur d’eau, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O) et d’ozone (O3).
-
[3]
Par « objectif climatiques mondiaux », nous entendons ceux associés à l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.
-
[4]
La notion de groupe permet d’amener un terme plus adapté aux différentes populations autochtones à travers le temps et à travers le monde, sans avoir la charge sémantique assez variée que peuvent comporter les concepts de « nation » ou de « peuple », selon les différentes aires géographiques.
-
[5]
Si au niveau des instances internationales, comme celles de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), il est généralement question de « systèmes de savoirs locaux et autochtones », il est important de retenir que, selon les auteur.e.s cités dans ce texte et tout le long de ce numéro, les désignations données à ces savoirs et connaissances peuvent varier entre les qualificatifs « locaux », « autochtones » et « traditionnels », ce qui n’enlève rien à la portée de ce type de connaissances mises de l’avant. Concrètement, « […] les savoirs locaux et autochtones comprennent les connaissances, savoir-faire et philosophies développés par des sociétés ayant une longue histoire d’interaction avec leur environnement naturel », comme précise l’UNESCO sur leur site Internet dédié à ce sujet : Systèmes de savoirs locaux et autochtones (LINKS) (UNESCO 2021a).
-
[6]
En alignement avec la thématique de ce numéro et en reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples autochtones, tel que formulé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (ONU 2007), la graphie localement choisie des ethnonymes désignant les groupes autochtones ainsi que leurs formes dérivées sera conservée dans les contributions tel que précisé par les auteurs.e.s. Autrement, nous suivrons les recommandations de l’Office québécois de la langue française en ce qui a trait aux désignations des nations autochtones sur le territoire actuellement délimité de la province du Québec. VOIR note no. 7 qui est redondante. Faire un mix des deux en note no. 4.
-
[7]
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), entrée en vigueur le 29 décembre 1993 traite spécifiquement des « connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales » (ONU 1992 : 2).
-
[8]
On peut citer entre autres : l’Ancien Chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN) Perry Bellegarde; Hindou Oumarou Ibrahim, membre de la communauté Peul du Tchad en Afrique centrale, Patricia Gualinga du peuple Kichwa de Sarayaku, une communauté située dans l’Amazonie équatorienne.
Bibliographie
- ABANDA NGONO, Fernande, 2022, Patrimonialisation mondiale de la nature et développement descommunautés rurales et autochtones dans les territoires forestiers du bassin du Congo, thèse de doctorat, Université du Québec en Outaouais : Département des sciences sociales.
- AUBRUN, Alain, et Claude MARIUS, 1988, « Cartographie des mangroves exemple de la vallée de Bignona (Casamance-Sénégal) », ScienceduSol, 27 : 55-60.
- CHAPLIER, Mélanie, 2006, « Le conflit à la baie James. Pour une anthropologie de la nature dans un contexte dynamique », Civilisations, 55(1-2) : 103-115.
- CÔTÉ, Isabelle, 2021, « L’inclusion des perspectives autochtones dans le programme d’immersion française en Colombie-Britannique : les succès d’enseignants et d’enseignantes allochtones », Éducation et francophonie, 49(1) : 14–31. En ligne : https://www.erudit.org/en/journals/ef/2021-v49-n1-ef06013/1076999ar/.
- DE SOUSA SANTOS, Boaventura, 2011, « Épistémologies du Sud », Études rurales, 187 : 21-50.
- DOWIE, Mark, 2009, ConservationRefugees.TheHundred-YearConflictbetweenGlobal ConservationandNativePeoples, Cambridge/London : The MIT Press.
- ELLINGTON, Lisa, 2019, « Vers une reconnaissance de la pluralité des savoirs en travail social : le paradigme autochtone en recherche », Revuecanadiennedeservicesocial, 36(1) : 105–125. En ligne : https://doi-org.proxybiblio.uqo.ca/10.7202/1064663ar.
- FARGET, Doris, 2016, « Colonialisme et pollution environnementale : prolongement et effets sur les droits des peuples autochtones », Criminologie, 49(2) : 95–114. En ligne : https://doi-org.proxybiblio.uqo.ca/10.7202/1038418ar.
- GARCÍA-VINUESA, Antonio, GONZALEZ-GAUDIANO, Edgar J., et Pablo Á. MEIRA CARTEA, 2022, « La dimension politique de l’éducation au changement climatique en temps de COVID-19 », Éducation relative à l’environnement, 17-2. En ligne : https://journals.openedition.org/ere/8724.
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat — GIEC, 2007, Bilan 2007deschangements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d’évaluationduGrouped’expertsintergouvernementalsurl’évolutionduclimat, Genève : GIEC.
- HEEMERYCK, Antoine, 2022, « Quelle est la nature de l’environnement aux yeux du capitalisme ? », L’Homme&laSociété, 2022/1 (N° 216) : p. 67-87. DOI En ligne : 10.3917/lhs.216.0067. URL : https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2022-1-page-67.htm
- HITCHCOCK, Robert K., 2019, « The Impacts of Conservation and Militarization on Indigenous Peoples »,. Humannature, 30(2) : 217-241.
- MAILHOT, José, 1993, Lesavoir écologique traditionnel.Lavariabilitédessystèmesdeconnaissanceetleur étude. Montréal : Bureau de soutien de l’examen public du projet Grande Baleine.
- MCGREGOR, Deborah, WHITAKER, Steven, et Mahisha SRITHARAN, 2020, « Indigenous environmental justice and sustainability », CurrentOpinioninEnvironmentalSustainability, 43 : 35-40.
- MCGREGOR, Deborah, 2004, « Traditional Ecological Knowledge and Sustainable Development: Towards Coexistence », in Blaser, M., Harvey, A. F. et Glenn McRae (Dirs), In the Way of Development:IndigenousPeoples,LifeProjectsandGlobalization (72-91), London/New York : Ze.
- NAKASHIMA, Douglas J., GALLOWAY MCLEAN, Kirsty, THULSTRUP, Hans D., RAMOS CASTILLO, Ameyali, et Jennifer T. RUBIS, 2012, WeatheringUncertainty:TraditionalKnowledgeorClimateChangeAssessmentandAdaptation, Paris : UNESCO.
- Organisation des Nations Unies — ONU, 1992, Convention sur la diversité biologique, ONU. En ligne : https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf.
- Organisation des Nations Unies — ONU, 2007, DéclarationdesNationsuniessurlesdroitsdespeuplesautochtones, Genève : Nations Unies, Département de l’information de l’ONU.
- Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture — UNESCO, 2021a, Systèmesdesavoirslocauxetautochtones(LINKS), UNESCO. En ligne : https://fr.unesco.org/links.
- Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture — UNESCO, 2021b, Plan d’action mondial de la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032), document d’information 41 C/INF.14, Paris : UNESCO.
- OXFAM International, 2020, Confrontingcarboninequality.PuttingclimatejusticeattheheartoftheCOVID-19 recovery, Oxfam media briefing 21 September 2020. En ligne : Confronting Carbon Inequality: Putting climate justice at the heart of the COVID-19 recovery (openrepository.com).
- REED, Graeme, BRUNET, Nicolas, MCGREGOR, Deborah, SCURR, Curtis, SADIK, Tonio, LAVIGNE, Jamie, et Sheri LONGBOAT, 2022, « Toward Indigenous visions of nature-based solutions: an exploration into Canadian federal climate policy », ClimatePolicy, 22(4) : 514-533.
- ROYER, Marie-Jeanne. S., 2012, L’interaction entre les savoirs écologiques traditionnels et leschangements climatiques : les Cris de la Baie-James, la bernache du Canada et le caribou des bois (Thèse de doctorat), Département de géographie, Université de Montréal.
- SCHMIDT, Paige M., et Markus J. PETERSON, 2009, « Biodiversity conservation and indigenous land management in the era of self-determination », ConservationBiology, 23(6) : 1458–1466.
- YEARLEY, Steven, 2009, « Sociology and Climate Change after Kyoto: What Roles for Social Science in Understanding Climate Change? », CurrentSociology, 57(3) : 3

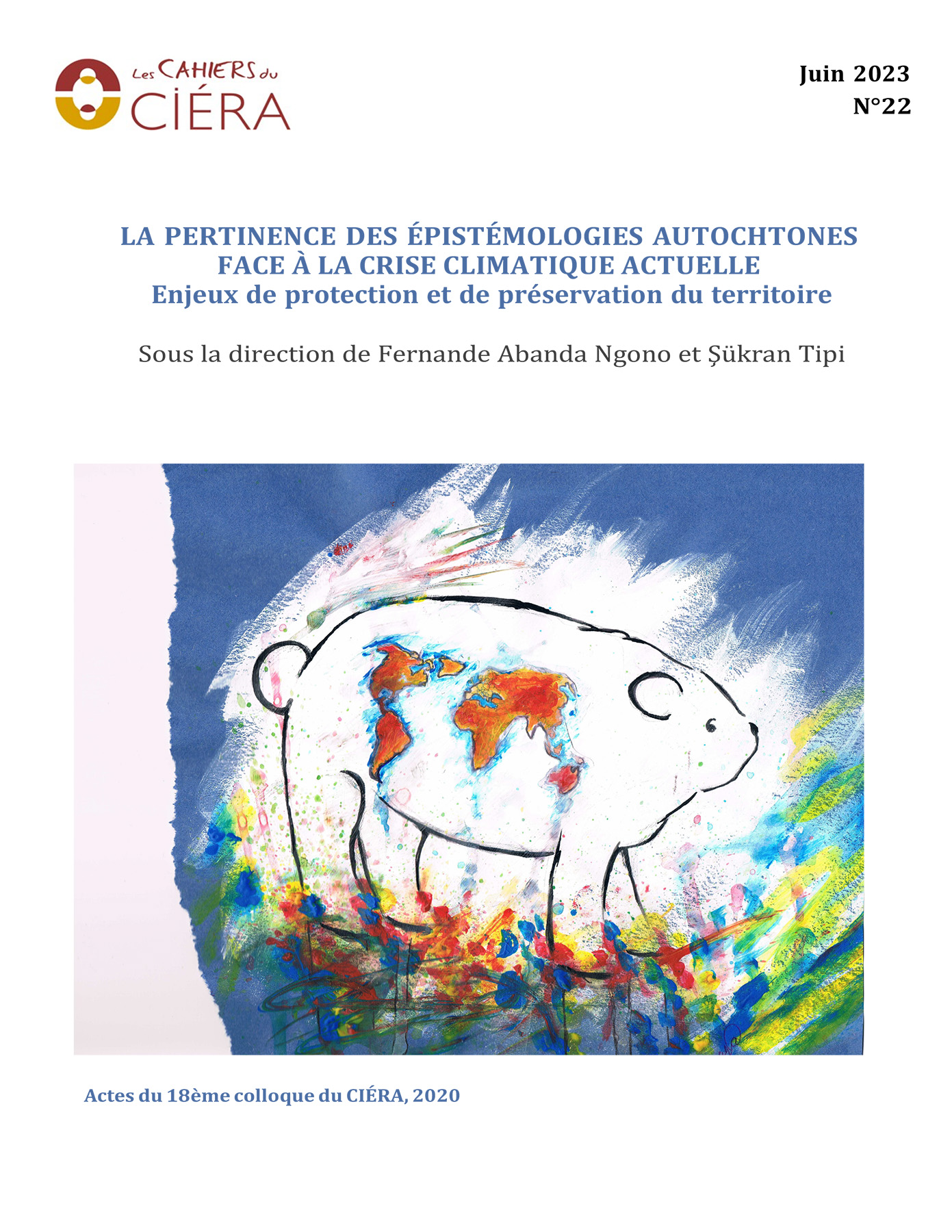

 10.7202/1076999ar
10.7202/1076999ar