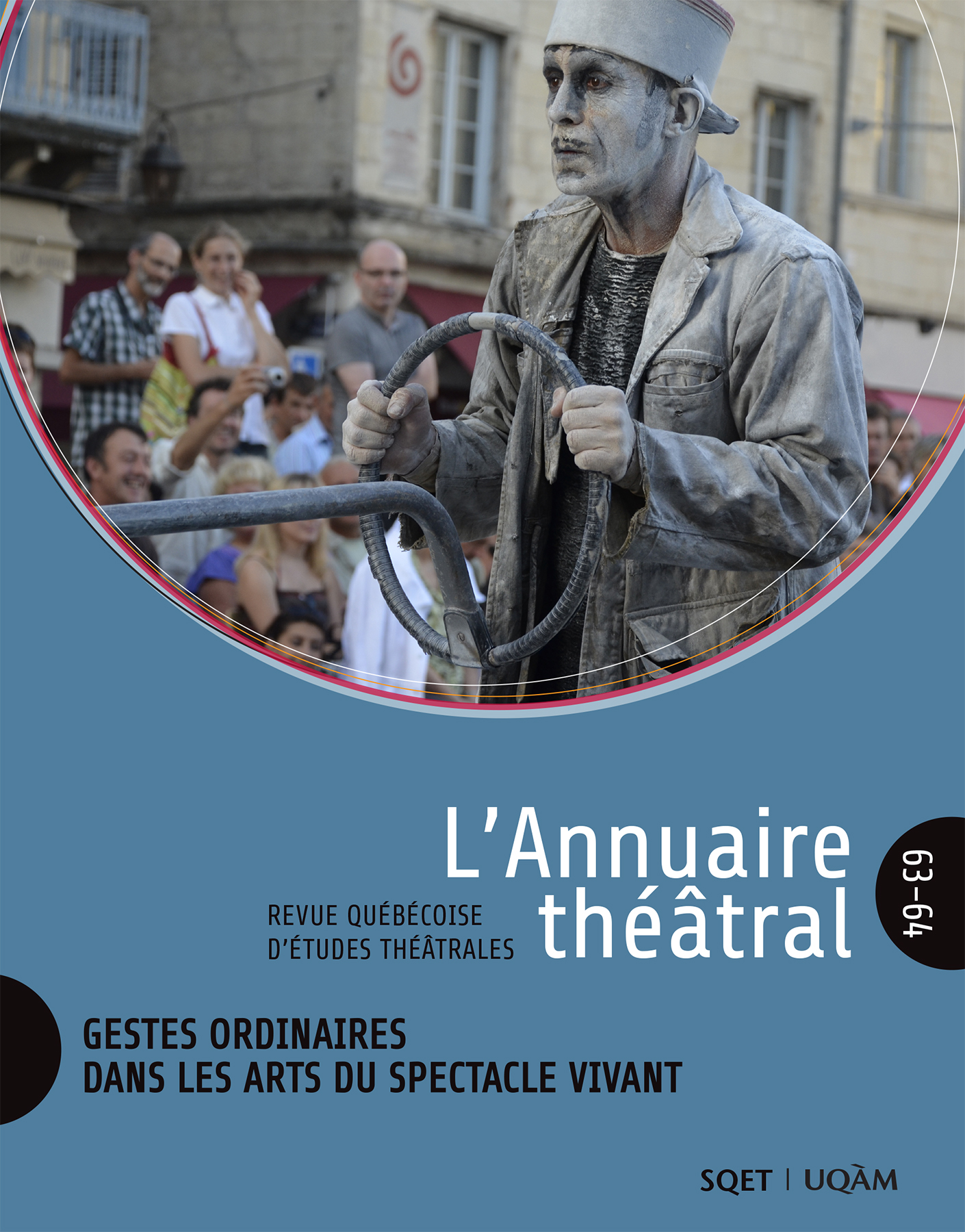Corps de l’article
À l’entretien conventionnel, nous avons préféré une forme permettant à nos voix, à nos idées, de se croiser, se faire écho et se prolonger : une écriture à quatre mains dissociée.
Éric Soyer : À l’origine de mon parcours, il y a une scène vide, des comédiens, de la lumière, l’apprentissage de ce qu’est un théâtre, des projecteurs. Ce que c’est que conduire un spectacle, le refaire plus d’une centaine de fois dans des lieux différents. Ce que c’est que d’entrer en scène, en sortir, de sculpter un corps, d’évoquer un extérieur, un intérieur. Ce que c’est que de synchroniser des départs de son avec de la lumière, de la machinerie, du jeu. En fait de jouer, d’inventer et de réinventer, d’être ému. Au départ, il y a une forme d’émerveillement à échelle humaine et des rencontres déterminantes qui font croître la confiance. Construire, déconstruire, recommencer et toujours donner corps à ce rêve de pouvoir fabriquer une réalité qui se joue du temps. Entrer dans une salle, une autre, et éprouver la diversité des rapports au public et comment les mêmes ingrédients donnent une autre recette. Remettre sur l’établi des formes simples et prendre le temps de les voir grandir et s’épanouir. L’observation comme forme d’école.
Puis, ce savoir se structure, le jeu s’agrandit ainsi que l’échelle, les enjeux, le territoire. Les partenaires de jeu se précisent, s’organisent en familles de sensibilité et, là, le public fait caisse de résonance, les moyens doucement augmentent et la recherche permet de développer ce que l’on appelle un langage qui se déploie au fil des ans, des tournées, des expériences, des pays. Une grammaire prend forme, devient identifiable. Un voyage sur place qui utilise la mémoire vive du spectateur comme terreau d’une image en construction.
C’est une tentative désespérée d’assembler les fragments pour obtenir une image complète, de trouver l’équilibre et de le rompre... de sauter sur un château de cartes. D’inventer un monde, de le tordre, le vriller jusqu’à se soustraire à la pesanteur du corps. De susciter l’émerveillement du rêve éveillé suspendu comme un long courrier, de croire à la fiction, la fiction de l’espace et du jeu, la rendre tangible.
L’espace comme fiction, la fiction comme espace
Véronique Lemaire : Dans le travail scénographique qu’Éric Soyer a mené avec le metteur en scène Joël Pommerat, particulièrement dans la période allant des années 1997 à 2008, la distinction entre espace de représentation (la scène) et lieu de fiction (l’endroit où se déroule la fable) semble s’être dissoute, absorbée par le processus même de création scénographique et textuelle. Au commencement n’était pas la fable ni le texte, mais bel et bien « des lieux », envisagés par Pommerat comme points d’ancrage d’écriture. Deux créations paraissent exemplatives de ce processus de création : Les marchands[2] et Je tremble (1 et 2)[3].
Le point de départ est une première séance de travail au cours de laquelle Joël Pommerat, l’auteur et metteur en scène, expose à Éric Soyer, le scénographe, les lieux dans lesquels il pressent que la fiction se déroulera. Cela suppose qu’il ait à l’esprit un thème qu’il souhaite aborder. Mais le principe premier est la définition des lieux de l’action. Par exemple, pour le spectacle Les marchands, les lieux préalablement définis étaient relatifs au monde du travail : une usine dans laquelle on pouvait distinguer une chaîne de montage et des bureaux, des appartements tels qu’on les rencontre dans les grandes cités de HLM, et un bar, situé au pied d’une tour de HLM. En ce qui concerne Je tremble (1 et 2), le lieu de départ était celui du cabaret, de la scène donc, sur laquelle divers personnages viendraient faire état de leur vie et du monde. L’élément scénique qui allait identifier ce lieu de façon métonymique serait un rideau de scène noir à paillettes argentées. La détermination de ces lieux déclenche ensuite la réflexion du scénographe sur une matière ou une sensation : celle du béton, de la froideur, de la rigidité pour Les marchands; celle du révélateur émotif, une peau qui rougirait par exemple, pour le rideau de Je tremble. Créer des espaces sensibles.
À partir de ces variations spatiosensorielles, Éric Soyer conçoit un dispositif scénique, un espace en devenir, ouvert à l’inscription des lieux de la fiction; c’est un espace encore neutre : un instrument de travail. Il le fait construire et monter sur scène. Joël Pommerat et les comédiens investissent ensuite cet espace et l’explorent dans une démarche d’écriture et de jeu qui se développe simultanément, à travers un aller-retour et un enrichissement mutuel.
L’écriture de la pièce vient donc du plateau; c’est une élaboration collective en ce sens qu’elle se construit au départ des thèmes proposés par Joël Pommerat, sur lesquels les acteurs improvisent en costume et développent des situations de vie et de jeu, dont Soyer explore à son tour les potentialités spatiales et scéniques avec l’appui des propositions sonores et que l’auteur retravaille ensuite par l’écriture. Pour Les marchands, l’ensemble de la compagnie, auteur-metteur en scène, scénographe, acteurs, créateur son, costumière, mais aussi techniciens, visionne par ailleurs des documents tels que des reportages, des films, des documentaires ce qui vise à déclencher les débats, à approfondir et à nourrir le travail de création sur le plateau, qui, à nouveau, renvoie l’auteur à son travail d’écriture textuelle.
L’espace comme chantier
É. S. : Ce lieu neutre, un peu brut, qu’est la cage de scène devient le réceptacle vivant de ces moments suspendus dans nos existences qui sollicitent et bousculent notre capacité à vivre des histoires. Et puis arrive doucement la nécessité d’exploser la connaissance, de déplacer les fondations, d’échapper aux routes déjà tracées. Toujours revenir à ces émotions premières. Comment échapper au maniérisme? Creuser un sillon, oui, peut-être plusieurs et s’apercevoir que ce que l’on sait est finalement bien fragile, que ce savoir contient sa propre limitation... La tentation du refuge est grande d’exploiter un savoir. Il n’existe pas de recettes pour enrichir et développer un langage.
La lumière, ciseau de l’espace
Les matériaux de base sont les éléments construits, que l’on peut toucher, qui fabriquent un espace, qui organisent les circulations, les entrées et sorties, les hauteurs physiques de jeu, les matières qui reçoivent la lumière. Cette dernière est aussi tangible qu’immatérielle, elle a ses propriétés physiques de propagation dans l’air, ses propriétés physiologiques sur les spectateurs, ses règles, ses grains. Elle se travaille comme la musique, comme le parfum dans l’espace et le temps, elle se compose.
La lumière est une matière qui nous enveloppe et nous traverse. Elle est un écho du son, une vibration.
Les plans se dévoilent, se télescopent, s’absorbent, se diluent. Elle est régie par quelques principes simples et demande du temps d’observation, d’expérimentation pour en saisir les infinies possibilités d’assemblage. Elle a ses règles de diffusion dans l’espace, se laisse couper, trancher, adoucir, se transforme en permanence au gré des obstacles qu’elle rencontre. Des flammes qui ondoient aux filaments qui rougeoient, aux arcs qui aveuglent, aux DEL qui aplanissent jusqu’au laser qui transperce, toutes les technologies sont bonnes pour constituer une palette, puis des gammes et, enfin, une partition.
Les qualités des dégradés annoncent le passage de l’ombre à la lumière. Aiguisée comme un couperet ou vaporeuse, elle participe activement à la construction mentale de la troisième dimension. Je pourrais parler de mise en ombre pour attiser la curiosité des sens, pour dévoiler l’indicible et éveiller l’imaginaire. La lumière définit le rapport au temps dans sa transformation, charrie ses mystères, se joue de nos sens.
Toutes les qualités et textures de lumière sont utiles pour ce travail de composition. Il s’agit d’écrire un espace-temps particulier, malléable à merci. J’aime quand ce sont les corps des interprètes qui déclenchent les phénomènes et déploient les espaces. Il y a un rapport intime de l’interprète à l’espace qui agit comme l’oxygène dont il a besoin. Je n’en connais qu’un spectre infime et ai la sensation de toujours recommencer au pied du mur.
V. L. : Ces allers-retours entre le plateau et l’écriture s’affinent et s’aiguisent réciproquement jusqu’à ce qu’apparaissent une forme et un fond indissociables. C’est alors que s’opère la naissance du lieu dans la boîte de jeu et qu’Éric Soyer commence sa recherche sur le noir, la lumière et les profondeurs de champ comme modes d’architecturalisation de l’espace. Le dialogue entre écriture scénographique, textuelle, sonore et jeu des protagonistes continue de se construire ensemble, tout au long du processus de création.
É. S. : Je compose des peintures éphémères grand format avec des équilibres en mouvement, des tableaux vivants incluant les corps des interprètes. Ils s’approprient ces architectures de lumière dont ils sont parfois l’épicentre et au sein desquelles ils peuvent aussi se jouer des limites.
V. L. : La lumière est à la fois l’outil et le matériau, le ciseau et le bois; c’est elle qui va donner à l’espace son organisation et sa matière. C’est elle qui constitue le procédé scénographique majeur qui féconde l’oeuvre. Non parce qu’elle la montre et l’éclaire, la « met en lumière », mais parce qu’elle crée la relation qui s’établit entre le propos (le texte) et le visible (la scène), pour donner naissance au récit. Chez Éric Soyer, la lumière constitue le langage du récit.
En astronomie, le moment durant lequel seul un demi-disque de lune est visible, laissant l’autre demi-disque dans l’obscurité, est appelé la dichotomie. La dichotomie est donc ce moment où le visible et le non-visible coexistent et se cautionnent mutuellement. Elle repose sur la capacité du visible à dévoiler le non-visible…
Ce principe est analogue au travail qu’Éric Soyer effectue avec la lumière pour faire naître les espaces des Marchands et de Je tremble (1 et 2), mais en procédant à l’inverse : il met en scène le non-visible, le noir ou l’ombre, pour faire apparaître le visible, la lumière. De la sorte, il parvient à rendre présente l’absence et à faire varier le degré de présence de la présence, jusqu’à ce que le spectateur vienne à douter de celle-ci.
A contrario du procédé théâtral qui, depuis que la représentation théâtrale se joue dans un lieu clos, lutte contre le noir pour mettre en lumière l’espace scénique (par force chandelles, bougies, lampes à huile, lampes à gaz et, enfin, lampes, puis projecteurs électriques), Éric Soyer crée d’abord le noir, il s’assure de sa qualité de noir absolu, pour ensuite y « déposer » la lumière. Tout au long de son travail scénographique, elle pénètre l’obscurité contingentée dans la boîte et la découpe, la sculpte. Nous pourrions dire que, chez Soyer, la dichotomie s’effectue dans le sens d’une monstration du demi-disque caché, pour nous y dévoiler le demi-disque lumineux.
Par la lumière, il procède à la retranscription visuelle de ce que Joël Pommerat nomme la réalité, soit :
le domaine du visible et de l’invisible, du mystère de l’inconnu, de tout ce qu’on ne peut pas tout à fait déterminer – de ce qui échappe à la connaissance, qui échappe à la conscience ou à la possibilité de conscience – et cette dimension-là, elle a une part dans notre existence, elle a une part dans nos vies donc voilà, moi, je rends ça
(Pommerat, cité dans Armand, 2008).
En travaillant sur la division entre le visible et l’invisible, entre ce que l’on voit et ce qui échappe, Éric Soyer parvient à retranscrire scéniquement l’indicible de ce que Joël Pommerat nomme la réalité, faite de visible et d’invisible. Il parvient donc non seulement à montrer ce que l’on ne voit pas, mais également à montrer que l’on ne voit pas. C’est là tout l’enjeu de ses espaces. Cette préoccupation est une constante réinterrogée qui traverse tous les spectacles.
Un processus en ouverture
Le répertoire de la compagnie Louis Brouillard a vu naître à ce jour une vingtaine de spectacles dont les créations n’ont cessé de questionner le mode de production, pour le mettre au service des processus d’écriture, de recherche, de laboratoire et d’exploration des rapports scène-salle (frontal, circulaire, bifrontal, carcéral, total, abolissant la frontière avec le public) et de diffusion.
1997
Treize étroites têtes, création au Centre dramatique national de Montluçon (France)
1998
Pôles, Mon ami, Treize étroites têtes, trilogie créée au Théâtre Paris-Villette (France)
2002
Pôles, Mon ami, recréation des éclairages et du dispositif scénique au Lavoir Moderne Parisien (France)
Grâce à mes yeux, création au Théâtre Paris-Villette (France)
2004
Au monde, création au Théâtre National de Strasbourg (France)
Le petit chaperon rouge, création au Théâtre de Brétigny (France)
2005
D’une seule main, création au Cendre dramatique régional de Thionville (France)
2006
Les marchands, création au Théâtre National de Strasbourg (France)
Cet enfant, création au Théâtre Paris-Villette (France)
2007
Je tremble (1), création au Théâtre Charles-Dullin de Chambéry (France)
2008
Pinocchio, création au Théâtre national de l’Odéon Berthier (Paris, France)
Je tremble (1 et 2), création au Festival d’Avignon (France)
2010
Cercles / Fictions, création au Théâtre de Bouffes du Nord (Paris, France)
2011
Ma chambre froide, création au Théâtre de l’Odéon (Paris, France)
Thanks to My Eyes, opéra de chambre d’Oscar Bianchi, Théâtre du Jeu de Paume (Festival d’Aix-en-Provence, France); Théâtre de la Monnaie (Bruxelles, Belgique)
2012
Cendrillon, création au Théâtre National de Bruxelles (Belgique)
La grande et fabuleuse histoire du commerce, création au Centre dramatique régional de Béthune (France)
2013
La réunification des deux Corées, création au Théâtre national de l’Odéon (Paris, France)
Une année sans été, texte de Catherine Anne, création au Théâtre National de Bruxelles (Belgique)
2014
Au monde, opéra de Philippe Boesmans, Théâtre de la Monnaie (Bruxelles, Belgique)
2015
Ça ira : fin de Louis, création au Théâtre des Amandiers (Nanterre, France)
2017
Pinocchio, opéra de Philippe Boesmans, Grand Théâtre de Provence (Festival d’Aix-en-Provence, France)
2018
Marius, adaptation du roman de Marcel Pagnol, écriture in situ avec un groupe de détenus de la maison d’arrêt d’Arles (France)
É. S. : La relation au monde est fondamentale. Le mot « représentation » est intéressant. La création comme un moyen de saisir, d’appréhender ce monde qui nous entoure et dont je fais partie. J’aime ce temps-là où tout semble possible. Temps du voyage, concentré des existences, des expériences humaines émotives et sensorielles. Je prépare la palette, j’organise les outils et, avec l’aide d’un pupitreur, je commence le travail de sculpture, de peinture, de composition.
Les points de vue changent. Le cap est le même et le processus de maturation est incompressible. Les expériences s’enrichissent mutuellement et, si chaque pièce est unique et intrinsèquement différente, mon tout fait corps dans l’équilibre instable du marcheur. La nécessité de me fragmenter sur plusieurs pistes de décollage de longueurs différentes apparaît. Il y a là une chose salutaire. Et toujours d’observer, d’entrevoir d’un coup un chemin caché, une ramification, une parallèle, de saisir l’opportunité de déplacer son savoir, de le questionner. C’est pourquoi le principe d’incertitude et l’accident sont si importants afin d’ouvrir des failles. Repousser l’instant des décisions pour rester proche de l’écriture en mouvement, du désir de jouer, de transformer.
Pourtant, il s’agit de fixer, mais surtout de ne pas figer, d’écrire une partition, des partitions, des gammes, d’organiser des palettes, d’élargir des variations. Quels sont les indicateurs pour mettre en marche un processus créatif, quelle est la marge de manoeuvre, quelle est la part accordable au rêve, à la recherche, à la réalisation? Et surtout, dans tous ces étages, quelle est la part dynamique, celle qui amène l’effervescence, puis la capacité de discerner, d’extraire l’essence?
Le regard de l’autre déplace nos propres lignes, il y a une chose chorégraphique dans le processus. L’art scénographique interroge le contenant et le contenu, il s’opère dans un espace-temps particulier qui fait une mise en rapport, en abîme des imaginaires. Imaginaires des créateurs, des interprètes et des spectateurs. Le principe d’insatisfaction, de renouvellement, de nécessité est un fondement primordial.
Il ne peut y avoir de remise en cause de la méthode, si l’on n’interroge pas l’économie générale de sa pratique; pour échapper au maniérisme, il est nécessaire de repartir d’un endroit de combat, d’un endroit inattendu, de tendre vers un but hors plébiscite.
Au départ était l’espace, au départ est un processus qui ne connait pas sa forme, une équation insoluble dans un tableur, un point d’arrivée inconnu traversé de flashs de certitudes, enrobé d’un doute constant. Tout comme les espèces, les processus de développement sont d’une temporalité variable. Ébranler les convictions pour toucher la matière sensible malléable à merci… Laisser affleurer ce que sera demain et son prisme de lecture.
Il n’y a que le temps et les routes pas encore tracées qui peuvent dire si cela en valait la peine, si l’effort était orienté dans la bonne direction. Des routes, des chemins qui, à leur tour, seront explorés par d’autres, c’est sûrement le vrai baromètre, la possibilité de ramifications.
Parties annexes
Notes biographiques
Éric Soyer
Éric Soyer participe aux processus d’écriture scénique avec de multiples créateurs, metteurs en scène, chorégraphes et compositeurs sur les scènes d’Europe, tels que Théo Mercier, Angelin Preljocaj, Maud Le Pladec, Jeanne Added, Phia Ménard, Josse De Pauw. Il entame une collaboration avec l’écrivain et metteur en scène Joël Pommerat en 1997, qui se poursuit aujourd’hui autour de la création d’un répertoire de vingt spectacles de la compagnie Louis Brouillard. Il reçoit le prix de la critique journalistique française pour son travail en 2008 et en 2012.
Véronique Lemaire
Comédienne, Véronique Lemaire a acquis sa pratique scénique en Belgique, France et Italie avant de s’orienter vers la théorie théâtrale. Autrice d’une thèse en 2011 intitulée « Réalité et effet de réel dans la scénographie théâtrale contemporaine » qu’elle a réalisée sous la direction de Jean-Louis Besson et Marcel Freydefont, ses recherches portent sur la scénologie de la représentation et son histoire. Elle a fondé en Belgique un Groupe de recherche en scénographie (GRES) qui réunit des chercheurs des universités et des écoles supérieures des arts ainsi des artistes scénographes. Elle enseigne au Centre d’études théâtrales de l’Université catholique de Louvain, à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre ainsi qu’à l’Institut des arts de diffusion (IAD-théâtre). Elle est coautrice de Scénographes en France : diversité et mutations (1975-2012) (Luc Boucris, Marcel Freydefont, Jean Chollet, Véronique Lemaire, Mathab Mazlouman [dir.], Paris, Actes Sud, 2013). Elle a coorganisé, au sein de l’Union des scénographes (France), les Rencontres européennes de la scénographies (Théâtre de l’Odéon, Ateliers Bertier, Paris, 2017). Véronique Lemaire est également rédactrice en chef de la revue Études théâtrales (Louvain-la-Neuve, Belgique).
Notes
-
[2]
Les marchands est le troisième spectacle d’une trilogie (Au monde – D’une seule main – Les marchands) et se consacre à l’exploration des rapports entre pouvoir et monde du travail. Le spectacle a été créé au Théâtre National de Strasbourg en 2006.
-
[3]
Une première partie du spectacle, Je tremble (1), a été créée en 2007, au Théâtre Charles-Dullin à Chambéry (France). Je tremble (1 et 2) a été créé en 2008, à l’Opéra-Théâtre d’Avignon, dans le cadre du 62e Festival d’Avignon.
Bibliographie
- ARMAND, Blandine (2008), Raconter l’indicible réalité : à propos de la pièce Pinocchio d’après Carlo Collodi, écrite et mise en scène par Joël Pommerat, Paris, Arte France et Zadig Productions.