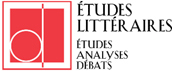Résumés
Résumé
Si le roman Voyage au bout de la nuit (1932), de Louis-Ferdinand Céline, a pu faire scandale à son époque en évoquant l’aliénation des masses ouvrières, non pas dans la langue de ceux qui dirigent mais bien de ceux qui travaillent, il n’en reste pas moins que le texte, contre toute vraisemblance sociolinguistique, place également le français oral populaire dans la bouche de personnages de bourgeois, de savants, voire d’intellectuels. L’analyse cherche à dégager les connotations sociales d’un tel déplacement langagier, dans la visée de réfléchir à la paradoxale conception – et donc représentation – du travail qui en découle.
Abstract
The novel Journey to the end of the night (1932), by Louis-Ferdinand Céline, created a scandal at the time by evoking the alienation of the working classes, not in the language of those who command but rather of those who work. Nevertheless, and against any sociolinguistic probability, the text also puts oral-popular French in the mouths of middle-class characters, scientists, or even intellectuals. The analysis seeks to reveal the social connotations of such a linguistic displacement, in order to reflect on the resulting conception – and thus representation – of work, and the paradoxes it contains.
Parties annexes
Références
- Alméras, Philippe, Les idées de Céline, Paris, Berg international, 1992.
- Bellosta, Marie-Christine, Céline ou l’art de la contradiction : lecture de Voyage au bout de la nuit, Paris, Presses universitaires de France, 1990.
- Camus, Albert, L’étranger, Paris, Gallimard (Folio), 1942.
- Céline, Louis-Ferdinand, « Hommage à Zola », repris dans Céline et l’actualité littéraire, 1932-1957, Paris, Gallimard, 1976 (éd. Jean-Pierre Dauphin et Henri Godard), p. 77-83.
- Céline, Louis-Ferdinand, « Lettre no 17 à Élie Faure [2 mars 1935] », repris dans Les Cahiers de l’Herne : Louis-Ferdinand Céline II, Paris, Minard Lettres Modernes, 1965 (éd. D. de Roux et M. Beaujour), p. 57-58.
- Céline, Louis-Ferdinand, Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard (Folio), 1952 [1932].
- Cresciucci, Alain (dir.), Céline. Voyage au bout de la nuit, Paris, Klincksieck, 1993.
- Dubois, Jacques, Le roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, 1992.
- Dubois, Jacques, Pour Albertine : Proust et le sens du social, Paris, Éditions du Seuil, 1997.
- Ducrot, Oswald et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Éditions du Seuil, 1972.
- Gide, André, Paludes, Paris, Gallimard (Folio), 1920 [1894].
- Godard, Henri, Les manuscrits de Céline et leurs leçons, Tusson, Du Lérot, 1988.
- Groupe μ, « Rhétoriques particulières — figures de l’argot », Communications, 16, 1970, p. 70-93.
- Hess, Rémi et Antoine Savoye, L’analyse institutionnelle, Paris, Presses universitaires de France, 1993.
- Jouve, Vincent, L’Effet-personnage dans le roman, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.
- Lourau, René, L’analyseur Lip, Paris, Union générale d’éditions, 1974.
- Lourau, René, Les analyseurs de l’Église, Paris, Anthropos, 1972.
- Lukács, Georg, Balzac et le réalisme français, Paris, La Découverte, 1999 (trad. de P. Laveau).
- Proust, Marcel, Du côté de chez Swann suivi d’À l’ombre des jeunes filles en fleur, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1954, t. 1 (éd. P. Clarac et A. Ferré).
- Sartre, Jean-Paul, « Pour qui écrit-on ? », Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard (Folio), 1988.
- Vitoux, Frédéric, Louis-Ferdinand Céline : misère et parole, Paris, Gallimard, 1973.
- Wolf, Nelly, Le peuple dans le roman français de Zola à Céline, Paris, Presses universitaires de France, 1990.