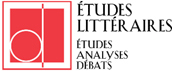Le soleil écrit derrière mes paupières. Une écriture nombreuse et compliquée parmi les pétales de rose, les plages de sable, les buissons chargés de feuilles et de fleurs. Les festons se déroulent, les volutes d’or se ramassent, s’étirent, se contractent. Ou bien ce sont des bulles menues qui montent, ou des corpuscules, des amibes qui se dédoublent et se multiplient. Cela n’a plus de fin, jusqu’à ce que j’ouvre les yeux. Sur le sol de la forêt, des rectangles blancs ou presque blancs, mais griffés de gris, de mauve, d’or qui se recroquevillent comme s’ils refusaient de s’ouvrir. Des pages arrachées, livrées aux quatre vents, toute une bibliothèque répandue dans la forêt. Mais en voici la source : encore debout, un tronc de bouleau pourrissant, épluché, écaillé, dont l’écorce lève en lanières et se déchire. C’est comme un rouleau de la Torah abandonné là, attendant que quelqu’un le recueille, le lise, l’interroge. Et toutes les écorces blanches sont des messages à recueillir, à moi adressés. Dans mon enfance il y eut d’abord les récits de voyages, les romans d’aventures. Cook voisinait avec Némo, les enfants du capitaine Grant avec les chasseurs de girafes, Sinnbad avec les nomades du Nord : les « livres de lecture » comme on les appelait pour les distinguer des livres de classe, ceux-ci imposés, ayant par la loi droit de cité, ceux-là tolérés, un peu suspects, puisque ce n’était pas en eux qu’on pouvait « s’instruire ». Quelque chose comme les feuilletons que nos mères suivaient dans le journal quotidien, qu’elles commentaient entre elles comme elles l’eussent fait d’événements survenus dans le quartier ou la ville, de personnes de leur connaissance qui se conduisaient mal, ou devenaient des héros ou des victimes. Ces « livres de lecture », on les lisait en cachette ou presque, après, c’est-à-dire après les devoirs faits, dans les marges, sous la lampe ou mieux encore au lit alors que le silence pouvait encore longtemps se prolonger. Ou bien encore ils accompagnaient la lente sortie de la maladie, gardant vivante la conscience pour qu’elle ne glisse pas complètement dans le sommeil définitif, laissant la convalescence s’achever ni se perdre dans les bousculades d’une cour de recréation. Que n’ai-je reçu de ces livres qu’aucun exercice, problème, dictée ou rédaction à l’école ne pourrait jamais me donner ! Et il y avait aussi les dictionnaires auxquels s’accolait ce mot mystérieux d’« encyclopédiques ». En eux s’abolissait la frontière entre livres de classe imposés et livres de lecture, les histoires. En ouvrant l’un des dix tomes reliés de cuir vert, il ne fallait pas se précipiter, mais, jour après jour, en tourner les pages avec respect, presque avec crainte : c’était l’émerveillement. Tout le savoir était donc là, tout ce que l’humanité avait appris, accumulé, filtré, mis en mots, imprimé sur le papier en colonnes serrées, avec des illustrations, des vignettes noires ou colorées, des cartes, des tableaux qui révélaient, représentaient mais laissaient plus encore à deviner. Tout ce qui entourait l’enfant, le baignait, l’enveloppait, le traversait, tout ce qui l’attendait, tout ce qui lui faudrait parcourir, toute l’histoire des hommes, et tout l’univers. Cet univers était le palais des merveilles et un labyrinthe. Dans cette profusion de richesses que prendre, dans ce dédale quelle voie choisir ? Pour le jeune être sur ce seuil, il ne s’agit pas seulement d’un savoir déjà constitué, disponible, à acquérir mais d’une expérience, pour laquelle nul ne peut se substituer à lui. Il lui faut découvrir par lui-même les sentiments et les rêves, les épreuves, les intuitions, les désirs, la conscience qui s’élargit, l’inconscient qui fait irruption …
Témoignages
Écrire et autres questions[Notice]
- Roland Bourneuf
Diffusion numérique : 6 juillet 2009
Un article de la revue Études littéraires
Volume 39, numéro 3, automne 2008, p. 163–167
Les voix intérieures
Tous droits réservés © Université Laval, 2008