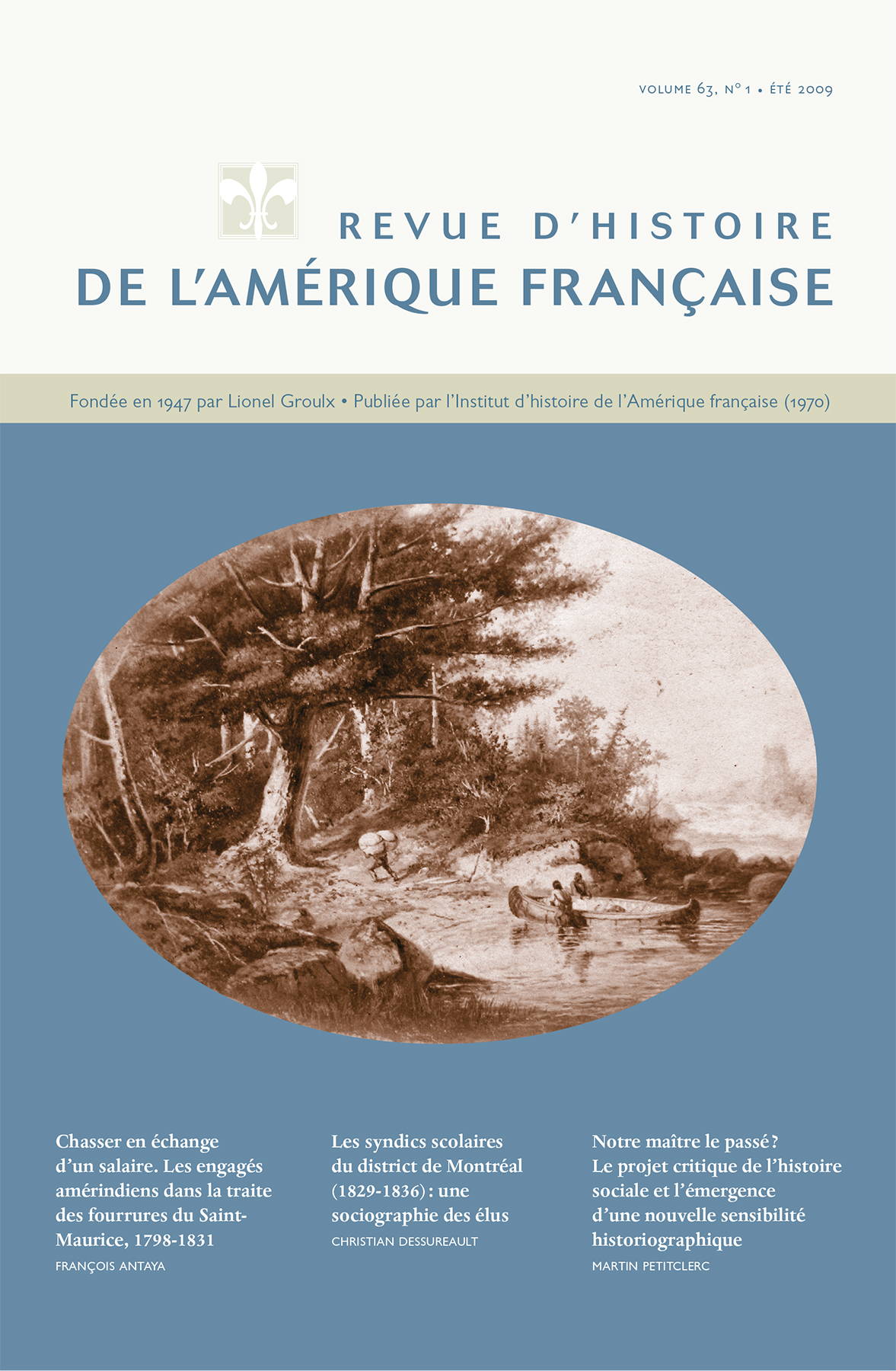Corps de l’article
Né avant la loi de décriminalisation du jeu (1969), j’ai de la difficulté à imaginer une société qui criminalise le 6/49. Le livre Casino State nous fait découvrir comment la légalisation du jeu au Canada fut un débat éthique quasi religieux et pourquoi les gouvernements provinciaux ont choisi de rapidement multiplier leurs revenus en optant pour une politique d’accessibilité au jeu. La thèse centrale du livre nous démontre que les gouvernements provinciaux tentent d’offrir un type de consommation à risque sans toutefois contrôler le risque d’une telle consommation.
Plusieurs questions importantes et intéressantes sont abordées dans ce livre. Faut-il accepter socialement le jeu ou bien le prohiber comme ce fut le cas avant 1969 ? La légalisation des vices devient-elle une arme administrative visant à combattre la criminalité ou sert-elle plutôt à l’accompagner dans ses activités criminelles ? Comment peut-on concilier une politique de réduction des méfaits envers les joueurs compulsifs tout en assurant un maintien, voire une hausse des revenus de l’État par des taxes indirectes comme le jeu ? Pourquoi les gouvernements provinciaux ont-ils sciemment suivi une politique néolibérale de baisse d’impôts depuis les vingt dernières années tout en multipliant par six les revenus du jeu ? Pourquoi les gouvernements préfèrent-ils suivre une politique d’accessibilité au jeu plutôt que d’élaborer une politique de raréfaction ? Dans quelle mesure les nouvelles technologies limitent-elles le rôle de l’État dans la législation sur le jeu ? Répondre à ces questions s’avère une tâche complexe que les auteurs relèvent avec brio, mais une question demeure : la légalisation du jeu par l’État favorise-t-elle ou non la criminalité ?
De 1992 à 2006, les revenus nets du jeu au Canada ont augmenté passant de 2,7 à 13,3 milliards, la plus importante croissance toutes industries confondues. Passant de 11 000 à 40 000 employés, l’industrie du jeu est devenue une source indispensable de revenus en plus de créer des milliers d’emplois. Bien que la légalisation du jeu semble devenue irréversible, les auteurs de Casino State nous présentent en quatre parties les différentes facettes de cette normalisation de ce qui était naguère considéré comme un vice.
Dans la partie initiale qui porte sur la moralité, le commerce et l’État, Ramp et Badgley nous expliquent que la culture morale du Canada anglais du début du xxe siècle a façonné la vie sociale et personnelle en définissant les frontières des politiques formelles et informelles qui régissent l’espace social légitime et illégitime du travail et du plaisir. À cette époque, le désir d’établir un capitalisme propre, dénudé de spéculation qui anime les forces chaotiques de la chance, représentait un rempart contre le désordre public. Le jeu fut donc considéré comme une utilisation irrationnelle, voire improductive, du capital. Pour ces auteurs, le mouvement de tempérance (alcool, drogue et jeu) visait à établir un monde où la richesse naturelle ne pouvait être pervertie par la spéculation qui dénature la valeur du travail. Le jeu constituait donc un capitalisme immoral qui laissait place à la déchéance sociale, au même titre que la prostitution, les drogues, l’alcool et la criminalité.
Dans le deuxième chapitre de cette première partie, Cosgrave mentionne que le mouvement de tempérance perdit beaucoup de son influence lorsque le jeu devint une pratique sociale acceptée présageant la levée de son interdiction. Cet auteur mentionne que la libéralisation du jeu s’avère un progrès social mais que les gouvernements doivent considérer les formes de régulations qui organisent le comportement des individus en relation avec le jeu. Aucun véritable débat sur la façon de légaliser le jeu n’a finalement permis aux autorités provinciales d’engouffrer des sommes énormes sans réflexion éthique.
La deuxième partie de l’ouvrage compare les politiques du jeu entre le Canada et l’Australie, pays qui n’a jamais interdit le jeu. Campbell souligne que si la décriminalisation des loteries et courses de chevaux (1969) et des machines à sous (1985) fut une décision fédérale, ce sont les provinces qui en ont fixé les règles. Certaines provinces ont carrément tenté d’occuper tout l’espace en gérant leurs propres casinos et machines vidéopoker. Celles qui ont préféré laisser l’industrie privée gérer les casinos moyennant redevances envers l’État arrivèrent sensiblement au même résultat. Ainsi, environ 5 % des joueurs compulsifs génèrent près de 40 % des revenus de machines à sous. Que ce soit le privé ou l’État, les résultats sont sensiblement les mêmes.
Dans l’analyse du cas de l’Australie, McMillen aborde les différentes approches gouvernementales des provinces australiennes qui visent davantage à éviter le jeu transprovincial et à limiter les pertes des joueurs compulsifs par des politiques de raréfaction des machines à sous.
La troisième partie examine les politiques gouvernementales du jeu qui ont opté pour l’accessibilité et la multiplication des sources de taxes indirectes et non sa raréfaction. Klassen et Cosgrave présentent la politique du NPD en Ontario sous Bob Rae qui visait à accroître les revenus du gouvernement en pleine récession. Les auteurs montrent que le clivage droite-gauche disparaît quand vient le temps de générer des revenus pour l’État. Le jeu n’est plus perçu comme un coût social mais comme un risque économique à gérer. Or, avec l’arrivée du jeu virtuel en ligne, les gouvernements ont de moins en moins la capacité de gérer le risque.
MacNeil affirme que la légalisation des machines à sous a accentué la dépendance au jeu compulsif en plus de doper les revenus des États. Il souligne que, parfois, les partis d’opposition demandent la réduction du jeu, tandis que ceux au pouvoir prônent le statu quo, voire le développement de cette source de revenu pour l’État. Que ce soit la multiplication des videopokers en Nouvelle-Écosse ou l’âpreté à engranger des profits de Loto-Québec, l’État est aussi devenu un joueur compulsif en quête de sous. Pourtant, l’auteur met en lumière le modèle Reno, une approche scientifique qui a montré qu’il est possible d’atténuer les effets pervers du jeu chez les joueurs. Le jeu peut, en effet, produire des effets bénéfiques pour la communauté (en extirpant la criminalité) et le coût du bénéfice peut surpasser les coûts sociaux du jeu compulsif.
La dernière partie du livre aborde l’aspect social du jeu. Ce chapitre nous apprend comment il est difficile d’établir des statistiques fiables pour relier jeu et crime organisé. Smith, Hartnagel et Wyne nous rappellent que les casinos attirent les criminels, petits et grands, car c’est un lieu où circule l’argent. Or les provinces n’ont pas toutes le mêmes critères quand il s’agit de définir un acte criminel directement relié au jeu, ce qui a pour résultat qu’il est très difficile d’établir des données fiables.
Nous touchons, ici, l’une des principales lacunes de ce livre. En effet, on ne fournit aucune donnée sur le montant des revenus provenant du crime organisé. Le blanchiment d’argent par les casinos de l’État demeure encore un sujet inexploré dans la criminologie. Des lois strictes ont été établies pour prévenir le crime organisé dans la sous-traitance du jeu, mais rien n’a été élaboré pour filtrer l’entrée d’argent sale au casino. Les auteurs soulignent que le jeu, notamment les casinos, génère son lot de criminalité directe et indirecte, en l’occurrence le prêt usurier, la contrefaçon, la fraude et le blanchiment d’argent. Soixante-huit pour cent des joueurs compulsifs avouent avoir commis un acte illégal pour soutenir leur dépendance. Parmi une quinzaine de crimes associés au jeu, le blanchiment d’argent reste un mystère puisque les auteurs n’osent pas proposer un pourcentage des recettes criminelles blanchies dans les casinos de l’État (notamment à Montréal et Vancouver, soulignent-ils). Les auteurs affirment que les criminels contournent assez facilement la loi qui exige une déclaration de toute transaction dépassant 10 000 $. L’étude examine la ville d’Edmonton et démontre que la plus grande part (63 %) des actes criminels reliés au jeu concerne la contrefaçon, suivie des fraudes reliées aux cartes de crédit. Quant au blanchiment d’argent, un membre du Edmonton Police Service veut qu’entre 15 % et 20 % des revenus du casino proviennent du crime organisé. Comme l’explique un administrateur d’un casino d’Edmonton : « les criminels viennent dépenser leur argent et non la blanchir » et les mafieux locaux sont acceptés dans leur établissement seulement s’ils se comportent adéquatement.
Derevensky, de son côté, nous explique que la jeunesse est particulièrement influençable et que peu de politiques cherchent à prévenir le jeu compulsif des jeunes. Miser de l’argent donne l’impression d’être adulte. La prévention semble être le meilleur remède mais l’acceptation sociale du jeu, sa grande accessibilité et sa glamorisation amenuisent ses effets et assurent la reprocduction d’une nouvelle génération de joueurs compulsifs.
Casino State est une importante contribution à la réflexion sur le rôle de l’État dans la gestion du vice. Il ressort de ces études que le jeu reste prisonnier d’une approche mitigée au Canada. Cette divergence d’opinion s’inscrit dans la lutte entre une vision collectiviste et paternaliste de la santé et une idéologie néolibérale axée sur les droits individuels et le laissez-faire économique. Pour certains, l’individu malade est responsable de sa personne, tandis que pour d’autres l’État et la loi ont le devoir de contrer le vice qu’est la dépendance au jeu. Casino State aborde cette question sans toutefois dicter la meilleure approche.