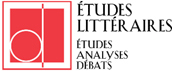Résumés
Résumé
En France, est-ce injurier quelqu’un que de taxer son propos d’antiaméricanisme ? Voilà la question à laquelle l’auteur de cette communication entend apporter quelques éléments de réponse en passant par une analyse de la pièce de théâtre La putain respectueuse et du tollé que ses premières représentations, en novembre 1946, soulevèrent dans la critique parisienne. L’étude amènera en outre l’auteur à se pencher sur le type particulièrement brutal de relation que, dans sa volonté d’engagement, le théâtre sartrien établit avec son public.
Abstract
In France, is it an offense to pretend someone’s comments are antiamerican ? This is the question the author of this paper intends to answer. To do so, he analyzes Jean-Paul Sartre’s play La putain respectueuse (The Respectful Prostitute) and the outcry started by its first representations in November 1946. The author also questions the particularly brutal kind of relationship Sartre’s theater, in its will to commitment, establishes with its audience.
Corps de l’article
Je les attends venir, ceux qui m’accuseront d’avoir écrit un livre antiaméricain. Qu’ils le disent et le redisent, pour mieux se trahir. Car s’ils le font, c’est que pour eux, l’Amérique se confond avec ses trusts, ses bigots et ses lyncheurs. Ils oublient que les nègres de Scottsboro sont Américains, eux aussi.
Vladimir Pozner[1]
En France, est-ce injurier quelqu’un que de taxer son propos d’antiaméricanisme ? Il ne fait en tout cas aucun doute que, de nos jours, de nombreux protecteurs autoproclamés de l’Oncle Sam donnent volontiers aux termes « antiaméricain » et « antiaméricanisme » une connotation infamante. On s’en convaincra en (re)lisant American Vertigo, le plus récent livre de Bernard-Henri Lévy, où, afin de défendre un point de vue prétendument objectif sur les États-Uunis, tout en se donnant à lui-même des airs de philosophe tocquevillien qui résiste à la tyrannie de la majorité, l’auteur ne cesse de stigmatiser la masse de ses « concitoyens pavlovisés[2] » qu’il nomme, exemple entre cent, les « anti-américains monomaniaques et furieux[3] ».
Pourfendre les pourfendeurs des États-Unis : voilà, pour le doxographe contemporain, une manière aisée de se ranger derrière les détenteurs du pouvoir en place, tout en prétendant aller courageusement à rebours d’une opinion publique emportée par la haine. L’invective « antiaméricain » offre, en outre, un double avantage à celui qui la profère : 1) elle lui permet de disqualifier l’adversaire idéologique, celui qui critique un aspect des États-Unis, sans avoir à tenir compte de ses raisons ou de ses arguments, qui sont présentés comme les simples exutoires d’une rancoeur peu avouable ; 2) elle lui donne la possibilité de prendre l’autre à partie violemment tout en se présentant soi-même, non pas comme un agresseur, mais comme le noble et désintéressé défenseur d’une tierce partie, l’Amérique, injustement bafouée.
Contrairement aux apparences, cette marque ostentatoire de fausse abnégation, auréolée d’un pseudo-non-conformisme intellectuel, aujourd’hui popularisée par Bernard-Henry Lévy et consorts, n’offre rien de bien original lorsqu’elle est replacée dans l’histoire des discours français sur les États-Unis. À l’aube de la guerre froide, de belles âmes s’étaient déjà portées, contre de supposés tyrans antiaméricains de l’opinion, à la défense de la démocratie héroïque qui avait libéré la France du joug nazi quelques années plus tôt. Leurs voix s’étaient entre autres élevées contre un dramaturge immensément populaire qui avait caricaturé le Sud américain. À partir du 8 novembre 1946, La putain respectueuse, présentée au Théâtre Antoine en complément de Morts sans sépulture, est l’objet d’une vive polémique. S’il faut en croire les comptes rendus dont nous disposons, les premières représentations ont soulevé des protestations, lesquelles dégénérèrent à quelques reprises en bagarre entre les spectateurs. Jean-Paul Sartre, l’auteur, à qui on avait déjà reproché ses oeuvres scatologiques, sa philosophie pessimiste et son mode de vie scandaleux, est désormais affligé d’une nouvelle tare : une haine radicale, irrationnelle et injustifiée à l’endroit des États-Unis. Pierre-Aimé Touchard dénonce, dans Le Parisien libéré du 11 novembre et dans Opéra deux jours plus tard, « un réquisitoire si brutalement agressif » et dit regretter « cette intrusion de la démagogie dans l’art[4] ». Yves Krier, journaliste à Paris-Matin, se fend le 13 novembre d’une exclamation indignée : « Comme c’est facile d’être courageux au détriment des Américains[5] ! » Thierry Maulnier parle de son côté, dans le Spectateur du 19 novembre, de la « gêne presque intolérable » que produit « cette pièce où, deux ans après la Libération de Paris, des Américains nous sont montrés avec le visage de la férocité, de l’imposture, de l’hypocrisie les plus répugnantes ». Le chroniqueur poursuit en assurant que si un soldat des États-Unis avait été dans la salle, il n’aurait « pas osé le regarder[6] ». Le conseiller municipal Édouard Frédéric-Dupont va jusqu’à interpeller le préfet de police, dans le Figaro du 21 novembre 1946, en lui demandant d’interdire cette « pièce qui constitu[e] une grossière diffamation à l’encontre de la grande Démocratie américaine à laquelle Paris porte une si grande reconnaissance pour la part glorieuse qu’elle a prise à sa Libération[7] ».
S’il ne réagit habituellement pas aux insultes nombreuses et, en général, assez colorées (« hyène à stylographe », « agité du bocal ») qui lui viennent en ces années tant de la droite que de la gauche, Sartre prend cette fois la peine de se défendre. Le 20 novembre 1946, l’édition européenne du New York Herald Tribune publie « A Letter from M. Sartre ». L’auteur de La putain respectueuse entend corriger le contresens commis, selon lui, par un lecteur du journal qui avait la semaine précédente été irrité par l’antiaméricanisme allégué de la pièce : « Je ne suis pas antiaméricain et je ne comprends pas ce que “antiaméricain” veut dire[8]. » Afin de contrer ceux qui lui reprochent de haïr les États-Unis, Sartre cherche à démontrer que le qualificatif « antiaméricain » est littéralement insignifiant, et que, par le fait même, il ne saurait être appliqué à sa personne ou à son oeuvre :
On peut arriver à une opinion simple et absolue en ce qui concerne un pays totalitaire, et dire que l’on est antinazi ou antifasciste, prosoviétique ou antisoviétique. Mais les États-Unis ne sont pas, et n’ont nullement le désir de constituer un tout. On trouve là-bas des institutions, des façons de penser et des façons de vivre qui sont excellentes et d’autres qui ne sont pas tout à fait aussi bonnes[9].
Deux ans plus tard, en 1948, la traduction américaine de La putain respectueuse (The Respectful Prostitute) est accompagnée d’une préface où, après être revenu à la charge sur l’insignifiance du terme « antiaméricain » et sur l’erreur que commettent ceux qui y recourent, Sartre entend définir lui-même ses intentions, sa personne et sa pièce à l’aide de l’épithète « antiraciste » qui s’accorde, celle-là, avec son éthique de l’engagement :
Quand j’ai fait représenter cette pièce, on a dit que j’avais montré bien peu de reconnaissance envers l’hospitalité américaine. On a dit que j’étais anti-américain. Je ne le suis pas. Je ne sais même pas ce que ce mot signifie. Je suis antiraciste car je sais ce que le racisme, lui, signifie. Mes amis américains — tous ceux que j’ai aimés parmi ceux qui m’ont reçu — sont également antiracistes. Aussi je suis sûr que je n’ai rien écrit qui leur déplaise ou qui me révèle comme ingrat envers eux[10].
En s’employant à disqualifier simultanément l’idée d’« antiaméricanisme » et ceux qui s’en servent, tout en cherchant à remettre en circulation une image valorisante de sa personne et de sa pièce au travers d’une profession de foi antiraciste, Sartre montre que le bât blesse lorsque l’on critique son rapport aux États-Unis Tout se passe comme si les attaques essuyées sur le front de l’antiaméricanisme le représentaient d’une façon trop déshonorante pour être simplement ignorées. Et c’est là le propre de l’insulte qui porte : elle dégrade l’éthos de son destinataire, ce qui le force à réagir.
Mais pour quelles raisons l’accusation de haine à l’endroit des États-Unis est-elle à ce point avilissante ? D’après Philippe Roger, l’antiaméricanisme français fonctionnerait grâce à l’accumulation progressive, puis à la reprise et à l’adaptation constante de traits caricaturaux que les Français croiraient constitutifs de la population des États-Unis. L’antiaméricanisme français serait, à l’image de la prose antisémite, un discours autarcique au service d’une passion délirante. Se retrouvant — et sévissant — à tous les degrés de l’échelle sociale, dans les formations politiques et idéologiques en apparence les plus opposées, la fortune de ce discours s’expliquerait essentiellement par le ressentiment largement éprouvé au sein d’une nation qui assiste depuis deux siècles à l’émergence, puis au triomphe d’une nouvelle puissance — les États-Unis — au moment où elle-même perd progressivement son influence militaire, politique, économique, culturelle et artistique sur le plan international. L’antiaméricanisme serait à cet égard, pour reprendre les termes ouvertement offensants de Roger, « un discours à la fois réactif et résigné, un discours de vaincus d’avance, de déj’-colonisés [sic]. La haine de l’Amérique s’y nourrit d’un violent mépris de soi-même[11] ». Crier à l’antiaméricanisme, comme Roger le fait à répétition tout au long des 600 pages de L’ennemi américain, et comme l’avaient fait auparavant Thierry Maulnier et consorts au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c’est d’abord chercher à insulter l’adversaire présumé des États-Unis en le traitant d’insulteur patenté. Mais c’est aussi — et surtout — l’accuser de se laisser emporter par une forme particulière de xénophobie. Dire d’une pièce comme La putain respectueuse qu’elle est antiaméricaine, c’est faire de son auteur un être faible, déraisonnable et maladivement violent qui aliène sa lucidité au profit d’un ressentiment revanchard. Dans leur ensemble, ces traits sont à l’exact opposé de la figure de l’intellectuel engagé que Sartre théorise et dont il se fait le principal porte-étendard au sortir de la guerre. Voir dans sa pièce la manifestation d’une exécration viscérale à l’égard des États-Unis, ce n’est pas seulement s’en prendre à l’image publique de l’auteur, c’est aussi rabattre l’essentiel de son projet philosophique, littéraire et politique du côté de la propagande haineuse, ce qui apparente ce projet au choix existentiel de l’antisémite. Quand on connaît les portraits impitoyables de la passion antijuive que Sartre a proposés notamment dans « L’enfance d’un chef » (1939), « Drieu La Rochelle ou la haine de soi » (1943) et Réflexions sur la question juive (1946)[12], on comprend aisément qu’il n’ait pas voulu se laisser accoler pareille étiquette.
Reste à se demander ce qui en est exactement de La putain respectueuse. Au cours de la polémique de 1946, la pièce ne fut analysée ni par ses détracteurs dans leurs attaques ni par l’auteur dans sa défense. Sur le plan idéologique, cette oeuvre se caractérise-t-elle ou non par « l’antiaméricanisme » ? Peut-on considérer qu’elle constitue, en elle-même, un acte de violence verbale dirigé contre les États-Unis ?
Chose certaine, l’histoire représentée ne donne pas une image fort réjouissante de la société américaine. Lizzie MacKay, une prostituée new-yorkaise fraîchement débarquée dans une ville du Sud, est manipulée par le sénateur Clarke et son fils Fred : les deux hommes la poussent à lancer une fausse accusation de viol contre un vieil homme noir qui ne l’a pas même touchée. La pièce caricature au passage l’anticommunisme, l’antisyndicalisme et le puritanisme américains ; elle moque dans les premières scènes l’amour obsessionnel que la femme américaine est censée éprouver pour la propreté et les appareils électroménagers ; mais sa charge satirique porte principalement sur le problème racial étatsunien. La putain respectueuse montre une population blanche du Sud qui communie dans la haine sanguinaire du Noir. Tandis que l’action scénique, divisée en deux tableaux, se déroule entièrement dans la chambre de Lizzie, les rues de la ville (hors scène) sont le terrain d’une « chasse au nègre » dont la violence culmine au moment où un homme de couleur, n’ayant strictement rien à voir avec la putain et son faux témoignage, est capturé par la foule, pendu, brûlé et criblé de balles[13]. Pendant ce temps, les Blancs qui prennent la parole sur la scène alignent une série de déclarations au racisme outrancier et se font, comme le dit le sénateur, les représentants de la « ville tout entière, avec ses pasteurs et ses curés, avec ses médecins, ses avocats et ses artistes, avec son maire et ses adjoints et ses associations de bienfaisance[14] ». Recourant constamment à la première personne du pluriel et au pronom personnel indéfini « on », ce qui lui permet d’étendre son propre point de vue à celui de la ville, voire à celui du Sud américain, Fred explique par exemple à Lizzie que relever les jupes d’une putain, tuer un nègre, « ce sont des gestes qu’on a sans y penser, ça ne compte pas[15] ».
Au-delà des anciens États confédérés, la pièce écorche l’ensemble de l’Union par l’entremise de ses personnages « américains à 100%[16] » et de leurs déclarations grotesques : tour à tour, les deux Clarke se prétendent les porte-parole du pays tout entier. Dans la dernière scène du premier tableau, le sénateur convainc Lizzie de signer son faux témoignage après avoir parodié (et dégradé) la prosopopée des Lois du Criton, en prêtant sa voix et sa personne à une représentation allégorique des États-Unis :
Le Sénateur : Je parle en son nom [l’Amérique]. (Il reprend.) « Lizzie, ce nègre que tu protèges, à quoi sert-il ? Il est né au hasard, Dieu sait où. Je l’ai nourri et lui, que fait-il pour moi en retour ? Rien du tout, il traîne, il chaparde, il chante, il s’achète des complets rose et vert. C’est mon fils et je l’aime à l’égal de mes autres fils. Mais je te le demande : est-ce qu’il mène une vie d’homme ? Je ne m’apercevrai même pas de sa mort. »[17]
Dans la dernière scène de la pièce, Fred parvient ensuite à s’attacher définitivement les complaisances de la putain grâce à un récit le présentant comme le descendant d’une famille qui a bâti les États-Unis et qui, pour cette raison, exerce un droit de propriété sur le pays :
Fred […] : Le premier Clarke a défriché toute une forêt à lui seul ; il a tué seize Indiens de sa main avant de périr dans une embuscade ; son fils a bâti presque toute cette ville ; il tutoyait Washington et il est mort à Yorktown, pour l’indépendance des États-Unis ; mon arrière-grand-père était chef des Vigilants, à San Francisco, il a sauvé vingt-deux personnes pendant le grand incendie ; mon grand-père est revenu s’établir ici, il a fait creuser le canal du Mississippi et il a été gouverneur de l’État. Mon père est sénateur ; je serai sénateur après lui : je suis son seul héritier mâle et le dernier de mon nom. Nous avons fait ce pays et son histoire est la nôtre. Il y a eu des Clarke en Alaska, aux Philippines, dans le Nouveau-Mexique[18].
Les seuls personnages de la pièce qui pourraient contester cette prétention hégémonique, la New-Yorkaise Lizzie et le « Nègre[19] » faussement accusé de viol, contribuent, au contraire, tous les deux, à démontrer que les Clarke parviennent à imposer leur vision des États-Unis, et leur suprématie, aux individus socialement défavorisés. Grâce à leurs discours, la mainmise que les notables sudistes exercent sur le pays et son histoire passe pour justice, tandis que leur idéologie a force de vérité. Si Lizzie résiste d’abord en refusant de signer un faux témoignage, c’est uniquement par amour pour une série de principes abstraits (honnêteté, vérité, justice), et non parce qu’elle s’opposerait à l’oppression que les Blancs exercent sur les Noirs. Au contraire, la putain, qui poursuit pour son propre compte un idéal de stabilité, d’aisance et de bienséance bourgeoises, est prédisposée à partager les goûts et les dégoûts qui permettent à la classe dominante de se distinguer et d’asseoir son autorité. Se montrant pour le moins aussi raciste que les Blancs du Sud, elle exprime à plusieurs reprises la répugnance que lui inspire le Nègre avant d’en venir, même si elle sait qu’il n’a pas commis le crime dont on l’accuse, à se laisser contaminer par la haine ambiante et à se demander si, comme tout le monde le lui répète, les Noirs ne sont pas d’emblée et toujours coupables : « Il faut tout de même que tu sois un drôle de paroissien pour avoir toute une ville après toi. […] Ils disent qu’un nègre a toujours fait quelque chose. […] Tout de même, une ville entière, ça ne peut pas avoir complètement tort[20]. » De son côté, le Nègre est à ce point aliéné qu’il adopte lui aussi un point de vue raciste à l’égard de sa propre personne, à laquelle il n’accorde pas la même valeur qu’à celle de ses bourreaux. Convaincu de son infériorité, il dit à Lizzie, dans le second tableau, qu’il ne peut pas se défendre et « tirer sur des Blancs » pour la seule et unique raison que ce « sont des Blancs[21] ». Difficile de ne pas en conclure que, dans la société américaine dépeinte par la pièce de Sartre, « tout le monde est d’accord[22] », comme la prostituée le remarque au cours d’un moment de désabusement lucide.
Le tableau peut certes paraître d’une noirceur et d’une simplicité excessives. Il ne peut cependant pas, pour cette seule raison, être considéré comme la marque d’une passion antiaméricaine qui serait spécifique à Sartre ou à la France de l’après-guerre. Les atrocités commises contre les Noirs du Sud par la population blanche ont d’abord été mises en circulation, et mises à la mode, par une série de romans américains traduits en français qui furent immensément populaires dès les années 1930, et encore davantage après la Seconde Guerre mondiale. Light in August (1932), l’oeuvre faulknérienne préférée de Sartre, retrace les circonstances qui ont conduit à l’émasculation du Nègre Joe Christmas par une foule en colère. Black Boy (1945), le roman autobiographique de Richard Wright qui inspira quelques-unes des thèses les plus fécondes de Qu’est-ce que la littérature ?, décrit en détail « la mort blanche, ce fléau dont la menace était suspendue au-dessus de la tête de chaque mâle noir vivant dans le Sud[23] ». Trouble in July (1945), d’Erskine Preston Caldwell, raconte de son côté l’histoire d’une chasse au nègre lancée contre un adolescent faussement accusé d’avoir violé une jeune Blanche. En dehors de la littérature proprement dite, l’affaire connue sous le nom de « Scottsboro case », dans laquelle deux Blanches ont été forcées à lancer une fausse accusation de viol contre neuf jeunes Noirs, avait connu un retentissement international à la fin des années 1930 avant d’être racontée par l’écrivain communiste Vladimir Pozner dans Les États-désunis (1938), récit de voyage romancé qui inspira à Sartre le sujet de sa pièce[24]. Après la guerre, les actualités en provenance des États-Unis rapportent, aux côtés des lynchages qui se produisent toujours régulièrement au sud de la ligne Mason-Dixon, les sorties racistes du sénateur Theodor Gilmore Bilbo[25].
La putain respectueuse prend place dans un état du discours social français où les États-Unis et leurs problèmes raciaux sont les sujets à la fois d’une attention constante et de scandales répétés. Sur scène, une mode de « pièces américaines tirées de romans célèbres dura plusieurs années[26] ». Dans son étude de la représentation du Noir au théâtre depuis la Renaissance, Sylvie Chalaye souligne que, pour la première fois à partir de 1945, « le nègre, pour les Français, n’est plus seulement un Africain ou un Antillais, c’est aussi un Américain victime, en raison de sa couleur, de la ségrégation raciale et des lynchages[27] ». Lorsque Des souris et des hommes est monté, en novembre 1946, Pierre Berge, critique de Paris-Presse, se plaint que, dans la salle, le « Café de Flore était au grand complet, les émules de Sartre et quelques néo-surréalisants communiaient visiblement dans un amour immodéré pour le “genre américain”[28] ». En mars 1947, l’adaptation théâtrale du roman de Caldwell La route du tabac suscite une polémique en raison du traitement cru qu’elle réserve à la sexualité et de l’image barbare qu’elle donne des sudistes[29]. Le tollé le plus mémorable fut toutefois soulevé, non par une pièce, mais par J’irai cracher sur vos tombes (1946), faux roman américain de Vernon Sullivan, alias Boris Vian, qui raconte comment Lee Anderson, un « Nègre blanc », venge son frère « noir ébène » en abusant de jeunes filles de bonne famille, avant d’être lynché. En avril 1948, l’oeuvre sera adaptée pour la scène et montée au Théâtre Verlaine où elle continuera à susciter une certaine indignation sans remporter de véritable succès auprès du public ou de la critique.
Cette multiplication de querelles autour des représentations et des discours qui prennent le Sud des États-Unis pour thème montre que, dans la France de l’immédiat après-guerre, parler de l’Amérique et de ses problèmes raciaux, ce n’est pas seulement, ni même principalement, une façon ingrate d’agresser les libérateurs d’hier. Pas plus J’irai cracher sur vos tombes que La putain respectueuse n’est a priori destiné à un public américain qu’il s’agirait d’insulter. Écrites en français, publiées ou montées à Paris, ces oeuvres choquent d’abord une partie du public hexagonal à qui elles s’adressent. Si les critiques français prétendent parler au nom des Américains, comme Thierry Maulnier imaginant un éventuel soldat des États-Unis dans le public de La putain respectueuse, ils ne viennent pas pour autant au secours d’une victime étrangère qui serait injustement outragée. Nul autre qu’eux (et qu’une partie de leurs lecteurs) ne ressent cette pièce comme une offense, à laquelle ils réagissent exclusivement pour leur propre compte, quoi qu’ils en disent. Ce n’est que latéralement, dans le cas où quelques Américains bilingues en prennent connaissance, ou plus tard, au moment où elles sont traduites en anglais, que ces mises en scène françaises des États-Unis provoquent, dans la critique américaine, des échos qui, habituellement, sont beaucoup moins virulents que ceux de la critique parisienne. Pour Boris Vian, Jean-Paul Sartre et leurs contemporains, dresser un portrait critique de la « grande démocratie amie » est en fait une manière détournée de prendre position sur des enjeux sociaux et politiques sensibles qui touchent directement les Français. La violence des réactions suscitées par leurs oeuvres montre à quel point le procédé fut efficace.
Dans le cas de La putain respectueuse, le public virtuel ciblé par la pièce est d’autant plus français que les codes théâtraux mobilisés s’inscrivent dans une tradition dramaturgique spécifiquement hexagonale. Pascal Ayoun a démontré que, dans l’ensemble de ses pièces, Sartre use, plus ou moins explicitement selon les cas, d’une série de procédés propres au théâtre de boulevard, « ce genre à la fois populaire et parisien[30] ». Loin de faire exception, La putain respectueuse, que Sartre tenait pour une comédie bouffe[31], est sans doute celle de ses pièces où cette influence est la plus significative. Sans prétendre analyser en détail les fonctions socio-idéologiques que remplissent tous les aspects boulevardiers et vaudevillesques de la pièce, entreprise excédant les dimensions et les ambitions de la présente étude, il faudra se contenter ici de signaler les principales caractéristiques de La putain respectueuse qui sont aussi des éléments constitutifs de la tradition où triomphèrent Scribe, Labiche, Courteline, Feydeau, Guitry et tant d’autres. En effet, la pièce met en scène un intérieur bourgeois[32] ; l’organisation de l’espace scénique, avec un grand rideau et la porte d’un cabinet de toilette derrière lesquels les personnages peuvent se dissimuler, favorise les jeux de cache-cache, les tromperies, ainsi que les rencontres fortuites produisant coups de théâtre et retournements de situation ; l’histoire présente des problèmes à caractère privé qui se déploient autour d’une relation triangulaire (Lizzie — les Clarke — le Nègre) ; la passion et le sexe hors mariage (entre Fred et Lizzie), qui jouent un rôle prédominant dans la progression de l’intrigue et sa résolution, menacent dans un premier temps les cadres de la société bourgeoise, mais sont finalement institutionnalisés ; les personnages se définissent presque exclusivement par leur position et leur fonction sociales ; la caricature tend à l’emporter sur le vraisemblable, faisant constamment osciller la pièce entre réalisme et absurde ; le tempo des échanges est rapide, sans temps morts ; les quiproquos abondent, notamment entre Lizzie et le sénateur[33], de même que les tics cocasses et les « scies[34] ». Voilà qui forme un cadre d’intelligibilité, moins familier à l’habitué de Broadway qu’à celui des salles de la rive droite, utilisé par Sartre avec une habilité quasiment perverse pour (se) jouer des attentes, des habitudes et de l’idéologie de ses concitoyens. Par son propos étatsunien, en abordant la question de l’oppression raciste sur le ton du divertissement populaire et apparemment inoffensif, Sartre critique sans aucun doute les injustices qui sévissent outre-Atlantique, mais il vise d’abord ceux qui, chez lui, ont l’habitude d’aller au théâtre pour communier, et rire, dans la bonne conscience satisfaite, le partage des mêmes bienséances et l’amour de l’ordre établi. Car, alors que le véritable théâtre de boulevard diffuse « les valeurs de la bourgeoisie, [qu’]il fonde l’identité de la classe dominante et [qu’il] cimente l’ordre social[35] », Sartre, de son côté, « met le boulevard à distance. Il ne l’introduit que pour le repousser et, ainsi, “déranger” le spectateur[36] ».
À côté de la dramaturgie proprement dite, le niveau de langage des personnages et les termes qu’ils utilisent renvoient eux aussi à des types parisiens. On retrouve bien, ici et là, avec la mention d’un breakfast ou l’échange de quelques « Hello ![37] », certains vocables qui donnent un vernis d’américanité aux dialogues. Toutefois, Fred évoque moins le riche sudiste qu’un paradoxal mélange de bourgeois Second Empire et de jeune dessalé à la mode existentialiste lorsqu’il emploie des expressions ou des mots tels que « Je me marrais », « Tiens-toi tranquille ou je te fais boucler », « Dame », « roulure » et « môme[38] ». De son côté, Lizzie « cause[39] » du début à la fin de la pièce comme une grue de Montparnasse ou de Pigalle, avec ses « tire-toi », « Jamais je ne donnerai un homme aux poulets », « les flics », « Ça vous la coupe ? », « J’ai […] besoin de fric », « Si tu avances, je te bute[40] », etc.
Le côté boulevardier de la pièce joint à l’argotisme parigot de certaines répliques incite le spectateur ou le lecteur à établir des correspondances entre les personnages étatsuniens de la pièce et les principales classes sociales qui structurent la société française. Située entre les dominants (les Clarke) et la masse la plus radicalement opprimée (les Nègres), Lizzie occupe, comme l’a remarqué Benoît Denis, une position ambivalente, similaire à celle de la petite bourgeoisie française, à la fois victime et oppresseur, mystifiée par un ordre aliénant auquel elle acquiesce sans pouvoir s’en libérer[41]. Le Nègre pourrait de son côté renvoyer soit à l’Africain colonisé, soit au prolétaire écrasé par l’ordre capitaliste[42]. À l’autre bout de l’échelle sociale, les Clarke s’identifient clairement eux-mêmes comme les dignes représentants de la catégorie des « chefs » et des « hommes d’expérience ». Dorothy McCall a relevé d’importantes ressemblances entre Fred et Lucien Fleurier, le personnage central de la nouvelle « L’enfance d’un chef », qui se donne une personnalité et une place dans le monde en optant pour l’antisémitisme, l’Action française, le mariage bourgeois et la direction d’entreprise[43]. De la même manière, il serait possible de montrer que le sénateur adopte une position idéologique en tous points similaire à celle d’Olivier Blévigne, du docteur Rogé et de tous les autres « Salauds » qu’Antoine Roquentin éreinte dans La nausée. La putain respectueuse a beau situer son intrigue aux États-Unis, le type de relation de domination qu’elle critique n’a rien de spécifiquement étatsunien, bien au contraire.
Le rapport de domination qui s’établit entre Lizzie et les Clarke repose moins sur une inégalité du pouvoir financier ou du capital social et politique que sur la supériorité manifeste du talent oratoire dont jouissent les seconds. Alors que les pots-de-vin proposés et les menaces d’emprisonnement n’ébranlent pas Lizzie dans son refus de témoigner contre le Nègre, ce sont l’éloquence du sénateur, puis celle de Fred qui parviennent successivement à la faire fléchir. D’après Robert Lorris, il y a toujours, dans le théâtre sartrien, un personnage secondaire qui « aide le héros à trouver sa vérité et dans les scènes de débats lui fournit l’occasion de s’exprimer[44] ». C’est exactement le contraire qui se produit ici : le sénateur et son fils sont des sophistes qui utilisent leur talent de rhétoricien et de discoureur à des fins mystificatrices. Leur art de la parole et leur prestance leur permettent de neutraliser, chez celle à qui ils s’adressent, toute velléité de (se) choisir librement une éthique et une ligne de conduite. Après avoir été amenée à signer le faux témoignage, Lizzie se rend elle-même compte qu’elle a été dépossédée de ses repères : « Je ne m’y reconnais plus ; vous [le sénateur] m’avez embrouillée ; vous pensez trop vite pour moi[45] ». Avant la fin de la pièce, cette vague conscience de son aliénation sera elle-même emportée. Au terme du second tableau, Lizzie ne prendra plus la parole, n’exprimera plus aucun point de vue qui lui soit propre, se contentant de répondre à la question « C’est vrai que je t’ai donné du plaisir ? » par un ultime assentiment, dépourvu de la moindre réserve : « Oui, c’est vrai ». Les didascalies (ou les mouvements de l’actrice) auront auparavant indiqué au lecteur (ou au spectateur) qu’elle s’est livrée à Fred, lequel la conduit, par le seul pouvoir de ses paroles, à devenir, non pas sa maîtresse, mais son esclave :
Je t’installerai sur la colline, de l’autre côté de la rivière, dans une belle maison avec un parc. Tu te promèneras dans le parc, mais je te défends de sortir : je suis très jaloux. Je viendrai te voir trois fois par semaine, à la nuit tombée : le mardi, le jeudi et pour le week-end. Tu auras des domestiques nègres et plus d’argent que tu n’en as jamais rêvé, mais il faudra me passer tous mes caprices. Et j’en aurai ! (Elle s’abandonne un peu plus dans ses bras)[46].
Trois mois après la première de La putain respectueuse, Sartre critiquait dans « Pour qui écrit-on ?[47] » la relation hiérarchique que, depuis le XIXe siècle, la littérature établit entre l’écrivain et son public. Au-delà de leur misogynie manifeste, les termes employés ne sont pas sans rappeler la malléabilité de Lizzie devant les discours du sénateur et de son fils :
Aujourd’hui le public est, par rapport à l’écrivain, en état de passivité : il attend qu’on lui impose des idées ou une forme d’art nouvelle. Il est la masse inerte dans laquelle l’idée va prendre corps. [… L]e rapport de l’auteur au lecteur est analogue à celui du mâle à la femelle : c’est que la lecture est devenue un simple moyen d’information et l’écriture un moyen très général de communication[48].
S’il est vrai, comme le théoricien de l’engagement l’a soutenu à la même époque, que les dramaturges français d’après-guerre entendent « projeter au public une image agrandie et enrichie de ses propres souffrances[49] », il apparaît que, à travers sa charge antiraciste (dirait Sartre) ou antiaméricaine (diraient ses détracteurs), La putain respectueuse s’attaque d’une façon détournée, mais d’autant plus acerbe, à la déférence servile pour les doxographes dans laquelle tendent à se complaire les lecteurs (ou les spectateurs) d’après-guerre. Tandis que la pièce présente les premiers comme des salauds intégraux qui assoient leur pouvoir en se donnant pour les seuls gardiens légitimes des grands principes, de l’ordre social et de la vérité, les seconds prennent de leur côté l’allure d’une putain mystifiée ne demandant qu’à jouir de sa soumission. Que celui à qui elle s’adresse soit un écrivain professionnel ou un simple amateur des belles-lettres, la représentation sartrienne lui renvoie une image ignominieuse de lui-même, de sa société et de sa culture. Ne lui laissant aucune échappatoire possible, elle lui interdit d’adopter, et sur l’action scénique, et sur sa propre situation, quelque point de vue moralement confortable que ce soit.
Dans un récent article où il analyse en détail les principaux procédés de la dramaturgie sartrienne, Jean-François Louette a bien vu, et démontré, que, dans son ensemble, ce théâtre « cherche à inventer une relation aux spectateurs fondée sur une certaine brutalité, une certaine gêne[50] ». Le cri à l’antiaméricanisme poussé par Thierry Maulnier et ses semblables à la suite des premières représentations de La putain respectueuse peut être compris comme une réaction à cette brutalité, à cette gêne qui fondent la relation aux spectateurs inventée par le théâtre sartrien. Se porter à la défense d’une Amérique injustement raillée fut pour eux une manière de restreindre le sens de la pièce afin de ne pas (ou de ne plus) apparaître comme ses cibles premières, tout en contre-attaquant, insultant à leur tour celui qui les avait d’abord insultés.
L’exemple de La putain respectueuse montre que l’oeuvre dramatique de Sartre peut être associée à un théâtre de l’invective et de l’outrage. Il ne s’agit pas chez lui d’interpeller directement le public pour l’offenser, ni même de franchir — ne serait-ce que sporadiquement — le mur imaginaire séparant l’action scénique de la salle, comme l’a prôné un important courant du théâtre expérimental au XXe siècle. Préférant détourner à son profit les codes traditionnels de la représentation théâtrale plutôt que les briser ou que les distancier à la manière brechtienne — ce qui a incité une partie de la critique à reprocher son manque de modernité à la dramaturgie existentialiste[51] —, Sartre utilise l’allégorie et la caricature pour renvoyer à son public une image intolérable de lui-même qui devrait non seulement l’acculer à la mauvaise conscience, mais aussi, idéalement, l’inciter à vouloir transformer à la fois sa propre personne et sa situation. Cette façon particulière d’attaquer les spectateurs permet à l’auteur de surmonter l’une des ambiguïtés majeures de son théâtre, qui est également l’une de ses plus grandes forces. Avec La putain respectueuse, comme avec plusieurs autres de ses pièces, Sartre s’en prend à la fascination que les hommes de pouvoir de tout acabit (littérateurs, politiciens, militaires, chefs religieux, capitaines d’industrie) exercent par la parole sur leurs interlocuteurs. Mais il le fait dans une forme de communication qui suppose, en elle-même, la captation et l’envoûtement d’un public[52]. Vilipender ce public, le bousculer en caricaturant certains de ses penchants, offre au chantre de la liberté, de la responsabilité et de la lucidité individuelles une manière de faire passer son point de vue philosophique, politique et esthétique sans devoir pour autant renoncer entièrement à la littérature et au rapport de séduction qu’elle implique toujours d’une manière ou d’une autre. Sartre l’avait lui-même compris : la violence des réactions suscitées par son théâtre lui prouvait que ses pièces « touch[aient] le public là où il importe qu’il soit touché[53] ». À en juger par l’indignation que suscita La putain respectueuse, cette pièce trop souvent tenue pour mineure devrait plutôt être considérée comme l’un des modèles de la littérature engagée d’après-guerre.
Parties annexes
Note biographique
Yan Hamel
Yan Hamel est professeur substitut à la Télé-université de l’Université du Québec à Montréal. Il a publié récemment son premier livre, La bataille des mémoires. La Seconde Guerre mondiale et le roman français, aux Presses de l’Université de Montréal dans la collection Socius. On lui doit également plusieurs ouvrages collectifs : Portrait de l’homme de lettres en héros (@nalyses, 2006), Des mots et des muscles ! Représentations des pratiques sportives (Québec, Éditions Nota bene, 2005), Victor Hugo 2003-1802. Images et transfigurations (Montréal, Éditions Fides, 2003). Le projet de recherche qu’il poursuit actuellement, et dans le cadre duquel il a déjà publié une série d’articles, s’intitule « Sartre et l’Amérique : romans, essais, théâtre ».
Notes
-
[1]
Vladimir Pozner, Les États-désunis, 1948, p. 11.
-
[2]
Bernard-Henri Lévy, American Vertigo, 2006, p. 213.
-
[3]
Ibid., p. 412. L’imagination de Bernard-Henry Lévy en la matière est remarquablement féconde. Dans American Vertigo, les « ennemis de l’Amérique », jamais clairement identifiés, sont également appelés les « automates déréglés », les « pourfendeurs du Yankee way of life », « les anti-américains pavlovisés », « les anti-Sudistes pavlovisés », l’« internationale terroriste » et les « djihadistes ». La liste n’est pas exhaustive.
-
[4]
Cité par Geneviève Latour, Théâtre, reflet de la IVe République. Événements, politique, société, idées…, 1995, p. 21.
-
[5]
Id.
-
[6]
Cité dans Jean-Paul Sartre, Théâtre complet, 2005, p. 1364-1365.
-
[7]
Cité par Geneviève Latour, Théâtre, reflet de la IVe République, op. cit., p. 21.
-
[8]
Cité par Michel Contat et Michel Rybalka, Les écrits de Sartre. Chronologie, bibliographie commentée, 1970, p. 137.
-
[9]
Cité dans Jean-Paul Sartre, Théâtre complet, op. cit., p. 1365.
-
[10]
Ibid., p. 243.
-
[11]
Philippe Roger, L’ennemi américain : généalogie de l’anisme français, 2002, p. 359.
-
[12]
Jean-Paul Sartre, « L’enfance d’un chef », dans Oeuvres romanesques, 1981, p. 314-388 ; « Drieu La Rochelle ou la haine de soi », dans Michel Contat et Michel Rybalka, Les écrits de Sartre, op. cit., p. 650-652 ; Réflexions sur la question juive, 1985, p. 7-64.
-
[13]
Jean-Paul Sartre, La putain respectueuse, dans Théâtre complet, op. cit., p. 232-233.
-
[14]
Ibid., p. 225.
-
[15]
Ibid., p. 218 ; je souligne.
-
[16]
C’est Simone de Beauvoir qui décrit ainsi Clarke et son fils. Voir Lettres à Nelson Algren, 1997, p. 73.
-
[17]
Jean-Paul Sartre, La putain respectueuse, dans Théâtre complet, op. cit., p. 224.
-
[18]
Ibid., p. 234-235.
-
[19]
Dans La putain respectueuse, ce personnage n’est pas désigné autrement. Dépourvu de prénom, il est uniquement connu, dans la liste des personnages et dans l’ensemble de la pièce, comme « le Nègre ». C’est pour Sartre une manière d’accentuer au maximum l’aliénation et la dépersonnalisation dont le Noir américain est la victime.
-
[20]
Ibid., p. 232.
-
[21]
Ibid., p. 230.
-
[22]
Ibid., p. 231.
-
[23]
Richard Wright, Black Boy, 2004, p. 294.
-
[24]
Vladimir Pozner, Les États-désunis, op. cit., p. 104-114. C’est Simone de Beauvoir qui rapporte, dans ses mémoires, que Sartre s’est librement inspiré du livre de Pozner pour écrire La putain respectueuse. Voir La force des choses I, 1963, p. 160.
-
[25]
Deux fois gouverneur démocrate du Mississippi (1916-1920, 1928-1932), puis sénateur des États-Unis (1935-1947), Bilbo, surnommé « The Man », fut un ardent défenseur des lois ségrégationnistes, de la white supremacy et de la déportation de tous les Afro-Américains au Liberia. Sa carrière de sénateur prit fin lorsqu’il fut accusé d’encourager l’intimidation violente des Noirs qui voulaient exercer leur droit de vote.
-
[26]
Geneviève Latour, Théâtre, reflet de la IVe République, op. cit., p. 20.
-
[27]
Sylvie Chalaye, Du Noir au nègre : l’image du Noir au théâtre de Marguerite de Navarre à Jean Genet (1550-1960), 1998, p. 370.
-
[28]
Pierre Berge, Paris-Presse, 3 mai 1946. Cité par Geneviève Latour, Théâtre, reflet de la IVe République, op. cit., p. 19.
-
[29]
Voir ibid., p. 32-34.
-
[30]
Pascal Ayoun, « L’inspiration boulevardière dans le théâtre de Sartre », 1991, p. 823.
-
[31]
Il s’agit en fait d’une forme de comédie bouffe volontairement dégradée qui, en alliant le ridicule, le caricatural et l’horrible, s’inscrit dans la veine du grotesque telle que définie par Wolfgang Kayser dans The Grotesque in Art and Literature, 1966.
-
[32]
On pourrait objecter que la chambre d’une prostituée n’est pas un intérieur bourgeois. Cependant, les didascalies et les répliques de Lizzie indiquent que la chambre en question se caractérise par la propreté, l’ordre, de même qu’un chic et un goût conventionnels assez proches des intérieurs mis en scène chez les dramaturges du boulevard. Pour Sartre, c’est là une façon de critiquer la bienséance petite-bourgeoise en l’associant implicitement au milieu de la prostitution.
-
[33]
Voir Jean-Paul Sartre, La putain respectueuse, op. cit., p. 223-224.
-
[34]
Selon Brigitte Brunet, ce « terme de théâtre date du XIXe siècle ; il désigne une formule répétée à tort et à travers par un personnage tout au long de la pièce » (Le théâtre de boulevard, 2004, p. 74). Dans le cas de La putain respectueuse, Fred accuse par exemple constamment, mécaniquement et « puritainement » Lizzie et le Nègre d’être « le Diable ». De son côté, Lizzie ne cesse de se tourner vers un bracelet « porte-malheur » qu’elle porte et qu’elle tient pour responsable de tous les maux qui l’accablent.
-
[35]
Ibid., p. 20.
-
[36]
Pascal Ayoun, « L’inspiration boulevardière, art. cit. », p. 836.
-
[37]
Jean-Paul Sartre, La putain respectueuse, op. cit., p. 215 et 222.
-
[38]
Ibid., p. 212, 214, 218 et 221.
-
[39]
Ibid., p. 212.
-
[40]
Ibid., p. 213, 218, 219, 220, 228 et 235.
-
[41]
Benoît Denis, « Genre, public, liberté. Réflexions sur le premier théâtre sartrien (1943-1948) », 2005, p. 168.
-
[42]
Dans la pièce, rien d’explicite ne permet d’établir cette équivalence entre le Nègre et le prolétaire. La correspondance entre Noir étatsunien et ouvrier européen a toutefois été établie par Sartre dans les reportages qu’il a écrits lors de son premier voyage aux États-Unis. Il explique aux lecteurs du Figaro que le « problème noir n’est ni un problème politique, ni un problème culturel : les Noirs appartiennent au prolétariat américain et leur cause est la même que celle des ouvriers blancs » (Jean-Paul Sartre, « Retour des États-Unis. Ce que j’ai appris du problème noir », Le Figaro, 16 juin 1945, cité par Michel Contat et Michel Rybalka, Les écrits de Sartre, op. cit., p. 123).
-
[43]
Dorothy McCall, The Theatre of Jean-Paul Sartre, 1969, p. 80.
-
[44]
Robert Lorris, Sartre dramaturge, 1975, p. 334.
-
[45]
Jean-Paul Sartre, La putain respectueuse, op. cit., p. 227.
-
[46]
Ibid., p. 235.
-
[47]
Avant de devenir la troisième partie de Qu’est-ce que la littérature ? (1948), cet article a été publié séparément dans Les temps modernes en février-mars 1947.
-
[48]
Jean-Paul Sartre, Situations, II, 1948, p. 134.
-
[49]
Jean-Paul Sartre, « Forger des mythes », 1973, p. 64. Une première version de ce texte est parue en juin 1946 dans la revue Theater Arts sous le titre « Forgers of Myths : The young Playwrights of France ».
-
[50]
Jean-François Louette, « Sartre : Un théâtre d’idées sans idées de théâtre ? », 2005, p. 212.
-
[51]
Pour un panorama des principaux reproches que les critiques dramatiques adressent au théâtre sartrien, voir ibid.
-
[52]
Sur cet aspect essentiel du théâtre sartrien et de la littérature engagée, voir John Ireland, Sartre un art déloyal : théâtralité et engagement, 1994.
-
[53]
Jean-Paul Sartre, « Forger des mythes, art. cit. », p. 63.
Références
- Ayoun, Pascal, « L’inspiration boulevardière dans le théâtre de Sartre », Les temps modernes, no 531-533 (octobre-décembre 1991), p. 821-843.
- Beauvoir, Simone de, La force des choses I, Paris, Gallimard (Folio), 1963.
- — — —, Lettres à Nelson Algren, Paris, Gallimard (Folio), 1997.
- Brunet, Brigitte, Le théâtre de boulevard, Paris, Nathan (Lettres sup.), 2004.
- Chalaye, Sylvie, Du Noir au nègre : l’image du Noir au théâtre de Marguerite de Navarre à Jean Genet (1550-1960), Paris — Montréal, L’Harmattan (Images plurielles), 1998.
- Contat, Michel et Michel Rybalka, Les écrits de Sartre. Chronologie, bibliographie commentée, Paris, Gallimard, 1970.
- Denis, Benoît, « Genre, public, liberté. Réflexions sur le premier théâtre sartrien (1943-1948) », Revue internationale de philosophie, vol. LIX, n° 231 (2005), p. 147-169.
- Ireland, John, Sartre un art déloyal : théâtralité et engagement, Paris, Éditions Jean-Michel Place (Surfaces), 1994.
- Kayser, Wolfgang, The Grotesque in Art and Literature, New York — Toronto, McGraw — Hill Book, 1966.
- Latour, Geneviève, Théâtre, reflet de la IVe République. Événements, politique, société, idées…, Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris, 1995.
- Lévy, Bernard-Henri, American Vertigo, Paris, Éditions Grasset, 2006.
- Lorris, Robert, Sartre dramaturge, Paris, A. G. Nizet, 1975.
- Louette, Jean-François, « Sartre : Un théâtre d’idées sans idées de théâtre ? », Les temps modernes, n° 632-634 (juillet-octobre 2005), p. 208-255.
- McCall, Dorothy, The Theatre of Jean-Paul Sartre, New York — Londres, Columbia University Press, 1969.
- Pozner, Vladimir, Les États-désunis, Paris, La Bibliothèque française (Tous les cieux), 1948 [1938].
- Roger, Philippe, L’ennemi américain : généalogie de l’antiaméricanisme français, Paris, Éditions du Seuil (La couleur des idées), 2002.
- Sartre, Jean-Paul, « Forger des mythes », dans Un théâtre de situations, Paris, Gallimard (Idées), 1973 (textes choisis et présentés par M. Contat et M. Rybalka), p. 55-67.
- — — —, « L’enfance d’un chef », dans Oeuvres romanesques, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1981 (éd. de M. Contat et de M. Rybalka), p. 314-388.
- — — —, Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard (Folio), 1985.
- — — —, Situations, II, Paris, Gallimard, 1948.
- — — —, Théâtre complet, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2005 (éd. de M. Contat).
- Wright, Richard, Black Boy, Paris, Gallimard (Folio), 2004 [1947] (trad. de M. Duhamel).