Résumés
Résumé
Une réflexion sur l’essai critique contemporain ne peut faire l’économie de la perspective historique, tant le terme d’« essai » est porteur de malentendus. Quoi de commun en effet entre l’entreprise téméraire de Michel de Montaigne et l’institutionnalisation progressive de l’essai comme discours de maîtrise du savoir ? L’article se propose de comparer tout d’abord le début des XXe et XXIe siècles, en interrogeant les oeuvres parallèles de Proust et de Péguy, qui s’approprient la forme de l’essai critique pour se démarquer du positivisme et inventer un nouveau mode de relation avec le lecteur. La situation est à la fois plus trouble et plus tendue aujourd’hui, alors que l’écrivain ne peut faire oeuvre critique, au plein sens du terme, que sous des formes indécidables, comme c’est le cas de Pascal Quignard et de Richard Millet, ou bien, à l’instar de Nancy Huston et de Florence Delay, en mettant en valeur ce qui résiste au concept : la force de répulsion ou de séduction des oeuvres. Ces voix dissidentes, que les stratégies éditoriales hésitent à légitimer, permettent pourtant de comprendre la façon dont la littérature nous donne à penser, autrement que dans le champ des savoirs cautionnés par l’institution.
Abstract
Any reflection on the contemporary critical essay — a generic term which often carries misconceptions — needs to adopt an historical perspective. What does Montaigne’s bold undertaking have in common with the progressive institutionalisation of the essay as an authoritative discourse? This article will present a comparison between the beginnings of the 20th and the 21st centuries by examining the works of Proust and Péguy who adopted the genre of the critical essay in order to dissociate themselves from positivism and to invent a new type of relationship with the reader. Today the situation is blurred and strained, since the author can only produce critical works, in the true sense of the term, by using indecisive forms, as can be seen in the works of Pascal Quignard and Richard Millet, as well as in those of Nancy Huston and Florence Delay who focus on literature’s force of repulsion or seduction. These dissenting voices, that publishing strategies hesitate to legitimize, allow us to understand how literature conveys ways of thinking different from the fields of knowledge accepted by the institution.
Corps de l’article
L’actualité de l’essai est celle d’un anachronisme. L’heure lui est moins favorable que jamais. […] Mais l’essai a affaire à ce qu’il y a d’aveugle dans ses objets[1].
Theodor Adorno
Si l’âge d’or de l’essai se confond en France avec l’apogée de la critique française après la Seconde Guerre, cela tient pour beaucoup à la voix singulière de écrivains-critiques comme Jean-Paul Sartre, Maurice Blanchot et Roland Barthes[2] qui permirent à l’acte critique de s’affirmer «comme un acte de pleine écriture[3]» et à l’essai de s’avouer «presque un roman[4]». On sait aussi que cette critique essayiste qui, le plus souvent, se fit d’abord entendre dans des revues d’avant-garde comme Les Temps modernes, Critique, Arguments, fut tour à tour ignorée, vilipendée puis consacrée par l’Université qui, en l’annexant au grand discours objectiviste de l’enseignement[5], lui conféra le statut de nouvelle doxa[6].
Aussi interrogerai-je a contrario ici des écrivains-critiques qui, parce qu’ils ne bénéficient pas de la même légitimité, n’ont ou n’eurent d’autre recours que d’assumer «leur propre voix, puisque, à l’ignorer on s’enferme dans une autre variante de l’objectivisme[7]». Je m’efforcerai de montrer comment la critique essayiste devient un exercice d’inquiétude, aux antipodes des discours de maîtrise. Mon hypothèse est que cet impensé tient à la césure silencieuse qui s’est opérée, après Montaigne, entre l’invention critique d’un non-genre, ou d’un genre en amont des genres, les Essais, et l’institutionnalisation générique de l’essai, qui en évacuera progressivement toute forme d’ «idiosyncrasie[8]» ou de voix propre[9]. Cette césure marque en effet le partage entre une critique qui se pense comme sujet impliqué et une critique qui fait de la littérature un objet d’investigation sociologique, psychoanalytique, rhétorique, linguistique, etc.
À la lumière des travaux de quelques écrivains représentatifs des contradictions du siècle écoulé et de celui qui commence, trois questions me semblent s’imposer:
comment penser l’essai au moment où, au tournant du XXe siècle, s’instaurait durablement sinon définitivement la hiérarchie des savoirs avec la suprématie des sciences humaines sur la littérature? Revendiquant ici une «contemporanéité hors chronologie[10]», j’esquisserai un parallèle entre Marcel Proust, qui s’absorbe dans l’essai-roman de La recherche contre la séparation des savoirs et de la création littéraire, et Charles Péguy, qui invente une forme d’essai dialogique hors norme, contre le discours magistral en place;
pourquoi, un siècle plus tard, l’essai a-t-il besoin du paravent de l’inactuel pour se perpétuer? Je retiendrai le double exemple d’une oeuvre qui oscille entre forme lacunaire et vérité assertive[11], comme celle de Pascal Quignard et celle de Richard Millet, dont l’oeuvre se déploie entre méditation sur la langue et autoportrait légendaire;
en quoi le temps de l’essai est-il enfin toujours lié à celui de ces lectures qui, creusant celui de notre vie, ignore le cours pour ne pas dire le trafic des valeurs littéraires? C’est à cette question que me semblent notamment répondre aujourd’hui les essais de deux écrivains aussi différents que Nancy Huston, qui prend résolument le contre-pied d’une certaine vogue nihiliste sur le marché des valeurs, et Florence Delay, qui court-circuite par l’exemple les constructions de l’objectivisme critique.
De ce parcours qui s’apparente à une dérive contrôlée surgiront peut-être quelques-unes des nervures de l’essai critique contemporain[12].
L’impensé de l’essai: retour sur une césure silencieuse
Force est de constater que le terme d’«essayisme», introduit entre les deux guerres par Albert Thibaudet pour caractériser une critique non dogmatique[13], a fait fortune du fait de la commodité qu’il y a à rassembler sous un même genre autant de sous-genres que de fonctions pragmatiques assumées à un moment donné par l’essai. À partir de l’entre-deux-guerres, dans la société française, le mot désigne en effet aussi bien une synthèse intellectuelle, un discours polémique, une aventure poétique, une position morale, une vision culturelle, selon le panorama du XXe siècle que l’on pouvait dresser par exemple dans les années 1980[14].
Plus encore qu’un «cas d’homonymie remarquable[15]», le brouillage conceptuel relève à mon sens de la «syllepse invisible[16]» dès lors que se confond le nom du genre, ou la catégorie éditoriale de l’«essai» avec le texte singulier auquel chacun se confronte nécessairement. De ce malentendu résulte que, sans le vouloir, nous ne parlons pas de la même chose lorsque nous nous référons à la catégorie de l’essai, notamment en matière de critique littéraire. Il s’agit, de l’aveu même de ceux qui y ont recours, d’une notion aveugle dans la théorie des genres: «Nous ne parlons pas de l’essai comme d’un genre qui s’ajouterait aux genres consacrés; il est une exigence en deçà et par delà des genres. De là son omniprésence et son caractère protéiforme[17].» Aussi est-ce moins d’un nième reclassement générique dont nous avons besoin aujourd’hui pour comprendre ce qu’il advient de l’essai critique que d’un déplacement de perspective, puisqu’une «exigence» procède moins du genre, c’est-à-dire du connu, que de la recherche d’un inconnu.
Si l’impensé de la notion d’essai, loin de se réduire à un débat sur les mots du genre, soulève la question «du fonctionnement historique et culturel de tel ou tel langage pour tel ou tel public — un rapport d’énonciation / situation[18]», le langage de l’essai, dès son avènement chez Montaigne, n’est ni univoque ni circonscrit. Essayer de faire un livre qui soit une véritable «incorporation» du vivre ressortit davantage à un art de penser inséparable de l’«expérience» que d’une appellation littéraire: «Contrairement à ceux qui reprendront ce titre par la suite, [Montaigne] n’y associe pas une catégorie littéraire, mais une notion de méthode. […] Il réserve volontiers “essai” (et “essaier”) pour désigner sa méthode intellectuelle, son style de vie, son expérience de soi[19].»
Il y avait surtout à lire, dans cette méthode, l’épreuve d’une voix, un «poème de circonstance méditatif, dans une prose de forme ouverte, modeste en comparaison du grand art[20]». Cette forme ouverte, c’est ce qu’a fini par désigner, au risque de le réifier, le terme d’«essai», terme qui va bientôt faire oublier le sujet empirique de Montaigne au bénéfice de l’objet méthodologique de Francis Bacon[21], «pour qui l’abnégation de soi-même était la première règle de la méthode et le prix à payer pour tout progrès scientifique[22]». Au milieu du XXe siècle, Theodor Adorno proposera le suggestif oxymore de «fantaisie scrupuleuse» pour qualifier ce sujet de l’essai qui n’est pas maître chez lui: «L’essai procède pour ainsi dire d’une manière a-méthodique[23].» L’essai, qui du point de vue de la théorie critique est conçu comme un antidote à la rationalité des Lumières, s’apparente alors à un contre-discours, qui «coordonne les éléments au lieu de les subordonner[24]»:
Sur ce point aussi, l’essai touche à la logique musicale, l’art rigoureux et pourtant non conceptuel du passage, pour assigner au langage du discours quelque chose qu’il a perdu sous l’emprise de la logique discursive, que l’on ne peut pas tout à fait laisser de côté mais avec laquelle il faut seulement ruser dans ses formes propres en les pénétrant au moyen de l’expression subjective[25].
Au regard de cet art du «passage[26]», prétendre ranger ou définir l’essai en termes génériques relève du travail de Sisyphe, car autant l’étymon d’«essai» dénote le devenir, l’invention — et, à la limite n’est pas un substantif —, autant le nom du «genre» relève de ce que Péguy appellera à la suite de Bergson «le tout fait», distinct du «se faisant[27]», qui est au principe de l’expérience du temps ainsi que de l’histoire — et désigne plutôt un procès. Aussi le souci taxinomique ne peut-il que générer de la gêne: d’un côté, les voies de traverse ouvertes par les Essais, moyennant le démontage truculent de la bibliothèque humaniste à la lueur des humeurs, de la maladie, de l’amitié, des voyages et de l’horreur du siècle, de l’autre, le discours de la preuve, de la vérification, de la maîtrise, fût-il présenté sous le visage avenant de la conversation savante, que Barthes a su, au détour des années 1960, élever au rang de nouvelle rhétorique[28].
Au regard de ce nouveau discours de maîtrise auquel l’essai se voit, pour des raisons à la fois institutionnelles et sociologiques, annexé, il importe d’aller rechercher, sous la syllepse invisible, l’inquiétude d’une pensée qui «veut arriver ailleurs plutôt que de ne pas arriver[29]». Les trajectoires de Proust et de Péguy, au tournant du XXe siècle, sont exemplaires pour comprendre aujourd’hui l’incertitude fondamentale dont se nourrit l’essai.
Actualité de deux dissidents: Proust et Péguy
Voilà deux oeuvres aux destins comparables, qui s’apparentent à des entreprises essayistes, à des tentatives, certes démesurées sinon extravagantes, au regard des normes éditoriales, en ce sens qu’elles ont inventé, avec les armes et les exigences de la critique, une façon d’échapper au triomphe du positivisme et à la nouvelle architecture des savoirs qui se dessinait à la fin du XIXe siècle. Si tout semble, à première vue, séparer les deux écrivains — la naissance, la fortune, l’éducation —, la pensée de Henri Bergson fut, comme on sait, leur ferment commun, à savoir une conception du devenir et de la forme qui, prenant à revers la logique déterministe de l’Histoire, innerve de part en part le processus «créateur» et permet d’en rendre compte:
Pour l’artiste qui crée une image en la tirant du fond de son âme, le temps n’est plus un accessoire. Ce n’est pas un intervalle qu’on puisse allonger ou raccourcir sans en modifier le contenu. La durée de son travail fait partie intégrante de son travail. […] Le temps de l’invention ne fait qu’un ici avec l’invention même. C’est le progrès d’une pensée qui change au fur et à mesure qu’elle prend corps. Enfin, c’est un processus vital, quelque chose comme la maturation d’une idée[30].
Pour autant, Proust et Péguy ne tirent pas des leçons identiques ni mêmes mimétiques de l’enseignement de Bergson, mais ils se découvrent eux-mêmes par l’entremise de son intuition de la durée. Proust, comme le note Walter Benjamin[31], découvre ainsi dans la mémoire involontaire le moyen d’éterniser le sentiment de la durée, et comprend dès lors la nécessité de fondre tous ses projets d’essai ou d’étude en une seule forme d’essai-roman dont la durée sera à la fois la matière et le sujet. En mai 1908, loin de songer à une quelconque fiction homogène, l’auteur se voyait ainsi partagé entre une infinité de directions possibles dans le champ éclaté du savoir, dont il dresse la liste à son correspondant comme autant d’éléments juxtaposés sans subordination possible:
J’ai en train: une étude sur la noblesse
un roman parisien
un essai sur Ste Beuve et Flaubert
un essai sur les femmes
un essai sur la pédérastie (pas facile à publier)
un essai sur les vitraux
une étude sur les pierres tombales
une étude sur le roman[32].
L’essai comme pratique de la lecture et de l’étude ne précède donc pas le roman proustien, il est au coeur même de son déploiement et de ses dédoublements: «faut-il en faire un roman, une étude philosophique, suis-je romancier[33]?» Les deux éditions du Contre Sainte-Beuve, celle de Bernard de Fallois en 1954 puis celle de Pierre Clarac en 1971, montreront les «deux visages différents d’un même texte[34]», l’un narratif, l’autre spéculatif, sans qu’il soit vraiment possible de dissocier «la pensée créatrice de Proust» d’«une couche superficielle», qui serait «celle de sa pensée critique[35]». Indissociable de la critique d’art, de l’enquête sociale et d’une quête de la vérité, la dynamique de la Recherche est tout entière du côté du «se faisant»: à la fois critique et créatrice parce que non seulement elle ne suit pas l’ordre linéaire d’un exposé d’idées toutes faites ni celui d’un simple récit, mais aussi parce qu’elle puise encore son élan dans la «Conversation avec maman» sur la lecture, conversation étendue en rosace à de multiples personnages de lecteurs empiriques, au point que la Recherche ne cesse d’orchestrer une foule de voix liseuses, que les «parenthèses» ou les commentaires rétroactifs du narrateur tentent de canaliser, faisant alors de l’essayiste le héros d’une sorte de «roman d’apprentissage[36]»… de la critique.
Lorsque, dans les années 1960, la «Nouvelle Critique» se cherchera des précurseurs, Proust passera pour celui qui annonçait l’École de Genève, voire les méthodes de la critique thématique. Or elle oubliait l’essentiel: en dénonçant le scientisme de son époque, au risque de passer pour réactionnaire, Proust proposait un véritable renversement de perspective en faisant de l’oeuvre un acte de langage indivisible, une expérience intempestive:
En art, il n’y a pas (au moins dans le sens scientifique) d’initiateur, de précurseur. […] Chaque individu recommence pour son compte, la tentative artistique ou littéraire; et les oeuvres de ses prédécesseurs ne constituent pas, comme dans la science, une vérité acquise dont profite celui qui suit[37].
Cette déclaration bien connue s’accorde en tout point avec la démarche même de l’essai, la postule et la fonde comme éthique, en ce sens que l’événement de l’oeuvre n’est assignable en dernier ressort qu’à l’intuition de la durée dont elle est organiquement l’épreuve: pour le narrateur de la Recherche, l’usage de la «digression» s’apparente en effet à un phrasé autant qu’à un mode de composition en rosace qui correspond à la circulation en spirale dans ses livres de chevet: George Sand, Saint-Simon, Chateaubriand, Nerval, Mme de Sévigné, Racine, etc. En ce sens, La Recherche, jusqu’à l’inachèvement de tous les possibles de la lecture, est bien «un essai ininterrompu pour lester une vie entière de la plus haute présence d’esprit[38]».
Péguy, à la différence de Proust, entreprend de défendre et d’illustrer Bergson par la controverse, «en regardant de plus près l’expérience qui a donné naissance à cette philosophie, ou contre laquelle elle fut convoquée[39]», c’est-à-dire du point de vue de l’expérience de l’Histoire, par la bouche ironique amère de Clio, muse nouvellement promue par les historiens au rang de grande géomètre du temps. Péguy, poète prosateur, ne s’imagine pas un instant «romancier», mais donne corps à une figure d’intellectuel issu d’un peuple sans écriture, qui prend en charge tout ce qu’implique la durée bergsonienne dans «l’expérience inhospitalière et aveuglante qui est propre à l’époque de la grande industrie[40]»:
On croit généralement qu’il suffit qu’une idée soit neuve pour qu’elle soit nouvelle. On croit qu’il suffit qu’une idée soit neuve pour qu’elle n’ait jamais servi. Quelle erreur. Elle a servi au fabricant […] Homère est nouveau ce matin, et rien n’est peut-être aussi vieux que le journal d’aujourd’hui[41].
Or «l’entrée de Péguy», selon la magnifique expression de Thibaudet qui ne le range pas tout à fait dans la «critique essayiste» mais, significativement, dans la«critique des nourritures[42]», perturbe les catégories génériques, puisque l’essai critique s’impose ici par «la forme d’un débat incessant entre soi et soi-même, entre soi et les autres[43]» et ne requiert de ce fait aucune assignation définie dans le champ des savoirs reconnus: théologie, philosophie, politique, critique littéraire. La pragmatique de l’essai s’étend ainsi dans toute l’entreprise de Péguy, depuis l’échoppe bruissante des Cahiers, où l’on «parlait toutes les langues[44]», jusqu’au style babélien de tous ses «essais». De fait, c’est dans les Cahiers de la Quinzaine que s’engage un dialogue sans précédent dans l’histoire de la critique française entre des tempéraments et des familles d’esprit antagonistes — Bernard-Lazare, Halévy, Sorel, Tharaud, Benda, Jaurès, Rolland —, et que remontent ainsi au grand jour les grandes oppositions autour de l’idée de Nation comme unité organique toujours en train de se créer, autour de l’idée de culture. En termes bergsoniens, le temps des oeuvres témoigne en effet contre le temps du progrès «qui revient essentiellement à être une théorie de caisse d’épargne[45]», car leur «rythme de durée[46]» s’incorpore chaque fois dans le présent de la lecture qui suppose un lecteur se réappropriant la durée de l’oeuvre, son processus, selon la définition donnée dans Clio: «la lecture est l’acte commun, l’opération commune du lisant et du lu, de l’oeuvre et du lecteur, de l’auteur et du lecteur[47].» Chez Péguy, la relecture incessante d’Homère, de Sophocle, de Corneille, de Hugo, de Michelet ne prend pas seulement le relais de leur transmission par l’École républicaine, elle répond à la nécessité de refaire pour soi l’expérience temporelle de la lecture comme activation d’une mémoire nucléaire, «parce que l’opération de l’oeuvre est essentiellement un problème, un problème de l’organisation même de la mémoire[48]».
Cette perspective critique retentit sur la composition et la nature mêmes des livres publiés par Péguy ou restés inédits à sa mort: ses dialogues imaginaires sont littéralement des essais, au sens où, dans les ouvrages de ce type, «la question du genre se confond avec celle de la valeur[49]» — et je dirais même: la question de l’oeuvre, de ce qui fait oeuvre soulève immédiatement celle de la valeur, tandis que, le plus souvent, l’oeuvre faite, circonscrite en dispense. Dès lors, soulever la question de l’ordre, en l’occurrence du «désordre[50]» de l’oeuvre de Péguy, revient à poser la question même de sa valeur, de son «style». Dans le sillage du tâtonnement, de l’hésitation, des «allongeails» opposés par Montaigne aux syllogismes de la scolastique, l’engagement littéraire de Péguy revendique en effet, contre la dissertation, le droit au «bégaiement» polémique: «Le bégaiement, on le sait, est la plus grande marque temporelle de la sincérité[51].» Aussi Clio est-il un livre qui piétine, bifurque, digresse, revient sur lui-même, embrassant le mouvement à la fois horizontal et vertical du Temps[52]. Cet emportement extrêmement concerté du style fait justement qu’«il n’y a pas dans Clio un problème de forme qu’on puisse détacher: ce que dit Péguy et la façon dont il le dit, c’est le sujet même de Clio[53]».
Malaise dans la classification
Avec la digression proustienne et la digression péguyenne — à laquelle Proust s’est d’ailleurs montré réfractaire[54] — la dissidence de l’essai prend un tour nouveau, et Péguy a forgé, par la pratique, les concepts lui permettant de penser la poétique de sa pensée, comme «déconduction», «recreusement» ou «recroisement[55]». Se pose alors la question de la qualité de l’attention requise par le lecteur, attention aux retours, circuits, recoupements analogiques, bifurcations. Cet engagement de la lecture met cruellement en évidence le malentendu que véhicule, depuis le premier tiers du XXe siècle, la catégorie éditoriale de l’essai qui va progressivement masquer l’essai vivant au bénéfice d’une conception
qu’illustra longtemps, par exemple, des années trente à l’aube des années soixante-dix, la collection «Les Essais», chez Gallimard — à savoir des textes qui se tiennent à côté d’oeuvres campées dans les champs disciplinaires acceptés […] généralement ouverts au franchissement du partage des savoirs[56].
Par contrecoup se pose la question de la réception et de la légitimité de l’espèce d’essais, de tentatives, d’«approximations», disait déjà Charles Du Bos, qui n’entrent pas dans le système de partage des savoirs adoubés par les sciences humaines. Proust a évité l’échec en faisant de son essai labyrinthique sur le temps le laboratoire d’un «roman» qui fomente à sa manière la fin du roman; Péguy a persévéré dans une entreprise inclassable en prouvant que l’essai pouvait devenir «la forme de la catégorie critique de notre esprit[57]». En récusant, notamment pour des raisons sociologiques et politiques, toute inféodation à un champ déterminé du savoir — «moi qui n’ai aucun système et qui à cause de cela ne ferai aucune fortune (je dis même intellectuelle)[58]» —, Péguy n’assumait pas seulement le rôle du polémiste auquel on est parfois tenté de le réduire: il s’éliminait par avance de la catégorie éditoriale qui, sous le nom d’«essai», allait s’imposer en France entre les deux guerres moyennant la promotion d’un genre nouveau dont les propriétés
autorisent la dénégation du caractère nouveau de la catégorie derrière la fausse évidence de l’éternité d’un genre. Cette nécessaire illusion de permanence est un autre signe du mode d’affirmation de l’avant-garde consacrée qui incarne la modernité d’un «mouvement littéraire» maintenu dans le cadre rassurant de la littérature pensée comme monument. L’exemple de l’essai conduit à se demander si le rôle des catégories génériques n’est pas, avant tout, de neutraliser l’histoire du champ et les dangers qu’elle fait courir à la monumentalité littéraire[59].
Or ces dangers, comme on vient de le voir, permettent de penser à nouveaux frais cette catégorie générique, dont il apparaît qu’elle est chaque fois «le produit d’enjeux historiquement situés dont l’illusion de la récurrence reste le principal obstacle à leur compréhension[60]». Le recours à l’histoire du champ éclaire ainsi l’impensé d’une catégorie, dès lors que des écrivains hétérodoxes, comme Proust et Péguy — mais on pourrait convoquer aussi Valery Larbaud, Jacques Rivière, Jean Paulhan — ni philosophes habilités, ni critiques littéraires patentés, pas même titulaires d’une chaire en Sorbonne n’ont pu, ne peuvent y trouver leur place.
Or loin d’être une gêne ou un obstacle, l’impensé de l’essai peut au contraire devenir un atout pour tenter de défricher les nouvelles terres de l’essai critique, telles que l’inventent aujourd’hui quelques écrivains-critiques qui, tout en se référant aux grands discours du savoir, ne leur prêtent nulle allégeance et n’ont d’autre légitimité que celle que peuvent conférer les éditeurs et les collections qui acceptent de les accueillir.
Le présent anachronique de l’essai
Si la réticence à l’égard de toute forme d’étiquetage générique constitue l’un des lieux communs de la modernité, et plus encore du «post-modernisme[61]», cette réticence est constitutive de tout un courant que l’on me permettra d’appeler au meilleur sens du terme critique, «au sens fort du terme, lequel ne se résorbe pas dans des formes d’écritures “mixtes”, mais innerve la façon même de concevoir un texte[62]». Tel est le cas de l’essai chez Quignard, qui estime que «c’est le genre qui s’est perdu plutôt que des changements de genre qui auraient eu lieu. Je ne sais pas répondre aux questions qui concernent les genres. […] La seule chose que je cherche c’est le non-genre qui permette l’intégration du noétique, de l’affectif, etc.[63]». Quignard commence toutefois — et l’on ne peut s’empêcher de songer à Montaigne — par publier des commentaires relevant d’«une recherche embarrassante ou dissidente[64]» (sur Maurice Scève, Michel Deguy, Louis-René des Forêts), avant de s’engager plus tard dans une entreprise indécidable.
En écrivant ce que l’on pourrait appeler des essais sans objet identifiable, les Petits traités, dont l’ambition «noétique» contraste avec la force abréviatrice ou suspensive du fragment, Quignard se meut tout à la fois dans l’univers du conte, de la méditation, du portrait, de la vie brève, de l’aphorisme. Mais, ce n’est pas un hasard si l’auteur se place, dès le début, sous l’invocation de Pierre Nicole («Treize volumes sont parus sous le règne de Louis XIV sous le titre d’Essais de morale[65]»), avant de s’avancer lui-même à découvert:
J’écrivais ces traités dans cette joie furieuse qui se dérobe ce qu’elle cache parce qu’elle préfère bondir et parce qu’elle veut foncer. Ces textes n’étaient assujettis à aucun ordre général. Ils n’avaient à se soumettre à rien, pas même au contraste entre eux. […] Quel éditeur s’intéresserait à cette suite baroque attendue par la forêt peut-être, un aveugle et un loup? Personne[66].
Ce parti pris de l’anachronique, peut-être aussi jubilatoire que mélancolique[67], que l’on aurait tort d’attribuer à une esthétique de l’hybridité, est le symptôme plus profond d’une utopie de la lecture que seule «la suite baroque» de l’essai dissident peut encore incarner. La suite discontinue des Petits traités, publiés d’abord chez un éditeur à la fois illustre et confidentiel, comporte en effet des portraits de lecteurs sublimes qui font de la lecture l’expérience même. Il suffit de rappeler que le deuxième traité est un portrait de Spinoza: «Il souffrait d’une insomnie chronique qu’il avait transformée en bonheur en lisant. Il aimait tellement la joie[68].» Il faut comprendre ici que lire, c’est devenir autre — ce qu’entend Quignard dans le très ancien mot «essai»: «Essais. Experior. Exercices matériels. Tels sur les bords du Rhin, jadis, les exercices d’annihilation et de désappropriation[69].» À la lumière de maître Eckart et de la théologie négative, la lecture comme expérience de dépossession de soi conteste ici tout projet de maîtrise: «De la violence de quel désir lire purge[70]?»
Le choix de l’inactuel répondant à l’impossibilité de faire entendre la violence de cette question dans un monde dominé par «l’idéologie communicationnaire[71]», l’expérience ne peut, le plus souvent, se faire ou se dire que de façon clandestine et non sans d’inévitables malentendus. Ainsi Millet, écrivain proche de Quignard, se voit-il décerner en 1994 le prix de l’Essai de l’Académie française pour Le sentiment de la langue, pour des raisons sans doute plus idéologiques que littéraires. Un lecteur non prévenu sera alors tenté de réduire ces mélanges à une nouvelle défense la langue française menacée à ses frontières comme dans son génie propre, et se gardera ainsi de l’obscur danger que présente un ouvrage dont la «logique musicale, l’art rigoureux et pourtant non conceptuel du passage[72]» résistent à l’enrôlement générique. Recueil morcelé, mosaïque autobiographique, ce livre en progrès connut d’abord trois éditions (1986, 1990, 1993), puis une quatrième «revue et augmentée» dix ans plus tard, escortée d’un avant-propos qui porte le fer au coeur de la poétique solitaire de l’essai aujourd’hui:
C’est donc un livre de haute solitude, et nul (même ceux qui font profession de n’être pas de leur temps) n’est plus seul que moi aujourd’hui. […] Mais lit-on vraiment les livres qu’on soupçonne irrigués d’un sang trop sombre? Qui entrera avec moi dans les motifs, les échos, les hantises, les aversions, les contradictions, dont il se nourrit et dont la résolution est souvent plus musicale que dialectique[73]?
Cette propédeutique à la lecture d’un ouvrage revendiqué comme anachronique, qui tient de l’«involontaire autoportrait» et de l’elliptique «esquisse d’une autobiographie intellectuelle[74]», répond à la conception tout aussi inactuelle que Millet se fait de la lecture, de l’ascèse qu’elle implique et dont l’essai serait devenu dans la France d’aujourd’hui la forme improbable:
En quoi le lecteur est-il pour vous «un chrétien qui s’ignore».
Notre rapport au texte littéraire obéit à une tradition de lecture, à une forme de sacrifice silencieux dont les herméneutes bibliques que nous sommes, nous autres chrétiens, sont les modèles […]. Le roman, la poésie, les essais (ceux, par exemple, de Praz, Magris, Citati, Calasso, Agamben, dont il n’y a pas d’équivalent en France, à la frontière entre philosophie et littérature, fruits d’un souci qui suppose une érudition qui est elle-même un objet d’art), ne les lisons-nous pas aujourd’hui comme une ultime herméneutique du sacré dans un contexte de déchristianisation grandissante[75]?
À elle seule, cette longue parenthèse dévolue à des «essayistes» étrangers souligne combien l’anachronisme de l’essai tient à son statut atopique (qu’il s’agisse d’écrivains italiens isole davantage la conception officielle de l’essai «à la française»). Mais il y a plus, car la réponse faite à la question s’inscrit d’emblée dans une mémoire de la lecture dont Péguy fut le sourcier incompris un siècle plus tôt, même si la mystique hétérodoxe de Quignard ou de Millet passe par l’ellipse, le bref[76], le silence, que les solitaires de Port-Royal cultivaient pour faire pièce à l’éloquence des grands sermonnaires, et que Simone Weil portera à son incandescence dans La pesanteur et la grâce. Semblablement, si Millet, tant dans Le sentiment de la langue, dans L’amour mendiant que dans Accompagnement, oppose à «l’exercice de la dissertation» le choix du divers, de la fatrasie, de l’hétérogène, il ne fétichise nullement le fragment qui peut être «plus ennuyeux, moralisateur, poseur, qu’un long essai[77]».
On comprend que le mot «essai», entaché d’un malentendu rédhibitoire, répugne désormais à ceux-là mêmes qui, en petit nombre, en réinventent en sous-main la forme imprédictible tout en laissant entendre que celle-ci a fait long feu au profit de ces dissertations, élégantes ou sérieuses, que le public est invité à consommer chaque rentrée littéraire sous le nom d’«essais». Sans doute le préfacier du Sentiment de la langue voyait-il juste en 1993 — «Depuis Julien Gracq, tout essai devrait s’intituler en lisant en écrivant, tant l’écriture prend substance dans la rumination du langage des autres[78]» —, car le double gérondif de ce titre imprenable empêche précisément de séparer une forme d’existence et une activité placée sous le signe de ce «vice impuni» qu’est la lecture.
Dans cette mesure, des recueils d’essais qui ne sont autres que des livres d’heures renouent aujourd’hui avec la forme du journal spirituel, où la critique implique toujours un déracinement du lecteur.
L’essai entre idiolecte et idiotie – ou le lecteur exposé
C’est sans doute sur fond de déroute de la théorie littéraire que la dérive de l’essai reprend ses droits en ce début de XXIe siècle, une déroute à ce point sensible dans l’enseignement que d’aucuns pourraient même triompher à bon compte[79]. Des essais atypiques comme ceux de Huston et de Delay on pourrait dire tout d’abord ce que Bertrand Leclair déclare de sa propre Théorie de la déroute:
cet essai, s’il est d’abord le modeste livre d’heures d’un idiot du village global, prétend pourtant travailler l’articulation entre le littéraire et le politique à la façon dont la littérature contemporaine, en tant qu’elle est un art, travaille les articulations, fondamentalement politiques entre l’être et le devenir, entre l’intime et le social[80].
Le moins que l’on puisse dire est que Huston, dans son dernier livre d’heures — un essai conçu comme un recueil de radiographies d’écrivains nihilistes ou «néantistes» couronnés par le XXe siècle, de Schopenhauer à Elfride Jelinek —, aborde de front ces articulations, puisqu’elle choisit à la fois le point de vue de l’intime — celui de la femme écrivain qu’elle est par toutes ses fibres — et celui du social — la réception en France, et plus largement en Occident, d’une littérature solipsiste devenue grégaire. Alors qu’elle aurait pu opter pour un discours de surplomb et d’objectivation, Huston choisit au contraire de puiser à son expérience personnelle pour renverser un certain nombre d’idées reçues, la première étant que la source biographique d’un écrivain, son terreau affectif, est sans rapport avec l’accomplissement de l’oeuvre affichée. En d’autres termes, c’est en posant des questions qui frisent le scandale aux yeux des théories textualistes qu’elle met le feu aux poudres, non en tant que critique professionnelle mais en tant que lectrice privée, si bien que la frontière entre l’expérience intérieure de l’auteur et celle du lecteur redevient poreuse.
Surtout, elle montre, à partir des nappes phréatiques de leur biographie, c’est-à-dire de l’enfance, comment les oeuvres de Schopenhauer, d’Emil Cioran, de Thomas Bernhardt, amplifient un affect originel de vengeance ou de ressentiment envers leurs proches, étendu à l’espèce humaine. Inversement, l’expérience de l’anéantissement de l’humain vécu au contact des camps de la mort ne détermine pas une seule et même littérature lazaréenne: à l’effrayant constat d’Imre Kertesz, celui de «la continuité entre son enfance et Auschwitz[81]», s’opposent en effet les tentatives de libération non couronnées de prix littéraires de Jean Améry ou de Charlotte Delbo[82], ce qui n’est pas un hasard.
On pressent les objections auxquelles s’expose Huston en ayant «à coeur de comprendre […] de quelle manière une névrose d’ordre personnel peut se transformer en un système de pensée qui semble l’expression la plus adéquate de toute une époque[83]». Ce sont les objections qu’entraîne toute lecture impliquée: le Flaubert de Sartre, même s’il est fait dans une tout autre ambition, répond à la même exigence. Ce qui en revanche singularise Huston, c’est la façon dont elle transforme les attentes avec lesquelles un lecteur aborde en général ce genre d’essais. On s’attend à l’exposé d’une thèse, on a en réalité affaire, à l’instar du dialogue de Péguy avec Clio, la muse de l’Histoire, à l’oralité musclée d’un dialogue avec «Déesse Suzy[84]», divinité de rechange à ce «Seigneur Dieu» sous la bannière duquel Huston range ironiquement les trois générations d’auteurs «négativistes» qu’elle a choisis d’interroger. Au lecteur d’investir le recueil[85] et d’établir des relations entre ces portraits et d’autres qui s’en rapprochent ou en diffèrent comme ceux du recueil Âmes et corps (textes choisis 1981-2003), où, s’arrachant à «l’emprise des voix sépulcrales qui nous hypnotisent depuis un siècle et demi[86]», elle présente cette fois des textes de circonstance comme «des jalons sur [son] chemin de romancière et d’expatriée, de mère et d’intellectuelle, de rêveuse et de réaliste, d’âme et de corps[87]». Et ce n’est pas un hasard si ce livre hétérogène s’ouvre sur une sorte de biographie intellectuelle intitulée «Déracinement du savoir», faisant une large part à sa traversée du séminaire de Barthes en 1975, puis à la nécessité de libérer l’essai du «ton universitaire aux visées sévèrement scientifiques» pour inclure «à chaque fois de petites “vignettes” sur [sa] vie quotidienne, [ses] lectures, [son] enfance». Et comme pour souligner l’idiotie patente de pareille entreprise elle conclut: «Il y a nettement plus d’autobiographie dans mes essais que dans mes romans! […] Le je que j’employais dans mes essais, totalement nu et intime, sans protection aucune, était par ailleurs l’un des effets du savoir déraciné[88].»
Or c’est précisément comme lectrice au savoir déraciné que Delay, s’adressant au lecteur, réunit en 1996 un ensemble d’essais qui, par son titre énigmatique, La séduction brève, tente d’articuler non plus «l’intime et le social», mais bien plutôt «l’être et le devenir[89]», en ce sens que les livres lus, comme autant de propos qu’un Autre nous adresse personnellement, reviennent en nous «sans qu’on leur fasse commande, n’appartiennent plus seulement à la littérature. Ils font partie de notre individu au même titre que nos humeurs[90]». La séduction, au contraire du désespoir qui englue, est ce qui nous prend à part — se-ducere — sur le mode de l’éclair, de l’effraction furtive, si bien que la plupart du temps,
[l]’activité critique ressemble à un art tauromachique détourné de ses règles horaires. D’autant plus que ce que prétend la ou le critique est tout bonnement impossible: il prétend être toréador du texte alors que c’est le texte qui porte l’habit de lumière[91].
La séduction brève est par quintessence un défi lancé au discours critique: comment la dire tout en la faisant vivre, brièvement? Sans doute le prière d’insérer parle-t-il «d’essais romanesques», soulignant ainsi la part d’aventure et d’inconnu qui fait de la liaison critique une expérience de soi dans le temps perdu et retrouvé de la lecture, un temps éprouvé comme durée (bergsonienne?), mais c’est pour mettre l’accent sur cet affect central qui pense avec nous, qui «insiste en nous: l’agent secret de nos vies».
En nous parlant d’auteurs, Delay ne parle que de rencontres, c’est-à-dire du sujet exposé à la séduction «qui est la bête» dont la littérature est la forme: la trouvaille des greguerias de Ramon Gomez de la Serna («Notre âme est faite de greguerias[92]»), l’invention du «volcan portatif» de Jules Supervielle, «l’envol» de Jean Giraudoux, le «oui-ne» du dernier Georges Bernanos. D’une voix incisive, l’auteur de La séduction brève raconte en réalité l’histoire d’une perpétuelle «conversion par la lecture», où «les livres se convertissent en d’autres livres» depuis l’arrachement à lui-même de saint Augustin guidé par «une voix d’enfant qui répétait en chantant: prends et lis[93]». Hors de cette histoire, en effet, c’en est fini du plus petit commencement de l’ombre d’une théorie de la littérature — théorie qui n’est peut-être que la manifestation socialement acceptable de cette intensité[94]de présence provoquée par ces absents que l’on s’obstine à appeler des «auteurs»:
On s’essaie à deviner pourquoi ils nous tirent obstinément les mêmes cartes. C’est le temps de l’essai qui, comme Merlin, prophétise aussi bien le passé que l’avenir et nous échappe jusqu’à la fin[95].
«On s’essaie à deviner»: «on», lecteur et auteur associés le temps d’une «promesse furtive[96]».
Conclusion
Telle est sans doute, en ces temps de détresse théorique, l’hérésie critique de l’essai, qui nous rappelle sans cesse à l’intériorité de l’expérience qui se joue dans la lecture. Et ce n’est pas jouer sur les mots que de dire que l’impensé de l’essai nous oblige à penser en termes toujours neufs la singularité de ce lien fragile qui fait du texte un lieu de passage de voix en voix, c’est-à-dire d’écoute. Aussi la pensée à l’oeuvre dans l’essai met-elle d’abord en crise l’identité supposée séparée du lecteur et de l’auteur. Loin d’être réductibles à une lutte sur ou pour les dénominations, les avatars de l’essai critique dans le siècle trahissent au contraire l’effort pour dire non pas ce que pense la littérature, ce qui serait la rabattre sur des énoncés monnayables, mais plutôt comment elle pense ou, ce qui va peut-être plus loin, comment elle peut nous donner à penser autrement que dans les bornes du savoir légitime, sur le mode d’une séduction ou d’une aversion, c’est-à-dire d’une incarnation: «Or, il ne faut pas attacher le sçavoir à l’âme. Il l’y faut incorporer[97].» Le mode de l’essai, sans lequel toute pensée devient idée «toute faite», serait alors, au sens exact, celui du participe présent — et en cela, éminemment politique.
Parties annexes
Note biographique
Jérôme Roger
Maître de conférences de littérature et de langue française du XXe siècle, Jérôme Roger enseigne à Bordeaux. Après avoir écrit une thèse de doctorat sur l’oeuvre d’Henri Michaux, auquel il a consacré un livre, Henri Michaux, poésie pour savoir (Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000), puis divers articles (dans Littérature, Les Temps modernes, Le Magazine littéraire), il a publié un ouvrage sur La critique littéraire (Paris, Nathan (Université), 2002). Ses travaux portent sur les relations entre écriture de l’essai, critique et formes de pensée, notamment chez Charles Péguy, Jacques Rivière, Jean Paulhan, Maurice Blanchot et Raymond Queneau. Membre de l’équipe de recherche sur les modernités littéraires (Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3), il a coordonné le volume L’auteur entre biographie et mythographie (Modernités, n° 17, Presses universitaires de Bordeaux, 2003). Il a récemment publié un commentaire d’Ecuador et de Un barbare en Asie de Michaux pour la collection «Foliothèque» de Gallimard.
Notes
-
[1]
Theodor Adorno, «L’essai comme forme», dans Notes sur la littérature, 1984, p. 29.
-
[2]
Tzvetan Todorov, Critique de la critique: un roman d’apprentissage, 1984, p. 55 et suivantes. Bien que discutable, ce regroupement est symptomatique du paysage de la critique tel qu’il peut se dessiner rétrospectivement.
-
[3]
Roland Barthes, Critique et vérité, 1966, p. 47.
-
[4]
Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, 1954, p. 124.
-
[5]
Phénomène dont fut témoin parmi tant d’autres Richard Millet qui, étudiant en Sorbonne en 1980, voit «enseignée cette “Nouvelle critique” qui peu d’années auparavant était une hérésie majeure et avait failli me coûter le CAPES» (Le sentiment de la langue, 1993, p. 270).
-
[6]
Voir Jean-Pierre Martin, «Avant-propos», dans L’invention critique, 2004, avec P. Lepape, D. Noguez, J.-C. Pinson, P. Bayard, J.-M. Delacomptée, J. Dubois, B. Leclair.
-
[7]
Tzvetan Todorov, Critique de la critique, op. cit, p. 173.
-
[8]
Sur l’ambivalence de l’adjectif grec idios, voir Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions européennes, 1969, vol. I, ch. 3: «L’homme libre».
-
[9]
Sur cette notion, voir Jean-Pierre Martin, «La critique et la voix: la double injonction», 2003.
-
[10]
Richard Millet, Le sentiment de la langue,op. cit., p. 253.
-
[11]
Dominique Rabaté analyse l’ethos de cette dimension assertive dans «Vérité et affirmation chez Pascal Quignard», 2004.
-
[12]
Cette dérive est donc, j’en ai conscience, partielle: la place manquera ici pour évoquer notamment Michel Butor et ses Répertoires, Georges Perros et ses Papiers collés, la lucidité caustique du Protée et autres essais de Simon Leys, mais aussi La patrie de l’âme de Jean Mambrino, «lecture intime de quelques écrivains du XXe siècle».
-
[13]
Albert Thibaudet, Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, 1936, p. 462 et suivantes.
-
[14]
Germaine Brée et Édouard Morot-Sir, Du surréalisme à l’empire de la critique, 1984, p. 269. Voir en particulier l’important chapitre sur «L’essayisme du XXe siècle», p. 363-397.
-
[15]
Voir Marielle Macé, «Le nom du genre: quelques usages de l’“essai”», 2002, p. 406.
-
[16]
J’emprunte cette notion stimulante à Pierre Bayard, Enquête sur Hamlet: le dialogue de sourds, 2002, p. 30 et suivantes.
-
[17]
Germaine Brée et Édouard Morot-Sir, Du surréalisme à l’empire de la critique, op. cit., p. 269.
-
[18]
Henri Meschonnic, «Pour une épistémologie de l’écriture», dans Pour la poétique II , Paris, Gallimard, 1973.
-
[19]
Hugo Friedrich, Montaigne, 1984, p. 354.
-
[20]
Ibid., p. 353.
-
[21]
On lira les premières critiques contre les fameuses «règles de Bacon» dans la Note conjointe sur M. Bergson de Charles Péguy, dans Oeuvres en prose, 1909-1914, 1961.
-
[22]
R. Lane Kauffmann, «La voie diagonale de l’essai: une méthode sans méthode», 1988, p. 73.
-
[23]
Cité dans ibid., p. 81.
-
[24]
Id.
-
[25]
Theodor Adorno, «L’essai comme forme», art. cit., p. 27.
-
[26]
De Montaigne à Michaux, en passant par Adorno, la pensée du «passage» est coextensive à l’écriture de l’essai, comme j’ai tenté de le montrer dans Henri Michaux, poésie pour savoir, 2000.
-
[27]
Charles Péguy, Note conjointe sur M. Bergson, op. cit., p. 1321.
-
[28]
On lira le pastiche de cette rhétorique proposé par Dominique Noguez dans «Lire de près, lire de loin», dans L’invention critique,op. cit., p. 46-48.
-
[29]
Charles Péguy, Note conjointe sur M. Bergson, op. cit., p. 1335.
-
[30]
Henri Bergson, L’évolution créatrice, 1983, ch. 4, p. 341.
-
[31]
Walter Benjamin, Oeuvres, 2000, vol. III, p. 332-334.
-
[32]
Marcel Proust, «À Louis Albuféra», dans Correspondance, 1970-1992, vol. VIII, p. 112-113.
-
[33]
Id.
-
[34]
Isabelle Serça, «Roman / essai: le cas Proust», dans Pierre Glaudes (dir.), L’essai: métamorphoses d’un genre, 2002, p. 89.
-
[35]
Bernard de Fallois, préface du Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard (Idées), 1954, p. 48.
-
[36]
Pierre Glaudes et Jean-François Louette, L’essai, 1999, p. 32.
-
[37]
Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, op. cit., p. 124.
-
[38]
Walter Benjamin, Oeuvres, op. cit., vol. II, p. 150.
-
[39]
Ibid., vol. III, p. 132.
-
[40]
Id.
-
[41]
Charles Péguy, Note conjointe sur M. Bergson, op. cit., p. 1322-1323.
-
[42]
Albert Thibaudet, Histoire de la littérature française, op. cit., p. 467.
-
[43]
Pierre Glaudes et Jean-François Louette, L’essai, op. cit., p. 152.
-
[44]
Robert Burac, Charles Péguy. La révolution et la grâce, 1994, p. 100.
-
[45]
Charles Péguy, Clio, dans Oeuvres en prose, op. cit., p. 128.
-
[46]
Ibid., p. 131.
-
[47]
Ibid., p. 106.
-
[48]
Id.
-
[49]
Pierre Glaudes et Jean-François Louette, L’essai, op. cit., p. 155.
-
[50]
Voir Joseph Bonenfant, «Le discours de l’essai», dans Péguy mis à jour, 1976, p. 176 et suivantes. Le Québec, pour des raisons qu’il faudrait analyser, s’est montré beaucoup plus sensible que la France à la pensée de Péguy dans la période contemporaine. On se reportera également à «l’explication» de la Note conjointe par Renée Balibar dans Les Français fictifs, 1974, p. 205 et suivantes.
-
[51]
L’argent suite, cité dans Pierre Glaudes et Jean-François Louette, L’essai, op. cit., p. 156.
-
[52]
Recherche illustrée et thématisée à partir de la récurrence de la vieille chanson de Malbrou dans les Châtiments et dans la chanson de Chérubin chez Beaumarchais, deux oeuvres révolutionnaires, c’est-à-dire populaires. Voir Charles Péguy, Clio, op. cit., p. 137 et suivantes.
-
[53]
Bruno Latour, «Pourquoi Péguy se répète-t-il?», 1977, p. 102.
-
[54]
«Lettre à Daniel Halévy», citée dans Pierre Glaudes et Jean-François Louette, L’essai, op. cit., p. 156.
-
[55]
Voir Charles Péguy, Clio, op. cit., p. 143 et 246, à propos d’un refrain de Hugo, et Note conjointe sur M. Bergson, op. cit., p. 1405, à propos des digressions concertées du dialogue.
-
[56]
Éric Vigne, directeur de la collection «Les Essais» chez Gallimard, L’essai, 1997, p. 8.
-
[57]
Dans «L’essai et sa prose», cité dans Theodor Adorno, «L’essai comme forme», art. cit., p. 23.
-
[58]
Charles Péguy, Note conjointe sur M. Bergson, op. cit., p. 1316.
-
[59]
Philippe Olivera, «Catégories génériques et ordre des livres: les conditions d’émergence de l’essai pendant l’entre-deux-guerres», 2002, p. 106. Cette stimulante étude inspirée par les travaux de Pierre Bourdieu et d’Alain Viala vaut, par extension, pour les collections qui aujourd’hui publient sous d’autres noms des essais en marge du discours universitaire, comme «L’un et l’autre», chez Gallimard, notamment.
-
[60]
Id.
-
[61]
Article «Post-modernisme», dans Paul-Louis Rossi, Vocabulaire de la modernité littéraire, 1996, p. 138.
-
[62]
Dominique Viart, «Les “fictions critiques” de Pascal Quignard», 2004, p. 27.
-
[63]
Pascal Quignard, Pascal Quignard le solitaire. Rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison, 2001, p. 162.
-
[64]
Ibid., p. 86.
-
[65]
Pascal Quignard, Petits traités, 1997, vol. I, p. 18.
-
[66]
Ibid., p. 30-31.
-
[67]
Sur cette voix mélancolique, voir Dominique Rabaté, Poétiques de la voix, 1999, p. 171 et suivantes.
-
[68]
Ibid., p. 40.
-
[69]
Ibid., p. 73.
-
[70]
Ibid., p. 72.
-
[71]
Bertrand Leclair, Théorie de la déroute, 2001, p. 41.
-
[72]
Theodor Adorno, «L’essai comme forme», art. cit., p. 27.
-
[73]
Richard Millet, Le sentiment de la langue, 2003, «Avant-propos», p. 10. «Musicale» est souligné dans le texte.
-
[74]
Id.
-
[75]
Richard Millet, Fenêtre au crépuscule. Conversation avec Chantal Lapeyre-Desmaison, 2004, p. 129.
-
[76]
L’art du bref est le titre d’une revue dirigée par Richard Millet il y a plusieurs années.
-
[77]
Richard Millet, Fenêtre au crépuscule, op. cit., p. 132.
-
[78]
Yannick Haennel, «Préface», dans Richard Millet, Le sentiment de la langue, op. cit., p. 9.
-
[79]
Voir en particulier le bilan que dresse Antoine Compagnon dans Le démon de la théorie, 2000. Cet ouvrage, souvent invoqué en France par ceux qui, à divers titres, prônent le relativisme théorique, laisse précisément ouverte la question du discours théorique.
-
[80]
Bertrand Leclair, Théorie de la déroute, op. cit., p. 12.
-
[81]
Nancy Huston, Professeurs de désespoir, 2004, p. 164.
-
[82]
Ibid., p. 133-165.
-
[83]
Ibid., p. 109.
-
[84]
Ibid., p. 14. Nancy Huston s’approprie en la retournant contre son auteur l’hypothèse de Thomas Bernhardt d’un dieu féminin qui «serait enceinte tous les ans. Du reste qui l’adorerait» (id.).
-
[85]
Voir Robert Major, «Le recueil d’essais ou l’ombre de Montaigne», 1999, p. 13-36.
-
[86]
Nancy Huston, Professeurs de désespoir, op. cit., p. 353.
-
[87]
Nancy Huston, Âmes et corps, 2004, «Note aux lecteurs», p. 9.
-
[88]
Ibid., p. 22.
-
[89]
Voir plus haut la citation de Bertrand Leclair.
-
[90]
Florence Delay, La séduction brève, 1997, p. 11.
-
[91]
Ibid., p. 20.
-
[92]
Ibid., p. 68.
-
[93]
Ibid., p. 204.
-
[94]
Roland Barthes en appelait à une critique qui serait la recherche des intensités. Voir Préparation du roman, 2003, p. 178.
-
[95]
Florence Delay, La séduction brève, op. cit., p. 12.
-
[96]
Je reprends cette suggestive formule à l’ouvrage de Jean-Louis Chrétien, Promesses furtives, 2004.
-
[97]
Michel de Montaigne, Essais, 1994, vol. I, XXV, p. 140.
Références
- Adorno, Theodor, Notes sur la littérature, Paris, Flammarion, 1984.
- Balibar, Renée, Les Français fictifs, Paris, Hachette (Littérature), 1974.
- Barthes, Roland, Critique et vérité, Paris, Éditions du Seuil, 1966.
- — — —, Préparation du roman, Paris, Éditions du Seuil, 2003.
- — — —, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil, 1954.
- Bayard, Pierre, Enquête sur Hamlet: le dialogue de sourds, Paris, Éditions de Minuit, 2002.
- Benjamin, Walter, Oeuvres, Paris, Gallimard (Folio), 2000 (trad. de R. Rochlitz, M. de Gandillac et P. Rusch).
- Benveniste, Émile, Le vocabulaire des institutions européennes, Paris, Éditions de Minuit, 2 vol., 1969.
- Bergson, Henri, L’évolution créatrice, Paris, Presses universitaires de France (Quadrige), 1983.
- Brée, Germaine et Édouard Morot-Sir, Du surréalisme à l’empire de la critique, Paris, Arthaud (Histoire de la littérature française), 1984.
- Burac, Robert, Charles Péguy. La révolution et la grâce, Paris, Robert Laffont, 1994.
- Chrétien, Jean-Louis, Promesses furtives, Paris, Éditions de Minuit, 2004.
- Compagnon, Antoine, Le démon de la théorie, Paris, Éditions du Seuil, 2000.
- Delay, Florence, La séduction brève, Paris, Gallimard, 1997.
- Friedrich, Hugo, Montaigne, Paris, Gallimard (Tel), 1984.
- Glaudes, Pierre (dir.), L’essai: métamorphoses d’un genre, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2002.
- — — — et Jean-François Louette, L’essai, Paris, Hachette Supérieur (Contours littéraires), 1999.
- Huston, Nancy, Âmes et corps, Arles / Montréal, Actes Sud / Leméac, 2004.
- — — — Professeurs de désespoir, Arles / Montréal, Actes Sud / Leméac, 2004.
- Kauffmann, R. Lane, «La voie diagonale de l’essai: une méthode sans méthode», Diogène, n° 143 (1988), p. 68-93 (trad. de M.-A. Béra).
- Latour, Bruno, «Pourquoi Péguy se répète-t-il?», dans Péguy écrivain, Paris, Klincksieck, 1977, p. 77-102.
- Leclair, Bertrand, Théorie de la déroute, Paris, Éditions du Seuil, 2001.
- L’invention critique, Paris — Lyon, Cécile Defaut — Villa Gillet, 2004.
- Macé, Marielle, «Le nom du genre: quelques usages de l’“essai”», Poétique, n° 132 (novembre 2002), p. 401-414.
- Major, Robert, «Le recueil d’essais ou l’ombre de Montaigne», dans François Dumont (dir.), La pensée composée, forme du recueil et constitution de l’essai québécois, 1999, p. 13-36.
- Martin, Jean-Pierre, «La critique et la voix: la double injonction», Études françaises, vol. XXXIX, n° 1 (2003), p. 13-23.
- Meschonnic, Henri, Pour la poétique II , Paris, Gallimard, 1973.
- Millet, Richard, Fenêtre au crépuscule. Conversation avec Chantal Lapeyre-Desmaison, Paris, La Table Ronde, 2004.
- — — —, Le sentiment de la langue, Paris, La Table Ronde, 2003 [1993].
- Montaigne, Michel de, Essais, Paris, Presses universitaires de France, 3 vol., 1994 (éd. de V.-L. Saulnier).
- Olivera, Philippe, «Catégories génériques et ordre des livres: les conditions d’émergence de l’essai pendant l’entre-deux-guerres», Genèses, n° 47 (juin 2002), p. 84-106.
- Péguy mis à jour, Québec, Presses de l’Université Laval, 1976.
- Péguy, Charles, Oeuvres en prose complètes, 1909-1914, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1961 (éd. de M. Péguy).
- Proust, Marcel, Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard (Idées), 1954 (éd. de B. de Fallois).
- — — —, Correspondance, Paris, Plon, 21 vol., 1970-1992 (éd. de P. Kolb).
- Quignard, Pascal, Pascal Quignard le solitaire. Rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison, Paris, Les Flohic éditeurs, 2001.
- — — —, Petits traités, Paris, Gallimard (Folio), 2 vol., 1997.
- Rabaté, Dominique, Poétiques de la voix, Paris, José Corti, 1999.
- — — —, «Vérité et affirmation chez Pascal Quignard», Études françaises, vol. XL, n° 2 (2004), p. 77-85.
- Roger, Jérôme, Henri Michaux, poésie pour savoir, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000.
- Rossi, Paul-Louis, Vocabulaire de la modernité littéraire, Paris, Minerve, 1996.
- Thibaudet, Albert, Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, Paris, Stock, 1936.
- Todorov, Tzvetan, Critique de la critique: un roman d’apprentissage, Paris, Éditions du Seuil, 1984.
- Viart, Dominique, «Les “fictions critiques” de Pascal Quignard», Études françaises, vol. XL, n° 2 (2004), p. 25-37.
- Vigne, Éric, L’essai, Paris, Ministère des Affaires étrangères, 1997.

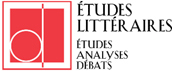
 10.7202/006738ar
10.7202/006738ar