Résumés
Résumé
Polyphonique, l’ironie s’avère une communication fragile. L’article traite des stratégies du discours ironique dans ses rapports avec le malentendu. La réflexion porte sur Le nez qui voque de Ducharme. Dénaturalisée, la voix narrative ne possède pas de signaux univoques garantissant la réception ironique. C’est pourquoi il convient d’envisager aussi l’autre voie, celle du mal, de l’illégitime et de l’invective littéraire. Obligeant le lecteur à séjourner dans l’inconfort de l’irrésolu, Ducharme atteint un certain idéal ironique.
Abstract
Polyphonic by nature, irony is a threat to communication. This article examines the strategies of ironic discourse with respect to the misunderstanding. It focuses on Réjean Ducharme’s Le nez qui voque. In fiction, the narrative voice doesn’t include unequivocal signals of irony, which is why we will study another strategy : invective. Aiming to create a text that remains undecidable, Ducharme reaches a certain ideal form of irony.
Corps de l’article
“ Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. — Et je l’ai trouvée amère. — Et je l’ai injuriée. ”
Rimbaud, Oeuvres complètes.
“ Je ne suis pas responsable de moi et ne peux le devenir. Comme tout ce qui a été fait, comme la chaise et le calorifère, je n’ai rien à répondre de rien. ”
Réjean Ducharme, L’avalée des avalés.
Provocateur et excessif, Réjean Ducharme demeure l’une des figures les plus dérangeantes de la littérature québécoise. La position marginale dans laquelle s’est placé cet auteur amène à poser sur l’oeuvre un regard critique prudent. De fait, refusant le commentaire, Ducharme soumet son écriture à une tension, souvent insoutenable, éprouvant l’engagement (ou le désengagement) de la parole fictionnelle. La présente étude propose de comprendre le malentendu comme une stratégie essentielle de la production ducharmienne. Pour nourrir notre réflexion, nous choisissons son deuxième roman, Le nez qui voque paru en 1967, puisqu’il s’agit de son texte le plus explicitement équivoque. Ce roman suscite un questionnement sur l’emploi et la réception de l’ironie, car il se présente comme un procédé complexe dont la portée s’avère toujours plurielle. L’accueil de l’ironie est variable d’un lecteur à l’autre de sorte qu’il importe d’aussi envisager la possibilité limite de cette forme d’énonciation : l’invective.
Pour interroger la forme de l’ironie, on doit montrer en quoi et sur quoi porte l’acte énonciatif et de quelle façon il opère dans la perspective restreinte de la “ parole romanesque[1] ” de Ducharme. Aussi, notre démarche analytique sera double, visant à appréhender le projet de la parole ironique et la représentation fictionnelle allant de l’ironie[2] à l’invective.
Le projet de la parole ironique
Le langage s’appuie sur un univers de contraintes dont les exigences prévoient d’éventuels emplois “ déviants ”. Dans L’énonciation. De la subjectivité dans le langage Catherine Kerbrat-Orecchioni rappelle qu’il importe de placer au centre de la théorie linguistique les “ ratés ” de la communication. Posture d’énonciation particulière, l’ironie implique un discours antiphrastique et suppose donc un engagement argumentatif ambigu. Disant une chose, mais désirant faire entendre le contraire, l’énoncé ironique travaille deux arguments contradictoires. De ce fait, l’ironie “ ne saurait être, automatiquement, unique et univoque […][3] ”. Il s’avère que cette “ polyphonie énonciative[4] ” encourage de nombreux problèmes de réception. L’énonciation se présente ici comme un phénomène dialogique qui nécessite des partenaires, une médiation, une intentionnalité et une réversibilité, si bien qu’elle appelle un réajustement permanent dans l’échange verbal.
Interpréter le discours ironique consiste alors à “ reconstituer par conjecture l’intention sémantico-pragmatique ayant présidé à l’encodage[5] ”. Dans l’énonciation en contexte réel, cette opération pose déjà problème. La réception de tout discours dépend des compétences du récepteur, qui varient en fonction des déterminations psychologiques, psychanalytiques, culturelles et idéologiques. La compréhension d’un énoncé nécessite une certaine homologie des valeurs esthétiques et sociales entre les actants du dialogue. L’émetteur évalue le récepteur pour en faire son partenaire dans la relation d’allocution. Aussi, les opérations d’encodage sont partiellement déterminées par l’image que l’émetteur se construit du récepteur. Cependant, cette représentation ne garantit pas les conditions d’efficacité du message de sorte que la communication risque toujours d’avorter.
Le discours ironique constitue un cas particulièrement problématique de communication. Constituée de paradoxes, de contrastes et d’inversions, l’ironie se révèle “ une communication fragile, à hauts risques, qui présente plusieurs dangers[6] ”, tels que des malentendus divers, voire une non-réception du message. Selon Philippe Hamon, cette ambiguïté intrinsèque distinguerait le discours ironique du “ discours sérieux ” dont les actants craignent la polysémie. Ils souhaitent plutôt produire “ un message monologique, compréhensible par tous[7] ”. Reposant sur une infraction, l’ironie est vue comme “ dia-bolique ” ou “ sadique ” par le discours sérieux :
[…] pour la plupart de ces discours d’autorité, l’ironie serait volontiers dia-bolique (ce qui s’oppose au sym-bolique univoque et à finalité consensuelle du discours religieux par exemple), dans la mesure où un discours ironique est toujours susceptible de “ mauvaise interprétation ”. C’est bien d’herméneutique qu’il s’agit : toute mauvaise interprétation peut être aisément taxée d’hérésie, pose le problème de l’hérésie, est à la limite proche du blasphème[8].
Alain Berrendonner insiste également sur le caractère inadmissible de la parole équivoque :
Sadisme sémiologiquement licite, qui consiste à plonger le destinataire dans l’incertitude du sens, de telle sorte que, s’il est sérieux au point de ne pas tolérer l’équivoque, il se trouvera dans l’obligation de choisir lui-même, de prendre le risque d’une interprétation “ personnelle ”, c’est-à-dire de présumer de la valeur de l’énonciation sans pouvoir se fonder en rien sur les caractéristiques propres de cette énonciation. La parole ironique, comme toute performance paradoxale ou contradictoire, est sibylline : on sait qu’elle veut dire quelque chose, mais elle ne permet pas de savoir quoi[9].
L’ironiste place le destinataire dans une position inconfortable. Directement confronté à ses compétences (ou incompétences) linguistiques, le récepteur du discours ironique doit apprendre à se contenter de l’incertain. Il ne saurait se dispenser d’entretenir un doute : a-t-il bien saisi les enjeux du message ? C’est précisément de cette inquiétude que se joue Ducharme dans Le nez qui voque.
La représentation romanesque
De l’ironie…
Fondé sur un jeu phonétique d’une subtilité relative (ou elle-même ironique), le titre du roman Le nez qui voque offre l’équivoque comme figure maîtresse du récit. La générosité que suppose cette clé de lecture semble louche au lecteur ducharmien, qui a appris à se méfier des raisonnements faciles avec Bérénice, la première héroïne de Ducharme. Mais, ne craignons pas “ d’aller loin dans la niaiserie[10] ”, tentons de “ continuer ainsi pendant deux cents pages[11] ” et suivons un moment cette piste de lecture.
Le terme “ équivoque ”, issu du latin aequivocus, composé de aequus (égal) et de vox (parole, mot), signifie “ à double sens ”. Appliquée à un texte littéraire, cette particularité s’oppose aux attentes de la lecture. De fait, si, comme le soutient Jacques Derrida, la littérature n’a pas d’essence et accueille autant le légitime que l’illégitime[12], les différents acteurs du champ littéraire — les lecteurs (et les non-lecteurs), les éditeurs, la critique, les écrivains, etc. — entretiennent néanmoins une conception du romanesque désirant une écriture lisible, qui suppose une certaine clarté, une précision, une cohérence. Accordant une place centrale à l’équivoque, Le nez qui voque se présente donc comme une oeuvre dont la construction et la matière s’inventent à rebours des attentes du lecteur.
Le nez qui voque propose l’histoire d’un couple d’adolescents, Mille Milles et Chateaugué, qui décident de cohabiter quelque temps comme frère et soeur avant de mettre à exécution leur pacte de suicide. Après bien des malentendus, seule Chateaugué mettra fin à ses jours, provoquant chez Mille Milles un rire exprimant un double bind[13], un rire déplacé :
Chateaugué est morte. Elle s’est tuée, la pauvre idiote, la pauvre folle ! Si elle s’est tuée pour m’attendrir, elle s’est tuée pour rien, elle a manqué son coup. Je m’en fiche ! J’ai failli m’évanouir quand j’ai ouvert la porte, mais maintenant je ne sens plus rien. J’ai comme envie de rire[14].
Le personnage de Mille Milles, usant d’un langage excessif, invite à une réception ironique. Inacceptable, le système de valeurs qu’incarne ce narrateur homodiégétique porte à supposer l’ironie à tous les détours du discours, de sorte qu’il rend l’étude du procédé à la fois excitante et vertigineuse. En conséquence, disposer d’un passage particulièrement significatif devrait nous permettre de mener à bien notre entreprise sans prétendre circonscrire le procédé :
Une femme, c’est comme un cheval ; ce n’est bon qu’à échanger contre des moutons. Une femme, c’est comme un écureuil ; c’est beau. Une femme, c’est plus grand qu’une allumette. Je pourrais continuer ainsi pendant deux cents pages. Avoir une belle femme, c’est comme avoir un beau cheval. Les hommes qui se mettent à genoux aux pieds des femmes sont des hommes qui se mettent à genoux devant leur propre pénis : ce sont des maniaques, des obsédés sexuels. La femme peut être prêtée, échangée, vendue, perdue et donnée, comme un cheval. Plus la femme est belle, plus elle vaut cher. Mettre la femme sur un pied d’égalité avec l’homme, c’est comme mettre un écureuil sur un pied d’égalité avec l’homme. Les femmes gagnent souvent contre les hommes, mais seulement quand l’homme accepte de jouer le jeu de la femme. […] La femme est devenue insolente. Elle est glorifiée par la police, la magistrature et le Conseil législatif. La femme la plus insolente est celle qui a le plus beau derrière. Plus son derrière est beau, plus elle fait la grave et l’intouchable. La femme mesure son importance à la beauté de son derrière ; c’est pourquoi elle méritait son esclavage. La femme qui n’a pas un beau derrière se méprise, est humble. Beau derrière est égal à beau visage. La beauté du visage n’a d’autre mérite que d’exciter à la convoitise du derrière. La galanterie est fondamentalement sexuelle, puisqu’elle ne peut être exercée que par un membre de sexe masculin. La galanterie doit donc être jugée comme on juge le reste du sexuel, les revues pornographiques incluses. Dire que la femme est magnifique et que le sexuel est horrible, c’est dire deux choses contraires au sujet d’une même chose. Voilà, Madame. […] Une femme n’a rien à accorder. La femme n’a qu’à se taire et jouir, ou souffrir, selon le cas, des faveurs de l’homme. La femme est comme l’homosexuel, est une sorte d’efféminée exhibitionniste et ridicule qui ne peut penser qu’aux hommes. La lesbienne n’est pas comme l’homme ; elle est exhibitionniste. J’en ai assez. Pan ! Pan ! Pan ! Les acteurs sont comme les femmes : s’exhiber. Pan ! Pan ! Pan[15] !
Dans ce passage, Mille Milles fait exploser sa vision des femmes. Sous le couvert d’un discours argumentatif misogyne sont attaquées diverses instances — dont les institutions sociales, la littérature, la pornographie, l’homosexualité, l’art —, si bien que s’imposent différents discours de l’exclusion. Cet extrait possède une pluralité de sens permettant de le rendre exemplaire.
Il importe d’insister sur la fictionnalité du discours. En effet, le propos ironique acquiert une portée spécifique parce qu’il est envisagé dans un contexte romanesque. Ici, l’ironie se révèle une communication différée, de sorte qu’elle pose le problème de l’intégration du verbal dans un système sémiotique scriptural. Résultante d’un ensemble de faits de nature lexicale, syntaxique et illocutoire, l’ironie romanesque se présente comme un véritable point de mire du discursif et du diégétique, du réel et du fictif :
Cette double orientation [extratextuelle et intratextuelle] explique […] la complexité de la parole romanesque “ qui ne se laisse point approcher en termes, unilatéraux, de mimésis pure, qui relève de l’oral tout en étant sanctionnée par le scriptural, qui est susceptible à la fois de reproduire le système pragmalinguistique en vigueur dans le hors texte, de “ dire vrai ”, et de provoquer des décrochages par rapport à ce même système, de “ dire plus ou moins vrai ” […] ”[16].
Dans un contexte fictionnel, la communication est complexe parce que l’énonciateur se dédouble en un sujet extratextuel (l’auteur) et un sujet intratextuel (le narrateur) de même que le lecteur effectif se double d’un récepteur fictif inscrit dans l’énoncé. Ces nouveaux actants se présentent comme autant d’écrans venant compliquer la réception du discours. De fait, Hamon envisage le texte littéraire comme un “ carrefour d’absences[17] ”, parce que la parole n’est pas naturalisée et que la destination n’est pas unique, si bien qu’il est par essence lié au malentendu. Dans le passage étudié, Mille Milles est un locuteur fictionnel problématique parce que l’opiniâtreté de son discours l’apparente à la parole essayistique.
Mimant une progression argumentative, le personnage construit de façon stratégique un discours circulaire de l’imposition. De ce point de vue, le passage où est défendue l’inégalité entre les hommes et les femmes est exemplaire. Mille Milles soutient :
Mettre la femme sur un pied d’égalité avec l’homme, c’est comme mettre un écureuil sur un pied d’égalité avec l’homme. Les femmes gagnent souvent contre les hommes, mais seulement quand l’homme accepte de jouer le jeu de la femme. Les hommes perdraient tout le temps contre les chevaux et les écureuils s’ils acceptaient de jouer le jeu des écureuils et des chevaux.
Le personnage parodie ici le discours essayistique, puisque les arguments s’avèrent vains, les indices d’une progression de la pensée sont inutiles et la quête n’aboutit pas. L’écriture génère une force centrifuge exerçant une pression sur toutes les lignes du discours, les obligeant à se courber afin de rendre impossible tout raisonnement linéaire et causal. Le premier lieu de l’ironie se situe donc dans la construction du discours qui tourne en dérision les procédés du discours argumentatif. Notons cependant que ce procédé énonciatif n’altère pas forcément la valeur polémique du propos.
L’ambivalence générique nargue le lecteur et encourage l’attribution du discours au signataire du roman. Mais, la nature particulière de la parole romanesque interdisant cette équivalence, l’origine énonciative demeure invérifiable. De même, la formule d’adresse “ Voilà, Madame ”, apparaissant dans la conclusion du passage, est un marqueur problématique. L’apostrophe laisse croire que le narrateur-personnage, dans un ultime mouvement provocateur, adresse directement son discours aux femmes. Pourtant, l’interprétation de cette destination n’est pas univoque. S’entendant de la même façon que la formule impersonnelle “ Oui, Madame ” servant souvent de surenchère aux argumentations orales et populaires, l’expression “ Voilà, Madame ” de Mille Milles pourrait se révéler être une clôture cliché plutôt qu’un indice du récepteur envisagé.
La voix énonciative se trouve délocalisée dans le discours fictionnel du Nez qui voque. Aussi, pour que l’ironie soit comprise, la narration doit se ponctuer de signaux qui posent une distance par rapport au propos et remplacent ainsi les mimiques de l’ironiste “ réel ”, par “ nostalgie du corps perdu[18] ”, dit Hamon. Le marqueur le plus explicite de l’ironie romanesque dans Le nez qui voque est assurément l’exagération. Dans le passage précédent, le discours de Mille Milles est si radical, si dur, qu’il ne saurait être pris au pied de la lettre. Argumentation exagérée, le plaidoyer de Mille Milles incite à la recherche des marqueurs de l’ironie.
Le recours à des figures rhétoriques voyantes telles la comparaison et la métaphore est une importante stratégie du discours ironique. La comparaison est la figure sur laquelle se fonde principalement le discours de Mille Milles. La première partie de l’extrait file la comparaison entre la femme et l’animal. Perdant son humanité, la femme est mise en parallèle avec des bêtes possédant une valeur marchande, le mouton et le cheval, mais également avec l’écureuil, animal généralement jugé vif et agile. L’incongruité de cette dernière association fissure le système argumentatif, ce qui fait poindre l’ironie. Par ailleurs, le bizarre lien entre la femme et l’écureuil entraîne une comparaison encore plus inintelligible avec “ une allumette ” — faut-il y voir l’allusion à la femme “ allumeuse ” ? — poussant en définitive le narrateur à cette boutade : “ Je pourrais continuer ainsi pendant deux cents pages. ” La désinvolture dont fait ici preuve Mille Milles invite à une réception détendue du discours misogyne qui suit. Cette posture d’énonciation pourrait ainsi dévoiler l’ironie du discours.
Les premières et les dernières propositions de Mille Milles supposent des formulations totalitaires incitant à la réception ironique. Par exemple, l’expression exclusive “ ce n’est bon qu’à ” trahit une faiblesse argumentative laissant croire à une conviction incertaine du locuteur. De même, à la fin de l’extrait proposé, l’assertion “ La femme est comme l’homosexuel, est une sorte d’efféminée exhibitionniste et ridicule qui ne peut penser qu’aux hommes ” accumule dans une construction syntaxique bancale des termes insultants si peu convaincants qu’ils en deviennent risibles : la femme est “ efféminée ”, clame Mille Milles… certes. Dans ce cas, l’ironie n’est pas intrinsèque à la parole, elle est plutôt garantie par la réception. Supposé moqueur, le jugement du destinataire renverse la valeur des opinions.
L’argumentation construisant la partie centrale de notre passage enrichit le cliché de la femme-objet. Dans un mouvement métonymique attendu, la femme est réduite à son — plus ou moins — joli arrière-train. Le choix du mot “ derrière ” est ici significatif. De fait, il s’entend comme un euphémisme enfantin évoquant avec pudeur les fesses de la femme. La puérilité du terme “ derrière ” trahit l’inexpérience constitutive du personnage de Mille Milles et discrédite du même coup les qualités provocantes de son discours. Devant détourner le langage pour traiter la sexualité, le jeune homme révèle les tabous qui le torturent depuis le début du roman :
Maintenant que le sexuel s’en mêle, cela ne va plus. La cochonnerie. Depuis que le sexuel est en moi, je suis écoeuré, je suis infect envers moi-même et pour moi-même. Je ne suis plus pur, voilà pourquoi je me tue, voilà pourquoi je ne peux plus souffrir mon mal de l’âme, voilà pourquoi je pense que je ne vaux plus la peine que j’aie mal. Je ne peux plus tenir le coup, mais ce n’est pas par manque de courage : c’est parce que le sexuel rend infect, c’est parce que je n’en vaux plus la peine. Est-ce clair ? Est-ce assez clair[19] ?
Si limpide soit-elle, cette explication trouve de nombreux échos dans le roman. À ce titre, le passage étudié reprend le même code moral voulant que la sexualité soit condamnable et donc que la femme — toujours héritière de Lilith : “ Il n’y a rien de plus vil, de plus hypocrite, de plus poison, de plus serpent que les femmes[20] ” — le soit également. Aux prises avec des désirs contradictoires — “ Je veux la femme, l’impureté. Je veux l’impureté aussi sauvagement que je la repousse[21] ” —, le personnage soutient un discours incohérent dont l’agressivité pourrait être imputable à son jeune âge. La maladresse du discours de Mille Milles provoquerait la réception ironique.
Néanmoins, dans l’extrait proposé, l’écriture ne possède pas suffisamment de marqueurs univoques (“ déformations d’expression, emploi déviant de signes typographiques, hyperbole, modalisations, permissio, implications contextuelles contrariantes… etc. [22] ”) pour conclure que l’ironie se trouve à l’état latent dans le texte analysé. Dans son étude sur la sémiologie de l’ironie dans l’oeuvre de Ducharme, Pierre-Louis Vaillancourt conclut que “ pour admettre une ironie généralisée, en quelque sorte, il faut supposer que le discours du “ socius ” est unique et uniforme, ce qui n’est pas le cas, car il est aussi tissé de contradictions ”. Il ajoute toutefois “ Une lecture supra-segmentaire de l’ironie qui ne ferait pas appel à un référent extra-textuel reste cependant possible. Il suffit de noter les répétitions ou les contradictions, qui s’établissent dans l’ensemble de l’oeuvre[23]. ” Selon nous, c’est plutôt la lecture critique qui, souhaitant désamorcer ce discours illégitime, suppose une intention ironique et entreprend le renversement des valeurs du discours. Rien dans le discours de Mille Milles ne permet sans conteste de désamorcer la parole, il n’y a pas d’absolu révélant la polysémie du discours agressif.
Si les exagérations invitent à une réception ironique de la parole de Mille Milles, elles deviennent également un facteur de malentendus. En effet, le discours du personnage se développe selon un axe d’intensité passant du sourire caché au rire dédaigneux, voire à l’invective littéraire. Les exclamatifs “ Pan ! Pan ! Pan ! ”, évoquant par onomatopée la détonation du revolver, demandent une relecture entraînant cette fois la parole romanesque dans la sphère risquée de la violence verbale.
… à l’invective
La rencontre conflictuelle présume des conditions d’énonciation extrêmes. Soulevant des passions, le conflit ne s’embarrasse pas de considérations éthiques ou morales :
L’invectiveur transgresse cet axiome social selon lequel la violence par sensibilité aux idées se tempère quand elle atteint la personne, ou la vie privée et sans doute, il flatte un désir inconscient du public qui trouve une jouissance à faire fi des règles élémentaires que la vie sociale impose à la violence de chacun[24].
L’hostilité animant les acteurs de l’échange agonistique leur fait littéralement “ perdre la raison ” dans la mesure où le raisonnement implique une logique de l’urgence selon laquelle tous les coups sont permis. Le combat emprunte les voies d’un discours performatif[25] dont la visée extrême consiste alors à tuer l’autre par les mots.
Dans la société occidentale moderne, l’invective s’avère un comportement illégitime, déviant, irrecevable, ne correspondant pas aux normes et aux critères d’acceptabilité établis. Mais, l’illégitime est un concept essentiellement social. Au quotidien, des règles implicites régissent le comportement et le langage selon des usages établis par chaque culture. Ceux que Nietzsche appelle les “ troupeaux humains ” — c’est-à-dire les associations humaines, les diverses institutions privilégiant “ l’instinct de l’obéissance ” au détriment de “ l’art de commander[26] ” — prescrivent l’acceptable. Ils garantissent et définissent la légitimité.
Cependant, cet équilibre est précaire. L’ordre social repose sur une base instable puisqu’il suscite un comportement ambivalent à l’égard de l’interdit qui suppose des désirs de transgression, puisque la désobéissance exige aussi l’acquisition d’un pouvoir :
L’homme qui a transgressé un tabou devient lui-même tabou parce qu’il a la dangereuse capacité de susciter chez autrui la tentation de suivre son exemple. Il éveille l’envie : pourquoi ce qui est défendu aux autres lui serait permis ? Il est donc réellement contagieux dans la mesure où chaque exemple incite à l’imitation et c’est pourquoi lui-même doit être évité[27].
Si la principale fonction sociale du tabou est de protéger, l’invective cherche au contraire à exposer au danger. Mais il semble que la transgression possède également ses propres tabous. Il est en effet des identités — les femmes, les marginaux, les personnes handicapées, les “ minorités visibles ”, etc. — que la violence se refuse généralement de toucher. Celui qui brave les interdits des interdits, qui refuse tous les degrés de tabous et qui s’attaque à ces individus, s’expose doublement aux foudres de l’opinion publique. Pour retrouver l’ordre social, on doit proposer une solution à cette forme d’hybris : une catharsis. Les excès et les transgressions apparaissent alors sous un nouveau jour, ils deviennent purgatoires. Le mal mène au bien. Tout est en ordre.
Et si ce n’était pas le cas ? Si l’agression, et particulièrement l’agression des entités intouchables, n’avait pas de finalité ? Si l’illégitime ne constituait pas une autre voie pour la purification ? Si le meurtre parfait et gratuit existait ?
Ce sont, semble-t-il, des questions que pose l’argumentation de Mille Milles. D’un point de vue pragmatique, l’invective engage trois actants abstraits. Et cette relation triangulaire construit un petit théâtre dans lequel se produit la violence. La situation conflictuelle primitive exige qu’un injurieur adresse à un injuriaire un message impliquant un injurié, qui peut être l’injuriaire lui-même ou un référent extérieur. Cette nomination est empruntée aux travaux d’Evelyne Larguèche, qui nomme ainsi le destinateur, le destinataire et le référent de la violence verbale[28].
L’invective s’envisage comme un acte performatif impliquant un ethos ou un pathos agressifs. En outre, une invective s’avère une parole intentionnellement agressive ou une parole entendue comme une agression. L’ethos et le pathos agressifs apparaissent comme des paramètres essentiels à la définition de la violence verbale, mais leur examen dans le contexte particulier de la fiction se révèle délicat, car la parole romanesque n’est pas naturalisée — par opposition à la parole pamphlétaire ou essayistique, par exemple.
L’ethos de l’invective est supposé violent, agressif, alors que l’ethos de l’ironie, lui, est interprété comme moqueur, méprisant ou dédaigneux. La frontière entre les deux états émotifs paraît bien mince, de sorte qu’il n’est pas impossible que des paroles ironiques fonctionnent pragmatiquement comme des invectives, puisque l’évaluation détermine dans les deux cas les conditions d’efficacité de ces actes d’énonciation. Aussi, l’invective ne saurait être réduite à un échantillonnage de phrases insultantes, à une somme de figures spécifiques. Dans ce cas, des énoncés ironiques peuvent aisément devenir des invectives.L’univers de l’échange verbal reproduit dans le texte du Nez qui voque se structure comme un espace conflictuel où se déploient des dispositifs stratégiques dont les enjeux sont problématiques. Dans ce cas, Mille Milles injurieur dirige essentiellement sa violence contre les femmes qui sont les principales injuriées, mais attaque aussi au passage “ la police, la magistrature et le Conseil législatif ”, “ l’homosexuel ” et “ l’acteur ”. Ces digressions rappellent une opinion revendiquée par le personnage au début du roman :
Les Canadiens français qui administrent des salles de cinéma sont des ignorants ; ils sont responsables de la mauvaise réputation des Canadiens français auprès des Français de France, qui devraient passer toute leur vie en France. Et, à cause des homosexuels nombreux dans la rue Saint-Laurent, sur le boulevard Saint-Laurent, tous les homosexuels américains pensent que tous les Canadiens français sont des homosexuels. Mon cousin, qui a fait de l’auto-stop aux États-Unis, m’a dit que tous les homosexuels qui l’embarquaient le comptaient de leur bord aussitôt qu’il leur disait qu’il était Canadien français.
— Montréal ! s’écriaient-ils, m’a confié mon cousin. Et ils débouclaient leur ceinture de sécurité[29].
Le lien entre le cinéma, la politique et les homosexuels paraît donc constitutif de la vision du monde prêtée à Mille Milles.
Ces convictions agressives ne se destinent néanmoins pas à un injuriaire clairement défini. La présence du personnage de Châteaugué lors de la tirade contre les femmes est incertaine, si bien qu’il n’est pas possible d’en faire l’injuriaire unique. Ce flou laisse envisager plusieurs situations d’énonciation possibles dans le contexte fictionnel. Les relations variables entre les actants de l’échange verbal modifient la situation d’énonciation.
L’ethos agressif laisse croire qu’il s’agit d’un monologue violent dont les destinataires ne sont pas clairement définis. Pour que l’invective se réalise, elle doit affecter un injuriaire. Dans le contexte romanesque, la situation monologique, multipliant les injuriaires potentiels, suppose une double réception. Sur le plan fictionnel, l’invective s’adresse aux autres instances représentées, en l’occurrence les personnages de Châteaugué et de Questa, les deux femmes les plus proches de Mille Milles. Dans cette éventualité énonciative, l’agressivité de l’adolescent participe de la construction du personnage. En outre, la situation du discours sans destinataire précis fait intervenir une seconde réception, métadiégétique.
Dans la situation du monologue agonistique fictionnel, le lecteur s’avère un injuriaire potentiel, même s’il n’est pas défini dans le discours comme l’injurié. L’ouverture de la situation d’énonciation offre au lecteur un rôle dans l’échange verbal. Complice ou agressé par les propos misogynes, homophobes et anti-intellectualistes de l’injurieur, le lecteur injuriaire offre de nouvelles voies à l’outrage. Dans ce cas, le pathos crée l’invective.
Cette possibilité d’agression repense la portée du discours fictionnel. Le narrateur ébranle le lecteur d’une agression qui n’est plus de l’ordre de la fiction. Pourtant, des linguistes comme Éric Beaumatin soutiennent que l’invective dans le contexte fictionnel s’avère de “ l’invective en dentelle[30] ”. Cette appellation ne semble que partiellement satisfaisante. Féminisant le procédé, le théoricien lui donne un sens péjoratif, rendant la notion inoffensive. Ce renversement de la sexualité liée à l’invective est très représentatif d’une certaine conception de la littérature et du monde. Dans un contexte réel, l’invective est volontiers associée aux lieux typiquement masculins comme la caserne ou la taverne. Mais, envisagée dans le contexte romanesque, l’invective “ fait dans la dentelle ”, elle devient alors féminine et donc innocente.Cette conception de l’invective littéraire met l’accent sur l’illusion de la représentation. Traduite dans le contexte romanesque, la parole violente serait une contrefaçon. À cet égard, la difficulté du projet de la parole violente romanesque se développe en parallèle avec le problème plus général de la mimesis littéraire. Selon Roland Barthes, le réel n’est pas représentable : “ c’est parce que les hommes veulent sans cesse le représenter par les mots, qu’il y a une histoire de la littérature[31]. ”
La non-correspondance avec le réel constitue le défaut originaire du langage. Compte tenu de ce défaut, la représentation littéraire ne peut reproduire la réalité. Ainsi, la mimesis ne copie pas le réel, elle le contrefait à la façon du mime : “ Que fait un mime ? Il fait, au sens de … mimer. Il donne à reconnaître ce qu’il n’est pas. Il lui manque par exemple les ailes et il fait l’oiseau. Il les “ représente en leur absence ” [32] ”, explique le poète Michel Deguy.
Impliquant des partenaires réels et fictifs, présents et absents, la communication fictionnelle peut être envisagée comme un espace complexe où la rencontre n’est toujours que partielle. Néanmoins, ce nouveau schéma de la communication n’empêche pas l’invective de s’accomplir en tant qu’acte de langage. S’il est impossible d’associer des paroles fictionnelles à l’auteur concret, il serait également inacceptable de ne pas les entendre sous prétexte qu’elles sont fictionnelles. Puisque la finalité de la violence verbale s’accomplit dans la réception, le récepteur garantit les conditions d’efficacité. Aussi, la distance mimétique ne désamorce pas forcément l’invective ; il semble plutôt qu’en transformant le dispositif pragmatique, l’invective littéraire multiplie les réceptions ce qui permet d’atteindre différents types de cibles. La représentation romanesque de l’invective en fait une performance de l’ordre du théâtral. Et, au théâtre, l’énonciation peut produire une rencontre entre le fictif des comédiens et le réel du spectateur. À terme, l’invective littéraire se révèle posséder le même pouvoir performatif.
Conclusion
Dans le contexte fictionnel, l’ironiste risque de rebuter le lecteur, mais il établit aussi une relation dont l’aspect conflictuel, nécessairement ludique malgré tout, contribue au plaisir de sa lecture. De fait, l’ironie est une parole élitiste impliquant une sélection des lecteurs. Excluant les naïfs, cette forme crée une communauté souriante de sorte que par un chemin détourné, l’ironiste obtient le crédit d’un certain lectorat. Se réclamant de l’équivoque, l’écriture du Nez qui voque demande au lecteur élu de séjourner dans l’inconfort de l’irrésolu. Le lecteur idéal de Ducharme accepte de demeurer dans l’incertain, sans chercher à “ résoudre ” les ambiguïtés.
Déterminer si l’ethos agressif est réel ou feint n’est pas possible dans ce contexte d’énonciation. Le travail de la lecture consiste plutôt à déterminer certains ethos, ironique ou insultant, sans faire du discours un axiome, sans chercher à défendre un sens univoque. Cette demande rend l’invective indissociable de l’ironie. Les deux formes se trouvent enlacées, elles participent d’un même effet, constituant une figure unique. L’invective ne va jamais sans une pointe d’humour parce que le ludisme accompagne les passages polémiques, mais l’agression est aussi au coeur de l’ironie puisque le jeu n’est jamais innocent.
Rendant la réception univoque impossible, Ducharme atteint un certain idéal ironique. En effet, les théoriciens s’accordent pour dire que “ l’ironie est à son plus efficace quand elle est moins présentée, quand elle est quasiment in absentia[33] ”. De fait, Berrendonner va jusqu’à s’interroger : “ La meilleure ironie n’est-elle pas, au dire des amateurs, celle qui rend l’équivoque totalement insoluble[34] ? ” Dans le passage choisi, le travail du lecteur est moins de découvrir l’intentionnalité ultime de la parole romanesque que de prendre conscience de la nature profonde de la forme ironique.
Bouleversant les “ troupeaux ”, Ducharme évoque ceux que Nietzsche appelle les “ tentateurs ” :
Une nouvelle race de philosophes montent à l’horizon : je me hasarde à les baptiser d’un nom qui ne va pas sans danger. Tels que je les pressens, tels qu’ils se laissent pressentir — car ils appartiennent à une nature de vouloir rester des énigmes sur quelques points — ces philosophes de l’avenir voudraient avoir le droit, peut-être aussi le tort, d’être appelés des tentateurs. Ce terme même n’est en fin de compte qu’une tentative, ou, si l’on veut, une tentation[35].
Faire de Ducharme l’un de ces nouveaux philosophes serait probablement exagéré. Néanmoins, il est permis de croire que cet écrivain participe à leur avènement, qu’il rend possible leur venue non pas en trouvant de nouvelles voies vers l’absolu, mais en interrogeant la définition même de l’illégitime de l’écriture et de la vie :
Nous avons constaté que l’Europe et les pays où l’influence européenne domine s’étaient mis d’accord pour l’essentiel, sur les jugements moraux : visiblement, on sait en Europe ce que Socrate ne croyait pas savoir, ce que le célèbre vieux serpent avait promis d’enseigner jadis, — on sait aujourd’hui ce qu’est le bien et le mal[36].
Exhibant des valeurs dangereuses, Ducharme doute. Soupçonnant la “ sagesse ” occidentale, il se risque à orienter son écriture vers des penchants condamnables. Investissant des registres du mal, il concourt à repenser le statut de l’illégitime. Sa production accueille aussi l’inacceptable. Elle prend toutes les libertés et elle ne retient que quelques éléments des systèmes de normes et d’orientations régissant la vie quotidienne. Tenue de recueillir aussi l’horreur, la littérature commerce avec le mal. Et cet accueil dont fait preuve la production de Ducharme n’exorcise pas le mal pour en faire du bien, il convoque plutôt les deux pôles dans leur disjonction.
Parties annexes
Note biographique
Marie-Hélène Larochelle
Boursière du F.Q.R.S.C., Marie-Hélène Larochelle prépare une thèse en cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université Bordeaux III. Son travail porte sur l’invective romanesque chez Réjean Ducharme et Louis-Ferdinand Céline. Elle possède une maîtrise et un DEA de l’Université de Bordeaux III. Elle a présenté diverses communications et articles sur Louis-Ferdinand Céline, Réjean Ducharme et Henri Michaux. Elle est chargée de cours à l’Université de Montréal et à l’Université Laval.
Notes
-
[1]
Gillian Lane-Mercier, La parole romanesque, 1989.
-
[2]
L’ironie chez Ducharme intéresse les études littéraires depuis les années 1970. Nous renvoyons notamment à la thèse d’Arlette Saheb Niedoba, L’ironie, dire et vouloir-dire chez Roch Carrier, Marie-Claire Blais, Réjean Ducharme, 1978.
-
[3]
Philippe Hamon, L’ironie littéraire : essai sur les formes de l’écriture oblique, 1996, p. 4.
-
[4]
Alain Berrendonner, Éléments de pragmatique linguistique, 1981, p. 198.
-
[5]
Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, 1980, p. 180.
-
[6]
Philippe Hamon, L’ironie littéraire, op. cit., p. 36.
-
[7]
Ibid., p. 61.
-
[8]
Ibid., p. 61.
-
[9]
Alain Berrendonner, Éléments de pragmatique linguistique, op. cit. p. 222.
-
[10]
Réjean Ducharme, La fille de Christophe Colomb, 1969, p. 48.
-
[11]
Réjean Ducharme, Le nez qui voque, 1993, p. 54.
-
[12]
Dans Demeure : Maurice Blanchot, 1998, p. 29, Jacques Derrida écrit : “ Il n’y a pas d’essence ni de substance de la littérature : la littérature n’est pas, elle n’existe pas, elle ne se maintient pas à demeure dans l’identité d’une nature ou même d’un être historique identique à lui-même. […] On peut lire le même texte — qui donc n’existe jamais “ en soi ” — comme un témoignage dit sérieux et authentique, ou comme une archive, ou comme un document ou comme un symptôme — ou comme l’oeuvre d’une fiction littéraire, voire l’oeuvre d’une fiction littéraire qui simule tous les statuts que nous venons d’énumérer. Car la littérature peut tout dire, tout accepter, tout recevoir, tout souffrir et tout simuler, elle peut feindre même le leurre, comme les armées modernes qui savent disposer de faux leurres; ceux-ci font croire à de vrais leurres et trompent les machines à détecter les simulations sous les camouflages les plus sophistiqués. ”
-
[13]
Cette notion désigne “ le fait d’être pris dans la contrainte d’une double injonction contradictoire où se maintient la plus grande tension entre les deux pôles du dilemme qui la fonde ” (Jean-Pierre Moussaron, Limites des Beaux-Arts I. À défaut — la littérature, 1999, p. 28).
-
[14]
Réjean Ducharme, Le nez qui voque, op. cit., p. 334.
-
[15]
Ibid., p. 54-56.
-
[16]
Gillian Lane-Mercier, La parole romanesque, op. cit., p. 15.
-
[17]
Philippe Hamon, L’ironie littéraire, op. cit., p. 4.
-
[18]
Ibid., p. 72.
-
[19]
Réjean Ducharme, Le nez qui voque, op. cit., p. 40.
-
[20]
Ibid., p. 135.
-
[21]
Ibid., p. 171.
-
[22]
Pierre-Louis Vaillancourt, “ Sémiologie de l’ironie : l’exemple de Ducharme ”, 1982, p. 515.
-
[23]
Ibid., p. 520.
-
[24]
Marc Angenot, La praole pamphlétaire, 1982, p. 62.
-
[25]
Le terme “ performatif ” est un emprunt des linguistes et des philosophes à l’anglais performative issu des travaux de J. L. Austin, qui, le premier, a défini les énoncés performatifs dans How to Do Things with Words (1962). Il s’agit d’énoncés de forme indicative, c’est-à-dire qu’ils se présentent comme des descriptions d’événements dont l’énonciation accomplit l’événement qu’ils décrivent. Par exemple, l’énonciation de la phrase “ Je promets de le faire ” accomplit l’action de la promesse. Seuls quelques verbes possèdent cette propriété (conseiller, décider, jouer, promettre, jurer). L’invective ne produit pas d’énoncés performatifs au sens où l’a défini J. L. Austin. Néanmoins, il s’agit d’un acte performatif, dans la mesure où son énonciation produit des effets sur les actions, les pensées ou les croyances des destinataires.
-
[26]
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Par-delà bien et mal, 1971, p. 122.
-
[27]
Sigmund Freud, Totem et tabou, 1966, p. 123.
-
[28]
Evelyne Largueche, L’effet injure. De la pragmatique à la psychanalyse, 1983, p. 12.
-
[29]
Réjean Ducharme, Le nez qui voque, op. cit., p. 20.
-
[30]
Éric Beaumatin et Michel Garcia, L’invective au Moyen Âge, 1995, p. 261.
-
[31]
Roland Barthes, Leçon, 1978, p. 22.
-
[32]
Michel Deguy, La poésie n’est pas seule, 1987, p. 144.
-
[33]
Linda Hutcheon, “ Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie ”, 1981, p. 157.
-
[34]
Alain Berrendonner, Éléments de pragmatique linguistique, op. cit., p. 222.
-
[35]
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Par-delà bien et mal, op. cit., p. 59
-
[36]
Ibid., p. 114.
Références
- Angenot, Marc, La parole pamphlétaire, Paris, Payot, 1982.
- Barthes, Roland, Leçon, Paris, Éditions du Seuil (Point), 1978.
- Beaumatin, Éric, et Michel Garcia, L’invective au Moyen Âge, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1995.
- Berrendonner, Alain, Éléments de pragmatique linguistique, Paris, Éditions de Minuit, 1981.
- Deguy, Michel, La poésie n’est pas seule, Paris, Éditions du Seuil (Feuillure 4), 1987.
- Derrida, Jacques, Demeure : Maurice Blanchot, Paris, Galilée (Incises), 1998.
- Ducharme, Réjean, La fille de Christophe Colomb, Paris, Gallimard, 1969.
- — — —, Le nez qui voque, Paris, Gallimard (Folio), 1993.
- Freud, Sigmund, Totem et tabou, Paris, Payot, 1966 (trad. de S. Jankélévitch).
- Hamon, Philippe, L’ironie littéraire : essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette, 1996.
- Hutcheon, Linda, “ Ironie, satire, parodie. Une approche pragmatique de l’ironie ”, Poétique, n° 46 (1981), p. 140-155.
- Kerbrat-Orecchioni, Catherine, L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 1980.
- Lane-Mercier, Gillian, La parole romanesque, Paris — Ottawa, Éditions Klincksieck — Presses de l’Université d’Ottawa, 1989.
- Largueche, Evelyne, L’effet injure. De la pragmatique à la psychanalyse, Paris, Presses universitaires de France, 1983.
- Moussaron, Jean-Pierre, Limites des Beaux-Arts I. À défaut — la littérature, Paris, Galilée (La philosophie en effet),1999.
- Niedoba, Arlette Saheb L’ironie, dire et vouloir-dire chez Roch Carrier, Marie-Claire Blais, Réjean Ducharme. Thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 1978.
- Nietzsche, Friedrich Wilhelm, Par-delà bien et mal, Paris, Gallimard (Folio essais), 1971 (éd. de G. Colli et M. Montinari, trad. de C. Heim, I. Hildenbrand et J. Gratien).
- Vaillancourt, Pierre-Louis, “ Sémiologie de l’ironie : l’exemple de Ducharme ”, Voix et images, vol. VII, n° 3 (printemps 1982), p. 513-522.

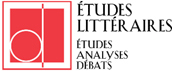
 10.7202/200345ar
10.7202/200345ar