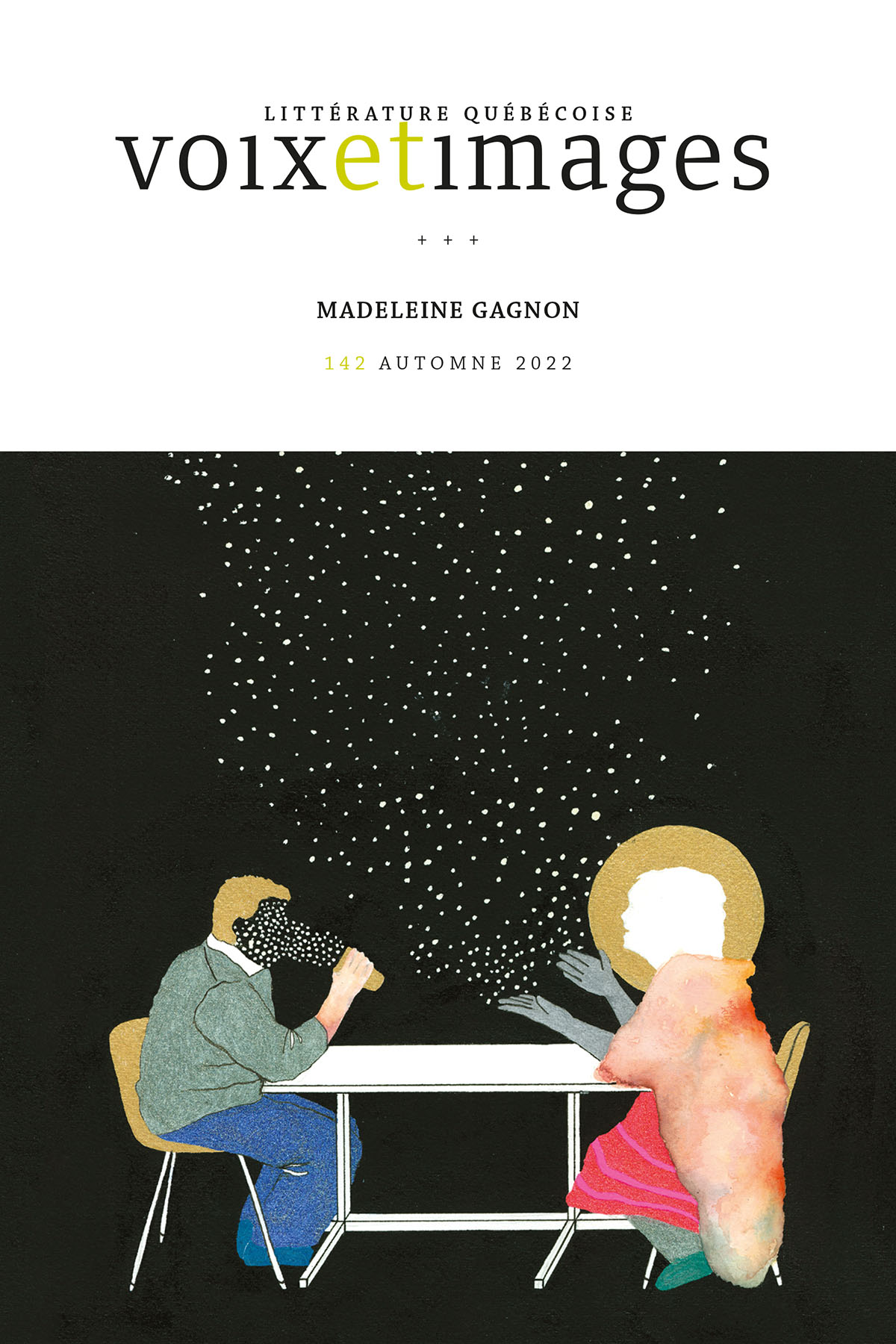Article body
MADELEINE : TENDRESSE ET TÉNACITÉ, SOLIDARITÉ • RENALD BÉRUBÉ
Nous sommes originaires du même pays, la vallée de la Matapédia, qui prolonge vers l’ouest la baie des Chaleurs ; les années de p’tite école terminées, nous avons à peu près le même âge, leur continuation allait se nommer études classiques, et se dérouler dans un pensionnat. Selon un penchant géographique quasi inné dans l’Est-du-Québec des années 1950, la direction desdits pensionnats allait se situer plus à… l’est, au Nouveau-Brunswick. Madeleine se retrouverait à Moncton, je rallierais Bathurst. Nous savions l’un et l’autre (comment l’avions-nous donc appris ?) qui nous étions, d’où nous venions et où nous étudiions ; ce n’est pourtant qu’au début des années 1970, à l’UQAM tout juste née, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Elle arrivait d’Aix-en-Provence où elle avait terminé son doctorat, j’arrivais (comme plusieurs autres) du collège Sainte-Marie où j’enseignais depuis quatre ans. À ce jour, l’amitié ne s’est jamais démentie, loin de là, solidarité. La solidarité est Madeleine, ce qui peut être l’occasion de comprendre pourquoi « la lionne » est aussi son surnom.
À l’UQAM, je dirigeais la revue Voix et Images (du pays, alors) ; j’ai bien vite demandé un texte à Madeleine ; il parut dès 1972, intitulé « Angéline de Montbrun : le mensonge historique et la subversion de la métaphore blanche », avec deux épigraphes comme entrée, l’une de Jacques Lacan, l’autre de Jacques Derrida. On pourrait dire, le passage du temps permettant telle affirmation avec certaine assurance, que l’oeuvre et l’action de Madeleine se trouvent là déjà regroupées : elle analyse une oeuvre dont le personnage principal est une jeune fille, et l’auteure une femme sous pseudonyme ; en ouverture à cette analyse, des citations de deux auteurs « travaillés » par le langage, le psychanalyste pour qui « l’inconscient est structuré comme un langage » et le philosophe de la différance pour qui l’oral contient déjà l’écrit. L’un et l’autre savent les ruses de l’oral comme de l’écrit, savent ce que subvertir veut dire, et tentent de débusquer et d’éclaircir les stratagèmes.
Or, la pratique de l’écriture selon Madeleine, de la poésie au récit, de l’essai à l’autobiographie, et chacun de ces genres selon divers modes, cette pratique témoigne du désir de « faire dire » ce qui cherche ou qui a tendance à se taire. Quand je repense aux années premières de l’UQAM au Département de littérature et d’esthétique – tel était alors le nom du Département d’études littéraires –, le nom de Madeleine Gagnon, l’un des premiers, est lié au féminisme et aux études sur le sujet, malgré silences et diverses surdités – ténacité de Madeleine ; à la psychanalyse aussi, comme approche de lecture, car elle sait pister les ruses (mensonges, inventions, fantasmes) de l’écriture pour mieux subvertir ses subversions, les mettre au clair, c’est-à-dire pour lire au mieux le parcours du texte littéraire. Et si on pense que plus tard le politique prendra grande place chez Madeleine, il faut souligner que déjà son engagement féministe l’était, politique, que son analyse d’Angéline de Montbrun en témoignait déjà, qui montrait que le roman signifiait ce que la société d’alors voulait taire, ne pas voir.
En 1975, je quittais l’UQAM pour l’UQAR (où j’allais rejoindre Jacques Pelletier qui prendrait la route de l’UQAM en 1981). Devenu directeur du Département de lettres vers la fin des années 1980, il me semblait d’évidence que Madeleine dût être invitée chez nous, en l’occurrence chez elle ; elle sera professeure invitée pour une année, puis une autre – à la fin, professeure invitée puis écrivaine en résidence, elle sera à l’UQAR entre 1990 et 1994. J’entends encore la vice-rectrice à la formation et à la recherche me dire que notre professeure invitée faisait presque « léviter » nos étudiant·es. Nos sourires s’accompagnèrent, bien sûr ; et je me disais que dame Gagnon n’avait surtout rien perdu de ses moyens magnifiques de professeure, de son empathie et de sa rigueur. Sans oublier que pour son plus grand plaisir, qui plus est, elle pouvait les exercer en étant parmi les siens, en Matapédia ou presque, psychanalyse, féminisme et politique n’arrivant (certes) jamais à faire l’économie de l’intime, s’il m’est permis de paraphraser l’intitulé de l’article de Gabrielle Frémont dans le dossier consacré à Madeleine dans la livraison de Voix et Images de l’automne 1982 – il y a quarante ans ; quarante ans, non, mais… Bon anniversaire, Madeleine, s’il en est un puis plusieurs et quel(s) que soi(en)t leur(s) moment(s), santé et longue vie, entéka, et sans parenthèses !
LA GRANDE AVENTURE : VIVRE, ÉCRIRE • LOUISE COTNOIR
Madeleine Gagnon apparaît dans ma vie en 1969. L’UQAM vient d’ouvrir ses portes. Je ferai partie de la première cohorte de ses diplômé·es. Intimidée, je me retrouve devant une estrade où se présentent d’éminents professeurs. Une seule femme : Madeleine Gagnon. Déjà, c’est une apparition significative et inspirante. De plus, j’apprends qu’elle cumule de multiples formations : musique, philosophie, psychanalyse, lettres, etc. Je suis plus qu’impressionnée. Je ressens un immense respect silencieux devant son courage et sa ténacité de femme pour avoir acquis un tel savoir et à un si jeune âge. Et il y a enfin cette vibration dans sa voix, quelque chose de sensible, de singulier qui me touche, comme un vif désir de nous transmettre un peu de toutes ses connaissances. En évoquant ce souvenir, j’éprouve encore l’émerveillement qui fut le mien à ce tournant essentiel de ma vie. J’ai vingt ans et je découvre un modèle stimulant qui correspond à mon intense curiosité et à mon désir d’obtenir un peu d’une telle diversité d’acquis.
Quelques années plus tard, je retrouve mon enthousiasme intact à la lecture de son livre La venue à l’écriture (1977), qu’elle cosigne avec Hélène Cixous et avec celle qui deviendra sa grande amie, Annie Leclerc. Femme en mouvement dans sa vie comme en écriture, elle inscrit avec cet essai un premier jalon dans son parcours d’écrivaine engagée. Par la suite, esprit critique, intelligence et sensibilité s’imprimeront avec justesse dans ses propos tant dans ses essais que dans ses fictions. Ses oeuvres traversent plusieurs époques dont elle a épousé les questionnements. Je l’estime parce qu’elle ne craint pas d’assumer ses indignations comme ses contradictions. Sa démarche provient de son interrogation sur elle-même, qui l’amène à un approfondissement élargi du sujet collectif.
Le féminisme sera au coeur de ses engagements idéalistes le plus constant. On le retrouve déjà dans Mémoires d’enfance (2001), récit où les anecdotes racontées nous dévoilent une petite fille consciente de sa différence, une petite fille qui veut aussi voir le monde et rendre compte, par les mots, de l’énigme humaine. À ce titre, il faut découvrir Les femmes et la guerre (2000). Ce livre est pour moi l’exemple parfait de sa quête incessante pour lier expérience et savoir. Sa forme et son écriture nous y font saisir toute l’humanité de l’essayiste. On y éprouve la fragilité de l’autrice et son désir de s’identifier aux autres humain·es.
J’aime enfin le style de Madeleine Gagnon, à travers lequel je sens l’ivresse des mots, leur matérialité, leur métissage, et qui se déploie en un espace d’invention et de liberté, sur un terrain imaginaire qu’elle nous invite à partager.
Elle revisite entièrement cette passion à laquelle elle voue un travail scripturaire dans Depuis toujours. Récit autobiographique (2013). Plurivoque, son écriture n’est jamais figée, close. Elle ne cesse de travailler dans l’échange. Intime ou publique, sa voix provoque le doute et stimule la curiosité. Cette écrivaine ne peut être qu’inspirante dans sa double démarche : penser et se raconter. C’est la grande aventure de sa vie.
UNE PENSÉE SUBVERSIVE • LOUISE DUPRÉ
C’est à la fin des années 1970 que j’ai découvert l’oeuvre de Madeleine Gagnon, tout comme celle de Louky Bersianik, de Denise Boucher, de Nicole Brossard et de France Théoret. À la faveur du courant féministe, l’écriture des femmes prenait alors, au Québec comme ailleurs, un essor incroyable. J’ai été conquise par des titres comme La venue à l’écriture, en 1977, écrit en collaboration avec Hélène Cixous et Annie Leclerc, puis Antre, publié en 1978, et Lueur, paru en 1979. Si bien que j’ai voulu consacrer à cette écrivaine marquante une partie de mon doctorat, qui serait publié en 1989 sous le titre de Stratégies du vertige.
La poésie québécoise était en plein renouveau : « dans la poésie, tout est permis[1] », avait affirmé Madeleine Gagnon lors d’une entrevue pour le magazine La vie en rose en 1983. Cette phrase m’est restée. La poésie de l’Hexagone avait en effet cédé sa place à une écriture hybride à laquelle on donnait les appellations de texte, théorie-fiction ou fiction-théorie, et ce mélange des genres alliant le poétique, le narratif et la réflexion ne pouvait qu’enthousiasmer la jeune universitaire que j’étais alors, ravie de cette ouverture offrant de multiples possibilités.
Professeure au Département d’études littéraires de l’UQAM, Madeleine Gagnon axait ses recherches sur la psychanalyse, l’écriture des femmes et la création littéraire, ce que mettaient en lumière ses livres, dans lesquels la théorie prenait une grande place. Se frottant au discours poétique, la réflexion trouvait une subversion que n’avaient pas les ouvrages universitaires. Au contact de la vie quotidienne, des relations amoureuses et du rapport aux enfants, le féminisme et la théorisation sur l’écriture prenaient une autre dimension : cette immersion dans la vie concrète attirait l’attention sur les contradictions entre le construit de toute démarche intellectuelle et les mécanismes de l’inconscient. Elle interrogeait l’espace où s’estompe « la barre opposant noir et blanc, lignes et interlignes, inscriptions et marges[2] », comme elle l’écrivait dans Antre. Loin de rejeter les remises en question, Madeleine Gagnon privilégiait une pensée vivante, mouvante, toujours à la recherche d’idées neuves. Une pensée de poète se nourrissant de l’expérience du sujet.
Si le féminisme a été si fertile au Québec, c’est qu’il a su se renouveler grâce à des écrivaines comme Madeleine Gagnon. Dix ans plus tard, j’entrerais moi aussi à l’UQAM comme professeure de création littéraire. Mon enseignement serait, à l’instar de celui de Madeleine Gagnon, fortement marqué par une réflexion sur l’écriture des femmes et la psychanalyse. Madeleine Gagnon m’a ouvert la voie.
Je reviens souvent vers ses écrits. Récemment, j’ai relu Le deuil du soleil, publié en 1999, merveilleux livre tenant à la fois du récit et de l’essai, où elle aborde la perte de ses proches. J’y ai retrouvé l’intellectuelle animée par sa connaissance de la psychanalyse, l’érudite à la vaste culture qu’elle tient à partager avec ses lecteurs et lectrices, la poète qui se laisse porter par la musique de la langue et la femme aimante qui a voulu traverser « cette vie en chantant, avec et malgré la mort dedans[3] ». Elle sera toujours pour moi une source d’inspiration.
CHÈRE MADELEINE • SIMON HAREL
Chère Madeleine,
Tu m’as remis un billet, un bout de papier soigneusement plié, je l’ai ouvert et j’ai vu ton écriture, j’ai mis le tout dans la poche de mon pantalon, je suis sorti de ton séminaire.
C’était l’année 1980, au pavillon Read. Un séminaire de psychanalyse et d’études féministes. Il y avait là quelques jeunes hommes que tu avais accueillis avec gentillesse. Tu n’intimidais pas. Tu étais déjà une « gentille lionne », renommée ainsi par Patrick Straram. Mais tu ne cédais pas ta place, tu protégeais ta progéniture étudiante et tu n’acceptais pas les coups fourrés que les femmes professeures subissaient à l’université de la part d’un milieu majoritairement masculin méfiant, voire hostile à l’inconscient et au désir féminin.
Tu m’as enseigné et fait lire René Major, Catherine Clément et Hélène Cixous. Tu nous as fait lire Lispector et Montrelay, Irigaray et Claire Lejeune. Je ne sais comment te remercier, chère Madeleine. Tu m’as ouvert tant de portes. Tu fais partie de ma filiation au féminin avec Julia Kristeva et Régine Robin.
Le bout de papier que tu m’avais remis, je l’ai tenu fiévreusement au bout de mes doigts sans oser le déplier une seconde fois. Je me trouvais à la croisée des chemins. Il faut bien le dire, j’étais mal en point. Je t’avais transmis un secret. Tu m’avais remis une adresse. Tu m’avais répondu sans dire un mot, par l’entremise d’une lettre volante qui allait, sans que je le comprenne pleinement dans l’actualité de ma détresse de jeune homme, me conduire ailleurs.
Je suis rentré chez moi, le bout de papier dans la poche de mon pantalon. J’ai rédigé un travail que j’allais lire dans ton séminaire, sur l’hystérie masculine, un effort honnête de penser ma place dans le cours que tu donnais. Je n’étais pas le frère cadet de Dora ou de Bertha Pappenheim. Je ne pouvais pas usurper cette souffrance. Je tentais de penser la mienne dans une affabulation théorique qui tenait lieu de faux-semblant.
J’ai pensé longuement à l’endroit où j’allais déposer ton billet, en attendant de pouvoir me calmer. Il n’était pas question que ta lettre volante bien pliée, moitié origami moitié missive, se transforme en relique. Sans trop comprendre ce qu’il faut bien appeler un acte manqué, j’avais pourtant mis ce pantalon dans une brassée de lessive. Et c’est à la dernière seconde, alors que le tambour de la machine à laver s’activait, que je réussis, au prix d’une petite inondation, à sauvegarder ton message.
Il fallait que je me décide et que j’entreprenne de ne plus vivre à l’envers de ma vie. J’ouvris ton billet, il y avait deux noms et deux numéros de téléphone. L’un d’entre eux devint mon analyste. Chère Madeleine, tu fais partie du réseau des passeurs clandestins qui se constitue génération après génération. L’inconscient vit de cette manière. Ton billet m’a tiré d’un mauvais pas. Merci.
Appendices
Notes
-
[1]
Propos de Madeleine Gagnon recueillis dans Louise Dupré, « Poésie et féminisme. De la chair à la langue », La vie en rose, no 11, 1983, p. 55.
-
[2]
Madeleine Gagnon, « Antre », Les Herbes rouges, nos 65-66, juillet-août 1978, p. 50.
-
[3]
Madeleine Gagnon, Le deuil du soleil, Montréal, VLB éditeur, 1998, p. 149.