Abstracts
Résumé
De nature proactive, la Loi sur l’équité salariale oblige les employeurs à prendre des mesures pour corriger la discrimination salariale à l’endroit des emplois à prédominance féminine, en d’autres mots, à respecter le principe d’un salaire égal pour un travail équivalent. Cet article propose une réflexion critique de cette loi québécoise, en vigueur depuis 1997. J’examine quelques éléments qui m’apparaissent avoir une incidence sur les processus d’équité salariale réalisés dans les milieux de travail et j’exprime certains doutes quant à l’atteinte de l’équité dans l’ensemble des entreprises assujetties à cette loi. Sans nier le potentiel transformateur de cette législation, mes observations montrent que la Loi sur l’équité salariale peine à réduire l’écart salarial en faveur des hommes et à permettre une avancée significative vers l’égalité professionnelle des femmes au Québec.
Mots-clés :
- Loi [québécoise] sur l’équité salariale,
- loi proactive,
- discrimination salariale,
- égalité hommes-femmes
Abstract
Proactive in nature, the Quebec Pay Equity Act requires of employers to take steps to correct wage discrimination against female-dominated jobs, in other words, to respect the principle of equal pay for work of equal value. This article offers a critical thinking of this Act that has been in force since 1997. I examine some elements which appear to me to have an impact on the processes of pay equity accomplished in workplaces and I express some doubts as to the attainment of pay equity in all businesses covered by that Act. Without denying the law’s potential for change, my observations show that the Pay Equity Act is struggling to redress the wage gap in men’s favour and to significantly increase professional equality for women in Quebec.
Keywords:
- Quebec Pay Equity Act,
- proactive legislation,
- wage discrimination,
- men and women equality
Article body
Près de vingt-cinq ans après l’adoption unanime de la Loi sur l’équité salariale par l’Assemblée nationale du Québec, les écarts salariaux en faveur des hommes persistent dans l’ensemble du marché du travail, et ce, malgré une participation accrue de femmes dont la scolarité est en moyenne plus élevée que celle des hommes (ISQ, 2018 ; 2019). À la suite du dépôt d’un nouveau Rapport ministériel sur la mise en oeuvre de la loi[1], il m’apparaît utile de soumettre une réflexion sur cette législation ambitieuse qui oblige à « une révision de pratiques dans les entreprises et dans les relations de travail » et qui fait appel à « des changements de mentalités dans la société » (CES, 2006 : 14).
Mise en oeuvre en concertation avec les partenaires du marché du travail et administrée par une Commission de l’équité salariale[2], la loi québécoise s’adresse aux entreprises privées et publiques comptant un minimum de dix salariés, s’inspirant ainsi de la loi ontarienne, adoptée en 1987. De nature proactive, elle demande aux employeurs de corriger, au sein de leur entreprise, les écarts salariaux relevant de la discrimination systémique fondée sur le sexe. Cette législation ne peut donc pas être considérée comme l’outil de mise en oeuvre d’un changement préconçu ou prédéterminé du seul fait de son adoption en 1996. En effet, comme l’a mis en évidence le sociologue britannique Anthony Giddens (1987 : 305) dans sa théorie de la structuration, « le changement social dépend de la conjonction de circonstances et d’événements dont la nature peut varier selon les contextes » et selon la dynamique des acteurs concernés. Suivant Giddens, il est permis d’affirmer que les effets de la Loi sur l’équité salariale émergent progressivement et dialectiquement, c’est-à-dire au fur et à mesure de son appropriation par les acteurs présents dans les entreprises, compte tenu des diverses contingences organisationnelles et des systèmes de relations de travail déjà établis.
D’autres auteurs qui s’intéressent aux impacts des politiques publiques posent également la question du changement. Ainsi, le philosophe Jacques Chevallier (2005 : 384) affirme que la relation entre les politiques publiques et le changement social demeure complexe, les politiques étant tout aussi influencées et infléchies par l’état des rapports sociaux qu’elles ne parviennent à les modifier. De leur côté, bien qu’ils considèrent que les politiques publiques ne sont pas intrinsèquement porteuses d’innovation, Joseph Fontaine et Patrick Hassenteufel (2002 : 14) croient que le fait d’aborder leur examen sous un angle empirique peut éclairer quant à la nature et à la portée du changement possible.
Le présent article reprend certaines observations et réflexions présentées dans mon étude portant sur l’application de la Loi sur l’équité salariale (Boivin, 2015)[3], dans laquelle j’ai voulu rendre compte de ce qui se passe dans les entreprises lors d’une démarche d’équité salariale. Mais j’ai aussi cherché à faire émerger le « sens » des processus réalisés et des résultats obtenus[4]. Mon objectif était de mieux comprendre pourquoi la loi québécoise peine à traduire dans l’ensemble des entreprises les principes d’égalité et de justice dont elle se réclame. Essentiellement qualitative, ma démarche de recherche a d’abord pris la forme d’observations empiriques puis d’un retour introspectif et réflexif sur mes observations. Par ailleurs, dans la mesure où elle s’est déroulée sur un terrain déjà connu, ma démarche évoque la double posture de « praticien-chercheur » (Albarello, 2004 : 17 et suiv.). Comme je l’ai expliqué dans ma thèse (Boivin, 2015), il s’agit d’une position difficile à tenir puisque le praticien-chercheur doit constamment osciller entre une position d’engagement et une distanciation critique par rapport au terrain. Néanmoins, cette posture présente des avantages indéniables pour une compréhension approfondie d’une problématique complexe, telle la Loi sur l’équité salariale.
Dans les pages qui suivent, j’apporte d’abord quelques précisions sur l’orientation féministe de cette législation. Par la suite, je fais état de problèmes associés à certaines dispositions de la loi : la modulation des obligations des entreprises selon le nombre de salariés ; la complexité d’une évaluation « non sexiste » des emplois et l’importance de la participation des salariés ; l’impact négatif de programmes « distincts » au sein d’une même entreprise ; les modalités souples de l’évaluation du maintien de l’équité salariale et, enfin, le rôle plutôt discret de la Commission de l’équité salariale. En conclusion, je m’interroge sur le potentiel transformateur de cette législation et je soumets quelques pistes d’action au regard de l’enjeu de l’équité salariale.
Une politique féministe
Au Québec comme ailleurs dans le monde occidental, l’accès plus large des femmes au marché du travail, à compter des années 1960, n’est pas synonyme d’égalité et de mixité en emploi[5]. Les femmes demeurent concentrées dans un nombre restreint d’emplois et de secteurs et elles sont plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois à temps partiel et faiblement rémunérés[6]. C’est donc la division sexuée du travail doublée d’une moindre valorisation des secteurs féminins qui a été maintenue grâce aux mécanismes de ségrégation prévalant dans l’ensemble du marché du travail. D’une part, la ségrégation « professionnelle » renvoie à la surreprésentation des femmes dans certains niveaux de la hiérarchie professionnelle et à leur difficulté d’accéder aux postes les plus élevés dans la hiérarchie. D’autre part, la ségrégation « sectorielle » désigne la concentration des femmes dans certains emplois et secteurs d’activité, ceux-ci étant souvent moins valorisés sur le plan salarial que ceux investis par les hommes (Fortin et Huberman, 2002 ; Legault, 2011). Suivant l’analyse de la sociologue Danièle Kergoat (2000 : 40), la division sexuée du travail a le « statut d’enjeu des rapports sociaux de sexe ». Sans être « rigide et immuable », cette division assigne prioritairement les hommes à la sphère productive et les femmes à la sphère reproductive et comporte deux principes, celui de séparation entre travaux de femmes et travaux d’hommes et celui de hiérarchie : « un travail d’homme vaut plus qu’un travail de femme » (Kergoat, 2010 : 64).
L’équité salariale dépasse le principe « à travail égal, salaire égal » qui suppose l’octroi d’un même taux salarial aux personnes qui accomplissent des fonctions similaires. Faisant appel à la subjectivité ainsi qu’aux notions de différence, d’équivalence et de jugement de valeur, l’équité salariale vise l’application du principe consacré à l’article 19 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne depuis 1975 : « tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit[7] ». En ce sens, la Loi sur l’équité salariale peut être envisagée comme une nouvelle modalité qui se veut plus efficace que les dispositifs de la Charte québécoise. Mais elle est aussi une politique féministe. À la différence de l’article 19 de la Charte, qui s’adresse aux pratiques discriminatoires se rapportant à différents motifs, dont le sexe, la Loi sur l’équité salariale s’adresse spécifiquement à la discrimination sexiste. De plus, en raison de son caractère proactif, cette loi oblige les employeurs à prendre des mesures en vue de respecter l’équité salariale, libérant ainsi les femmes d’avoir à déposer une plainte et à démontrer la discrimination subie.
En d’autres mots, la loi québécoise reconnaît le caractère systémique de la discrimination sexiste sur le plan salarial. Comme l’a déjà précisé l’économiste Marie-Thérèse Chicha-Pontbriand (1989 : 85), la discrimination systémique ne se limite pas aux seuls comportements individuels reflétant une intention discriminatoire, elle s’adresse plutôt à des situations d’inégalité résultant de pratiques institutionnelles en apparence neutres mais ayant des effets préjudiciables, voulus ou non. Quant à la discrimination salariale, elle désigne, selon le Bureau international du travail (2003 : 50), le fait de déterminer les salaires en se fondant principalement sur les caractéristiques individuelles de la personne et non sur le contenu et les exigences des tâches à exécuter.
Au Québec, la problématique de la discrimination salariale devient de plus en plus présente dans les revendications féministes et syndicales à la fin des années 1970. Néanmoins, il faudra une mobilisation soutenue, étalée sur plusieurs années, pour vaincre la résistance des associations patronales et réaliser la nécessaire concertation des partenaires du marché du travail autour du projet d’une législation proactive. Dès les premières rencontres s’installera d’ailleurs une véritable dialectique entre les différents partenaires, aux orientations souvent opposées. Comme l’ont expliqué Muriel Garon et Pierre Bosset (2001 : 70), cette dialectique autour de l’enjeu de l’égalité des sexes témoigne des « racines profondes et anciennes » de la discrimination. Ayant « progressivement servi à forger l’ensemble du corps social », la discrimination « a façonné la façon de concevoir la place normale et juste des individus ». En ce sens, vouloir infléchir « cet ensemble complexe et cohérent » exige un « long travail de déconstruction », sans parler des « luttes idéologiques » inévitables.
Selon la philosophe américaine Nancy Fraser (2010 : 139), la problématique de l’équité salariale comporte un potentiel de transformation des rapports sociaux de sexe dans la mesure où elle associe explicitement la redistribution des revenus entre hommes et femmes à la transformation des modèles d’appréciation culturelle reflétant les hiérarchies de genre. Fraser fait aussi valoir l’importance de l’implication de tous les groupes sur un pied d’égalité dans une démarche d’équité salariale. Enfin, la thèse avancée par Fraser invite à réfléchir sur les impacts et les retombées de la Loi sur l’équité salariale et à se demander si son application va dans le sens d’une transformation des rapports sociaux ou de leur stabilité.
Des obligations différenciées ne simplifient pas l’application de la loi
Lors des premières consultations gouvernementales auprès des partenaires du marché du travail, au début des années 1990, les associations patronales ont insisté sur la difficulté, voire l’impossibilité d’effectuer, dans les petites entreprises, l’exercice d’évaluation et de comparaison entre les catégories d’emplois à prédominance féminine et celles à prédominance masculine. Les partenaires se sont donc entendus pour définir des modalités d’application souples afin de laisser la plus grande flexibilité possible aux employeurs et de « ne pas imposer un fardeau administratif trop lourd » aux petites entreprises (Chicha-Pontbriand et Carpentier, 1991 : 43). Ces préoccupations sont présentes dans l’énoncé législatif adopté le 21 novembre 1996, alors que les obligations des employeurs assujettis sont modulées selon le nombre de salariés[8].
Ainsi l’obligation d’établir un programme d’équité salariale et de créer un comité de type paritaire est réservée aux employeurs dont l’entreprise compte 100 salariés et plus[9]. Les employeurs dont l’entreprise compte de 50 à 99 salariés doivent aussi établir un programme d’équité mais ne sont pas tenus de créer un comité. Quant aux employeurs dont l’entreprise compte de 10 à 49 salariés, la loi leur demande de « déterminer les ajustements salariaux nécessaires afin d’accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories à prédominance féminine que celle accordée aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories à prédominance masculine » (art. 34).
À première vue, la modulation des obligations paraît simplifier la mise en oeuvre de la loi. En pratique, toutefois, cette disposition oblige les employeurs à analyser divers éléments de la situation de leur entreprise avant de s’engager dans un exercice d’équité salariale. Mais, surtout, l’absence d’obligation relativement à une démarche structurée à l’égard des plus petites entreprises introduit un flou ambigu qui induit les employeurs en erreur. En effet, cela laisse entendre qu’il est possible d’estimer les écarts salariaux discriminatoires sans procéder à un exercice d’évaluation et de comparaison des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine, alors que cette activité s’avère le passage obligé aux fins de l’établissement de l’équité salariale[10]. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que plusieurs employeurs dont l’entreprise compte moins de 50 salariés aient attendu les modifications législatives de 2009, qui comportaient des mesures incitatives à l’égard des entreprises retardataires, pour se conformer à la loi.
La complexité d’une évaluation des emplois « non sexiste »
Si la définition des catégories à prédominance féminine et masculine constitue le point de départ d’un exercice d’équité salariale, l’évaluation des emplois en est l’étape centrale et incontournable. Car, malgré son caractère essentiellement subjectif, cette procédure de gestion est considérée comme le moyen privilégié de réaliser l’équité salariale dans la mesure où elle permet de repérer les écarts salariaux injustifiés entre les catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine de valeur équivalente au sein d’une entreprise. On distingue traditionnellement différentes approches en matière d’évaluation des emplois, soit la méthode du rangement, la méthode de classification par catégorie et la méthode par point. La méthode par point décompose les diverses tâches et exigences en critères définis et attribue une valeur numérique à chacun des critères sélectionnés.
En raison de son caractère analytique et quantitatif, la méthode par point est considérée comme celle qui permet le mieux de justifier, de manière explicite, le classement de divers emplois en se basant sur leur valeur relative au regard de la mission de l’entreprise. Néanmoins, l’utilisation de cette méthode ne garantit pas l’atteinte de l’équité salariale. Comme l’a déjà relevé Dominique Gaucher (1996 : 70), non seulement la plupart des systèmes de pointage traditionnels s’adressent-ils à une seule famille d’emplois, mais ils ont d’abord été appliqués à des emplois à prédominance masculine, notamment les cadres et les emplois de production. En pratique, les systèmes d’évaluation qui ont une certaine ancienneté traduisent surtout les caractéristiques et les exigences des emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Aux fins de l’équité salariale, l’enjeu est de vérifier si la relation entre le salaire et la valeur des catégories d’emplois à prédominance féminine suit la même logique que celle des catégories d’emplois à prédominance masculine, considérées exemptes de discrimination. D’où l’importance d’utiliser une grille commune pour évaluer les catégories d’emplois à prédominance genrée, condition essentielle pour repérer les écarts discriminatoires et, le cas échéant, définir les ajustements salariaux requis.
Que dit l’énoncé législatif à propos de l’évaluation des emplois ? Laissant le choix de la méthode d’évaluation à l’employeur ou au comité d’équité salariale, la loi québécoise définit quelques grandes lignes ou conditions, à savoir : permettre une comparaison des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine ; mettre en évidence les caractères propres aux catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine ; se référer à quatre grandes dimensions (ou facteurs), soit les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail (art. 56 et 57). À cette fin, la Commission de l’équité salariale recommande que les descriptions de tâches dites officielles déjà constituées soient mises de côté au profit d’une nouvelle collecte d’information sur les emplois. Également, les éléments (ou sous-facteurs) associés aux quatre dimensions doivent permettre de mesurer la valeur d’emploi dont le contenu et les exigences peuvent être fort différents. Pensons notamment à des emplois de bureau (majoritairement féminins) qui sont comparés à des emplois de production (majoritairement masculins). En ce sens, le nombre d’éléments mesurés est souvent plus élevé dans une démarche d’équité salariale que dans les exercices traditionnels d’évaluation des emplois, certains éléments favorisant davantage les catégories d’emplois à prédominance féminine, d’autres celles à prédominance masculine. Bref, la définition d’une grille d’évaluation des emplois aux fins de l’équité salariale n’est pas une mince tâche[11].
Sans doute cette complexité de l’évaluation « non sexiste » des emplois explique-t-elle la présence d’un « régime d’exception » dans l’énoncé législatif, à savoir le chapitre IX, qui permet à des employeurs de se soustraire à l’application de la loi dans la mesure où ils ont réalisé, ou sont en voie de le faire, « un exercice d’équité salariale ou de relativité salariale » et qu’ils démontrent que cet exercice répond aux exigences énoncées au chapitre IX. Parmi la centaine d’employeurs qui se sont référés à ce chapitre dès l’entrée en vigueur de la loi en 1997, on retrouve le gouvernement du Québec, à titre d’employeur des salariés du secteur public, et la Fédération des caisses Desjardins, c’est-à-dire les deux plus importants employeurs des femmes au Québec.
Fait à souligner, les notions d’« équité salariale » et de « relativité salariale » se trouvent confondues dans le chapitre IX de la loi. En effet, l’exercice d’évaluation des emplois réalisé à des fins de « relativité salariale » a pour objectif d’assurer une meilleure cohérence (ou équité) interne dans l’ensemble de la structure de rémunération de l’entreprise. Quant à l’exercice d’évaluation effectué dans le cadre de la Loi sur l’équité salariale, il vise spécifiquement à mesurer – et corriger – les écarts de rémunération discriminatoires entre les catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine de valeur équivalente.
Peut-on vraiment s’étonner qu’à la date d’échéance, alors fixée au 21 novembre 2001, aucun des employeurs qui avaient eu recours au chapitre IX n’avait établi de programme d’équité salariale conforme à la loi ? Ces programmes seront amorcés en 2004 seulement[12], soit après le jugement d’inconstitutionnalité de ce chapitre, rendu par la juge Carole Julien de la Cour supérieure[13]. Ce jugement faisait suite à la requête d’abrogation déposée par des organisations syndicales au début de l’année 2000, alléguant que les dispositions du chapitre IX ne respectaient pas l’esprit de la loi.
La participation des salariés est essentielle à toute démarche d’équité
Les biais sexistes peuvent s’insérer à chacune des étapes du processus d’équité salariale. Une vigilance soutenue s’impose donc afin de faire contrepoids à la subjectivité inhérente à l’évaluation des emplois et qui peut donner prise à une certaine « manipulation » des résultats. Il importe surtout d’adopter une attitude impartiale lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur la valeur relative des emplois qui suppose une confrontation de différentes subjectivités. Dans le cadre de la loi québécoise, cette impartialité est conditionnelle à la présence d’un comité d’équité salariale[14] ainsi qu’à sa dynamique d’interaction et de délibération en vue d’atteindre un consensus entre les représentants de l’employeur et ceux des salariés, qui ont souvent des points de vue divergents en matière d’évaluation des emplois. En ce sens, l’impartialité paraît davantage réalisable en milieu syndiqué, alors que le fonctionnement paritaire est déjà installé. Sans être une garantie de l’atteinte de l’équité, la présence syndicale favorise une plus grande transparence de la démarche ainsi qu’une participation plus égalitaire des salariés tout au long de l’exercice d’équité. Ajoutons que les ajustements salariaux ont tendance à être plus nombreux en milieu syndiqué[15]. Dans le cas des entreprises non syndiquées (ou de comités d’équité dont les membres ne sont pas syndiqués), le déroulement des travaux en comité se trouve davantage contrôlé par la direction.
Rappelons qu’en vertu de la loi, l’obligation de créer un comité se limite aux employeurs dont l’entreprise compte minimalement 100 salariés. Dans les entreprises comptant de 50 à 99 salariés, la mise en place d’un comité est conditionnelle à la demande d’un syndicat (art. 31-32), et cela, même si un programme d’équité salariale doit être établi selon les quatre étapes définies dans la loi. Quant aux entreprises de moins de 50 salariés, elles n’ont aucune obligation à l’égard de la démarche d’équité salariale. D’ailleurs, à l’exception de la référence à la formation, aucun mécanisme spécifique n’est prévu pour structurer la participation au sein d’un comité d’équité. Les dispositions de la loi sont générales et ne tiennent aucunement compte de la situation désavantagée dans laquelle se trouvent les personnes non syndiquées au regard de la participation, étant donné l’absence de structure de représentation collective et de mécanismes d’appui et de formation qui y sont associés.
Il va sans dire qu’en limitant la mise sur pied obligatoire d’un comité aux entreprises totalisant un minimum de 100 salariés, la loi n’offre pas les mêmes chances à toutes les femmes d’accéder à l’équité salariale. En effet, comme je l’ai observé dans le cadre de mon étude, sans obligation explicite, bon nombre de dirigeants de petites et moyennes entreprises ne souhaitent pas mettre en place un comité d’équité. Préoccupés des coûts associés à l’établissement de l’équité salariale, plusieurs des dirigeants rejoints semblaient même inquiets à l’idée de devoir travailler en concertation avec les représentants des personnes salariées.
La particularité des petites entreprises
Il faut toutefois reconnaître que dans les entreprises de moins de 50 salariés, la question de la participation de ces derniers se pose différemment en raison des ressources limitées et de la faible structuration de ces entreprises. Ainsi, la mise sur pied d’un comité d’équité salariale tel que défini dans la loi ne convient sans doute pas à toutes les petites entreprises. Néanmoins, compte tenu du nombre réduit d’employés et de leur proximité avec la direction de l’entreprise, l’implication des salariés peut s’organiser facilement, notamment à l’étape de la collecte d’information sur les emplois aux fins de leur évaluation. Sans oublier que la plupart des dirigeants des petites entreprises connaissent bien le travail réalisé dans les différents postes de travail.
Pour autant, les difficultés associées à la réalisation d’un exercice d’équité salariale ne doivent pas être minimisées dans les petites entreprises, chacune des étapes comportant de nombreux détails à la fois techniques et stratégiques qui ont une incidence directe sur la rémunération. De plus, à la différence des employeurs des grandes entreprises qui disposent habituellement de grilles de classification et de politiques salariales, la plupart des dirigeants de petites entreprises ont l’habitude de se référer surtout au marché. La détermination des taux de salaire se fait donc souvent à la pièce, sans égard à la valeur relative des emplois au sein de l’entreprise et sans définition d’échelles salariales. Certes, le respect de la loi peut être l’occasion de rationaliser la gestion de la rémunération, mais cette opération peut paraître trop complexe et onéreuse pour les dirigeants de petites entreprises[16].
Pourquoi pas deux affichages dans les petites entreprises ?
Dans les entreprises comptant 50 salariés et plus, la loi exige deux affichages, le premier en cours de démarche doit faire état de la liste des catégories à prédominance et du choix de la méthode d’évaluation, le deuxième doit rendre compte de l’ensemble de l’exercice lorsque celui-ci est complété. Toutefois, dans les entreprises de moins de 50 salariés, un seul affichage est requis en fin de démarche. Même s’il est plus détaillé depuis les amendements de 2009, l’affichage unique dans les plus petites entreprises paraît insuffisant car il fait complètement abstraction de l’importance de l’information et de la communication en cours de démarche. Tout en se situant dans la logique de l’absence d’obligation explicite quant au processus à réaliser dans les petites entreprises, l’affichage unique s’avère aussi paradoxal, puisque c’est précisément dans ces petites entreprises que le droit de participation des salariés est somme toute inexistant, faute de comité d’équité, sans oublier que les écarts salariaux en faveur des emplois à prédominance masculine y sont réputés plus importants que dans les grandes entreprises (Rose, 2016 : 13). En pratique, l’affichage unique dans les entreprises de moins de 50 salariés fait en sorte que l’équité salariale se réalise souvent sous le sceau du secret. Certes, le dépôt de plaintes est possible si l’affichage a bien été effectué conformément à la loi, mais on ne saurait minimiser la crainte des femmes concernées d’être identifiées et possiblement congédiées.
Les programmes distincts, une disposition contraire à l’esprit de la loi
D’entrée de jeu, la loi québécoise énonce que tout employeur dont l’entreprise compte 50 salariés et plus doit élaborer un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble de son entreprise, indépendamment des accréditations syndicales (art. 10). Cet énoncé est d’ailleurs conforme à l’esprit de l’article 19 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui ne fait aucune distinction selon l’appartenance syndicale, se référant plutôt à l’établissement. Néanmoins, dès le principe posé de ce programme unique, la loi ouvre la porte à la possibilité d’élaborer un programme distinct à la demande d’une association accréditée (art. 11).
La question des programmes distincts a été évoquée par des représentants d’organisations syndicales dès les premières discussions relatives à l’adoption de la loi. C’est surtout une recommandation du Bureau ontarien de l’équité salariale à l’effet « d’éviter de regrouper les différentes unités syndicales » qui semble avoir influencé les discussions. De l’avis de celui-ci, une approche globale « aurait pour effet de ralentir le processus et même de compromettre l’atteinte de l’équité au sein d’une unité syndicale » (Chicha-Pontbriand et Carpentier, 1991 : 52).
En effet, compte tenu du régime décentralisé de relations de travail et du pluralisme syndical prévalant au Québec et au Canada, on peut retrouver, surtout dans les grandes entreprises privées, plusieurs unités d’accréditation et différentes affiliations syndicales donnant lieu à des politiques de rémunération très différentes dans un même milieu de travail. Comme l’ont déjà souligné Esther Déom et Jacques Mercier (2001 : 57), l’établissement d’un programme unique, tel qu’énoncé prioritairement dans la loi québécoise, ne correspond pas aux règles et pratiques déjà établies dans les milieux de travail. Selon ces auteurs, « les syndicats masculins ont vite saisi que, si leurs emplois devenaient des comparateurs pour les emplois féminins, leurs salaires y seraient dorénavant liés, et que cela influera négativement sur leur pouvoir de négociation par la suite ». Ce sont donc surtout des considérations d’ordre stratégique, plutôt que des préoccupations de « faisabilité technique » de la démarche d’équité, qui expliquent l’autorisation de programmes distincts.
D’ailleurs, la démarche d’équité salariale réalisée à l’intention du personnel syndiqué du réseau public de l’éducation et de celui de la santé et des services sociaux a démontré qu’il est tout à fait possible d’utiliser une grille unique d’évaluation malgré la diversité des situations de travail, des qualifications professionnelles et des missions spécifiques des établissements[17]. Mais il faut préciser que les syndicats du secteur public québécois sont obligés de s’entendre en raison d’une politique salariale commune alors que les syndicats du secteur privé se trouvent plutôt en concurrence, particulièrement en ce qui a trait à la négociation de la rémunération. Dans ce contexte, la concertation peut s’avérer très difficile, impossible parfois, au sein d’un comité unique d’équité salariale. On peut d’ailleurs convenir que des programmes distincts permettent de faciliter la réalisation des exercices d’équité salariale et en minimisent les incidences sur le maintien de l’équité et sur les futures négociations portant sur la rémunération.
Toutefois, dans la mesure où ils donnent lieu à différents exercices d’équité complètement étanches au sein d’une même entreprise, les programmes distincts donnent lieu à une application morcelée de la loi tout en réduisant l’ampleur des comparaisons… et des éventuels correctifs salariaux[18]. De tels programmes permettent aussi le maintien de plusieurs structures salariales au sein d’une même entreprise qui s’appuient sur des logiques et des modalités différentes pouvant s’avérer discriminatoires, notamment à l’égard de la catégorie traditionnellement féminine des « employés de bureau[19] ».
Des programmes d’équité salariale sans comparer les emplois ?
Les effets négatifs de l’article 11 autorisant des programmes distincts au sein d’une même entreprise ne s’arrêtent pas là. En effet, cet article a aussi permis que des « programmes » d’équité salariale puissent être établis à l’intention de groupes de salariés qui ne comptent aucune catégorie d’emploi à prédominance féminine. C’est donc la notion même de programme d’équité salariale qui se trouve ici mise en question, alors qu’il est impossible de procéder à la comparaison des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine.
Cette problématique est apparue dès les premières années d’application de la loi québécoise, alors que la Commission de l’équité salariale autorisait l’établissement de tels programmes faute de dispositions précises à cet effet dans l’énoncé législatif. Toutefois, à la suite de plaintes déposées par des syndicats au début des années 2000[20], la Commission se prononce contre cette pratique qui a pour effet de soustraire des catégories d’emplois à prédominance masculine à la comparaison requise aux fins de l’estimation des écarts salariaux discriminatoires. Se référant au jugement de la Cour supérieure rendu en 2004 sur l’inconstitutionnalité du chapitre IX de la loi, la Commission explique que l’établissement d’un programme d’équité salariale doit tenir compte du caractère proactif et réparateur de la loi. Cela suppose que chacune des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine de l’entreprise soit évaluée et comparée aux fins d’estimer les écarts salariaux entre elles. Or, la position de la Commission de l’équité salariale n’est pas unanime, l’une des trois commissaires considérant que cette comparaison entre les catégories d’emplois à prédominance genrée « doit se faire là où la situation le justifie » et non pas « à la seule condition que le groupe comporte une ou plusieurs catégories d’emplois à prédominance féminine ». La position défendue par la Commission de l’équité salariale sera donc soumise à la Commission des relations de travail (CRT)[21]. Dans une décision rendue en juillet 2006, la CRT conclut que l’interprétation de l’article 11 faite par la Commission de l’équité salariale est conforme à l’esprit et à l’objectif de la loi[22]. « Interpréter autrement cet article », souligne la CRT, « transformerait la négociation collective en outil de renforcement des pratiques discriminatoires ».
Insatisfaits de la décision de la Commission des relations de travail, les employeurs concernés, appuyés par le Conseil du patronat à titre d’intervenant, déposent alors une requête en révision judiciaire en Cour supérieure. Dans un jugement rendu en juillet 2008, la décision de la CRT sera ainsi révoquée et la validité d’un programme distinct sera admise même si le syndicat qui en fait la demande ne comporte pas de catégories d’emplois à prédominance féminine. Selon la Cour supérieure, le libellé de l’article 11 ne prévoit aucune condition préalable à l’autorisation d’un programme distinct sur demande d’un syndicat, telle l’existence d’une catégorie féminine[23].
Enfin, en septembre 2011, la Cour d’appel du Québec confirme le jugement de la Cour supérieure à l’effet que le libellé de l’article 11 de la loi ne prévoit aucune condition préalable liée à l’existence d’une catégorie d’emploi à prédominance féminine. « Le sens naturel qui se dégage de la lecture de cette disposition », précise la Cour d’appel, est que l’employeur doit établir un programme distinct dès que la demande est faite par une association accréditée, de sorte que l’existence d’une catégorie d’emploi à prédominance féminine ne constitue pas une condition préalable à la mise en place d’un programme distinct[24].
En résumé, les deux tribunaux reconnaissent qu’il s’agit d’une « faille » de la loi, puisque le groupe concerné, composé en totalité de catégories d’emplois à prédominance masculine, échappe de la sorte à l’obligation de corriger la discrimination salariale. Mais ils sont d’avis que l’intention du législateur, en permettant la mise en place de programmes distincts, était de respecter la structure syndicale dans le contexte de l’atteinte de l’équité salariale. La Cour d’appel souligne par ailleurs que ces programmes ont tous l’inconvénient de nuire à l’objectif de la loi « et d’en compromettre à divers degrés la réalisation en consacrant une structure syndicale, elle-même fortement marquée, historiquement, par la discrimination systémique ». En somme, le véritable problème est dans l’idée même du programme distinct. « On peut le déplorer et y voir une faiblesse de la loi, mais l’intention du Législateur est limpide : il a permis l’établissement de programmes distincts, selon les termes prévus explicitement par les articles 10, 11, 31 et 32 » (ibid. : 41).
Le principe de la préséance du droit fondamental à l’équité salariale sur la négociation collective, affirmée à l’article 2 de la loi, paraît donc difficile à appliquer. Il semble aussi qu’en raison du régime décentralisé des relations de travail, l’application de la loi pose certains problèmes aux syndicats du secteur privé, en particulier ceux qui regroupent majoritairement des salariés qui occupent des catégories d’emplois à prédominance masculine. On peut certes souhaiter que l’équité salariale fasse l’objet d’une opération distincte de la négociation collective et préconiser que la logique de l’équité l’emporte sur celle de la négociation, mais n’est-il pas illusoire d’espérer que les acteurs syndicaux puissent complètement faire abstraction de leur rôle premier et mis en pratique au quotidien, souvent depuis plusieurs années, soit celui de négocier des conditions de travail et de salaires au nom des membres qu’ils représentent ?
L’évaluation du maintien de l’équité salariale
Maintenir l’équité salariale est une obligation corollaire à celle d’implanter cette équité et traduit son caractère permanent. Loin d’être une question superflue, la présence de cette obligation indique qu’un premier exercice d’équité ne suffit pas et que, sans une vigilance continue, des écarts salariaux peuvent resurgir. Comme le soulignait le rapport du Groupe de travail chargé d’examiner les dispositions fédérales en matière d’équité salariale (Canada, 2004 : 422), la « seule façon d’assurer que le principe d’équité ne soit pas perdu est d’institutionnaliser les principes de l’équité salariale dans les systèmes de rémunération ». En d’autres mots, l’équité salariale doit devenir un paramètre essentiel de l’équité interne qui doit être considéré dans la définition et la gestion des politiques et des structures salariales. C’est sous cet angle que doit être envisagée l’évaluation périodique du maintien de l’équité salariale si l’on souhaite que l’application de la loi donne lieu au changement de pratiques et de valeurs dont parle le Rapport ministériel de 2006.
Avant les modifications législatives de 2009, les dispositions relatives au maintien de l’équité étaient très générales, demandant simplement aux employeurs de maintenir l’équité salariale dans leur entreprise après son implantation, en particulier lors de changements tels que la création de nouveaux emplois, des modifications aux emplois existants ou encore la négociation du renouvellement d’une convention collective. Les dispositions adoptées en 2009 parlent plutôt d’évaluer le maintien de l’équité salariale. Lors de ce contrôle périodique (à tous les cinq ans), les obligations sont les mêmes pour l’ensemble des entreprises, indépendamment du nombre de salariés. C’est l’employeur qui décide seul des modalités de cette évaluation sans égard à des situations particulières ou à des demandes de la part d’associations accréditées quant au type d’exercice à faire ou quant à la mise sur pied d’un comité de maintien de l’équité salariale. Au terme de l’opération, l’affichage obligatoire doit inclure divers éléments, dont un sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale, la liste des événements qui ont généré des ajustements et la liste des catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements (art. 76.3).
La grande marge de manoeuvre laissée aux employeurs lors de l’évaluation du maintien de l’équité salariale visait sans doute à favoriser le respect de cette obligation, ignorée par la plupart des employeurs jusqu’aux amendements de 2009. Il faut savoir qu’à l’occasion des consultations précédant les modifications de la loi, les associations patronales avaient recommandé de mettre fin à la phase proactive et de s’en remettre à l’article 19 de la Charte québécoise pour l’étape du maintien, considérée comme une opération de gestion. Se référant à l’Ontario, les représentants des employeurs avaient aussi recommandé que l’obligation de maintien de l’équité salariale n’ait pas pour effet d’empêcher l’apparition de nouveaux écarts salariaux résultant d’autres pratiques de rémunération !
Fait à souligner, la périodicité de cinq ans ne tient aucunement compte qu’en matière d’évaluation des emplois et d’équité salariale, une mise à jour s’impose régulièrement, surtout dans un contexte de changements technologiques et organisationnels fréquents comme c’est le cas dans la plupart des milieux de travail. Mais, surtout, l’absence de rétroactivité des ajustements salariaux laisse entendre que l’équité salariale est une obligation ponctuelle qui permet un retour à une situation de discrimination salariale à l’égard des catégories d’emplois à prédominance féminine. Différentes organisations syndicales se sont donc engagées dans une nouvelle contestation juridique, alléguant le caractère discriminatoire et inconstitutionnel des dispositions qui suppriment la rétroactivité des ajustements associés au maintien de l’équité salariale.
Un premier jugement, rendu par la Cour supérieure le 22 janvier 2014, donne raison aux syndicats. Le 12 octobre 2016, la Cour d’appel donne également raison aux syndicats à savoir que l’absence de rétroactivité des ajustements salariaux déterminés lors de l’évaluation du maintien est contraire à l’esprit de la loi. Enfin, le 10 mai 2018, la Cour suprême confirme le caractère discriminatoire et anticonstitutionnel des dispositions concernant l’absence d’ajustements rétroactifs lors de l’évaluation du maintien de l’équité salariale[25]. Après consultation des partenaires du marché du travail, de nouveaux amendements à la loi sont donc adoptés le 9 avril 2019[26]. Or, tout en reconnaissant que les correctifs salariaux doivent être rétroactifs à la date de l’événement discriminatoire, l’ajustement des salaires prend effet seulement au moment de l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien. En ce qui a trait à la période qui précède l’affichage, la correction des écarts constatés prend la forme d’une « indemnité forfaitaire ». Ajoutons que cette disposition a des incidences particulièrement négatives pour les salariées du secteur public qui avaient déposé de nombreuses plaintes au regard du maintien de l’équité salariale avant l’adoption des modifications législatives de 2019[27].
La Commission de l’équité salariale, initiatrice du changement ?
Le mandat confié à la Commission de l’équité salariale fait l’objet d’un chapitre entier de l’énoncé législatif de 1996. Parmi les fonctions attribuées à cet organisme, dont le rôle est indispensable aux fins du respect de la loi, mentionnons notamment celles de diffuser l’information et de surveiller l’établissement de programmes d’équité salariale, d’aider à la formation des membres des comités, de faire enquête, de prêter assistance aux entreprises et de développer des outils à l’intention des petites entreprises. Il est également stipulé que la Commission de l’équité salariale doit favoriser la concertation au sein des entreprises et effectuer des recherches et des études sur toute question relative à l’équité salariale. Malheureusement, la Commission a mis beaucoup de temps à assumer pleinement son rôle. Pensons entre autres à la lenteur et à la passivité de cet organisme au cours des premières années d’application de la loi. Alors qu’une approche proactive s’avérait essentielle, la Commission a été longue à démarrer en raison d’un budget insuffisant au regard de la nouveauté de la problématique et de sa complexité.
Le règlement concernant les entreprises sans comparateur masculin illustre les impacts de l’absence de proactivité de la Commission de l’équité salariale. En effet, dans certaines entreprises, pour la plupart comptant moins de 50 salariés, les catégories d’emplois à prédominance masculine sont inexistantes. Pensons par exemple ici aux petits commerces de détail, aux centres de femmes et aux centres de la petite enfance (CPE)[28]. Dans l’énoncé législatif de 1996, cette problématique est traitée à l’article 13 : « lorsque dans une entreprise il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine, le programme d’équité salariale est établi conformément au règlement de la Commission ». Cette disposition prévoit aussi que le versement des correctifs salariaux doit débuter deux ans après l’adoption du règlement. Or, ce règlement a été adopté en mai 2005, soit huit ans après l’entrée en vigueur de la loi et près de quatre ans après la date d’échéance pour l’ensemble des entreprises assujetties. De plus, ce règlement propose une démarche quasi virtuelle en proposant la définition de deux catégories d’emplois à prédominance masculine (une sorte d’emplois repères) dont le salaire est fixé par l’employeur à partir de balises définies par la Commission[29].
Ce retard a eu d’importantes conséquences négatives pour les femmes salariées de ces petites entreprises sans comparateur masculin. En effet, les salariées qui avaient droit à des ajustements n’ont pas pu bénéficier d’une rétroactivité au 21 novembre 2001, comme le prescrit pourtant la loi à l’égard des entreprises retardataires. Voilà d’ailleurs pourquoi une contestation juridique était engagée par les syndicats représentant des employées des CPE en 2013. Mais, dans un jugement rendu le 2 septembre 2014, la Cour supérieure a rejeté la requête des syndicats, considérée irrecevable au motif qu’elle concerne le mode d’application de la loi et non pas la discrimination salariale. Et, malgré un appel de ce jugement auprès de la Cour suprême, cette requête est de nouveau rejetée en 2018[30]. Tout en concluant qu’il y a bel et bien eu violation des droits des femmes garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, cette violation a été considérée justifiée dans les circonstances, dans la mesure où le délai visait à trouver la bonne solution, dans un contexte exceptionnel.
Au-delà de la problématique particulière des entreprises sans comparateur masculin, il faut souligner qu’à la suite du Rapport ministériel en 2006 et des modifications législatives de 2009, la Commission de l’équité salariale s’est montrée davantage proactive. Mentionnons notamment la mise en place d’un Comité consultatif sur l’équité salariale réunissant les différents partenaires du monde du travail, dont le mandat est d’assister la Commission dans ses opérations, ainsi que l’entrée en vigueur d’un nouveau programme de vérification auprès des employeurs, à compter de 2011[31].
Ces initiatives ont sans doute contribué à augmenter le taux de conformité à la loi. Ainsi, le Rapport du ministre du Travail déposé en 2019 (CNESST, 2019 : 75) fait état de taux d’application croissants tant dans le secteur public que privé, de sorte que « la majorité des employeurs assujettis sont maintenant en phase de maintien de l’équité salariale[32] ». Toutefois, le rapport souligne que plusieurs employeurs, notamment ceux des petites entreprises, « accusent du retard et ce, à toutes les phases des travaux[33] ». Il apparaît également que le niveau de conformité diminue après l’exercice initial d’équité salariale et davantage encore après une première évaluation du maintien de l’équité. Il fait aussi mention de la persistance « des incompréhensions et des difficultés liées à l’application de la loi » ainsi que de la sous-représentation des travailleuses non syndiquées qui se prévalent de leur droit de porter plainte (ibid. : 74). Il souligne par ailleurs que « les travailleuses ont peu d’occasions de participer aux travaux et hésitent à le faire par manque d’informations ou par crainte d’effets négatifs sur les relations de travail avec leur employeur » (ibid. : 51).
Il est donc étonnant qu’au-delà d’un certain nombre de pistes de réflexion, ce rapport ne propose pas davantage d’actions concrètes en réponse aux problèmes constatés. Pensons en particulier à l’information et à la transparence mais, surtout, à la participation des personnes salariées considérée comme « l’une des pierres d’assise de la loi » (ibid. : 77). Comme je l’ai souligné précédemment, la participation des personnes salariées à la démarche d’équité salariale en entreprise contribue à la correction d’écarts salariaux discriminatoires. En effet, le travail en comité est l’occasion, pour les femmes salariées, de discuter de la valeur de leur travail et, possiblement, d’en obtenir une reconnaissance plus juste. En ce sens, pourquoi ne pas rendre obligatoire la mise en place d’un comité d’équité salariale de type paritaire dans les entreprises comptant moins de 100 salariés ?
Conclusion
La Loi sur l’équité salariale reconnaît la discrimination sexiste comme une dimension structurante du marché du travail. Grâce à cette législation, les femmes qui subissent une discrimination salariale dans les entreprises comptant minimalement dix salariés n’ont plus l’obligation de déposer une plainte, le fardeau de la preuve étant transféré à l’employeur. Les nombreux ajustements salariaux accordés à des catégories d’emplois à prédominance féminine à compter des années 2000, en particulier dans le secteur public, confirment d’ailleurs la nécessité d’une mesure proactive en remplacement de l’article 19 de la Charte québécoise basé sur un système de plaintes.
Toutefois, compte tenu de la diversité des processus d’équité salariale, ainsi que des différentes exceptions, dérogations et différenciations introduites dans la loi, son implantation a progressé très lentement et a donné lieu, jusqu’à présent, à des résultats mitigés. Sans oublier la dialectique d’opposition entre les différents partenaires responsables de sa mise en oeuvre. Générant différents retards, cette dialectique a fait en sorte que l’intégration de l’équité salariale aux politiques de rémunération des entreprises québécoises demeure, encore aujourd’hui, quelque peu aléatoire. Pensons particulièrement aux femmes qui travaillent dans les entreprises de 10 à 49 salariés, souvent tenues à l’écart des démarches d’équité salariale qui sont, pour la plupart, effectuées sans consultation du personnel.
Telle qu’elle est définie et appliquée jusqu’à maintenant, la Loi sur l’équité salariale peine donc à traduire dans la réalité le potentiel de changement que laisse entrevoir son objectif. Comme l’a mis en évidence une recherche récente de l’Institut de recherche et d’information socioéconomique à propos du secteur public québécois (IRIS, 2019), il est sans doute temps de reconnaître que le fait de limiter la réalisation de l’équité salariale au sein d’une entreprise, voire au sein d’un syndicat, ne favorise pas l’atteinte de l’équité dans l’ensemble du marché du travail. D’ailleurs, faut-il le rappeler, en dépit de cette législation, des écarts de rémunération sont toujours observables, selon qu’il s’agit d’entreprises privées ou publiques, de petite ou de grande taille, syndiquées ou non syndiquées. Sans parler des niveaux de rémunération plus élevés dans les secteurs de haute technologie que dans ceux à forte dimension humaine et relationnelle, tel le réseau québécois de la santé et des services sociaux qui demeure, encore aujourd’hui, un « monde de femmes ».
Dans le contexte d’un marché du travail de plus en plus féminisé, l’enjeu de l’équité salariale est sans doute appelé à demeurer à l’ordre du jour des organisations syndicales et des groupes féministes, afin de poursuivre la mobilisation pour une meilleure reconnaissance du travail traditionnellement féminin et davantage de justice dans les conditions offertes aux femmes sur le marché du travail, notamment à l’égard des femmes de minorités visibles, nombreuses à occuper des emplois de services et de soins aux personnes, tel celui de préposée aux bénéficiaires.
Par ailleurs, la participation des personnes salariées aux démarches d’équité salariale apparaît essentielle dans l’ensemble des milieux de travail. Mais, comme le soulève l’étude de l’IRIS, il est aussi important d’élargir les analyses comparatives entre des catégories d’emplois à prédominance féminine et des catégories à prédominance masculine provenant de différentes entreprises, voire de différents secteurs. Ces analyses permettraient de rendre visibles les effets d’une ségrégation sectorielle toujours à l’oeuvre et qui fait en sorte de confiner les femmes dans certains […] secteurs d’activité, ceux-ci étant souvent moins valorisés sur le plan salarial que ceux investis par les hommes. Peut-être serait-il alors possible d’entrevoir une transformation des rapports sociaux de sexe sur le marché du travail ? C’est du moins l’hypothèse de la philosophe américaine Nancy Fraser (2005 : 95) qui défend la possibilité d’initier, à partir de mesures correctives, une « trajectoire de changement au sein de laquelle des transformations plus radicales deviendraient praticables avec le temps » aux fins d’une plus grande justice sociale.
Enfin, comme le réclament les groupes féministes et les organisations syndicales depuis la Marche Du pain et des roses en 1995, sans doute serait-il temps de décréter une hausse substantielle du salaire minimum. Une telle initiative permettrait à plusieurs femmes en emploi d’obtenir une bonification de leur salaire, en particulier celles qui travaillent dans les très petites entreprises exclues de la Loi sur l’équité salariale et dont la rémunération ne dépasse pas, dans plusieurs cas, le niveau du salaire minimum légal.
Appendices
Note biographique
Louise Boivin détient un doctorat en science politique de l’Université du Québec à Montréal (2015). Au cours de sa pratique professionnelle, elle a réalisé différents travaux de recherche ainsi que des interventions dans divers milieux de travail sur la problématique de l’équité salariale. Au terme de son parcours professionnel et dans le cadre d’études doctorales, elle s’est engagée dans une démarche de recherche réflexive, générée par un travail d’introspection, dans le but de mieux comprendre les effets de la mise en oeuvre de la Loi sur l’équité salariale du gouvernement du Québec.
Notes
-
[1]
Déposé à l’Assemblée nationale le 6 juin 2019 par le ministre du Travail, ce rapport a pour titre : La Loi sur l’équité salariale : un apport indéniable pour contrer la discrimination salariale. Il est à noter que ce nouveau rapport survient dix ans après l’adoption d’un certain nombre d’amendements afin de faciliter le respect de la loi : Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale (projet de loi 25 adopté le 28 mai 2009).
-
[2]
Aux fins de la mise en oeuvre de la Loi sur l’équité salariale, les partenaires du marché du travail sont les associations patronales, les organisations syndicales et les groupes féministes. À noter que depuis 2016, la Commission de l’équité salariale est intégrée à d’autres organismes du travail sous le nom de « Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail » (CNESST).
-
[3]
Cette étude a été rendue possible grâce à une interaction répétée avec des acteurs présents dans les entreprises québécoises assujetties à la loi. Dans le secteur privé, ma présence sur le terrain a pris la forme d’une cinquantaine d’interventions d’assistance à la suite de demandes faites par des propriétaires-dirigeants de petites et moyennes entreprises de moins de 300 personnes salariées (1998-2001 et 2009-2013). En ce qui a trait au secteur public, ma fonction de conseillère à la recherche à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) pendant plusieurs années (1986-1997 et 2002-2008) a facilité mes observations et mon analyse (Boivin, 2015 : 135 et suiv.).
-
[4]
En raison du nombre élevé d’entreprises rejointes, j’ai constitué un échantillon de 30 PME ayant complété un exercice d’équité et présentant différentes configurations organisationnelles jugées significatives au regard de l’application de la loi. Dans le secteur public, je me suis limitée à « l’entreprise du secteur parapublic », regroupant l’ensemble du personnel syndiqué du réseau de l’éducation (cégeps et commissions scolaires) et celui de la santé et des services sociaux. Il est à noter que j’ai eu recours à différentes stratégies de collecte de données, notamment l’observation sur le terrain, l’examen et la compilation de la documentation écrite ainsi que la réalisation d’entrevues avec des personnes-ressources afin de découvrir et de valider certains modèles de pratiques d’équité salariale dans différents milieux de travail (Boivin, 2015 : 130 et suiv.).
-
[5]
De 1976 à 2015, le taux d’activité des femmes est passé de 46 % à 75 %. Une catégorie d’emploi est dite « mixte » lorsqu’elle compte entre 40 % et 60 % de femmes et d’hommes. Au Québec, la grande majorité des grandes catégories socioprofessionnelles ne sont pas mixtes, mais présentent plutôt une prédominance d’un des genres (Rose, 2016 : 5, 14).
-
[6]
Au Québec, le salaire des femmes au début des années 1980 équivalait à un peu plus de la moitié de celui des hommes (David, 1986 : 10). La situation des femmes s’est améliorée depuis, mais l’écart de rémunération s’est maintenu. Ainsi, entre 1998 et 2016, l’écart horaire en dollars courants n’a pas véritablement diminué (ISQ, 2018 : 10). À noter également que près de 60 % des personnes travaillant au salaire minimum étaient des femmes en 2015 (Rose, 2016 : 13).
-
[7]
L’article 19 est en lien avec l’article 10 de la Charte québécoise : « toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur et le sexe ». Voir également l’article 15 de la Charte canadienne qui garantit l’égalité et protège contre toutes formes de discrimination.
-
[8]
Au Québec, plus 60 % des entreprises comptent moins de 100 salariés et près de 30 % en comptent moins de 20 (ISQ, 2019 : 84). Il est à noter que l’article 19 de la Charte québécoise continue de s’appliquer dans le cas des entreprises de moins de dix salariés, non assujetties à la loi.
-
[9]
Les quatre étapes d’un programme d’équité salariale énumérées dans l’article 50 sont : « 1o l’identification des catégories d’emplois à prédominance féminine et des catégories d’emplois à prédominance masculine, au sein de l’entreprise ; 2o la description de la méthode et des outils d’évaluation de ces catégories d’emplois et l’élaboration d’une démarche d’évaluation ; 3o l’évaluation de ces catégories d’emplois, leur comparaison, l’estimation des écarts salariaux et le calcul des ajustements salariaux ; 4o les modalités de versement des ajustements ».
-
[10]
La définition des catégories précède l’étape de l’évaluation. En vertu de la loi, la notion de « catégorie » désigne un ou des emplois comportant des qualifications et des responsabilités similaires ainsi que la même rémunération (même taux ou même échelle) (art. 54). Il faut aussi distinguer celles qui présentent une prédominance féminine de celles qui présentent une prédominance masculine en référence à certains critères énoncés dans la loi (art. 55).
-
[11]
À titre d’exemple, la production de l’outil d’évaluation (questionnaire structuré adapté à l’équité salariale), utilisé dans l’ensemble de mes interventions auprès des PME, a nécessité de nombreuses heures de recherche et d’analyse (voir Boivin, 2015, chap. 5).
-
[12]
Le Conseil du trésor (représentant l’État-employeur) a d’ailleurs attendu à 2006 – et après avoir décrété un gel des salaires – pour « conclure » l’équité salariale dans « l’entreprise du secteur parapublic ». Quant à la Fédération des caisses Desjardins, elle s’est obstinée jusqu’en 2010 à ne pas se conformer à la loi.
-
[13]
Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), CS, 2004.
-
[14]
Le comité d’équité salariale doit être formé d’un minimum de trois membres et au moins les deux tiers des membres doivent représenter les salariés, la moitié étant obligatoirement des femmes (art. 17).
-
[15]
Ainsi, dans « l’entreprise du secteur parapublic », la presque totalité des catégories à prédominance féminine a bénéficié d’ajustements salariaux, grâce à une implication soutenue des syndicats. Également, dans les PME rejointes dans le cadre de mon étude, j’ai noté des ajustements salariaux plus nombreux dans les entreprises syndiquées de 100 salariés et plus, tenues de mettre en place un comité d’équité salariale (Boivin, 2015 : 196).
-
[16]
Dans le cadre de mon étude, j’ai noté l’absence de personnel spécifiquement dédié à la gestion des ressources humaines dans les entreprises de moins de 50 salariés.
-
[17]
Dans le secteur public où l’État est l’employeur (par l’intermédiaire du Conseil du trésor), deux entreprises ont été définies aux fins de l’équité salariale, à savoir : « l’entreprise de la fonction publique », regroupant le personnel des ministères et de divers organismes, et « l’entreprise du secteur parapublic », regroupant le personnel syndiqué du réseau de l’éducation ainsi que celui de la santé et des services sociaux, regroupant plus de 400 000 personnes, en très grande majorité des femmes. La définition de ces deux entreprises relève donc de la logique des programmes « distincts » utilisés dans le secteur privé.
-
[18]
La seule restriction à l’établissement d’un programme distinct est l’impossibilité d’établir les comparaisons requises en raison de l’absence de catégories à prédominance masculine (art. 52).
-
[19]
J’évoque ici les échelles uniques s’adressant aux emplois de production (majoritairement masculins) et les échelles s’adressant aux emplois de bureau (majoritairement féminins) qui comptent divers échelons avant d’atteindre le maximum de l’échelle salariale considéré dans le cadre de la loi.
-
[20]
Plainte formulée par une association accréditée contre l’employeur Beaulieu Canada – division 6, Dossier no 400-01116 étudié aux 133e et 134e séances de la Commission de l’équité salariale, p. 7 et 14.
-
[21]
La Commission des relations du travail a compétence pour entendre et disposer de toute demande qui lui est adressée relativement à l’application de la loi (art. 104 et suiv.). Il est à noter que depuis 2016, cette commission a été remplacée par un Tribunal administratif du travail.
-
[22]
Beaulieu Canada – Syndicat des vêtements, du textile et al. c. Commission de l’équité salariale (en particulier p. 13), CRT, 2006.
-
[23]
Société des alcools du Québec c. Commission des relations du travail, CS, 2008.
-
[24]
Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec (SPTP) c. Société des alcools du Québec, CA, 2011.
-
[25]
Voir Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux c. Québec (Procureure générale) CS 2014 ; voir également Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Cour d’appel, 2016, et Cour suprême, 2018.
-
[26]
Il s’agit de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale afin principalement d’améliorer l’évaluation du maintien de l’équité salariale, 10 avril 2019.
-
[27]
Précisons qu’en janvier 2020, des organisations syndicales (CSN, CSQ, FTQ) ont déposé un recours à la Cour supérieure du Québec pour contester les modifications législatives adoptées en 2019, en particulier cette « indemnité forfaitaire » (Communiqué de la CSN, 15 janvier 2020).
-
[28]
Au début des années 2000, la Commission de l’équité salariale estimait à 2000 le nombre d’entreprises sans comparateur masculin, ce qui concerne environ 30 000 femmes. Il s’agit pour la plupart d’entreprises de moins de 50 salariés et souvent non syndiquées (CES, 2002 : 45).
-
[29]
Il est à noter qu’en 2009, une démarche facultative a été ajoutée, à savoir la référence à des catégories d’emplois à prédominance masculine existant dans une entreprise possédant des caractéristiques similaires à celles de l’entreprise concernée.
-
[30]
Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2018.
-
[31]
Ce programme de vérification oblige les employeurs à compléter une déclaration annuelle comportant quatre points : date du début des activités, nombre de personnes salariées, réalisation ou non de l’équité salariale et de l’évaluation du maintien, date de l’affichage. Cette déclaration permet à la Commission de l’équité salariale d’effectuer des vérifications ponctuelles sur l’état d’avancement de l’application de la loi.
-
[32]
Selon le Rapport du ministre du Travail (CNESST, 2019 : 41), plus de 34 550 entreprises privées et environ 740 organismes publics étaient assujettis à la loi au 31 décembre 2017. À noter que la grande majorité de ces entreprises comptent moins de 50 salariés.
-
[33]
Le récent Rapport du ministre (ibid. : 47) précise qu’au 31 décembre 2017, plus de 12 000 employeurs manquent à au moins une de leurs obligations.
Bibliographie
- Albarello, Luc, 2004, Devenir praticien-chercheur. Comment concilier la recherche et la pratique sociale, Bruxelles, Université De Boeck.
- Boivin, Louise, 2015, L’application de la Loi québécoise sur l’équité salariale ou le respect d’un droit fondamental confié à l’entreprise. Observations empiriques et réflexion critique, thèse de doctorat en science politique, Université du Québec à Montréal, Québec.
- Bureau international du travail, 2003, L’heure de l’égalité au travail. Rapport global en vertu de la Déclaration de l’OIT [Organisation internationale du Travail] relative aux principes et droits fondamentaux au travail, rapport 1 (B), Conférence internationale du Travail, 91e session.
- Canada, Groupe de travail sur l’équité salariale, 2004, L’équité salariale : Une nouvelle approche à un droit fondamental. Rapport final produit dans le cadre de l’examen de la législation sur l’équité salariale au Gouvernement du Canada, consulté sur Internet (http://publications.gc.ca/collections/Collection/J2-191-2003F.pdf) le 13 janvier 2019.
- Chevallier, Jacques, 2005, « Politiques publiques et changement social », Revue française d’administration publique, vol. 3, no 115, p. 383-390, consulté sur Internet (DOI : 10.3917/rfap.115) le 6 mars 2019.
- Chicha-Pontbriand, Marie-Thrèse, 1989, Discrimination systémique. Fondement et méthodologie des programmes d’accès à l’égalité en emploi, Montréal, Yvon Blais.
- Chicha-Pontbriand, Marie-Thérèse et Daniel Carpentier, 1991, Une loi proactive sur l’équité salariale au Québec.Rapport de consultation de la Commission des droits de la personne et recommandations, Montréal, Commission des droits de la personne du Québec.
- Commission de l’équité salariale (CES), 2002, L’équité salariale, un poids, une mesure.Rapport du ministre du Travail sur la mise en oeuvre de la Loi sur l’équité salariale dans les entreprises de 10 à 49 personnes salariées, Québec, Gouvernement du Québec, consulté sur Internet (www.ces.gouv.qc.ca/documents/publications/rappmini.pdf) le 2 février 2019.
- Commission de l’équité salariale (CES), 2006, La Loi sur l’équité salariale. Un acquis à maintenir.Rapport du ministre du Travail sur la mise en oeuvre de la Loi sur l’équité salariale, Québec, Gouvernement du Québec.
- Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), 2019, La Loi sur l’équité salariale. Un apport indéniable pour contrer la discrimination salariale.Rapport du ministre du Travail sur la mise en oeuvre de la Loi sur l’équité salariale, Québec, Gouvernement du Québec, consulté sur Internet (https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/equite/rapport_loi_equite_salariale.pdf) le 15 septembre 2019.
- David, Hélène, 1986, Femmes et emploi, le défi de l’égalité, Montréal, Institut de recherche appliquée sur le travail (IRAT).
- Déom, Esther et Jacques Mercier, 2001, « L’équité salariale et les relations de travail : des logiques qui s’affrontent », Recherches féministes, vol. 14, no 1, p. 49-61, consulté sur Internet (https://id.erudit.org/iderudit/058124ar) le 7 janvier 2019.
- Fontaine, Joseph et Patrick Hassenteufel, 2002, « Quelle sociologie du changement dans l’action publique ? Retour au terrain et “refroidissement” théorique », dans Joseph Fontaine et Patrick Hassenteufel (sous la dir. de), To Change or not to Change ? Les changements de l’action publique à l’épreuve du terrain, Paris, Presses universitaires de France, p. 9-29.
- Fortin, Nicole M. et Michael Huberman, 2002, « Occupation Gender Segregation and Women’s Wages in Canada : An Historical Perspective », Canadian Public Policy, p. 11-39, consulté sur Internet (http://faculty.arts.ubc.ca/nfortin/econ351/2002s-22.pdf) le 18 février 2019.
- Fraser, Nancy, 2005, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution [trad. et introd. Estelle Ferrarese], Paris, La Découverte.
- Fraser, Nancy, 2010, « Pour une politique féministe à l’âge de la reconnaissance : approche bidimensionnelle et justice entre les sexes », dans Annie Bidet-Mordrel (sous la dir. de), Les rapports sociaux de sexe, Paris, Presses universitaires de France, p. 123-141.
- Garon, Muriel et Pierre Bosset, 2001, Le droit à l’égalité : des progrès remarquables, des inégalités persistantes – La Charte québécoise après 25 ans, consulté sur Internet (www.cdpdj.qc.ca/publications/bilan_charte.pdf) le 20 janvier 2019.
- Gaucher, Dominique, 1996, « L’équité salariale. Une nouvelle perception du travail », Le marché du travail, vol. 17, no 9, p. 6-9 et 69-79.
- Giddens, Anthony, 1987, La constitution de la société [trad. Michel Audet ; titre original : Constitution of Society, 1984], Paris, Presses universitaires de France.
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2018, « Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au Québec : Perspectives au regard des différences de composition de la main-d’oeuvre », préparé par Luc Cloutier-Villeneuve, Flash-Info, vol. 19, no 1, consulté sur Internet (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/flash-info-201803.pdf) le 3 février 2019.
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2019, « Annuaire québécois des statistiques du travail. Portrait des principaux indicateurs du marché et des conditions de travail 2008-2018 », Travail et rémunération, vol. 15, consulté sur Internet (http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/annuaire-v15.pdf) le 15 septembre 2019.
- Institut de recherche et d’information socioéconomique (IRIS), 2019, Inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes au Québec : L’impact de la ségrégation professionnelle du secteur public, Rapport de recherche préparé par François Desrochers et Ève-Lyne Couturier, consulté sur Internet (https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/IRIS_equite_salariale_2019_web.pdf) le 27 février 2019.
- Kergoat, Danielle, 2000 [2e éd. aug.], « Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », dans Françoise Laborie, Hélène Le Doaré, Danièle Senotier et Helena Hirata (sous la dir. de), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, Presses universitaires de France, p. 35-44.
- Kergoat, Danielle, 2010, « Le rapport social de sexe – de la reproduction des rapports sociaux à leur subversion », dans Annie Bidet (sous la dir. de), Les rapports sociaux de sexe, Paris, Presses universitaires de France, p. 60-75.
- Legault, Marie-Josée, 2011, « La mixité en emploi au Québec… Dans l’angle mort chez les moins scolarisés ? », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (Remest), vol. 6, no 1, consulté sur Internet (https://id.erudit.org/iderudit/1000448ar) le 25 janvier 2019.
- Rose, Ruth, 2016, Les femmes et le marché du travail au Québec : portrait statistique. Résumé, Montréal, Québec, Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’oeuvre.
- Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, consulté sur Internet (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html) le 20 mars 2019.
- Charte des droits et libertés de la personne, LRQ c C-12, consulté sur Internet (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM) le 20 mars 2019.
- Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale afin principalement d’améliorer l’évaluation du maintien de l’équité salariale (LQ 2019, c4), Projet de loi no 10 adopté le 9 avril 2019, consulté sur Internet (http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-10-42-1.html), le 2 mai 2019.
- Loi sur l’équité salariale, 2019, L.R.Q. c. E-12.001, Québec, Les Publications du Québec, consulté sur Internet (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-12.001), consulté sur Internet le 20 avril 2019.
- Pay Equity Act, R.S.O. 1990, c. P.7, consulté sur Internet (https://www.ontario.ca/laws/statute/90p07) le 20 avril 2019.
- Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et als c. Procureur général du Québec et als, no dossier 200-17-011532-090 et autres, Cour supérieure, juge Édouard Martin, 22 janvier 2014.
- Beaulieu Canada – Syndicat des vêtements, du textile et al. c. Commission de l’équité salariale, 2006 QCCRT 0357, 10 juillet 2006.
- Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureure générale), 2018 CSC 18, 1 RCS 522, 10 mai 2018.
- Commission des relations de travail, dossier no 221536 – Référence : 2006 QCCRT 0357, le 10 juillet 2006, Commissaire Jacques Vignola, 10 juillet 2006.
- Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2016 QCCA 1659 CanLII), 12 octobre 2016.
- Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17, 1 RCS 464, 10 mai 2018.
- Société des alcools du Québec c. Commission des relations du travail, 2008 QCCS 3501 (CanLII), 500-17-032563-069, juge Sophie Picard, 29 juillet 2008.
- Syndicat du personnel technique et professionnel de la Société des alcools du Québec (SPTP) c. Société des alcools du Québec, 2011 QCCA 1642. 500-09-08989-087 (500-17-032563-069), 15 septembre 2011.
- Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général), 2004 (CanLII) QCCS 656 (Can LII), 200-05-011263-998, juge Carole Julien, 9 janvier 2004.

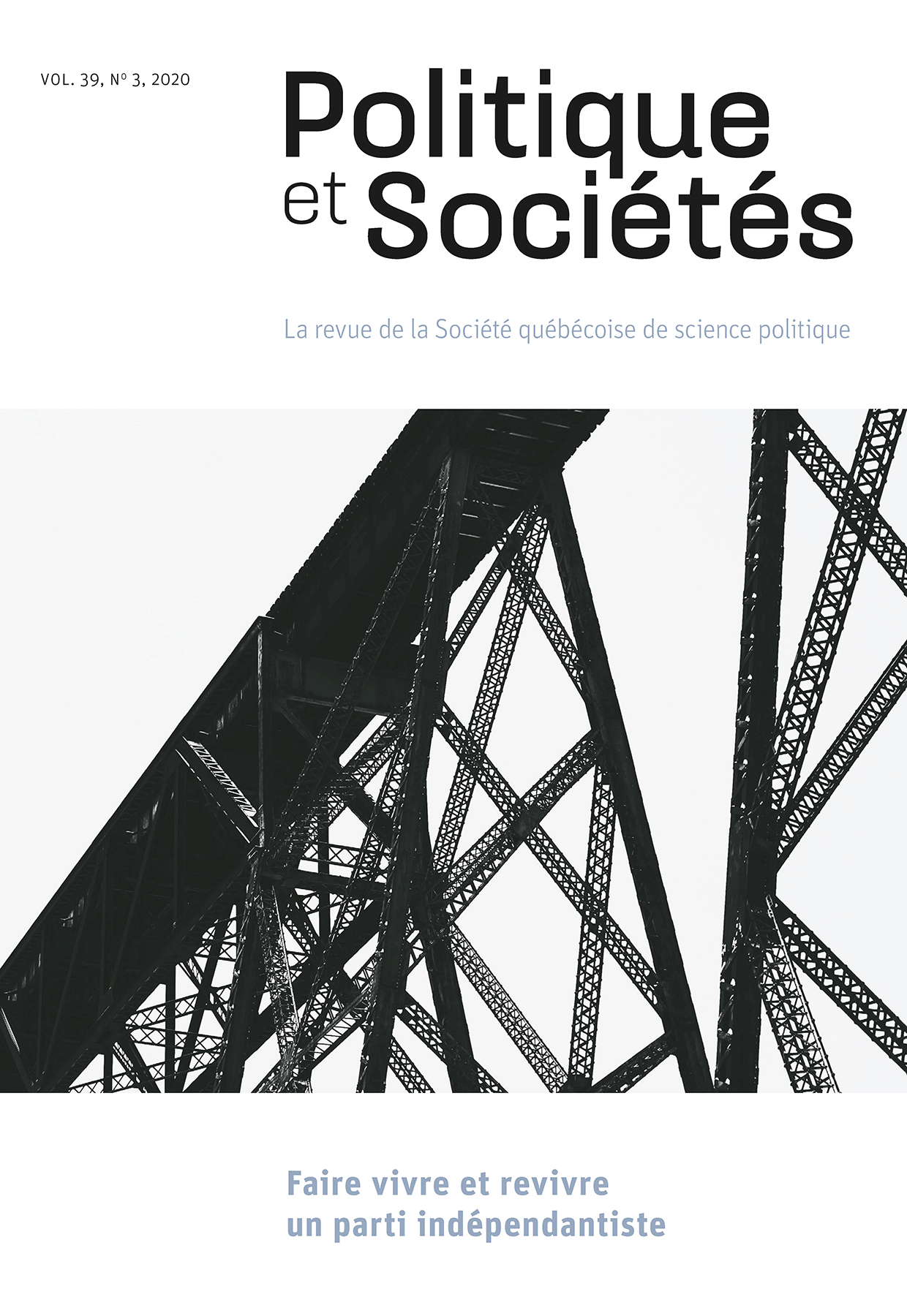
 10.7202/058124ar
10.7202/058124ar