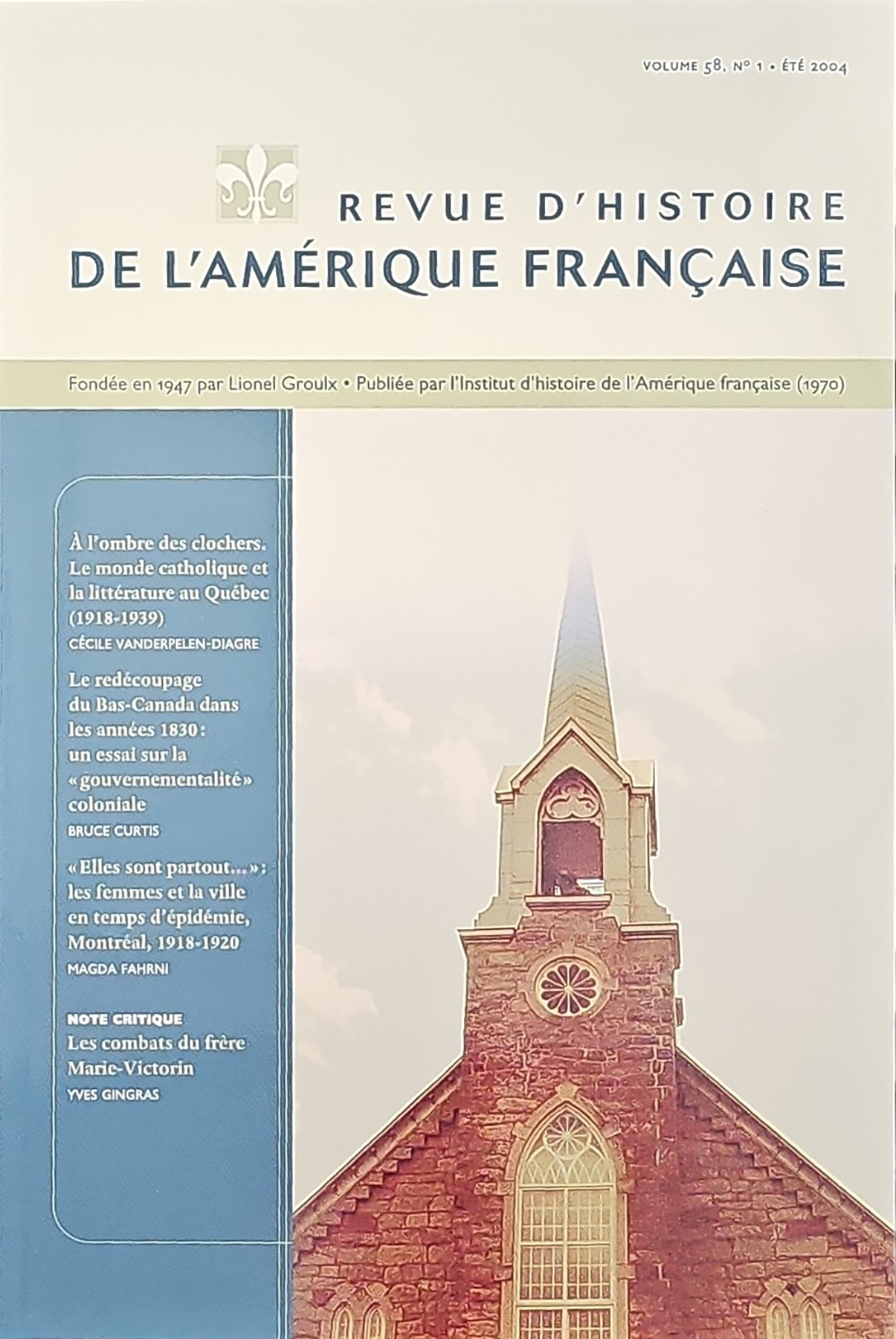Abstracts
Résumé
Bien que le poids de l’Église catholique se fasse fortement ressentir dans la vie culturelle et sociale du Québec de l’entre-deux-guerres, la littérature n’est pas marquée explicitement par cette influence. Jusqu’à la fondation de la revue La Relève (1934), romans et poèmes expriment la foi de leur auteur de manière latente. Il n’y a donc pas de la part des écrivains la volonté de produire une littérature « engagée », comparable aux oeuvres du « renouveau littéraire catholique » français et belge qui se développe à la même période. Afin de tenter d’expliquer ce phénomène, cette étude analyse l’articulation entre le monde catholique québécois et la littérature dans ses manifestations institutionnelles (les revues, les prix) et individuelles, grâce à l’examen de romans et de personnalités significatifs.
Abstract
Although the Roman Catholic Church had an important influence on Quebec cultural and social life during the interwar years, this influence did not have an explicit impact on the province’s literature. Indeed, until the creation of the journal La Relève (1934), novels and poems provided only a latent expression of their authors’ faith. Writers had no desire to develop a « littérature engagée » in the same vein as the works produced by the Catholic revival in French and Belgium literature during the same period. In an attempt to explain this phenomenon, this study analyses the ties between Quebec’s Catholic society and literature – in terms of both literary institutions (journals, awards) and the individual works and authors – by looking at key novels and individuals.
Article body
L’histoire de la littérature française a été marquée par les prises de position d’hommes de plume catholiques, qu’on pense à Bossuet, Pascal, Chateaubriand ou Louis Veuillot. Dans le dernier quart du xixe siècle, en France et en Belgique, naît un mouvement d’écrivains se revendiquant également du catholicisme mais selon des modalités neuves. Dans la foulée de l’émergence de la figure de l’écrivain « engagé » consécutive à l’affaire Dreyfus, ils cherchent à gagner reconnaissance et légitimité au sein du monde littéraire. Ce courant autoproclamé de « renaissance littéraire catholique » se mobilise pour lutter contre l’anticléricalisme, la sécularisation et la rationalisation de la société libérale née de la Révolution française. Sa particularité est de poser en permanence la question éthique en l’appliquant au fait littéraire, sans toutefois imposer l’expression d’une morale constituée. L’écrivain catholique engagé n’est donc pas seulement le porte-parole d’un parti, un militant, posture adoptée par les « B » du traditionalisme français : Bourget, Bordeaux et Bazin. Il s’inscrit dans un système qui vise à édifier des ponts entre institution littéraire et communauté catholique. En permanence, il doit résoudre une tension entre l’art pour l’art et l’art engagé et doit donc adopter un discours à double face : celui de la logique apologétique du système catholique et celui de la logique du champ littéraire. Cette démarche implique la mise en place d’un dispositif qui se compose comme suit : 1) l’objectivation du fait religieux à l’intérieur de l’oeuvre ;2) la tentative de trouver une définition de l’expression littéraire élaborée (par exemple : qu’est-ce que le roman catholique ?) ; 3) la fédération institutionnelle (par des revues, des maisons d’édition ou des salons), afin de conférer visibilité et autorité au mouvement. Dans l’entre-deux-guerres, lorsque l’espace culturel et médiatique est investi par la figure emblématique de l’écrivain engagé, les hommes et les femmes de lettres catholiques interviennent massivement dans les débats éthiques et politiques. Clairement discernables, leurs prises de position correspondent à un phénomène social comparable, dans ses dynamiques identitaires, à celui des écrivain(e)s communistes, socialistes, juif(ve)s ou féministes/féminines, pour n’en citer que quelques exemples[2].
Un tel phénomène se manifeste-t-il au Québec ? Il me semble intéressant d’analyser la manière dont l’articulation entre catholicisme et littérature se présente à l’heure où, de l’autre côté de l’Atlantique, le champ littéraire de deux pays francophones ayant également une histoire marquée par le poids de l’Église, la France et la Belgique de langue française, est animé par quelques écrivains catholiques renommés, par exemple Mauriac, Claudel et Bernanos. Il s’agit donc de mesurer les variations de la question identitaire selon l’ère sociopolitique québécoise.
Pour saisir l’interpénétration entre champ littéraire et champ religieux, il est nécessaire d’interroger la manière dont se passe leur cohabitation à l’intérieur de trois pôles : les institutions culturelles (maisons d’édition, revues culturelles et littéraires, instances de consécrations littéraires, académies, prix), les institutions religieuses (activités et directions des congrégations en matière littéraire) et les institutions sociopolitiques (système scolaire, subventions étatiques, présence d’écrivains dans le champ du pouvoir). Le champ littéraire lui-même doit être décomposé afin de déterminer les fractures sociales (les générations, les origines sociales, les professions, les sexes) et idéologiques qui déterminent la relation des auteurs avec la religion. À côté de ces aspects se pose la question de l’empreinte religieuse sur les pratiques littéraires, laquelle peut se manifester tant du point de vue du contenu que de la forme. Dans cette perspective, l’emploi des sujets généralement privilégiés par l’idéologie catholique (nationalisme, régionalisme, ruralité, culte de la tradition, etc.) doit être examiné et mis en lien avec les canons stylistiques (hiérarchie des genres, rapport au classicisme). Dans une première étape qu’illustre cet article, il s’agit de poser les jalons préliminaires de l’enquête. La comparaison avec le cas français, et dans une moindre mesure, belge, servira de levier à cette étude, qui me conduira à mettre en évidence les enjeux littéraires, politiques et sociologiques qui déterminent la rencontre entre catholicisme et littérature au « pays » de Mgr Camille Roy[3].
Une religion latente
L’espace littéraire québécois, tel qu’il se présente entre 1918 et 1939, n’offre aucune manifestation institutionnelle qui permettrait de parler d’un phénomène littéraire catholique socialement affirmé : aucune revue (comprenant un manifeste ou un programme), aucune maison d’édition et enfin aucun rassemblement (groupe, association, académie ou salon) plus ou moins informels ne sont créés dans le but explicite de défendre une telle cause.
Si on ne peut véritablement parler d’agrégation sociale autour d’un « projet littéraire catholique » défini, cela ne veut évidemment pas dire que la religion ait été absente de l’imaginaire d’écrivains qui, pour la plupart, sont croyants et pratiquants. Bien au contraire, les thèmes religieux imprègnent, voire déterminent, l’atmosphère de la littérature[4]. Comme l’écrit Gilles Marcotte, « le religieux, au Canada français, a partie liée avec la culture ; on pourrait dire à la fois qu’il l’asservit, et qu’il est asservi par elle[5] ». Cependant, ce substrat idéologique n’est jamais le noeud central de l’intrigue. Dans les romans classiques de l’époque (Un homme et son péché de Grignon, Trente arpents de Ringuet, Maria Chapdelaine de Louis Hémon, L’appel de la race de Groulx, Menaud maître draveur de Savard), la foi n’est pas un objet d’interrogation pour les personnages. Les poèmes, quant à eux, même lorsqu’ils sont écrits par des auteurs ouvertement catholiques comme Alfred DesRochers ou Clément Marchand, sont, dans leur grande majorité, peuplés de signes religieux, mais ne témoignent pas réellement de préoccupations spirituelles intimes. Le théâtre, tout particulièrement corseté par le clergé[6], est conçu comme un médiateur du message évangélique mais n’est pas construit à partir d’interrogations métaphysiques[7]. La critique, même tenue par des clercs tels Camille Roy ou M. A. Lamarche, ne cherche pas à déceler et à caractériser dans les oeuvres la substance religieuse, seul l’aspect moral, casuistique, l’intéresse. Toujours, la foi et le culte sont présents en toile de fond.
Certains se plaignent de cet état de fait. L’abbé Joseph-Marie Melançon, de son nom de plume Lucien Rainier, écrit :
De tous les genres littéraires, le genre religieux est peut-être celui qui est le moins cultivé par les poètes canadiens contemporains. […] On s’attend naturellement à ce que la poésie soit représentative, jusqu’à un certain degré, des sentiments d’une nation, la manifestation extérieure de son esprit. Il est évident, d’autre part que notre peuple est encore tout pénétré de foi ; les pratiques religieuses abondent en notre pays, l’Église y règne plus que nulle part ailleurs. Si un grand nombre d’ouvrages en prose reflètent cette mentalité de nos gens, on se demande pourquoi les poètes, – du moins ceux de l’heure actuelle, – ont si peu contribué à produire la même impression[8].
Lionel Groulx dresse le même constat, l’expliquant par un « mauvais laïcisme » qui aurait habitué les auteurs à « un catholicisme trop latent ». C’est pourquoi il les prie d’« obéir à la logique et à la sincérité de leur foi réelle », à confesser le Christ dans leur oeuvre[9]. Mais autant le théoricien se montre prolixe quand il s’agit d’exposer son plan d’action nationaliste et les éléments constituant sa doctrine, autant il développe peu sa conception d’une pratique littéraire plus imprégnée de religion. Sa prose ne comporte pas d’élément nous permettant d’éclairer cette question. Certes, Dieu accompagne les personnages et des débats théologiques parsèment les dialogues, mais la foi des personnages n’est pas mise en exergue. En ce sens, le roman est symptomatique de la présence religieuse dans la littérature de l’époque. Son auteur étant un catholique s’adressant à des catholiques, il n’éprouve pas la nécessité d’exposer la religion. Le roman L’Appel de la race est certes le récit d’une conversion, mais il s’agit d’une conversion essentiellement politique – le héros parle d’une « conversion patriotique[10] » –, pas d’un cheminement spirituel. Si l’adhésion au dogme catholique romain mobilise et conditionne les actes du héros, la croyance n’est ni analysée ni décrite en dehors des obligations cultuelles qui en découlent.
Pour Groulx, la nation et le catholicisme sont indissociablement liés et sa doctrine vise à le démontrer. Or il ne va pas de soi d’articuler ces deux paradigmes. L’Église catholique se voulant l’institution mère d’une communauté de croyants transnationale, elle se méfie des régimes qui cherchent à renforcer les particularités étatiques et risquent de provoquer des scissions à l’intérieur d’un bastion qu’elle voudrait uni. En 1926, elle condamne certes le journal L’Action française en raison du paganisme de son directeur, Charles Maurras, mais également en raison d’une doctrine nationaliste qu’elle juge excessive, et dès lors, dangereuse[11]. Comme l’a montré Norman F. Cornett, profondément religieux, Groulx cherche à fonder sa doctrine nationaliste sur le dogme théologique de l’Incarnation. L’unanimité du catholicisme au Canada français serait le signe d’élection d’un peuple destiné à accomplir une mission apostolique et prophétique : incarner la venue de Dieu sur terre[12]. L’axiome n’est cependant pas forcément facile à mettre en pratique, comme le montre l’intrigue proposée dans L’Appel de la race. Dans le roman, le père Fabien, pour sauver l’enseignement catholique francophone en Ontario, n’incite-t-il pas de Lantagnac à sacrifier un mariage chrétien ? L’institution du mariage est un des piliers de la doctrine chrétienne et Camille Roy reprochera à Groulx, en plus d’une vision nationaliste à laquelle il n’adhère pas, cet égarement théologique[13]. La fiction inventée par l’abbé est significative d’un discours identitaire bâti davantage sur la langue et la nation que sur la religion, celle-ci allant de soi. D’une certaine manière, l’action nationale précède l’action catholique.
On mesure la spécificité de cette position quand on la compare avec celles des Français Henri Massis, Robert Vallery-Radot ou Paul Claudel, et des Belges Henri Davignon ou Pierre Nothomb. Nationalistes et catholiques militants, ils énoncent de nombreux discours visant à caractériser leur identité religieuse et à préciser les modalités de l’inscription catholique en littérature. Groulx ne semble absolument pas avoir été influencé par ces écrivains. Il n’est du reste pas interpellé par le mouvement qu’ils animent ; aucun de ses nombreux voyages dans la République ne le mène vers l’un d’eux[14]. Sa correspondance ne porte aucune trace non plus de relations privilégiées avec les auteurs catholiques français reconnus de l’époque[15].
À cet égard, il est intéressant de constater que les écrivains québécois observent le mouvement de renaissance littéraire catholique de l’extérieur. Ils rapportent avec intérêt les débats de la Semaine des écrivains catholiques qui rassemblent annuellement à Paris l’essentiel des hommes de plume de cette obédience, mais l’événement ne les incite pas à porter un regard projectif de leur propre position ou situation. Ils ne se rattachent pas au mouvement. C’est presque malgré eux que, par la suite, ils y seront annexés[16]. Pourtant, les oeuvres sont bien connues : François Mauriac est abondamment lu et commenté[17]. Ces lectures semblent toutefois ne pas influencer réellement les auteurs.
Un indice permet de penser que, incidemment, la question du rôle des Québécois dans le mouvement français s’est posée. L’écrivain Berthelot Brunet dressant une chronique des « lettres catholiques », y intercale effectivement un petit chapitre sur les auteurs « de chez nous ». Toutefois, il ne se préoccupe que de l’« une de nos littératures catholiques, celle des prêtres[18] ». Serait-ce que les autres sont si nombreuses ou si impalpables qu’il ne peut même les évoquer ou les énumérer ? Il est permis de le penser.
Les prêtres représentent en tout cas la seule partie émergente d’un iceberg bien solide sur lequel écrivains et prêtres vivent en bonne entente. Les seuls événements qui provoquent une tension entre monde profane et monde clérical ont lieu lors de parutions soupçonnées d’immoralité (Les demi-civilisés, La chair décevante et Dans les ombres d’Éva Sénécal) ou jugées subversives (Regards et jeux dans l’espace d’Hector de Saint-Denys Garneau, comme nous le verrons plus loin). À cette occasion, des arguments casuistiques sont développés par les clercs, sans toutefois provoquer de la part des écrivains des débats conséquents, comme c’est le cas en France et en Belgique, autour des droits, devoirs et responsabilités des catholiques qui écrivent[19].
Au total donc, on ne relève pas de discours définitoire intégré dans une dialectique visant à la défense des a priori éthiques et esthétiques qui s’y rapportent. On ne peut non plus repérer dans le paysage littéraire de l’époque l’énoncé d’une prise de conscience de certains auteurs concernant leur foi et la nécessité de la défendre et donc, d’affirmer une identité singulière. Généralement, quand une telle prise de conscience a lieu, les individus concernés ressentent le besoin d’une visibilité. Ils produisent alors des anthologies et des essais. Après quelques années, il se crée une sorte de mise à distance des événements, qui leur inspire le besoin d’en relater l’histoire, souvent grâce à des mémoires. Ainsi, le groupe et le mouvement entrent dans l’histoire littéraire. Or, aucune histoire de la littérature québécoise n’intègre dans son propos la participation d’auteurs ayant écrit ou agi au nom de leur foi. À l’époque, on ne peut, sans anachronisme, distinguer un groupe d’écrivains engagés pour divulguer une vision catholique de la cité. Comme a pu le montrer l’historien de la littérature Benoît Denis, l’engagement suppose en effet « une réflexion sur les rapports qu’entretient la littérature avec le politique (et la société en général) et sur les moyens spécifiques dont il dispose pour inscrire le politique dans son oeuvre[20] ». Ce processus n’est pas mis en oeuvre dans le cas des romans prosélytes ou apologétiques et les hagiographies plus ou moins fictives, qui sont très présents dans l’espace québécois (par exemple Le centurion de Routhier[21]).
Des ouailles corsetées
Les recherches ont pu montrer le peu d’autonomie dont jouit la littérature québécoise avant la Révolution tranquille : le clergé censure de manière efficace le livre grâce à sa maîtrise du système éditorial et à son pouvoir d’influence dans les domaines politiques, scolaires et sociaux[22]. Dans ces conditions, l’existence d’un discours culturel introspectif et réflexif en matière religieuse est fortement compromise : l’engagement littéraire exige l’autonomie des écrivains[23]. Voilà pour la cause générale, mais cela n’explique pas les rouages du système. Pour ce faire, il est nécessaire d’examiner les positions occupées par l’Église et le champ littéraire dans l’appareil d’État et le corps social.
En principe, institutions littéraire et cléricale répondent à des logiques inconciliables. Toutes deux obéissent à des croyances différentes : liberté et primauté de l’art pour la première, Dieu et obéissance au droit canon pour la deuxième. Seule une conjoncture particulière permet l’interaction.
En France, le renouveau des lettres catholiques apparaît grâce à la conjonction de deux événements : 1) Les Lois Combes de séparation de l’Église et de l’État de 1905, qui plongent les intellectuels catholiques dans une position les incitant à prendre la plume pour affirmer leur identité. 2) Une place grandissante accordée au laïcat dans l’Église. Depuis la fin du xixe siècle, le clergé a choisi la stratégie du repli sur soi : l’infaillibilité papale, l’instauration du thomisme comme philosophie unique et officielle et le refus de toute approche du « modernisme » (encyclique Pascendi, 1907) sont autant de mesures limitant la marge de manoeuvre des clercs en matière de discours intellectuel. Cette intransigeance dogmatique a pour effet de libérer un champ d’expression venant du temporel. L’Église se sentant menacée accepte d’accueillir ce nouveau type d’intervention, dont la manifestation la plus parfaite est l’Action catholique de la jeunesse française.
Le cas du Québec est très différent. Il semble que l’espace indispensable à l’émergence d’un groupe d’intellectuels laïques n’a pu voir le jour que plus tard. Quatre facteurs peuvent expliquer ce phénomène.
1er facteur : des pasteurs qui ne sont pas des « passeurs »
L’Église trouve sa cohérence et ses assises au Québec au moment où, dans les autres pays francophones, elle doit faire face à la sécularisation des institutions et à une perte de son influence. Cette installation tardive dans un climat général antimoderniste façonne le clergé québécois qui, à la suite de l’échec des Rouges, peut compter sur le soutien de la petite-bourgeoisie, principale interlocutrice dans les questions politiques et sociales au niveau local[24]. Aussi, dans bien des domaines, l’institution ecclésiastique agit et fonctionne au Québec d’une manière beaucoup plus ultramontaine que dans les pays européens. Parmi ces domaines, celui des productions intellectuelles est le plus touché. Les polémiques modernistes qui bouleversent le vieux continent ne l’atteignent pas : il suit le Saint-Siège avec enthousiasme. Il en résulte une faible émulation intellectuelle au sein même du clergé[25]. Ce dernier souffre en outre du rôle essentiellement temporel dans lequel il est cantonné. Certains prêtres s’en plaignent, regrettant la difficulté pour eux de produire des oeuvres littéraires[26].
Dans ces conditions, il leur est impossible d’accomplir un travail de rapprochement entre mondes artistique et religieux. Si le prêtre Camille Roy est certes le parangon et le rassembleur du nationalisme littéraire, il ne l’est jamais au prix de la morale et du respect du dogme. Ses jugements en la matière sont sans appel. Rien de comparable avec le travail d’appropriation de la littérature à l’usage du catholicisme réalisé par les prêtres français Calvet et Bremond, pourtant fort lus de ce côté de l’océan. Convaincus de la nécessité de donner une légitimité à la littérature catholique au sein du champ littéraire, ces deux critiques s’évertuent constamment à dresser des ponts entre religion et littérature. Passeurs entre ces deux mondes, ils cherchent à « discerner dans les oeuvres très profanes le frémissement de la sève religieuse[27] ». Les éléments spirituels sont scrutés tant chez Proust et Verlaine, que chez Montherlant et Valery. Camille Roy ne joue pas ce rôle.
2e facteur : des écrivains qui ne peuvent être des prophètes
Au Québec, la séparation entre l’Église enseignée et l’Église enseignante façonne la présence au monde des fidèles. La hiérarchie entretient un tel clivage entre ces deux mondes qu’il n’est pas permis au laïcat d’exercer un travail de critique dogmatique propice au rapprochement entre préoccupations spirituelles et temporelles, comme c’est le cas, en France, chez les philosophes Jacques Maritain et Étienne Gilson. Ce n’est du reste pas un hasard si, malgré leur influence auprès des jeunes, les deux charismatiques théologiens sont suspects aux yeux de la hiérarchie et ne sont pas invités à professer dans les universités québécoises. C’est Toronto qui les accueillera[28].
La volonté des laïcs d’intervenir dans la cité est pourtant bien là. Il est significatif qu’en 1930, Antonio Perrault, juriste et professeur à l’Université de Montréal, se plaigne de l’impossibilité pour ses semblables de prendre la parole à l’Académie canadienne saint Thomas d’Aquin, aréopage où ils ne sont admis que depuis peu. Et d’invoquer le soutien du Saint-Siège à l’Action catholique et de plaider pour un rôle accru des « simples mortels » dans la propagande évangélique[29]. L’auteur met là le doigt sur un point fondamental : dans le très catholique Québec, l’Action catholique spécialisée ne s’implante qu’au début des années 1930 – soit dix ans après la Belgique et la France – et ne sera réellement coordonnée, c’est-à-dire efficace, qu’à la fin de la décennie. En fait, malgré les injonctions papales relayées par l’épiscopat, la culture politique de la hiérarchie est lente à assimiler la notion centrale de l’Action catholique : la participation des laïcs à l’apostolat de la hiérarchie[30].
En matière littéraire, l’Action catholique n’est pas sans pouvoir, puisque c’est elle qui décerne l’un des deux prix littéraires au Québec : le prix d’Action intellectuelle. Destiné aux jeunes auteurs, il précède le Prix David, récompense d’ordre national. Dans le jury de l’Action catholique siègent au moins deux prêtres qui veillent au grain moral. Alfred DesRochers aura à expérimenter l’intransigeance dogmatique de l’assemblée lorsqu’il se verra refuser une distinction pour son recueil de poèmes L’offrande aux vierges folles, jugé trop sensuel. Il aura beau arguer de la profondeur de sa croyance, dont son oeuvre est le reflet, imprégnée qu’elle est de symboles, d’expectatives et d’inquiétudes religieuses, rien n’y fera[31]. On verra à cette occasion le poète fort soucieux de défendre son oeuvre. Et pour cause : le prix, décerné par une institution confessionnelle, constitue l’un des principaux moyens de reconnaissance pour un jeune auteur québécois. Le poète Robert Choquette (1905-1991), rédacteur en chef de La Revue moderne, tentant d’expliquer les obstacles à l’épanouissement de la littérature canadienne-française, évoque le rôle de l’Action catholique :
Il est vrai […] que nous nous heurtons tous à de douloureux préjugés qui empêchent un art sincère. Est-il possible, par exemple, d’exercer le métier de romancier dans un pays où la peur des mots oblige souvent à de longues périphrases, et où une norme sévère de la morale, confite dans l’illusionisme [sic] et l’hypocrisie, empêche l’écrivain d’être complet en le confinant à des sujets conventionnels. Car pour les romanciers québécois, bon nombre de thèmes intéressants sont tabous. Imagine-t-on un romancier canadien-français publiant à l’A.C.F. des livres dans l’esprit de « Sous le Soleil de Satan », « Thérèse Desqueyroux » ou encore de « Jean le Bleu » ? D’un seul coup, dans les quelques [sic] deux ou trois cents journaux du pays, on verrait se liguer contre une telle sincérité tous les roquets de la pudibonderie, tous les champions de l’esprit primaire qui prétendent, sans en avoir l’air, que l’art est vassal de la feinte et du mensonge et qu’il peut s’épanouir sous une couche épaisse de restrictions et de simagrées[32].
On remarquera que deux des romans exemplaires cités par Robert Choquette sont apparentés à la renaissance catholique française, ce qui indique la force d’attraction d’une littérature qui témoigne des drames de la foi, pour mieux la répandre.
Mais la « peur des mots » dont parle Choquette caractérise également les modalités d’énonciation de tout ce qui a trait à la religion. C’est particulièrement sensible dans le champ de la critique. Dans la série d’essais lancée au début des années 1930 par l’éditeur Albert Levesque (collection « Les jugements »), on ne découvre aucun ouvrage qui aborde de front la question de la morale religieuse. Le seul à s’y être risqué est Louis Dantin (1865-1945). Ce prêtre défroqué, vivant en exil à Cambridge depuis 1903, exerce une influence de critique discrète mais profonde, les jeunes écrivains lui envoyant leurs manuscrits. À maintes reprises, il s’insurge contre la censure cléricale. Son essai est toutefois marqué par la prudence. Dans un chapitre intitulé « L’art et la morale », il tente de démontrer l’autonomie de la beauté par rapport à la morale. Précédemment, le texte a paru dans La Revue moderne, grâce à l’entremise de Choquette. Rompu à la rhétorique casuistique et soucieux de ne pas provoquer un scandale, Dantin dilue son message dans les litotes.
Notez bien, écrit-il à Choquette, que ma thèse est non seulement juste, comme l’admettra bien tout artiste, mais techniquement orthodoxe, et qu’elle a les réserves et les distinctions qui la feraient passer devant l’Inquisition elle-même. C’est pour cela, en somme, que je vous la confie : si elle était vraiment hérétique, je ne voudrais pas vous attirer des tracas, peut-être des foudres. Malgré tout, elle va bien plus loin que nos petits esprits ne voudraient admettre, ou dire tout haut tout en l’admettant[33].
L’article ne soulève, effectivement, pas de foudres.
J’étais sûr, écrit Dantin, à force de distinguos, d’y être resté orthodoxe, tout en frisant nombre d’hérésie. Et le Devoir n’a rien répondu parce que, au fond, je crois, il n’y avait rien à répondre. N’est-ce pas un bon point gagné pour l’art que de l’avoir dégagé de cette servitude envers un élément qui lui est étranger, d’avoir prouvé son indépendance au moins intrinsèque de tout ce qui n’est pas, purement et simplement le Beau[34] ?
Sans doute trop circonspect, l’article n’aura, à ma connaissance, aucune répercussion. Les homologues de Dantin s’abstiendront de le relayer et de lancer un débat. L’enjeu est de taille. Dans un système de cloisonnement entre monde clérical et laïque, les domaines de compétences sont clairement définis. Au premier, il revient de détenir le discours sur la sphère spirituelle, au second est réservé le pôle temporel. Les hommes de lettres ne peuvent se permettre d’aborder les questions éthiques, jugées d’ordre sacré, et laissent ce soin aux personnes autorisées.
3e facteur : censure et autocensure
Le problème avec les romans de Mauriac et de Bernanos, c’est qu’ils ne peuvent pas être « mis entre toutes les mains », puisqu’ils charrient des questions existentielles que seules sont autorisées à se poser les « âmes aguerries ». Les autres – les jeunes filles surtout – ne peuvent les lire sans danger. Il faut se rappeler, en effet, que toute la question de la morale en littérature se résume aux lecteurs : de natures et de qualités diverses, ils se répartissent sur une échelle allant de la couventine à l’homme mûr très instruit. Dans beaucoup de pays, pour s’assurer que chaque catégorie de lecteurs compulse les ouvrages qui lui conviennent, le clergé produit des quantités de guides, revues et répertoires qui distribuent des cotes morales. Au Québec, jusqu’à la fondation de la revue Lecture par Fides, en 1946, un tel système n’existe pas. Pour les écrivains, cela signifie l’impossibilité de s’adresser à un public avisé. Les cotes permettent à la littérature pour littérateurs d’exister. Sans cela, tout propos, même imprégné de religion, pourvu qu’il soit un tantinet subversif, subit une réprobation. Même le très clérical Séraphin Marion, critique à la Revue dominicaine, perçoit les dommages d’un système sans nuance[35].
De la sorte, l’écrivain s’adresse à un horizon d’attente homogène : des catholiques dont il faut préserver la morale. Les âmes ne sont pas à convertir mais à conserver. Nul n’est besoin par conséquent d’énoncer un message prosélyte, par nature plus introspectif. Si l’on en croit le père Lamarche, les récits de conversions, qui foisonnent en France, sont perçus comme des « confidences indiscrètes, inopportunes ». À lire le dominicain, on comprend que ce type de propos n’offre aucune pertinence pour des catholiques « confortablement installés dans leur foi, mais peu au courant des exigences si multiples, si variées de l’apostolat en terre de France ».
J’admets volontiers qu’un Canadien, ayant perdu puis recouvré la foi de son baptême, n’a guère à cette occasion d’autre devoir social à remplir que celui de reprendre son banc à l’église. Mais comment voulez-vous qu’un converti de là-bas, se souvenant avec angoisse des nombreux compagnons d’erreur semés en route et mesurant leur infortune à la sienne, n’éprouve aussitôt le besoin de partager avec eux son bonheur reconquis ? Et si ce néophyte tient en main une plume bien taillée qui propagea peut-être l’impiété et la licence, pourquoi cet instrument de ruine ne serait-il pas converti à son tour en instrument d’édification[36] ?
Aussi, dans la plupart des cas, les auteurs sont-ils parfaitement avertis des marges de manoeuvre dont ils disposent pour ne pas outrepasser la morale. Si on excepte la Scouine de Laberge (édité en privé à 60 exemplaires) et Les demi-civilisés et L’homme qui marche de Harvey, les auteurs omettent soigneusement de diffuser un discours attentatoire à ce qu’on appelle, à l’époque, « nos croyances ». C’est en vain qu’on cherchera un roman irrévérencieux à l’égard de la religion ou de ses médiateurs. Cependant, sporadiquement, les germes, sinon d’une contestation, du moins d’une prise de distance, sont bien là. Mais ils s’expriment en des accents très prudents. C’est clairement le cas chez le médecin Gabriel Ringuet (pseudonyme de Philippe Panneton). Dans son récit, Trente arpents, il rompt avec l’impératif du roman édifiant de la terre. La campagne qu’il décrit, loin d’être paradisiaque, est peuplée d’êtres animés d’une foi de façade, dictée par un esprit bassement matériel. Assurément, le fils du héros, en revêtant la soutane, emplit son père d’aise. Mais la fierté ressentie par le patriarche est prosaïque. Son ravissement vient de ce qu’il peut « mourir tranquille, estimé et surtout envié[37] », pas d’avoir donné un enfant à l’Église. Cette institution est perçue comme une sorte de mangeuse d’hommes. Une fois ordonné, le paysan devient un étranger, plus craint qu’admiré. « Sans hésitation il va prendre sur ses frères et soeurs une autorité qui les étonne, et vis-à-vis de son père un peu de condescendance[38]... » Sans être aimé, le curé est cependant respecté.
Pour toutes ces raisons, le roman frôlera la censure. Le rédacteur en chef de l’Action catholique, Louis-Philippe Roy, écrit : « Nous avons eu de nombreuses remarques, surtout de la part du clergé et des laïcs s’occupant d’enseignement, remarques plutôt sévères. On se plaignait même du fait que l’Action catholique n’avait pas encore dénoncé 30 arpents[39]. » Le livre sera toutefois autorisé à circuler. L’auteur a flirté avec le blasphème et l’hérésie, mais il a été suffisamment attentif pour ne pas enfreindre les codes.
Une tout autre forme de transgression nous est offerte dans La chair décevante de Jovette-Alice Bernier, journaliste à la Tribune et membre, avec Alfred DesRochers et Éva Sénécal, du mouvement littéraire des Cantons de l’Est, dans les années 1930. Contant les soucis amoureux d’une femme qui a mis au monde un enfant hors mariage, le roman provoquera une polémique. Pourtant, l’écrivaine met en scène une créature qui expie sa faute dans le remords et la souffrance morale. Certains critiques ne s’y tromperont pas. Le critique Albert Pelletier (1896-1971) voit bien l’« appel presque criant au bénéfice de la rectitude morale[40] » qui émaille le propos. Au « grand risque de sa belle âme[41] », Bernier tient à éditer l’oeuvre sans l’assentiment du clergé. Animée par le goût du risque, elle canalise toute sa désobéissance dans le titre.
Vous ne trouvez pas piquante l’image ? Il me semble que « notre clergé » ne pourrait pas le trouver scandaleux puisqu’il va avec la morale, toujours quand c’est décevant ce n’est pas encourageant d’essayer. Ils penseront ; il faut avoir essayé… Mais oui, c’est entendu ; on ne sait rien de rien quand on n’essaie pas un peu. Ce n’est pas si décevant qu’on le laisse voir[42]...
Les censeurs s’ils s’arrêtent sur « La chair… » verront bien qu’au fond ce n’est pas si suggestif que cela mon roman. Je veux un titre qui fasse vendre le livre. Camille Roy en aura la nausée mais ça fait passer la bile. Je pense que je vais le risquer mon titre ; ce qu’il a qui fait ouvrir les yeux c’est le mot « chair » mais mon Dieu, ils n’ont qu’à se regarder pour en voir et s’ils n’en ont pas, c’est cela qui est tragique. D’en avoir ça n’a affolé personne et puis je n’en montre pas dans mon roman[43]…
Ces deux lettres montrent la connaissance parfaite des risques encourus lors d’une déviation des règles dogmatiques. La démarche de la romancière consiste à protester contre les normes cléricales par le moyen du symbole, par les mots, pas par le fond du discours.
Il est à noter que l’ambiguïté de l’héroïne de Bernier – mi-ange, mi-démon –, ainsi que son habileté à manier le jeu de mots, posent problème aux plus pointilleuses critiques, qui ne peuvent sans injustice stigmatiser l’oeuvre. Elles feront donc appel à l’abbé Bethléem, chef de file de la censure française. Il est plus facile pour un prêtre français de prononcer une mise au ban[44]… Dans un appareil absolument dichotomique (juste/faux ; vrai/hérésie), une telle décision équivaudrait à une sorte d’excommunication, au contraire de la France et de la Belgique, où un mauvais classement par Bethléem ne voue pas l’auteur, même s’il est catholique, aux gémonies de la cité chrétienne.
4e facteur : une majorité en mal d’adversaire(s)
La situation hégémonique et omniprésente du catholicisme au Québec semble avoir un effet fondamental sur l’identité des écrivains. Bien qu’appartenant à la communauté des croyants, en raison de leur situation, ils semblent ne pas se ressentir comme catholiques. On est tenté de penser que la stratégie défensive de l’Église contre les « Autres » (les étrangers, les protestants, les socialistes, les francs-maçons[45]) soit restée dans l’ordre du discours. Si les clercs immigrés de France à la charnière du xixe et du xxe siècles importent et diffusent avec une certaine efficacité leurs harangues contre le monde sécularisé[46], ils ne parviennent toutefois pas à répandre réellement un sentiment de persécution. Un tel rapport au monde nécessite la présence d’un adversaire clairement identifié et identifiable. Si les anglophones protestants sont chargés de toutes les tares, il est permis de penser qu’ils n’occupent pas la place de contradicteur, d’objecteur concret. Sans doute n’est-ce pas possible en raison d’un manque de lieu de sociabilité partagé par les deux communautés qui canaliserait les luttes de pouvoir (le barreau, les universités, les instances dirigeantes, etc.). Dès lors, contrairement à la France et à la Belgique, les prises de position ne peuvent s’inscrire dans une dynamique dialectique.
Une très belle illustration de cet état de fait est la position et la perception d’un Louis Dantin, figure centrale du champ critique à l’époque qui nous occupe. Alors que dans un pays sécularisé le défroqué anticlérical serait la cible de toutes les polémiques, au Québec, il est perçu et traité comme une brebis égarée. Peu averti des habitudes de l’espace littéraire, et sans doute influencé par la France, le franciscain Carmel Brouillard rompt le pacte tacite et s’attaque à lui, lui reprochant d’inféoder dans ses poèmes la religion et l’amour au « vasselage des sens[47] ». Mal lui en prend : il est réprimandé par la majorité des collègues de Dantin. Le critique littéraire du Canada français Maurice Hébert (1888-1960) écrit un texte significatif :
Le cas pathétique de M. Dantin ne saurait être traité avec insistance ni indiscrétion. L’enseignement que nous avons reçu dans nos familles, si profondément chrétiennes, a toujours été qu’il faut prier pour le lévite qui se trompe et ne point faire de publicité à ses erreurs. […] Il y a des replis de conscience qu’on ne touche pas. On les abandonne à la lumière et à la grâce de Dieu. En outre, lorsqu’un prêtre, surtout un moine, met si vivement en cause un de ses frères au service de Dieu, cela ne tourne qu’au scandale des chrétiens[48].
De son côté, Dantin adopte une stratégie modérée, ne comprenant pas la violence et la maladresse d’un Jean-Charles Harvey. Il trouve plus sage d’exercer un « apostolat quotidien », les sons de flûte étant d’après lui plus efficaces que les coups de clairon. « Le temps n’est pas mûr, au Canada, écrit-il à Alfred DesRochers, pour ces attaques directes. Je crois qu’il vaut mieux exposer librement ses propres idées larges, et leur laisser le soin de s’imposer par leur seule force[49]. » Ce temps sera-t-il celui de La relève ?
La relève : un renouveau littéraire catholique ?
À n’en pas douter, La relève constitue un jalon fondamental dans l’histoire de la marche du Québec vers la modernité, puisque la revue offre des propositions qui, à bien des égards, peuvent être lues comme des prémisses au Manifeste du Refus global de 1948[50]. Cependant, il serait impropre de voir 1934, année de parution du premier numéro du mensuel, comme un événement fondateur, transformateur immédiatement des modalités d’interaction entre religion et littérature. Les réelles transformations viendront bien plus tard.
À ses débuts, le mouvement est avant tout spirituel et politique, la littérature n’est pas au centre de ses réflexions. On en voudra pour preuve le peu de polémiques littéraires et la faible place laissée à la production elle-même dans le périodique. Dans un premier temps, tout le débat culturel se fonde sur les théories de Maritain. C’est donc dans ce sens que se concentreront les premières investigations créatrices. Les écrits du philosophe concernant essentiellement la poésie, c’est ce genre qui trouvera sa première réalisation grâce au recueil de de Saint-Denys Garneau, Regards et jeux dans l’espace. L’oeuvre ne donne toutefois pas lieu à un discours définitoire et ne sera pas perçue comme l’amorce d’un programme. Les deux amis du poète, Robert Élie et Robert Charbonneau, focalisent leurs réflexions sur l’aspect esthétique des poèmes, pas sur la subversion éthique qu’ils recèlent par l’emploi du vers libre[51].
Certes le vers libre représente un profond bouleversement par rapport au conformisme stylistique de rigueur en 1937, ce qui ne sera pas du goût de la critique cléricale. Mais la poésie n’implique pas la morale comme le fait le roman, qui, lui, pose le problème du réalisme et de la description psychologique. Surtout, la fiction est nettement plus lue. Or, si on excepte Claudel et le théâtre d’Henri Ghéon et de Gabriel Marcel, le renouveau catholique français s’exprime par le roman. C’est essentiellement par les voix de Mauriac, Schwob, Daniel-Rops et Bernanos que le mouvement connaît sa réussite française et interpelle La relève. Malheureusement, pour ce genre, les théories de Maritain sont inopérantes. Ses essais concernent du reste uniquement la poésie. Bien qu’il soit très ami avec Mauriac, la question de la morale en littérature demeurera un sujet de désaccord entre eux. L’impasse doctrinale n’échappe pas au très lucide de Saint-Denys Garneau qui fait part à Jean Le Moyne de son scepticisme à l’égard des propositions du groupe rassemblé à Paris autour de la revue démocrate-chrétienne Esprit, à laquelle le périodique montréalais est apparenté sur plus d’un point. Pour de Saint-Denys Garneau, les réformes proposées à Paris semblent impraticables. À son avis, « un “programme” en art est stérile ». Il est délicat de « manier de front critique, théorie et réalisation[52] ». Conscient des écueils qui l’attendent s’il marie souci dogmatique et prose narrative, il ne s’adonnera jamais à ce genre, malgré le désir qu’il en a, ce dont témoignent les croquis esquissés dans son Journal.
Pour innover et fonder un art romanesque légitime en littérature et acceptable pour le dogme chrétien, lui et ses amis souffrent de deux handicaps, dont leurs homologues français n’ont pas dû se préoccuper. Premièrement, le renouveau littéraire français s’est cristallisé à la fin du xixe siècle, bien avant les écrits de Maritain. Huysmans, Bloy, Baumann et Mauriac n’ont pas eu, eux, à s’encombrer d’un appareil théorique.
Deuxièmement, les Québécois ne peuvent compter sur un critique averti du dogme qui, tel Charles Du Bos en France, exerce une fonction médiatrice entre le dogme et l’art et se consacre à un travail d’« euphémisation » des discours de part et d’autre. Maritain ne fait que passer à Montréal. Très soucieux de la réussite de La relève, il s’inquiète de cette lacune et propose à l’équipe un aumônier en la personne du père Fortin. Mais les jeunes, trop attachés à leur indépendance, refuseront catégoriquement cette assistance, d’autant que l’une de leurs revendications est la séparation entre le clergé et les fidèles[53]. Dans ce cas précis, il est clair que la fracture entre Église enseignée et Église enseignante est telle qu’il est impossible de concevoir un espace frontalier, ni surtout des douaniers. Ni dans sa correspondance, ni dans son Journal, de Saint-Denys Garneau ne parle de la fréquentation, par lui ou ses amis, d’hommes d’Église. Son ami Jean Le Moyne se souviendra avec détachement : « chacun de nous avait son confesseur, mais jamais longtemps le même[54] ». Rien à voir, donc, avec le rôle emblématique des « grands confesseurs » et « guides spirituels » des écrivains français, les pères Lacaze, Clérissac et Mugnier, pour n’en citer que quelques-uns[55].
Ce n’est qu’à l’orée de la Deuxième Guerre mondiale que Robert Charbonneau et Guy Sylvestre, fondateur de la revue Gants du ciel[56], posent nettement la question du roman catholique dans une perspective canadienne-française. De manière inédite, la série d’articles qu’ils produisent revendiquent le droit pour le croyant de saisir l’homme dans toute sa diversité et, par conséquent, le droit d’aborder le problème du péché[57].
Dans la foulée de ces réflexions, Robert Charbonneau édite en 1941 un roman, Ils possèderont la terre (précédemment paru en épisodes dans La relève), qui peut être vu comme initiateur d’un renouveau littéraire catholique québécois. Il ne s’agit toutefois pas d’une annexe ou d’une lointaine survivance du mouvement français. Non, la présence au monde des personnages et la symbolisation de l’imaginaire religieux mis en oeuvre par Charbonneau sont parfaitement singuliers et propres au substrat sociopolitique québécois. Alors que les romans catholiques classiques belges et français tracent l’itinéraire d’individus vers la rédemption et le salut, les personnages d’Ils possèderont la terre sont, jusqu’au dénouement de l’intrigue, incertains de la route à suivre. Laissés à eux-mêmes, ils agissent sans le conseil d’aucun représentant de Dieu sur terre. Ce n’est qu’incidemment que l’un des héros, Edward Wilding, demande conseil à un prêtre sur le choix d’une épouse. De la sorte, la non-rencontre, la rupture, l’incommunicabilité entre les pasteurs et les fidèles sont ici hypostasiés. Le message évangélique est, lui, arraché au cadre clérical, il devient une quête, une interrogation. Dans le roman, les événements et les dialogues sont équivoques. Le titre, dont la référence biblique ne fait aucun doute, n’est à aucun moment expliqué et est donc laissé à l’interprétation du lecteur.
La déréliction des personnages est renforcée par leur « être au monde », complètement déliés de la société. Alors que, souvent, les romans catholiques français et belges content les péripéties de l’individu qui chemine seul avant de retourner, tel le fils prodigue de la Bible, parmi la communauté des croyants – ce pourquoi on les qualifie de romans de socialisation –, il n’en est rien dans le roman de Charbonneau. Ses personnages, eux, portent un regard critique acerbe sur cette communauté, qui est toute la société. Ils se démènent dans le vide, sans milieu, sans tradition. Ils sont « fils de suicidés, de névrosés ou d’alcooliques ». Leur héritage n’est que démence, leur éducation fut celle de « pédagogues jansénistes », « éducateurs distraits et maladroits[58] ». Ce monde, ils veulent le réformer, pas le retrouver, ni encore moins l’agrandir, comme c’est le cas des auteurs outre-Atlantique. Aucun prosélytisme, aucun souci apostolique n’anime les individus, ce qui n’échappera pas à la critique cléricale.
Bien des romans écrits par la suite par Charbonneau, Robert Élie (Il suffit d’un jour), André Giroux (Au-delà des visages) et Anne Hébert (Le torrent) témoigneront du déracinement de l’individu croyant au sein d’une humanité désincarnée. D’une certaine manière donc, l’adversaire n’est pas le non-catholique, mais le mauvais catholique. Reste à savoir si, ainsi désigné, cet adversaire suffit à mobiliser les élites littéraires catholiques et, si c’est le cas, à déterminer la manière dont cette entité marche vers les métamorphoses sociales des années 1960.
Conclusion
Le xixe siècle a été au Québec marqué par les « grandes polémiques » : affrontements publics virulents (pamphlets, lettres ouvertes, articles de journaux) entre des écrivains emblématiques, tels Louis Fréchette et Arthur Buies, et le clergé. Les querelles sur le rôle civil de l’archevêché, sur fond de lutte entre libéralisme et ultramontanisme, agitent alors le landernau littéraire[59]. Les choses semblent avoir radicalement changé au tournant du siècle. Dorénavant, sauf quelques cas isolés, c’est en vain qu’on cherchera trace de prises de position anticléricales de la part des hommes et des femmes de lettres. Vraisemblablement, la contestation s’exprime désormais dans la clandestinité[60].
S’ils ne contestent pas, les écrivains ne font pas non plus de leur prose le support d’un message prosélyte, projet communément appelé « engagement littéraire ». Il semble qu’après la guerre, le catholicisme soit devenu un sujet presque « tabou ». Comment expliquer ce phénomène ?
Une explication immédiate invoque le mouvement nationaliste des années 1920 porté par Lionel Groulx et Camille Roy, chevilles ouvrières du sursaut identitaire dans le champ littéraire. Il est évident que, pour ces hommes, le rapport à l’identité québécoise ne peut se concevoir sans des fondations religieuses explicites. De manière un peu sommaire on peut dire que, dans le chef de l’intelligentsia ecclésiastique, la lutte contre l’anticléricalisme a fait place au combat pour la nation. Ainsi, les préoccupations patriotiques auraient masqué les thématiques religieuses. Mais l’absence de réel message religieux dans la littérature québécoise tend à penser que, outre la question politique, l’appropriation du thème religieux pose problème. Dans l’entre-deux-guerres, en effet, il semble qu’il ait été plus facile, moins risqué, de parler du rapport de l’homme au pays, que de sa relation à la foi.
Cela se comprend en raison de la politique menée alors par l’Église. À partir de la Première Guerre mondiale, le Saint-Siège prend un tournant répressif. En 1917, la Congrégation de l’Index est remplacée par une section du Saint-Office munie d’un appareil coercitif plus puissant. Un an plus tard, l’institution rappelle le caractère d’obligation du serment antimoderniste et réaffirme l’autorité des conseils de vigilance. Enfin, en 1922, l’investiture de Pie XI, pape savant, austère et autoritaire, entérine ce train de mesures : la suspicion envers les activités intellectuelles est un des axes de son gouvernement. Face à un monde évoluant vers la modernité (libéralisation des moeurs, affirmation des libertés individuelles, etc.), l’Église choisit le repli sur soi. Cette stratégie semble concerner tous les pays catholiques, qui connaissent invariablement une radicalisation morale[61]. Le Québec ne fait pas exception, bien au contraire.
Il faut garder à l’esprit que l’Église bénéficie dans ce domaine d’un relatif soutien de la part des instances gouvernementales. Le régime libéral québécois (à l’instar de son homologue belge) s’installe en prenant assise sur la fonction stabilisatrice de l’Église, utilisée comme gardienne de la paix sociale. Les élites libérales ne s’opposent donc pas réellement à la mainmise du clergé dans les secteurs des soins de santé et de l’éducation. À la suite de la crise et de l’ébranlement du capitalisme subséquent, cette connivence s’intensifie, pour atteindre son apogée en 1935 avec l’arrivée de l’Union nationale de Duplessis, de tendance franchement clérico-conservatrice[62]. De plus, élite laïque et haut-clergé sont formés dans les mêmes écoles, ce qui implique une complicité entre les deux groupes[63]. Dans ces conditions, il est difficile pour les auteurs de trouver un lieu d’adresse pour un discours, sinon subversif, du moins distancié de la doxa générale. On aurait tort, par ailleurs, de sous-estimer le rôle de l’institution scolaire dans le fonctionnement du champ littéraire. Comme l’écrivait Roland Barthes : « la littérature, c’est ce qui s’enseigne ». L’influence du clergé se situe donc bien en amont de la production livresque elle-même[64]. N’ayant aucune chance de pénétrer le système d’enseignement s’ils ne sont pas légitimés par ses cadres, les auteurs ont une marge de manoeuvre très réduite.
Romans et nouvelles sont par conséquent conçus en miroir d’une religion où on ne distingue que difficilement foi, coutume et contrainte. La dynamique permettant la rencontre entre la sphère religieuse et la sphère artistique ne peut se mettre en place. Or, toutes deux procédant de la médiation du symbolique, le religieux se sert volontiers de la sublimation artistique pour signifier un objet absent et invisible. Dans le cas québécois, l’Église oublie qu’« une religion ne peut rester vivante, c’est-à-dire conserver son efficace pour l’âme individuelle du croyant, comme pour la culture, que si l’expression symbolique y garde une place centrale, avant toute rationalisation de type dogmatique ou éthique[65] ». Les germes d’une expérience distanciée et engagée du religieux, annonciateurs de la modernité, pointent ça et là dans l’entre-deux-guerres mais, ne pouvant croître au grand jour – en l’absence d’une réelle autonomie de l’espace littéraire –, ils perdent leur fonction mobilisatrice. Sans doute, lors du mouvement massif de sécularisation des années 1960, l’Église ne pourra-t-elle que difficilement compter sur la contre-offensive d’une élite intellectuelle, dotée d’une tradition d’intervention dans la cité et d’une conscience d’elle-même, comme ce fut le cas en France et en Belgique 60 ans plus tôt. Au Québec, les réformes sont mises en oeuvre dans et par une société chrétienne. Les intellectuels animés de l’idéal « personnaliste » qui s’y engagent doivent lutter contre un anticléricalisme de l’intérieur[66], situation absolument singulière.
Il faut dire que le sentiment identitaire des écrivains catholiques au Québec n’a pu se construire, comme dans ces deux pays, en réaction aux autres entités sociétales. Jean-Paul Sartre a démontré concernant l’identité juive qu’un sentiment d’appartenance à un groupe peut se réaliser par le seul fait du regard de l’autre[67]. Ne vivant pas au sein d’une collectivité où on le tient pour catholique – en dépit des contacts avec les anglophones –, l’écrivain croyant ne voit pas les signes extérieurs de son identité religieuse désignés. Partant, il lui est difficile de les ressentir, et donc de les exprimer.
Appendices
Notes
-
[1]
Cet article a pu être réalisé grâce au CRILCQ (Université Laval) qui a financé mes recherches durant sept mois. Toute ma reconnaissance va aux membres du Centre et tout particulièrement à Denis Saint-Jacques qui a supervisé mon travail. Je remercie également tous les chercheurs qui m’ont très généreusement offert aide et conseils : Denyse Baillargeon, Michel Biron, Micheline Cambron, Aline Charles, Yvan Lamonde, Andrée Lévesque, Pascale Ryan. J’ai également une dette envers Éric Van der Schueren et Mathieu Lavoie.
-
[2]
Voir sur cette question : Littératures et identités numéro spécial de Sociétés contemporaines, 44 (2001). Notons qu’au Québec, contrairement aux relations entre catholicisme et littérature, les relations entre judaïsme et littérature ont fait l’objet de nombreux travaux (notamment : Études françaises. Écriture et judéité au Québec, 37,3 (2001), et pour un bilan historiographique : Iva Robinson, « La tradition et la littérature juives », dans Jean-Marc Larouche et Guy Ménard, dir., L’étude de la religion au Québec : bilan et prospective (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2001), 77-85.
-
[3]
Démarche que m’autorisent mes travaux personnels, Écrire en Belgique sous le regard de Dieu. La littérature catholique belge dans l’entre-deux-guerres (Bruxelles, Éditions Complexe-CEGES, coll. « Histoires contemporaines », 2004), et la thèse de doctorat (sociologie) d’Hervé Serry sur la France : La naissance de l’intellectuel catholique (Paris, La Découverte, coll. « L’espace de l’histoire », 2004).
-
[4]
Ben-Z. Shek, « Bulwark to Battlefield : Religion in Quebec Literature », Revue d’études canadiennes/Journal of Canadian Studies, 18,2 (été 1983) : 42-57.
-
[5]
Gilles Marcotte, « La religion dans la littérature canadienne-française contemporaine », dans Fernand Dumont et Jean-Charles Falardeau, dir., Littérature et société canadiennes-françaises (Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1964), 171.
-
[6]
Jean Laflamme et Rémi Tourangeau, L’Église et le théâtre au Québec (Montréal, Fides, 1979).
-
[7]
Il faudra attendre le théâtre du jésuite Gustave Lamarche, à la fin des années 1930, pour que le genre des pièces bibliques soit actualisé. Du reste, le théâtre au Québec, avant les années 1940, souffre de marginalité tant du point de vue de l’édition, que de la réception et de l’organisation. Seule commence à émerger la troupe des Compagnons de Saint-Laurent du père Legault. Voir à ce sujet : Anne Caron, Le père Émile Legault et le théâtre au Québec (Montréal, Fides, 1978) et Daniel Chartier, L’émergence des classiques. La réception de la littérature québécoise des années 1930 (Montréal, Fides, coll. « Nouvelles études québécoises », 2000), 241-279.
-
[8]
Joseph-Marie Melançon, « L’inspiration religieuse chez nos poètes contemporains », La revue dominicaine (mai 1922) : 195.
-
[9]
Lionel Groulx, « Une action intellectuelle », Dix ans d’Action française (Montréal, Bibliothèque d’Action française, 1926), 33.
-
[10]
Lionel Groulx, L’Appel de la race, [1922] (Montréal, Fides, coll. « Bibliothèque québécoise », 1980), 65.
-
[11]
Jacques Prevotat, Les catholiques et l’Action française. Histoire d’une condamnation (1899-1939) (Paris, Fayard, coll. « Pour une histoire du XXe siècle », 2001).
-
[12]
Je renvoie pour un développement de ces notions à Norman F. Cornett, The Role of Religion in Lionel Groulx’s Nationalist Thought, thèse de Ph.D. (études religieuses), Université McGill, 2002.
-
[13]
Pour les détails de cette affaire, voir : Lucie Robert, « Camille Roy et Lionel Groulx : la querelle de L’Appel de la race », Revue d’histoire de l’Amérique française, numéro spécial Lionel Groulx. 100e anniversaire de sa naissance, 1879-1979, 32,3 (décembre 1978) : 399-405.
-
[14]
Lionel Groulx, Mes mémoires (Montréal, Fides, 1970), tomes 1 et 2.
-
[15]
Sa correspondance ne contient que quelques lettres d’Émile Bauman et de René Bazin. Fonds Lionel Groulx, P1, Centre de recherche Lionel-Groulx.
-
[16]
Treize écrivains québécois sont repris dans l’index des auteurs francophones catholiques de Gonzague Truc (Histoire de la littérature catholique contemporaine (Paris-Tournai, Casterman, 1961) : Victor Barbeau, Robert Charbonneau, Alfred DesRochers, Léo-Paul Desrosiers, Lionel Groulx, Anne Hébert, Louis Hémon, Émile Nelligan, Hector de Saint-Denys Garneau, Félix-Antoine Savard, Marie LeFranc, Camille Roy et Gabrielle Roy.
-
[17]
On trouve une analyse quantitative de cette lecture dans Léon Debien, Saint-Denys Garneau et François Mauriac, mémoire de DES (études françaises), Université de Montréal, 1966.
-
[18]
Berthelot Brunet, « Les lettres catholiques. Une Renaissance ? Une Réforme ? », La revue dominicaine (mars 1937) : 121-127.
-
[19]
Sur ces « affaires », voir : Daniel Chartier, L’émergence des classiques…, op. cit., 177-219 ; Pierre Hébert avec la collaboration de Marie-Pier Luneau, Lionel Groulx et L’appel de la race ([Montréal], Fides, 1996) et Jane Everett, « Regards et jeux dans l’espace et la critique cléricale », Benoît Melançon et Pierre Popovic, dir., Saint-Denys Garneau et La relève, Actes du colloque tenu à Montréal le 12 novembre 1993 (Montréal, Fides/CETUQ, coll. « Nouvelles études québécoises », 1995), 81-98.
-
[20]
Benoît Denis, Littérature et engagement de Pascal à Sartre (Paris, Seuil, coll. « Points Essais », no 407, 2000).
-
[21]
Adolphe-Basile Routhier, Le centurion : roman des temps messianiques (Rome/Québec, Société de Saint-Jean l’Évangéliste/Desclée et Cie/L’Action sociale, 1909).
-
[22]
Voir notamment : Jacques Michon, Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle (Montréal, Fides, 1999) et Fernande Roy, Histoire de la librairie au Québec (Montréal, Leméac, 2000).
-
[23]
Benoît Denis, op. cit.
-
[24]
Nadia F.-Eid, Le clergé et le pouvoir politique au Québec. Une analyse de l’idéologie ultramontaine au milieu du xixe siècle (Montréal, Hurtubise HMH, coll. « Cahiers du Québec - Histoire », 1978).
-
[25]
Nicole Gagnon et Jean Hamelin, Histoire du catholicisme québécois, 3 : Le xxe siècle (Montréal, Boréal Express, 1984).
-
[26]
Adélard Dugré, s.j., « L’avenir littéraire du clergé », La revue dominicaine (mars 1923) : 106-115.
-
[27]
Jean Calvet, D’une critique catholique (Paris, Spes, 1927), 131.
-
[28]
Jean Le Moyne, « Les Maritain, de loin, de près », Jean Le Moyne. Une parole véhémente ([Montréal], Fides, 1998), 143. Textes réunis et présentés par Roger Rolland avec la collaboration de Gilles Marcotte.
-
[29]
Antonio Perrault, « La participation des laïques à l’apostolat intellectuel de l’Église catholique », Le Canada français, XVIII,4 (décembre 1930) : 217-222 et XVIII (janvier 1931) : 307-322.
-
[30]
Nicole Gagnon et Jean Hamelin, Histoire du catholicisme québécois, op. cit., 401.
-
[31]
Alfred DesRochers au RP Marc-Antonin Lamarche, Fonds Alfred DesRochers, Archives nationales du Québec (ANQ-S) 29 août 1929. Voir sur cette affaire l’article de Richard Giguère – que je remercie pour l’aide qu’il m’a apportée – : « Alfred DesRochers et la critique cléricale de son temps. Censure et autocensure de l’Offrande aux vierges folles (1928) », Les facultés des lettres. Recherches récentes sur l’épistolaire français et québécois (Montréal, Université de Montréal, 1993), 163-181. Études réunies par Benoît Melançon et Pierre Popovic.
-
[32]
Adrienne Choquette, textes recueillis par, Confidences d’écrivains (Trois-Rivières, Édition du Bien Public, 1939), 71-72.
-
[33]
Louis Dantin à Robert Choquette, 15 juillet 1928, Fonds Gabriel-Nadeau, ANQ-M.
-
[34]
Dantin à Choquette, copie, 20 octobre [1928], ibid.
-
[35]
Séraphin Marion, « Réclame littéraire et morale », Sur les pas de nos écrivains (Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1933), 145-155.
-
[36]
M. A. Lamarche, « La littérature de convertis », Ébauches critiques (Montréal, Adj. Ménard, 1930), 148-149.
-
[37]
Gabriel Ringuet, Trente arpents (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Bibliothèque du nouveau monde », 1991), 272.
-
[38]
Ibid., 237.
-
[39]
Louis-Philippe Roy à l’abbé Georges Panneton, Québec, 25 juillet 1939, cité dans Panneton, Roméo Arbour et Jean-Louis Major, « Introduction », Gabriel Ringuet, Trente arpents (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Bibliothèque du nouveau monde », 1991), 36.
-
[40]
Cité par Jacques Cotman, « La Chair décevante », Dictionnaire des oeuvres littéraires au Québec, 2 : 1900 à 1939 (Montréal, Fides, 1980), 199.
-
[41]
Jovette-Alice Bernier à Louis Dantin, 20 mars 1931, ANQ-M.
-
[42]
Ibid., 19 février 1931.
-
[43]
Ibid., 25 février 1931.
-
[44]
Pour une étude détaillée de cette affaire, voir : Daniel Chartier, L’émergence des classiques…, op. cit., 177-200.
-
[45]
On pense aux discours du journal de l’Action catholique (Richard Jones, L’idéologie de l’Action catholique (1917-1939) (Québec, Les Presses de l’Université de Laval, 1974).
-
[46]
Guy Laperrière, « Persécution et exil : la venue au Québec des congrégations françaises, 1900-1914 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 36,3 (décembre 1972) : 389-412.
-
[47]
Carmel Brouillard, Sous le signe des Muses. Essais de critique catholique (Montréal, Librairie Granger Frères limité, 1935), 15. Première série.
-
[48]
Maurice Hébert, « Quelques livres de chez nous. Sous le signe des muses », Le Canada français, 22 (juin 1935) : 1013.
-
[49]
Louis Dantin à Alfred Desrochers, 16 juin 1934, ANQ-M.
-
[50]
Pierre Popovic, « Les prémices d’un refus (global) », Études françaises, 23,3 (1988) : 19-30 et Marcel Olscamp, « Un air de famille : entre La relève et Refus global : la génération cachée », Tangence, 62 (avril 2000) : 7-33.
-
[51]
Il s’agit pourtant bien d’une révolution, comme le montre Gilles Marcotte : « Les années trente : de Monseigneur Camille à la Relève », Littérature et circonstance : essais (Montréal, L’Hexagone, coll. « Essais littéraires », 1989), 51-63.
-
[52]
Hector de Saint-Denys Garneau à Jean Le Moyne, Montréal, septembre 1934, Lettres à ses amis (Montréal, Éditions Hurtubise HMH, coll. « Constantes », no 8, 1967), 452.
-
[53]
Jean Le Moyne, « Les Maritain, de loin, de près », op. cit., 140.
-
[54]
Idem.
-
[55]
Voir à ce sujet : Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France (1885-1935) (Paris, CNRS, 1998) et Guislain de Diesbach, L’abbé Mugnier, le confesseur du tout Paris (Paris, Perrin, 2003).
-
[56]
Voir pour l’histoire de cette revue explicitement littéraire et catholique : Marie-Christine Lalande, « Gants du ciel, une revue de la renaissance littéraire catholique au Québec », dans Julie Gaudrault et Kathleen Tourangeau, dir., Jeunes recherches littéraires (Québec, CRILQ, coll. « Interlignes », 2003), 25-42.
-
[57]
Notamment : Blaise Orlier [Guy Sylvestre], « Le roman canadien », Les idées, IX,5 (mai 1939) : 452-456 ; Guy Sylvestre, « Roman et catholicisme », Amérique française, 2,II,4 (janvier 1943) : 49-51 ; Robert Charbonneau, « Le romancier canadien », La nouvelle relève, 2,3 (janvier 1943) : 165-167 et Connaissance du personnage (Montréal, Éditions de l’Arbre, 1944).
-
[58]
Arthur Laurendeau, « Vie de l’esprit. Ils possèderont la terre », L’Action nationale (1943) : 99.
-
[59]
Maurice Lemire et Denis Saint-Jacques, dir., La vie littéraire au Québec, IV : Je me souviens, 1870-1894 (Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 2000), 278-290.
-
[60]
Les études à venir devront éclaircir ce point grâce à un dépouillement général de la correspondance littéraire.
-
[61]
Voir sur la politique du Saint-Siège à l’égard des intellectuels l’excellente synthèse : Étienne Fouilloux, Une Église en quête de liberté. La pensée catholique française entre modernisme et Vatican II (1914-1962) (Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Anthropologiques », 1998).
-
[62]
Jacques Rouillard, « Duplessis : le Québec vire à droite », dans Alain-G. Gagnon et Michel Sarra-Bournet, dir., Duplessis entre la grande noirceur et la société libérale (Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997), 183-206.
-
[63]
René Hardy, Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec (1830-1930) (Montréal, Boréal, 1989), 218.
-
[64]
Voir sur cette question : Max Roy, « Enseignement de la littérature », Paul Aron, Denis Saint-Jacques et Alain Viala, Le dictionnaire du littéraire (Paris, Presses universitaires de France, 2002), 180-183.
-
[65]
Jean-Pierre Sironneau, Figures de l’imaginaire religieux et dérive idéologique (Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 1993), 21.
-
[66]
Expression du cofondateur de Cité libre Guy Cormier, cité par E.-Martin Meunier et Jean Philippe Warren, Sortir de la « Grande noirceur ». L’horizon personnaliste de la Révolution tranquille (Sillery, Septentrion, 2002), 130.
-
[67]
Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive (Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », [1946], 1954), 88.