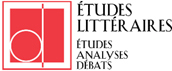Abstracts
Résumé
Écrits à une époque où les relations entre « arts » et « métiers » se font plus étroites, À rebours (1884) de Joris-Karl Huysmans et Monsieur de Phocas (1901) de Jean Lorrain thématisent et textualisent une littérature qui, ciselée par l’écrivain, devient orfèvrerie. Le joyau forme une matière narrative, la main manipule à la fois la page et la gemme, la langue est matériau. La métaphore du « texte-bijou » permet ainsi d’instaurer toute une poétique, mais elle inscrit également ces deux romans dans la société fin-de-siècle.
Abstract
Written at a time when boundaries separating “art” from “craft” were quite permeable, À rebours (1884) by Joris-Karl Huysmans and Monsieur de Phocas (1901) by Jean Lorrain both show the themes and textures of a literature that, under the author’s faceting skills, has become jewelry. Sapphires and emeralds form narrative matter, hands grip both pages and gems, and wording turns to precious stone. An entire aesthetic is derived from the “text-jewel” metaphor, yet establishes these two novels as natural products of a fin-de-siècle society.
Article body
La distinction entre artiste et artisan aura occupé bon nombre de théoriciens de l’esthétique. Si la frontière entre arts libéraux et arts mécaniques a historiquement établi une hiérarchie des pratiques artistiques, les arts décoratifs (céramique, orfèvrerie, poterie, etc.) ont longtemps tenu le bas du pavé au sein de cette hiérarchie. À la fin du XIXe siècle, les relations entre arts et métiers se font pourtant plus étroites, de sorte que peintres, sculpteurs, joailliers et orfèvres travaillent en interaction : des artistes s’approprient les méthodes et techniques des artisans[2], des peintres s’improvisent joailliers d’un jour, des expositions conjuguent Beaux-Arts et arts décoratifs[3].
En effet, le XIXe siècle est riche en bouleversements sociaux et scientifiques qui favorisent l’éclosion de nouvelles tendances en arts de la parure comme dans les Beaux-Arts et qui contribuent à estomper la traditionnelle hiérarchie des disciplines artistiques. Les découvertes de mines de diamants en Afrique du Sud en 1867 et l’essor de l’éclairage électrique remettent les diamants à la mode[4] ; les fouilles archéologiques en Égypte et le développement des entreprises coloniales provoquent l’émergence de nouveaux styles[5] ; les expositions universelles permettent aux créateurs d’examiner le travail d’autrui — contemporain ou ancien. Les impressionnistes découvrent l’art de l’Extrême-Orient, et certains accordent dès lors une plus grande importance à la valeur décorative de l’art[6], développent un goût pour le travail du miniature, s’inspirent des estampes japonaises et s’approprient des techniques d’impression habituellement réservées aux arts appliqués. Face à l’industrialisation, les défenseurs du mouvement Arts and Crafts, quant à eux, valorisent le travail de l’artisan, qu’ils élèvent au rang des Beaux-Arts[7].
Plus que de simples témoins du foisonnement des modes dans le domaine des arts appliqués ou du brouillage des frontières entres les pratiques artistiques, les écrivains de la fin du XIXe siècle apparaissent comme des vecteurs de ces tendances[8]. Car si les importants liens professionnels et personnels entre les écrivains de la fin du XIXe siècle et les peintres qui leur sont contemporains ne sont plus à démontrer[9], les auteurs de l’époque fréquentent également les arts décoratifs[10]. Dépêché aux Expositions universelles de Londres en 1871 et 1872, Mallarmé — sous le pseudonyme de L.-S. Price — prête une plume extasiée à la description et à la critique des meubles, joyaux et autres tapisseries qu’il découvre lors de ces événements[11]. Mallarmé apporte même sa contribution à l’essor des journaux de mode, qui foisonnent dès le Second Empire en France : bien qu’il déplore qu’« on multiplie les éditions à bon marché des poètes » et qu’il fustige « la vulgarisation de l’art[12] », il fondera La dernière mode. Gazette du monde et de la famille, revue où cohabitent aisément la reproduction d’une robe, un poème de Catulle Mendès, une recette ou une nouvelle de Daudet. De la main de l’écrivain à la main-d’oeuvre de l’artisan, il n’y a qu’un pas — qu’une page.
C’est l’étude d’oeuvres littéraires qui nous permettra ici de mieux saisir les liens qui se tissent, au tournant du siècle, entre littérature et arts décoratifs[13]. Au sein d’À rebours (1884) de Huysmans et de Monsieur de Phocas (1901) de Lorrain, textes où plusieurs formes d’art méritent l’attention de l’esthète[14], le travail de l’écrivain, qui cisèle son verbe, est en fait textualisé de la même façon que le labeur de l’orfèvre : le bijou devient matière narrative, la main manipule à la fois la page et la gemme, la langue devient un matériau à tailler et à sculpter. Se forme ainsi une véritable poétique du « texte-bijou ».
Des bijoux inspirants
Huysmans et Lorrain, à la manière de joailliers, fabriquent eux aussi des bijoux. Des bijoux imaginaires, soit, mais qui ne sont pas que de simples parures, d’anodines décorations. Dans À rebours et Monsieur de Phocas, les joyaux, créations de l’écrivain, constituent eux-mêmes une matière narrative. À rebours consacre chacun de ses chapitres aux opinons de des Esseintes sur un art en particulier (la littérature, sacrée d’abord, profane ensuite, les peintures de Gustave Moreau[15], mais aussi la botanique, la parfumerie, la joaillerie), si bien que le roman évacue toute intrigue au profit de la description : « Étourdi par une telle richesse descriptive, le lecteur conclut que cette écriture cherche à entraver le développement de l’intrigue. Celle-ci semble disparaître sous le poids des objets évoqués[16] », souligne Julia Przybos. La matière narrative d’À rebours ne repose pas sur la quête d’un héros — qui ici reste immobile —, mais bien sur des objets esthétiques et artistiques, dont des gemmes. Le chapitre 4 est, en effet, voué à la description des pierres précieuses qui forment la carapace de la tortue de des Esseintes. Ainsi la joaillerie est dotée d’un potentiel narratif et mérite un chapitre entier, comparable à ceux destinés aux Beaux-Arts. Surtout, la place qu’occupe ce chapitre, glissé entre celui sur les Écritures latines et celui décrivant les oeuvres de Moreau, confère à la gemmologie un statut de « véritable art[17] ». L’économie textuelle tend à hisser ce domaine au statut d’art consacré. Même que la joaillerie dissémine son lexique par delà la section qui lui est allouée. La fin du chapitre 3 traite du déclin de la littérature chrétienne — art traditionnellement noble — en des termes habituellement appliqués à la bijouterie : « les fabriques de verbe aux sucs épurés, […] d’adjectifs bizarres, taillés grossièrement dans l’or ; avec le goût barbare et charmant des bijoux goths, étaient détruites[18] ». Suit le passage sur la tortue « décorée », puis le chapitre sur les Salomé de Moreau, où se conjuguent éléments sacrés, architecturaux et décoratifs — en deux dimensions ceux-là :
Un trône se dressait, pareil au maître-autel d’une cathédrale, sous d’innombrables voûtes jaillissant de colonnes trapues ainsi que des piliers romans, émaillés de briques polychromes, serties de mosaïques, incrustées de lapis et de sardoines, dans un palais semblable à une basilique d’une architecture tout à la fois musulmane et byzantine.[19]
L’endroit où s’insère le chapitre 4 dans le roman permet d’emblée de considérer la tortue de des Esseintes comme une oeuvre d’art, mais c’est surtout le vocabulaire utilisé dans les descriptions qui est à ce sujet signifiant : il crée un effet de parallélisme entre les différentes pratiques recensées par l’esthète.
Si les joyaux constituent un bon matériau pour l’écrivain Huysmans, qui leur dédie tout son chapitre 4, les auteurs prisés par des Esseintes donnent aussi des bijoux à lire : alors que Mallarmé crée une Hérodiade libérée du « fourreau de ses joailleries[20] », Théodore Hannon éblouit des Esseintes « avec les chatoiements de ses étoffes, avec les incandescences de ses pierres, avec ses somptuosités, exclusivement matérielles[21] ». Quant à Baudelaire, voulant explorer les profondeurs de l’âme humaine, il « descen[d] jusqu’au fond de l’inépuisable mine, s’[…] engag[e] à travers les galeries abandonnées ou inconnues[22] ». Par métaphore comme au sens propre, la pierre est matière de littérature.
Une quinzaine d’années après À rebours, la gemme réapparaît au coeur d’un roman : l’intrigue de Monsieur de Phocas repose sur l’obsession du duc de Fréneuse, dit M. de Phocas, un esthète collectionneur de bijoux, qui cherche une lueur transparente, verte, dans les pierres ou les yeux des femmes. Puisque la quête du « héros » tourne entièrement autour des joyaux, ceux-ci deviennent une condition sine qua non au roman : sans gemmes, pas de récit. Le livre se présente d’ailleurs comme le manuscrit du duc de Fréneuse lui-même, qui aurait « consigné dans ces feuillets les premières impressions de [son] mal[23] ». Voilà que le collectionneur se veut auteur.
La pierre inspire la parole et l’écriture. Ainsi en va-t-il de l’écrivain à qui le duc confie son manuscrit : cet auteur anonyme a consacré des « pages inoubliables » à l’« art de ciseleur » du grand joaillier Barruchini, il a « décrit en poète l’art prismatique aux lueurs troubles et multiples de cet orfèvre magicien[24] ». La prise de parole de l’écrivain dépasse sa propre volonté, elle semble inéluctable : d’elle-même, « la formule […] monte aux lèvres devant ces fruits d’émail et ces fleurs de gemme emmaillées dans des ors[25] ».
Esthète, le duc de Fréneuse connaît les bijoux du ciseleur en eux-mêmes, mais il les découvre aussi à travers la littérature[26]. La longue tirade qu’il voue aux écrits au sujet des joyaux l’illustre bien. Le bijou devient ainsi une construction à la fois littéraire et joaillière[27]. Ainsi, lorsque Monsieur de Phocas affirme, à la fin de son discours qui convoque tant des bijoux réels que légendaires, « vous voyez que je connais mes auteurs[28] », le mot « auteur » prend un sens ambigu : désigne-t-il l’écrivain ou le ciseleur ? Car auteur et joaillier partagent un même objet, une même « matière narrative ».
Le livre-bijou
Or, la littérature implique une pratique matérielle, une activité, celle de lire ou d’écrire. Avant même l’étape de la lecture, le livre est un objet dont le lecteur se saisit ; avant même l’étape de l’écriture, la page est touchée par la main de l’écrivain. Chez Huysmans et Lorrain, l’auteur (ou le lecteur), à l’instar du joaillier, manipule un objet concret, qui devient pièce de collection. C’est du bout de sa canne, « un jonc d’au moins dix louis, dont la pomme, un ivoire vert d’un travail bizarre[29] », que Monsieur de Phocas feuillette son manuscrit. Quelques pages plus loin, le narrateur se souviendra du duc de Fréneuse, qui « relisait [ses pages] […] du bout de sa canne et du coin de ses yeux[30] ». Ces deux passages soulignent la matérialité de la pratique littéraire : pour lire, il faut tourner les pages. Surtout, la coordination de la canne et des yeux — organe anatomiquement essentiel pour lire — confère, au sein de l’acte de lecture, la même importance à la participation de la canne qu’à celle des yeux. Le duc relisait du bout de sa canne : les joyaux sont directement, et physiquement, impliqués dans la littérature.
Dans Monsieur de Phocas, la rédaction mobilise aussi les efforts de la main, de celle-là même qui porte et manipule les pierres. Dès le début du roman, la main du duc de Fréneuse est définie par ses bijoux et, surtout, apparaît comme une synecdoque du personnage : c’est en remarquant le fin bracelet qui orne le poignet du duc que le narrateur le reconnaît[31], ce qui illustre à quel point les pierres et métaux font partie du corps de l’esthète, constitutifs qu’ils sont de son identité. Par ailleurs, le premier souvenir que le narrateur évoque à propos du duc est celui de sa main examinant les gemmes du ciseleur Barruchini : « ce jour-là, la main dégantée du duc de Fréneuse planait avec d’infinies lenteurs au-dessus d’un tas de pierres dures […] ; et la main parfois se posait, […] désignant du doigt la gemme choisie…[32] ». D’emblée, le narrateur ne se souvient pas du duc, mais de sa main, qui occupe par ailleurs la fonction grammaticale de sujet dans ses souvenirs — c’est elle, et non le duc, qui scrute et choisit les pierres. S’imprime dans la tête du lecteur, dès les premières pages du roman, l’image forte d’une main qui a pour rôle de montrer des gemmes. Or, cette main a une autre fonction, l’écriture, mise en évidence lorsque le narrateur parcourt les pages du duc, « entièrement écrites de sa main[33] ». À l’instar de la canne, qui est physiquement impliquée dans l’acte de lecture comme dans l’apparence du dandy, la main sert à la fois l’écriture et la parure : s’instaure ainsi une correspondance entre l’amateur de pierres et l’écrivain, entre la pierre et la page[34].
Cette matérialité de la littérature se trouve également mise en scène dans À rebours, où les livres occupent une place centrale : véritables bijoux, ces livres sont parures ou pièces de collection. Chez des Esseintes, « volumes, bibelots, meubles[35] » et bibliothèques[36] composent le décor[37] ; même, des récipients d’encre[38] occupent la fonction de babioles ornementales[39]. Esthète, le personnage est particulièrement tenté par les livres dont la reliure est ornée :
deux grandes vitrines regorgeaient d’albums et de livres. Il s’approcha, attiré par la vue de ces cartonnages en papier bleu-perruquier et vert-chou gaufrés, sur toutes les coutures, de ramages d’argent et d’or, de ces couvertures en toiles couleur carmélite, poireau, caca d’oie, groseille, estampées au fer froid, sur les plats et les dos, de filets noirs[40].
Comme le dandy, le livre est paré, il est vêtement (il a des « coutures », des couvertures de « toiles ») et orfèvrerie (en font foi ses « ramages d’argent et d’or » et ses « estampes »). Le papier se fait ornement : parfois remplacé par des « étoffes apprêtées, des papiers à poils, des papiers reps[41] », parures de l’homme comme de l’ameublement, il est d’autres fois confectionné à partir d’une « pâte [dont] les fétus [sont] remplacés par des paillettes d’or[42] ». La calligraphie soignée, les lettres, « relevées de points d’or[43] » ou frappées par le poinçon de l’orfèvre[44] en font aussi foi : le livre, bijou ou tissu, se pare d’emblée comme une décoration[45].
Mais, au-delà de leur caractère ornemental, les volumes, présentés sous vitrine, deviennent ici des pièces de collection. L’esthète accorde de l’importance au caractère exclusif des livres qu’il achète : le papier pailleté d’or est préparé spécialement pour lui par un négociant anglais, et de cette façon il rassemble une collection d’ouvrages singuliers :
Il [se] procur[e], dans ces conditions, des livres uniques, adoptant des formats inusités qu’il [fait] revêtir par Lortic, par Trautz-Bauzonnet, par Chambolle, par les successeurs de Capé, d’irréprochables reliures en soie antique, en peau de boeuf estampée, […] des reliures […] à compartiments et à mosaïques, doublées de tabis ou de moire, ecclésiastiquement ornées de fermoirs et de coins, parfois même émaillées par Gruel-Engelmann d’argent oxydé et d’émaux lucides[46].
Ces livres-décoration constituent des pièces uniques, confectionnées par la main de grands maîtres[47] : que les noms des artisans soient donnés spécifiquement en est un signe[48]. C’est grâce à l’apport de l’artisan que le livre chez des Esseintes atteint le statut d’objet de collection.
En somme, Huysmans et Lorrain mettent en scène une matérialité du littéraire (lecture, écriture, livre) qui assimile la pratique de la littérature aux arts plastiques : sa proximité avec le travail de l’orfèvre s’en trouve renforcée.
Les matériaux : langue, pierres et métaux
Comme le joaillier, l’écrivain travaille à partir d’un « matériau » : la langue. Il manipule la phrase, la plie, la façonne, la tord, la taille, il « frapp[e], dans des gerbes d’étincelles, l’épithète d’un coup sec[49] », crée des pièces « superbement frappée[s] dans un style d’or[50] ». Karen Humphreys a avant nous observé comment chez Barbey d’Aurevilly l’utilisation des gemmes fonctionne comme une métaphore du processus créateur[51]. Dans À rebours et Monsieur de Phocas — mais de façon plus marquée, il est vrai, chez Huysmans —, ce rapprochement entre le travail de l’écrivain et celui du joaillier donne lieu à l’élaboration d’un art poétique. Si Thomas Welcôme s’extasie, en présence du duc de Fréneuse, devant les descriptions qu’il retrouve chez Villiers de l’Isle-Adam, « dans le métal en fusion de son verbe[52] », des Esseintes recherche les écrivains qui, dans leur pratique, font preuve d’originalité, des écrivains dont « l’ardente éloquence fon[d] et tor[d] cette langue[53] ». La création est bouillonnante activité, le génie est « ardent », la langue en fusion sera façonnée. Le cabinet de travail de l’écrivain ressemble à une fonderie où l’on travaille le métal. Au sein d’une poétique décadente qui vise à faire du neuf, mais qui doit forcément composer avec une langue — un « métal » — dont plusieurs combinaisons ont déjà été produites, l’image de la fonderie est, en effet, tout indiquée : des Esseintes exige « des fontes nouvelles et de phrases et de mots[54] ». Naît ainsi une littérature ampoulée, truffée d’archaïsmes, de mots recherchés et de phrases dont la complexité de structure surprend, qui « ten[d] à faire du texte lui-même un objet de luxe[55] ». La langue en elle-même devient une matière, (ré)inventée par l’écrivain : « le sujet “matériel” du roman se double d’une écriture “matérialisée” à outrance[56]. »
L’écrivain fin-de-siècle colore sa langue, il la texture, à l’instar du joaillier, dont les créations sont serties de pierres : si des Esseintes admire Aloysius Bertrand, « qui a transféré les procédés du Léonard dans la prose et peint, avec ses oxydes métalliques, des petits tableaux dont les vives couleurs chatoient, ainsi que celle des émaux lucides[57] », c’est qu’il a une vision de l’écrivain qui « plaque ses couleurs vibrantes[58] », qui fabrique des vers « luisants comme du phosphore[59] ». Des Esseintes dénigre le latin, une langue « sans couleurs, ni nuances », aux expressions « rocailleuses[60] ». La métaphore des pierreries sert ici d’art poétique, afin d’exprimer comment la matière polie (« luisant[e] comme du phosphore ») est à opposer à la matière brute et morte (« rocailleuse »)[61]. La comparaison entre l’oeuvre littéraire et les gemmes permet par ailleurs d’asseoir une poétique fondée sur la force des images qui, telles les pierres, se reflètent les unes dans les autres et qui, grâce à leurs savantes coupes, réfractent dans mille directions. C’est en effet toute une écriture — « symboliste » — qui fonctionne par associations et métaphores que des Esseintes admire chez Mallarmé :
Percevant les analogies les plus lointaines, [Mallarmé] désignait souvent un terme donnant à la fois, par un effet de similitude, la forme, le parfum, la couleur, la qualité, l’éclat, l’objet ou l’être auquel il eût fallu accoler de nombreuses et de différentes épithètes pour en dégager toutes les faces, toutes les nuances, s’il avait été simplement indiqué par son nom technique[62].
Refondue, tordue, raffinée, colorée, éclatante : la langue, de métal et de pierre, se matérialise en bijou. Toutefois, des Esseintes se désole des « forme[s] privée[s] d’idées[63] » ; dans certains cas, les « sonorités de timbres, [les] éclats de métal, ne lui masqu[ent] pas entièrement le vide de la pensée[64] ». La minutie et la précision, qualités de l’écrivain — de l’orfèvre —, doivent aussi être impliquées dans un processus analytique : des Esseintes est attiré par « des flores byzantines de cervelle et des déliquescences compliquées de langue[65] », il admire un roman qui « analys[e] avec une placide finesse […] [dans] une langue splendidement orfèvrerie[66] ». L’écrivain assume la fonction d’un artisan, d’un artisan du travail intellectuel, d’« un manieur expérimenté de loupe, un ingénieur savant de l’âme, un habile horloger de la cervelle », avec son « adresse à manier cet outil perfectionné de l’analyse[67] ». La création littéraire se fait véritable art mécanique : la production intellectuelle convoque les compétences du plasticien comme de l’ingénieur[68].
Par ailleurs, tandis que Claudius Ethal, dans Monsieur de Phocas, croit à l’« expression » des émeraudes[69] ou que le duc de Fréneuse s’épanche sur « l’arabesque épique » d’une falaise de « phosphore, [d’]onyx et [de] pierres précieuses[70] », Huysmans lui-même, plus tard, recourra au vocabulaire habituellement appliqué à la littérature pour célébrer la « parole » des gemmes. Dans sa préface de 1903, il soulignera l’importance qui devrait être accordée à la symbolique des pierres, leur attribuant des propriétés langagières :
Sans doute, je ne nie pas qu’une belle émeraude puisse être admirée pour les étincelles qui grésillent dans le feu de son eau verte, mais n’est-elle point, si l’on ignore l’idiome des symboles, une inconnue, une étrangère avec laquelle on ne peut s’entretenir et qui se tait, elle-même, parce que l’on ne comprend pas ses locutions ? […] l’on peut très bien dire qu’elles [les pierreries] sont des minéraux significatifs, des substances loquaces, qu’elles sont, en un mot, des symboles[71].
Littérature et orfèvrerie s’associent, s’imbriquent, comme pour former une seule et même pratique artistique.
Conclusion
À rebours et Monsieur de Phocas convoquent tout un foisonnement de pratiques artistiques[72] ; pour l’oeil éveillé et sensible de l’esthète, littérature, décoration, musique, peinture, joaillerie suscitent la réflexion. Ces deux romans font cohabiter plusieurs disciplines, ils s’offrent en ce sens comme des manifestations romanesques de La dernière mode de Mallarmé. Les arts dialoguent entre eux, partagent des techniques et des méthodes, des thèmes[73] et des formes — l’illustre l’admiration qu’éprouve des Esseintes devant les oeuvres de Gustave Moreau :
Il y avait dans ses oeuvres désespérées et érudites un enchantement singulier, une incantation vous remuant jusqu’au fond des entrailles, comme celle de certains poèmes de Baudelaire, et l’on demeurait ébahi, songeur, déconcerté, par cet art qui franchissait les limites de la peinture, empruntait à l’art d’écrire ses plus subtiles évocations, à l’art du Limosin ses plus merveilleux éclats, à l’art du lapidaire et du graveur ses finesses les plus exquises[74].
Pour l’esthète fin-de-siècle, il n’y a plus des arts, il n’y a que l’Art, et l’utilisation de la métaphore joaillière participe de cette fusion des média : appliquée à plusieurs pratiques, elle les réunit comme autant de pierres précieuses enfilées sur une même cordelette métallique.
En présentant la littérature comme un « art sur les autres arts », mais aussi comme un art plastique et un art formel, À rebours et Monsieur de Phocas deviennent des « livres sur les livres », des « livres sur les arts » — voire de l’« art pour l’art », dans la lignée des Émaux et camées de Théophile Gautier. Poussé par son intérêt marqué pour la peinture et la sculpture, Gautier évoque en effet, dans sa poésie, des tableaux, statues et objets précieux[75], il pense l’écriture en termes d’art et d’ambition formelle. La littérature ne devrait servir aucune cause, si ce n’est la « cause artistique » : tel des Esseintes, qui croit aux inventions du poète, « compliqué[es] et inutiles[76] », Gautier revendique le droit à l’inutilité de l’art. Afin de se positionner pour une séparation de l’art et de la politique, il renverra, dans la préface d’Albertus, à la joaillerie : « Les bijoux curieusement ciselés, les colifichets rares, les parures singulières, sont de pures superfluités. Qui voudrait cependant les retrancher[77] ? »
Pourtant, les textes-bijoux décadents ne sont pas que « pures superfluités ». En prônant l’art pour l’art, les décadents prennent paradoxalement une position sociale. Certes, le bijou est inutile, Gautier l’a bien écrit. Mais, à la fin du XIXe siècle, cette inutilité revendiquée comporte une prise de position sociale. Comme le port du bijou, qui constitue à l’époque — pour les hommes — « une entrave à l’effort utile[78] » qu’on attend du bourgeois, le texte-bijou se présente comme une contestation de l’impératif d’efficacité et prend part au discours public[79]. Autrement dit, dans une société où l’utilité est une valeur en soi, l’inutilité en constitue forcément une. Le bijou devient l’apanage du dandy, nostalgique de l’aristocratie, qui cherche à se distinguer[80] dans un monde entièrement tourné vers le profit ; le « texte-bijou » s’affirme par rapport à une société capitaliste, mais aussi par rapport à un champ littéraire désormais autonome, soumis aux lois du marché[81]. Par ailleurs, que les bijoux — ou le texte-bijou — soient envisagés comme issus d’un travail artisanal est contraire au triomphe de l’industrialisation[82]. Le livre-bijou de des Esseintes, unique, apparaît comme la concrétisation d’une volonté d’opposition face à la nouvelle production en série. Plus que des manifestes littéraires ou artistiques, les « textes-bijoux » prennent donc position contre des changements sociaux. Et la pierre, sculptée par la main de l’homme, intacte malgré le passage du temps, incarne cette volonté, par la création, de résister.
Appendices
Note biographique
Sophie Pelletier
Sophie Pelletier poursuit présentement un doctorat en cotutelle entre l’Université de Montréal et Paris VIII. Elle travaille sur la récurrence du motif du bijou dans les oeuvres de la fin du XIXe siècle, plus particulièrement dans les romans dits « décadents ». Ces recherches reçoivent l’appui d’une Bourse d’études supérieures du Canada octroyée par le C.R.S.H.
Notes
-
[1]
Cet article s’inscrit dans le cadre de recherches doctorales subventionnées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
-
[2]
Paul Gauguin travaillera notamment la céramique.
-
[3]
Voir Renée S. Neu, « Bijoux modernes et d’avant-garde », dans Ernst Albrecht et Jeanne Heiniger (dir.), Le Grand Livre des bijoux, 1974, p. 248.
-
[4]
Ibid., p. 245.
-
[5]
L’archéologie est effectivement une nouvelle science au XIXe siècle. Voir Julia Przybos, Zoom sur les décadents, 2002, p. 181.
-
[6]
Voir Pierre Francastel, « Japonisme et décor », L’Impressionnisme, Paris, Denoël (Bibliothèque médiations), 1974, p. 109-132.
-
[7]
Pour les rapports — complexes — entre industrialisation et Art Nouveau, voir Debora L. Silverman, « The Abdication of Technology and the Elevation of the Crafts », Art Nouveau in Fin-de-siècle France : Politics, Psychology, and Style, Berkeley / Los Angeles / London , University of California Press (Studies on the History of Society and Culture), 1989, p. 52-63 ; et Stephen Escritt, « Art et industrie : un artisanat ancien, une technologie nouvelle », L’Art nouveau, Paris, Phaidon (Arts et Idées), 2002, p. 335-380. Les deux auteurs soulèvent des différences fondamentales entre les pratiques de certains artistes Art Nouveau et les idéaux du mouvement Arts and Crafts.
-
[8]
L’esthète, amateur d’art et poète Robert de Montesquiou est certainement l’une des figures chez qui s’exprime le plus l’imbrication entre les arts décoratifs et la littérature. Voir Didier Coste, « Robert de Montesquiou, poète critique : la cristallisation du décoratif », Romantisme, vol. 13, no 42 (1983), p. 103-117 ; Pascale Mac Garry, « Le bijou et la chauve-souris : une enveloppe de Robert de Montesquiou », Littérature, no 72 (décembre 1988), p. 114-127 ; Willa Z. Silverman, « Unpacking his Library : Robert de Montesquiou and the Esthetics of the Book in Fin-de-siècle France », Nineteenth-Century French Studies, vol. 32, nos 3-4 (printemps-été 2004), p. 316-331.
-
[9]
La critique d’art pratiquée par plusieurs écrivains, de Baudelaire à Mirbeau, tout comme l’amitié qu’entretient Zola avec Cézanne, ou encore la circulation du personnage de Nana, personnage de l’une des toiles de Manet avant la publication du roman éponyme de Zola, traduisent en effet l’étroite interrelation entre littérature et Beaux-Arts dans la seconde moitié du siècle. L’ouvrage de Pamela Genova, Symbolist Journals : A Culture of Correspondance (Aldershot, Ashgate (Studies in European Cultural Transition), 2002) met d’ailleurs en lumière l’importance de la presse fin-de-siècle dans la formation des liens entre écrivains, artistes et musiciens. Peter Collier et Robert Lethbridge ont quant à eux réuni une série d’études concernant les rapports entre littérature et arts visuels durant tout le XIXe siècle dans Artistic Relations : Literature and the Visual Arts in Nineteenth-Century France, New Haven, London, Yale University Press, 1994. Voir également l’ouvrage dirigé par Patrick McGuinness, Symbolism, Decadence and the Fin-de-siècle : French and European Perspectives (Exeter, University of Exeter Press, 2000), qui propose une approche interdisciplinaire.
-
[10]
Il suffit de consulter quelques textes critiques au sujet de l’esthétique fin-de-siècle pour comprendre à quel point littérature et arts appliqués se sont influencés. Voir Philippe Jullian, « The Esthetics of Symbolism in French and Belgian Art », dans Anna Balakian (dir.), The Symbolist Movement in the Literature of European Languages, Budapest, Akadémiai Kiad?, 1984, p. 529-546, ainsi que l’important panorama de José Pierre, L’Univers symboliste : décadence, symbolisme et art nouveau, Paris, Somogy, 1991.
-
[11]
Ces articles sont regroupés sous l’appellation « Lettres de Londres » dans l’édition préparée par Michel Draguet des Écrits sur l’art de Mallarmé, 1998, p. 85-107. Pour une analyse de l’apport concret des arts décoratifs à la poésie de Mallarmé, voir Rae Beth Gordon, « Aboli Bibelot ? The Influence of the Decorative Arts on Stéphane Mallarmé and Gustave Moreau », Art Journal, no 45 (1985), p. 105-112.
-
[12]
Stéphane Mallarmé, « Hérésies artistiques », dans Écrits sur l’art, op. cit., p. 74.
-
[13]
C’est également l’approche que propose Mária Halász dans « Some Aspects of the Correlation between Literary Decadence and Art Nouveau », dans Béla Köpeczi et György M. Vajda (dir.), Actes du colloque de l’Association Internationale de Littérature Comparée, tenu à Budapest du 12 au 17 août 1976, Stuttgart, Kunst und Wissen, Erich Bieber, 1980, p. 575-581.
-
[14]
D’ailleurs, tant Lorrain, journaliste, que Huysmans, critique d’art, se sont positionnés publiquement par rapport aux manifestations artistiques de leur époque, qui les ont fortement influencés. Voir à ce sujet Will L. McLendon, « Jean Lorrain : Impresario de l’Art Nouveau », Orbis Litterarum, vol. 39 (1984), p. 54-64 ; Charles Maingon, L’Univers artistique de J.-K. Huysmans, Paris, Nizet, 1977. L’ouvrage Huysmans : une esthétique de la décadence s’intéresse quant à lui à la poétique de l’écrivain, telle qu’elle s’est élaborée dans son oeuvre romanesque et critique (Robert Kopp, Christian Heck et André Guyaux (dir.), 1987).
-
[15]
Il existe une — très — abondante critique au sujet des liens entre les peintures de Gustave Moreau et l’écriture de Huysmans et de Lorrain. Notamment, la question de la transposition d’art qui, selon Henry Bouillier, « consiste à utiliser toutes les ressources du langage, des mots, pour donner réellement un équivalent du modèle plastique » (« Huysmans et les transpositions d’art », dans Robert Kopp, Christian Heck et André Guyaux, op. cit., p. 128-129), a occupé bon nombre d’exégètes.
-
[16]
Julia Przybos, « De la poétique décadente : la bibliothèque de des Esseintes », 1988, p. 71.
-
[17]
Nous sommes à ce sujet tout à fait d’accord avec Pierre Brunel, qui affirme que, dans À rebours, « il faut […] insister sur la nécessité interne de ces catalogues, et aussi sur la nécessité interne de leur interruption » (« À rebours : du catalogue au roman », 1987, p.17).
-
[18]
J.-K. Huysmans, À rebours, 1978, p. 94. Nous soulignons.
-
[19]
Ibid., p. 104.
-
[20]
Ibid., p. 219.
-
[21]
Ibid., p. 213.
-
[22]
Ibid., p. 177. Nous soulignons.
-
[23]
Jean Lorrain, Monsieur de Phocas, 2001, p. 56.
-
[24]
Ibid., p. 53.
-
[25]
Ibid., p. 54.
-
[26]
Comme Huysmans lui-même, qui améliorera sa connaissance de la symbolique des pierres en consultant un ouvrage de William Jones, History and Mystery of Precious Stones, London, Richard Bentley and son, 1880.
-
[27]
D’ailleurs, à l’époque où oeuvre Lorrain, des joailliers écrivent sur leur art : Germain Bapst et Henri Vever, par exemple, font paraître d’importants ouvrages sur la pratique de la joaillerie à leur époque. Voir Graham Hughes, 5000 ans de joaillerie, 1973, p. 99. Hughes indique même que le talent de Bapst s’est peut-être « affirmé plus sur le plan littéraire que dans le travail du métal » (ibid., p. 102).
-
[28]
Jean Lorrain, op. cit., p. 55.
-
[29]
Ibid., p. 50.
-
[30]
Ibid., p. 60.
-
[31]
Ibid., p. 50.
-
[32]
Ibid., p. 51.
-
[33]
Ibid., p. 59.
-
[34]
L’association entre les objets « livre » et « bijou » passe aussi par la contiguïté des différents ateliers : l’officine du maître ciseleur de Monsieur de Phocas se situe « rue Visconti[,] où Balzac fut imprimeur » (ibid., p. 51).
-
[35]
J.-K. Huysmans, op. cit., p. 175.
-
[36]
Ibid., p. 74.
-
[37]
Cette question occupe d’ailleurs l’attention de Jean de Palacio, dans « À rebours, ou les leçons du rangement d’une bibliothèque », Figures et formes de la décadence, Paris, Séguier (Noire), 1994, p. 203-214.
-
[38]
L’encre de Chine est aussi utilisée par des Esseintes dans sa toilette quotidienne : dans son cabinet de toilette se trouvent en effet « de petites bouteilles remplies de solutions d’encre de Chine et d’eau de rose à l’usage des yeux, des instruments en ivoire, en nacre, en acier, en argent » (J.-K. Huysmans, op. cit., p. 159). Non seulement la fonction de l’encre est ici détournée, mais cette fiole se trouve parmi des objets de toilette servant tout autant à l’apparence physique du personnage qu’à la décoration de son cabinet — ce sont de beaux objets, en ivoire, en nacre, en acier, en argent… bref, des bijoux.
-
[39]
J.-K. Huysmans, op. cit., p. 71 et 159.
-
[40]
Ibid., p. 167.
-
[41]
Ibid., p. 176.
-
[42]
Id.
-
[43]
Ibid., p. 219.
-
[44]
Ibid., p. 176.
-
[45]
Lorsqu’il souhaite feuilleter ses volumes, des Esseintes a d’ailleurs la manie de « s’installer […] dans […] [les] niches dont le décor lui sembl[e] le mieux correspondre à l’essence même de l’ouvrage que son caprice du moment l’amèn[e] à lire » (J.-K. Huysmans, op. cit., p. 70) : l’ameublement a un rôle à jouer dans une expérience de lecture réussie.
-
[46]
Ibid., p. 176.
-
[47]
Pour reprendre les catégories de Genette — qui s’inspire lui-même de Nelson Goodman —, la littérature constituerait ainsi pour des Esseintes un art « autographique » (c’est-à-dire un « art où chaque oeuvre est un objet unique », comme la peinture ou la sculpture), plutôt qu’une pratique allographique (« où chaque oeuvre est ou peut être un objet multiple, […] une série d’objets tenus pour identiques, comme les exemplaires d’un texte ») (L’oeuvre de l’art : immanence et transcendance, 1994, p. 23).
-
[48]
De la même façon, lorsque des Esseintes se penche sur la calligraphie spéciale de son livre de Mallarmé, il parle du travail d’un « surprenant calligraphe » (J.-K. Huysmans, op. cit., p. 219) : dans chacun de ces cas, le livre est confectionné par une main humaine, la main d’un maître, d’un artisan en particulier.
-
[49]
Ibid., p. 90.
-
[50]
Ibid., p. 221.
-
[51]
Voir Karen Humphreys, « Dandyism, Gems, and Epigrams : Lapidary Style and Genre Transformation in Barbey’s Les Diaboliques », 2003, p. 259-277.
-
[52]
Jean Lorrain, op. cit., p. 246.
-
[53]
J.-K. Huysmans, op. cit., p. 182.
-
[54]
Ibid., p. 208.
-
[55]
Geneviève Sicotte, « Le luxe et l’horreur. Sur quelques objets précieux de la littérature fin-de-siècle », 2000-2001, p. 147.
-
[56]
Julia Przybos, « De la poétique décadente : la bibliothèque de des Esseintes », art. cit., p. 71.
-
[57]
J.-K. Huysmans, op. cit., p. 221.
-
[58]
Ibid., p. 90.
-
[59]
Ibid., p. 91.
-
[60]
Ibid., p. 84.
-
[61]
La métaphore du « mot-bijou » est aussi le prisme par lequel le roman de Huysmans revendique un style musical : tels des mots, deux bijoux, en se heurtant, provoquent un tintement, sonnent et résonnent. Ainsi l’esthète recherche le travail d’un « poète forgeant un hexamètre éclatant et sonore » (J.-K. Huysmans, op. cit., p. 90). Un adjectif comme « éclatant », grandement utilisé dans À rebours, devient polysémique : il peut autant renvoyer à une teinte qu’à un son, car la littérature est tout à la fois couleur et musique.
-
[62]
J.-K. Huysmans, op. cit., p. 220.
-
[63]
Ibid., p. 214.
-
[64]
Ibid., p. 86.
-
[65]
Ibid., p. 206. Nous soulignons.
-
[66]
Ibid., p. 87.
-
[67]
Ibid., p. 187.
-
[68]
Cela introduit un autre aspect des arts appliqués : ils requièrent de la machinerie. Ayant un faible pour les « poésies fabriquées par un ingénieux mécanicien qui soigne sa machine, huile ses rouages, en invente, au besoin, de compliqués et d’inutiles », des Esseintes souligne cette importante dimension du travail de l’artisan, qui ne s’applique habituellement pas au labeur de l’écrivain (J.-K. Huysmans, op. cit., p. 91). Humphreys, quant à elle, remarque que les textes de Barbey d’Aurevilly regorgent d’« outils » qui renvoient à l’aspect « artisanal » du travail de l’écrivain, d’autant plus que dans certains manuscrits, ces outils seraient dessinés (Karen Humphreys, op. cit., p. 261 et 266).
-
[69]
Jean Lorrain, op. cit., p. 240.
-
[70]
Ibid., p. 252.
-
[71]
J.-K. Huysmans, « Préface : Écrite vingt ans après le roman », op. cit., p. 50. Nous soulignons. Ce mandat d’« écouter » les gemmes, Huysmans le réalise une fois converti, en 1898, dans La Cathédrale. Au tournant du siècle, les pierres et matériaux signifient littéralement, ils parlent à l’écrivain, ils se font textes, en plus d’apparaître dans les textes.
-
[72]
Monsieur de Phocas ne traite pas que de littérature et de joaillerie : architecture, peinture et sculpture sont également des pratiques où le duc de Fréneuse est susceptible de retracer pierres et « lueur verte ».
-
[73]
Plusieurs thématiques propres à la littérature décadente sous-tendent également le travail des joailliers : ceux-ci exploitent la figure de la « femme-nature » — femmes-fleurs et femmes-libellules abondent dans les créations de Lalique, par exemple —, donnent dans le religieux et le mystique, en plus d’être inspirés, eux aussi, par l’art de l’Extrême-Orient — le « japonisme ». Voir Renée S. Neu, loc. cit., p. 246.
-
[74]
J.-K. Huysmans, op. cit., p. 110.
-
[75]
Voir Claudine Gothot-Mersch, « Préface », dans Théophile Gautier, Émaux et Camées, 1981, p. 10.
-
[76]
J.-K. Huysmans, op. cit., p. 91.
-
[77]
Théophile Gautier, « Préface d’Albertus », citée par Claudine Gothot-Mersch, loc. cit., p. 9.
-
[78]
Philippe Perrot, « Le vêtement masculin : le triomphe du noir », dans Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire du vêtement au XIXe siècle, 1984, p. 61. L’idéologie bourgeoise incitera les hommes à porter des vêtements sobres, tous pareils, conformément à sa valorisation du travail, de l’utilité et de l’égalité.
-
[79]
D’ailleurs, tant À rebours que Monsieur de Phocas prennent clairement position contre la bourgeoisie productiviste : des Esseintes fustige « l’immense, la profonde, l’incommensurable goujaterie du financier et du parvenu » (J.-K. Huysmans, op. cit., p. 238), tandis que Monsieur de Phocas est opprimé par « l’unanime laideur [des] villes modernes, où les palais sont des banques et les églises des usines » (Jean Lorrain, op. cit., p. 181).
-
[80]
Baudelaire écrivait d’ailleurs : « Le dandysme n’est même pas […] un goût immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle. Ces choses ne sont pour le parfait dandy qu’un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit » (Le Peintre de la vie moderne, Oeuvres complètes, 1976, t. 2, p. 710).
-
[81]
Voir Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil (Libre Examen), 1992, p. 165-200.
-
[82]
La production en série touche également le secteur de la joaillerie, qui profite de « la puissance du travail organisé des manufactures » (Graham Hughes, op. cit., p. 101). Des Esseintes déplore le phénomène, et indique que « seul […] le saphir a gardé des feux inviolés par la sottise industrielle et pécuniaire » (J.-K. Huysmans, op. cit., p. 96-97). Par ailleurs, le développement de la haute couture expliquerait, selon Jean-Pierre Lecercle, l’échec de La Dernière Mode de Mallarmé — et plus généralement des journaux de mode qui proposent patrons et modèles, milieu en déclin à partir de la Commune (Mallarmé et la mode, 1989, p. 29). En ce sens, la gazette de Mallarmé semble relever d’un monde voué à disparaître au tournant du siècle.
Références
- Baudelaire, Charles, Le peintre de la vie moderne, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1976, t. 2 (éd. Claude Pichois), p. 683-724.
- Bouillier, Henry, « Huysmans et les transpositions d’art », dans Robert Kopp, Christian Heck et André Guyaux (dir.), Huysmans : une esthétique de la décadence, Actes du colloque de Bâle, Mulhouse et Colmar des 5, 6 et 7 novembre 1984, Paris, Honoré Champion, 1987, p. 127-134.
- Brunel, Pierre, « À rebours : du catalogue au roman », dans Robert Kopp, Christian Heck et André Guyaux (dir.), Huysmans : une esthétique de la décadence, Actes du colloque de Bâle, Mulhouse et Colmar des 5, 6 et 7 novembre 1984, Paris, Honoré Champion, 1987, p. 13-21.
- Genette, Gérard, L’oeuvre de l’art : immanence et transcendance, Paris, Éditions du Seuil (Poétique), 1994.
- Gothot-Mersch, Claudine, « Préface », dans Théophile Gautier, Émaux et Camées, Paris, Gallimard (Poésie), 1981, p. 7-22.
- Hughes, Graham, 5000 ans de joaillerie, Paris, Calmann-Lévy, 1973.
- Humphreys, Karen, « Dandyism, Gems, and Epigrams : Lapidary Style and Genre Transformation in Barbey’s Les Diaboliques », Nineteenth-Century French Studies, vol. 31, nos 3-4 (printemps-été 2003), p. 259-277.
- Huysmans, Joris-Karl, À rebours, Paris, Garnier-Flammarion (GF), 1978.
- Lecercle, Jean-Pierre, Mallarmé et la mode, Paris, Librairie Séguier, 1989.
- Lorrain, Jean, Monsieur de Phocas, Paris, Garnier-Flammarion (GF), 2001.
- Mallarmé, Stéphane, « Lettres de Londres », Écrits sur l’art, Paris, Garnier-Flammarion (GF), 1998 (éd. M. Draguet), p. 85-107.
- Mallarmé, Stéphane, « Hérésies artistiques. L’art pour tous », Écrits sur l’art, Paris, Garnier-Flammarion (GF), 1998 (éd. M. Draguet), p. 67-75.
- Neu, Renée S., « Bijoux modernes et d’avant-garde », dans Ernst Albrecht et Jeanne Heiniger (dir.), Le Grand Livre des bijoux, Lausanne, Edita, 1974, p. 243-284.
- Perrot, Philippe, « Le vêtement masculin : le triomphe du noir », Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire du vêtement au XIXe siècle, Bruxelles, Complexe (Historiques), 1984, p. 56-63.
- Przybos, Julia, « De la poétique décadente : la bibliothèque de des Esseintes », L’Esprit créateur, vol. 28, no 1 (printemps 1988), p. 67-74.
- Przybos, Julia, Zoom sur les décadents, Paris, José Corti (Les essais), 2002.
- Sicotte, Geneviève, « Le luxe et l’horreur. Sur quelques objets précieux de la littérature fin-de-siècle », Nineteenth-Century French Studies, vol. 29, nos 1-2 (automne-hiver 2000-2001), p. 138-153.