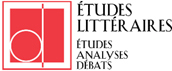Abstracts
Résumé
L’oeuvre de Thomas Bernhard fait une large place à l’invective. Cette dernière prend place lors de scènes de ménage qui sont des modèles de communication dysphorique. Prenant comme point de départ le renouveau des « écritures de la méchanceté » dans le domaine littéraire, nous interrogerons le statut d’une altérité mise à mal. Nous étudierons les formes de l’itération, de la répétition et de la projection, ces règles de base d’une énonciation où l’autre est réduit au statut de quantité négligeable. Dans le cadre de cet article, nous mettrons l’accent sur les représentations d’un récit de soi où le narcissisme domine : la figure de l’illimitation primordiale, modèle d’une écriture qui ne tolère pas l’altérité, est en effet au coeur de l’écriture de Thomas Bernhard. Le sujet de l’écriture (un misanthrope qui tente bon gré mal gré de rédiger un traité scientifique) est sans cesse interrompu dans son activité par une « présence » féminine inopportune. La scène de ménage, telle que décrite dans Béton et La plâtrière, met en valeur une division sexuelle qui oppose hommes et femmes, qui condamne toute velléité de communication.
Abstract
Thomas Bernhard’s production gives a large place to the violent speaks. It happens during domestic fights which appear like a model of discordant communication. Beginning with the new “writings of nastiness” in literature, we will interrogate the deconstruction of otherness’s status. We will study iteration, repetition and projection’s forms, as bases of the violent enunciation. We will insist on the representations of a dominant narcissism : the inimitable figure, first, which models Thomas Bernhard’s writing of the intolerance. The protagonist (a misanthropist who tries to write a scientific treatise) is frequently interrupted by a female presence. The domestic fight, described in Béton and La plâtrière, shows the fundamental distinction which opposes men and women and ruins communication.
Article body
Une surenchère verbale
Faire référence à l’invective, c’est se poser la question de la trajectoire de la parole. C’est de plus s’interroger sans délai sur son efficacité. Premier constat, qui relève en effet de l’évidence, l’invective est une atteinte de l’autre. À vrai dire, le choix de l’expression est le signe d’un malaise qui inaugure le projet au coeur de cet article. Est-il pensable d’envisager, sans panache rhétorique inutile, une invective qui ne soit pas simplement la manifestation d’une agression caractérisée ?
En d’autres termes, y a-t-il, dans le discours littéraire, un indice de fictivité probant qui altère un tant soit peu la violence de l’invective ? Et celle, plus particulièrement, qui est mise en scène dans les écrits de Thomas Bernhard ? Cette question nous semble importante dans la mesure où l’invective, telle qu’elle est sans cesse justifiée dans l’oeuvre de Bernhard, se donne comme mandat d’être plus vraie que nature. Au même titre que d’autres figures qui abondent dans l’oeuvre de cet écrivain (le suicide, la maladie), nous assistons à une mise en scène de soi et des autres qui joue sur l’excès, la surenchère.
Tout de même, elle n’avait pour moi que mépris et raillerie. Chaque fois qu’elle le pouvait, elle me ridiculisait, à tout instant et, quand l’occasion se présentait, devant tout le monde. Ainsi, elle l’a dit il y a une semaine, le mardi, alors que nous rendions visite au soi-disant ministre (ministre à la fois de l’agriculture et de la culture !) […] il (c’est-à-dire moi) travaille depuis dix ans à un livre sur Mendelssohn Bartholdy et il n’a même pas la première phrase en tête[1].
Ainsi, l’invective serait un fragment de réel qui se loge au coeur du discours romanesque, l’expression d’une authenticité de l’affect (chez Bernhard, il s’agit de l’irritation[2]) qui justifie le propos injurieux. Nous avons indiqué que la représentation de l’invective chez cet écrivain prenait l’aspect d’une attaque verbale qui fait mouche chaque fois. C’est dire que l’invective suppose un public qui fait office de spectateur (comme c’est le cas du roman Des arbres à abattre[3]). Mais il existe aussi des situations plus troublantes où ce public, qui incarne un auditoire captif, n’est plus de mise. En d’autres termes, l’expression de l’invective se fait aussi dans le domaine de la vie privée, en témoigne le scénario de la scène de ménage. Ces situations de confrontation (où l’invective a le beau rôle) abondent dans l’oeuvre de Thomas Bernhard. Nous mettrons l’accent sur deux récits (La plâtrière et Béton) qui décrivent, selon des modalités différenciées, une situation de confrontation entre hommes et femmes.
Ce propos est au coeur de l’oeuvre de Bernhard puisque le motif de la « guerre des sexes » est à l’ordre du jour. À l’encontre du discours habituel qui prône la résolution de conflits, l’usage bénéfique de la médiation, l’oeuvre de Thomas Bernhard revendique une méchanceté littéraire qui ne fait pas de quartier. Cette dernière traduit un affect dévastateur où, comme l’énonce l’expression consacrée, « les mots dépassent la pensée ». Bernhard écrit de l’intérieur de la maison autrichienne pour dire que son lieu de naissance lui fait mal, lui fait honte : « Je cherche l’origine de ma débâcle. Je purifie, j’interviens. Mais le pays natal se révèle à celui qui veut le prendre par ruse comme l’arrogance, l’ignorance transformée en dégoût[4] ». Il décrit un monde peuplé de garde-frontières, de montagnes et de cols enneigés. De façon incisive, Bernhard décrit un monde ruiné où les notions de haute culture et de patrimoine sont en déshérence. Il désigne l’irritation comme l’élan même de son écriture :
Aussi loin que je puisse me reporter dans le passé, déjà ma mère, mon parrain, mes frères et soeurs m’ont appelé trouble-fête. Je suis toujours resté le trouble-fête à chacune de mes respirations, dans chacune des lignes que j’écris. Toute ma vie, mon existence a dérangé. J’ai toujours dérangé et j’ai toujours irrité. Tout ce que j’écris, ce que je fais est dérangeant, irritant. Ma vie entière en tant qu’existence n’est rien d’autre qu’une volonté constante de déranger et d’irriter. En attirant l’attention sur des faits qui dérangent et irritent. Les uns laissent les gens tranquilles, les autres — je fais partie de ceux-là — dérangent et irritent. Je ne suis pas un homme qui laisse tranquille, je ne veux pas être d’un caractère de cette sorte-là[5].
Dans ce contexte, la parole méchante (dont l’invective pourrait être une des modalités) ne connaît pas de limites. Chez Bernhard, par exemple, on ne s’intéresse pas du tout à la forme d’un dialogue qui permettrait, par un savant exercice de communication, la reconnaissance de l’autre. Au contraire de ce point de vue, l’autre est un sujet inopportun qu’il s’agit d’éliminer par le biais du discours. Ce dernier est une véritable arme de guerre : la machinerie discursive bernhardienne est, en effet, sophistiquée et nous tenterons, dans le cadre de cet article, d’en saisir les modalités.
Un jour, j’avais écrit un article sur Haydn, pas sur Josef, sur Michael Haydn, lorsqu’elle a surgi tout à coup et m’a fait sauter la plume de la main. Comme je n’avais pas terminé mon article, il était fichu. Maintenant je t’ai fichu en l’air ton article ! s’est-elle écriée, ravie, puis elle a couru à la fenêtre et a crié à plusieurs reprises au-dehors cette phrase diabolique, maintenant je t’ai fichu en l’air ton article ! Maintenant je t’ai fichu en l’air ton article ! Cette horrible attaque surprise était trop forte pour moi. À table, elle brisait d’emblée toute conversation, elle l’interrompait tout bonnement d’un brusque éclat de rire ou par une remarque d’une bêtise sans bornes, qui n’avait rien à voir avec la conversation à peine entamée[6].
Il ne suffit pas en effet de déclarer que l’atteinte de l’autre est une caractéristique de l’oeuvre de Bernhard, qu’elle fait intervenir une violence dans l’exercice de la parole. Bien que ce propos ne soit pas faux, il a pour inconvénient de sous-estimer que cette atteinte est aussi une forme troublante de rencontre. Dans cette perspective, l’invective représente une intrusion dont l’impact ne doit pas être négligé. Chaque invective est une façon de s’en prendre à l’autre, de restreindre son importance. Bien que cela ne soit pas agréable à dire, l’irritation (qui est cet affect minoritaire de la méchanceté, observable dans l’oeuvre de Bernhard) traduit une expansion du moi, son hypertrophie maladive. À l’instar de cette écriture cérébrale qui crée pour le narrateur moult maux de tête, le moi est exagérément distendu par la méchanceté. Problématique chère à une disposition narcissique, l’écriture est affaire de soi plus que de l’autre. Sous ce point de vue, elle correspond assez bien à ce que Freud choisit d’appeler la pulsion d’autoconservation. L’expression du narcissisme, loin d’être l’apanage d’un trait de caractère, ou l’expression d’un jugement de valeur pour l’observateur éloigné, est, dans sa forme la plus archaïque, l’expression d’un besoin. Ainsi le sujet, dès les premiers moments de la vie, doit-il être nourri, lavé, langé. Il doit pouvoir dormir. Dans l’interaction qui le lie à sa mère (ou à toute autre figure faisant office de représentant de la psyché maternelle), la satisfaction de ces besoins permet de créer une réalité tolérée aussi longtemps qu’elle n’est pas le synonyme d’une agression en provenance du monde externe.
Fidèle à cette perspective psychanalytique, nous ne pouvons sous-estimer à quel point la perception d’un monde externe destructeur est le fondement de l’écriture de Thomas Bernhard. On peut y percevoir le fruit d’une causalité historique : le jeune Bernhard a vécu sous les bombes. Il a connu une enfance où la maladie, la pauvreté, l’instabilité dominaient[7]. Mais nous voyons bien, à tenir ce discours, que le point de vue moral abonde, et qu’il ne convient pas. Une telle perspective nous obligerait à circonscrire une méchanceté d’ampleur médiocre, à rabattre le produit de l’imagination sur les convenances d’une réalité plus ou moins normale. C’est d’autre chose dont il est question dans l’oeuvre de Thomas Bernhard. La méchanceté littéraire n’est pas le reflet d’une réalité extérieure au sujet : elle n’est pas réductible au poids de l’histoire ni aux vicissitudes de l’histoire personnelle.
Un discours qui s’emballe
Si l’on s’en tient de manière ferme à l’exigence bernhardienne de méchanceté, il faut avancer que l’invective (objet de notre propos) est extrusive, qu’elle attaque sans relâche la forme du réel qu’il s’agit de faire plier. Dans cette entreprise, le verbe est revendiqué. Il s’agit de pouvoir dire la méchanceté, de ne pas la réduire à un accès de colère facilement résorbé par la suite. Ainsi, l’invective favorisée par Thomas Bernhard n’est pas l’expression d’un baroud d’honneur. Au contraire de ce point de vue qui réduit l’invective ou l’injure à un phénomène d’une durée limitée dans le temps, l’oeuvre de Bernhard nous laisse percevoir la composition d’un discours romanesque et théâtral qui s’emballe à dessein, qui profère de manière répétée un discours dont le seul objectif manifeste est la dépréciation de l’interlocuteur.
Ma soeur répand dans tout Vienne, et justement là où cela a l’effet le plus désastreux pour moi, que je suis un raté. Je l’entends constamment dire à qui veut l’entendre : mon petit frère et son Mendelssohn Bartholdy. Sans aucune gêne, elle me traite de fou devant tout le monde[8].
Ainsi, l’invective, si elle demeure une énonciation localisée (nous verrons un peu plus loin dans quel contexte elle apparaît), traduit un phénomène de grande envergure. Il ne s’agit pas moins que de déstabiliser les formes habituelles d’interlocution en revalorisant l’exercice d’une violence sur autrui. On comprendra, pour ces raisons, que le propos de Thomas Bernhard renoue avec une réflexion qui, d’Antonin Artaud à Pierre Guyotat — dans le contexte français —, privilégie l’invective comme forme d’autodéfense, tant la réalité externe est perçue comme abêtissante. L’itération de l’invective est chez Bernhard un premier dispositif rhétorique. Toute l’écriture de cet auteur témoigne d’une fuite en avant dont l’invective est le ressort. S’en prendre à l’autre de manière répétée, c’est lui asséner ses quatre vérités : « Ta maison ! m’a-t-elle crié au visage, ta tombe ! Mais elle a raison, me disais-je à présent, tout ce qu’elle dit est juste, je ne fréquente pas un seul être vivant.[9] »
Mais c’est aussi s’en prendre à soi tant l’invective fait rebond, empiète sur le domaine réservé du locuteur. De façon troublante, l’invective façonne un univers de discours où l’antagonisme et le conflit ont droit de cité. Mais il s’agit d’un dispositif pernicieux dont il faut remarquer immédiatement l’asymétrie.
Chez Bernhard, l’énonciateur de l’invective a le beau rôle. Il occupe tout le champ de la parole. L’autre est réduit au statut de simple caricature, forme à peine schématisée qui incarne un stéréotype.
Et bien que j’eusse, comme je l’ai déjà dit, aéré trois fois, l’odeur de ma soeur était encore dans la chambre, en vérité son odeur était encore dans toute la maison, cette odeur me dégoûtait. Elle a aussi ma soeur cadette sur la conscience, me dis-je souvent, car elle aussi avait tout le temps peur de sa soeur aînée, les derniers temps, sans doute, une peur positivement mortelle[10].
Ainsi, la représentation de la femme subit tous les opprobres, ce qui a conduit une essayiste et auteure, Nancy Huston, à décréter la misogynie de l’écrivain. Bien que le propos de Nancy Huston repose sur des considérations psycho-biographiques discutables (ainsi la relation esquissée entre les enfances d’Hitler et de Bernhard), on ne peut passer sous silence, encore moins justifier ces descriptions dévalorisantes. Ne vaut-il pas la peine cependant d’étudier la mise en forme de l’invective, son agora ? Élément d’importance, la formulation de l’invective chez Bernhard obéit souvent à ce prototype qu’est la scène de ménage. Dans les deux récits que nous convoquons (Béton et La plâtrière), une relation entre homme et femme scelle cette irritabilité persistante qui est au coeur de l’oeuvre de Thomas Bernhard. Dans La plâtrière, un chercheur « fou » tente de rédiger un traité d’acoustique alors que sa femme, alitée et handicapée, ne cesse, semble-t-il, de le morigéner sur ses moindres faits et gestes.
Il y a tant de thèses de doctorat insuffisantes, des travaux d’amateur, consacrées à l’ouïe, avait dit Konrad à l’architecte (selon Wieser), et naturellement le dilettantisme de la dissertation est le plus pénible de tous. Le dilettantisme des hommes de métier est le plus pénible, ce que les gens dits de l’art ont de plus bouleversant, c’est toujours leur dilettantisme sans bornes. Si je vous disais (avait affirmé Konrad) que j’ai étudié à fond deux cents thèses sur l’ouïe, qui n’ont pas idée de ce que c’est ! Aucun enchaînement d’idées, avait dit Konrad, rien que des remaniements professionnels [11].
Dans Béton, le même scénario se répète à cette différence que frère et soeur s’affrontent. C’est encore une fois la promesse d’une oeuvre à venir qui est au coeur du propos :
J’ai aussi échoué dans mon projet d’écrire quelque chose sur Jenufa, ça c’était fin octobre, peu avant que ma soeur soit arrivée à la maison, me suis-je dit, maintenant j’échoue aussi avec Mendelssohn Bartholdy et j’échoue même maintenant, alors que ma soeur n’est même plus là. Même le papier Sur Schönberg, je ne l’ai pas terminé, elle me l’a réduit à néant, elle me l’a d’abord démoli et puis définitivement réduit à néant en entrant dans ma chambre au moment précis où je croyais pouvoir en achever l’ébauche[12].
Tout se passe, en effet, comme si l’impossibilité de créer une oeuvre de mots, prenant l’aspect d’un traité (dans tous les cas un ouvrage savant) justifiait une irritation sans entraves. L’autre se doit alors de subir un déferlement sonore dont l’amplitude, l’abondance sont l’envers (encore une fois caricatural) de la disette que l’écrivain se doit de subir jour après jour. La frustration est le moteur de l’invective, elle naît en grande partie (si l’on restreint notre propos à ces deux romans) de la promesse d’un livre qui ne voit pas le jour :
Une fois que ma soeur sera hors de la maison je pourrai commencer, me suis-je redit sans cesse, et vaincre une fois de plus. Une fois que le monstre sera hors de la maison, mon travail ira tout seul, de toutes les idées touchant à ce travail j’en ferai une seule, mon oeuvre. Mais à présent, il y avait déjà plus de vingt-quatre heures que ma soeur était hors de la maison et j’étais plus éloigné que jamais de pouvoir commencer mon travail. Elle, ma destructrice, m’avait toujours en son pouvoir. Elle dirigeait mes pas et en même temps obscurcissait ma tête[13].
À interpréter les choses de cette manière, on constate que le motif du boîtier d’écriture est de mise. L’écrivain (qui prend la forme d’un scientifique) tente avec insuccès de se protéger d’un monde externe dont il ressent la violence. Dans cet exercice, il veut se constituer un univers autocentré, réceptacle du narcissisme primaire.
Ce n’est pas un hasard si l’oeuvre de Thomas Bernhard octroie une place décisive à ce que nous avons appelé dans un autre contexte (à propos de l’oeuvre de Michel Leiris) un boîtier d’écriture[14]. Contre le déferlement d’une violence en provenance du monde externe, le sujet de l’écriture doit se replier dans un monde qui fait jouer une certaine quiétude. L’acte de création est à ce prix : la turbulence sensorielle de l’univers vous dessaisit de votre tranquillité alors que le livre est un refuge. Mais ce dernier représente après tout un abri bien temporaire. Car la violence du monde externe fait retour de manière insidieuse au coeur du monde des lettres :
Mais il arrivait qu’elle lui dît d’aérer alors qu’il venait de le faire, d’ouvrir la fenêtre quand il la refermait à peine. Ce faisant, elle essayait de le tourmenter. « Il passe un courant d’air sous la porte », disait-elle plusieurs fois par jour, à intervalles irritants ; « il passe un courant d’air », disait-elle de nouveau, exprimant ainsi sa colère contre lui, répétant : « Un courant d’air passe » (bien que jamais il n’y ait eu de moindre courant d’air dans sa chambre : en tout cas, pas avec les portes et les fenêtres fermées). Elle s’était forgée cette arme contre lui, répétant : « Un courant d’air passe », alors que l’air ne soufflait jamais[15].
L’inspiration n’est pas de mise. Chez Bernhard, les personnages-écrivains piétinent, compulsent indéfiniment notes de travail et plans d’ouvrages à peine entamés. L’écriture, plus qu’une sublimation, une envolée, nous ramène à cette veine mortifère du plus petit dénominateur commun. Ainsi, le boîtier d’écriture devient un lieu de réclusion tant le sujet est incapable de s’affranchir, de produire une oeuvre qui possède quelque mérite personnel. S’explique peut-être de cette manière la mise en jeu de l’invective. Tout se passe comme si l’irritation répétée (face à une oeuvre qui ne voit pas le jour) devait justifier l’identification d’un responsable :
Elle, sa femme, ne cherchait d’ailleurs plus qu’à le bafouer, lui Konrad, elle n’avait plus rien d’autre en tête que de le faire tourner en bourrique, lui dont elle croyait qu’il se prenait encore pour un savant, pour un philosophe ès sciences, soyons franc, avait dit Konrad à Fro. « Au fond, ma femme depuis longtemps, à ce qu’elle se figure, a pu faire de moi un paillasson, parce que je lui ai permis, sans qu’elle s’en rende compte, de me traiter comme tel, comme qui dirait en bouffon familier »[16].
Au coeur de cette scène de ménage que nous avons identifiée, ferment d’une affectivité qui met en conflit le soi et l’autre, le sujet reproduit, de manière quasi mécanique, une irritation dont le caractère épidermique est notable. De l’oralité (de l’invective) à l’écriture qui n’advient pas (et qui provoque le ressassement), il n’y a qu’un pas à franchir.
Une attaque en règle
L’itération de l’invective est donc une forme de protestation contre une injustice qui nous fait battre en retraite tant l’univers nous indispose. Toute l’oeuvre de Thomas Bernhard peut être comprise en tenant compte de ces balises qui traduisent une énonciation de la méchanceté. Complément de l’invective qui est un acte énonciatif singulier dont la portée est manifeste (il s’agit de circonscrire un « objet » discursif, de cibler celui ou celle qui fait l’objet d’une attaque en règle), la méchanceté correspond à une problématique plus générale. De toute évidence, l’invective est, par son étymologie, la manifestation d’un emportement, d’un déchaînement. Si la comparaison n’était pas si maladroite, nous pourrions comparer l’invective (qui consiste à s’en prendre à l’autre, voire à manifester une indisposition, une disposition contre l’autre) à ce que le vocabulaire post-freudien appelle le « passage à l’acte ».
Cette dernière expression suppose que le sujet ne se contient plus, qu’il n’est plus régi par les règles d’une argumentation consensuelle. À dire les choses ainsi, le « passage à l’acte » nous rappelle que le sujet peut commettre un meurtre :
[…] Konrad a tué sa femme parce qu’elle l’avait encore traité d’imbécile, de dément, ou selon son expression favorite quand elle lui parlait, de détraqué suprêmement intelligent. Dans la chambre du meurtre, rien ne confirmait, bien entendu, pareille explication, ni qu’elle lui eût rien déclaré de tel, disait Wieser, mais tout porte à croire que Konrad a tué sa femme à cause d’une sortie déplacée de sa part, selon la formule qu’il employait toujours à son propos[17].
Le sujet n’est plus soi, se laisse aller aux emportements criminels. À l’encontre d’un point de vue qui vante le mérite de l’autre, son importance dans la poursuite d’un dialogue où prévaut l’idée d’un respect mutuel, l’invective est d’abord une violence infligée à l’altérité : c’est parce que l’autre n’est rien qu’il suscite cette relation d’emprise[18] au coeur de laquelle surgit une scénographie de la méchanceté. À propos de l’invective, nous devons nous étonner qu’elle soit inopinée, qu’elle fasse son apparition sans préavis.
Elle décrit une forme de prédation contre laquelle il est difficile de se prémunir. En témoigne l’oeuvre de Thomas Bernhard qui ne fait pas de quartier. Fait qu’il n’est pas coutumier de constater, l’objectif est de réduire l’autre à néant tant la frustration et l’envie (liées à l’existence d’un sujet indépendant de soi) sont des enjeux pulsionnels décisifs. Ainsi, l’invective consiste à disqualifier l’autre par le recours aux mots. C’est d’une bien étrange joute verbale dont il s’agit ici, car celui qui invective ne peut s’affranchir d’un paradoxe. Il ne veut rien savoir de l’autre tant son existence est le signe d’une infériorité qui justifie le contenu injurieux des paroles adressées. Cependant, le monde des signes est convoqué sans relâche puisque le langage est un dernier recours, un filet de sauvetage qui protège l’invectivé de voies de fait. Nous retrouvons ce paradoxe dans toute l’oeuvre de Thomas Bernhard. L’invective permettrait de traduire (sous forme de langage) une énonciation qui est malmenée par un principe d’incomplétude. Tout ne peut-il pas être dit une fois que nous nous emportons ?
Nous avons fait état un peu plus tôt des distinctions à opérer entre le registre (limité) de l’invective et le cadre plus général d’un éthos de la méchanceté littéraire. L’invective représente un acte de parole, la localisation du sujet parlant dans un univers dont les balises spatiotemporelles sont délimitées. Ainsi, chez Thomas Bernhard, la scène de ménage est à l’avant-plan tant elle représente un principe moteur. Les interlocuteurs sont cantonnés dans un espace restreint. Ils sont les prisonniers d’un univers domestique.
Ils en viennent aux mots (plutôt qu’aux coups), sachant par ailleurs que le langage est une arme blanche qui peut blesser. Pour toutes ces raisons, l’invective fait référence à une deixis dans le cadre plus général d’une réflexion sur la méchanceté littéraire. À propos de l’invective, nous devons ajouter, s’agissant de l’oeuvre de Thomas Bernhard, qu’elle prend forme sur fond de division sexuelle.
L’expression n’est pas banale. Nous la choisissons à dessein. De façon générale, c’est de différence sexuelle dont nous entendons parler sans relâche. Héritière des multiples vulgarisations du discours freudien, la différence sexuelle est cet incontournable qui décrit de nouvelles alliances et confrontations. À suivre ce point de vue, la scène de ménage serait l’exacerbation de la différence sexuelle, la mise en jeu d’un conflit qui repose sur l’entrechoquement des revendications masculine et féminine. Plus encore, cette différence sexuelle exprimerait une incompréhension entre les sexes. Chez Bernhard, cette différence ne va pas de soi. Elle n’est pas le signe d’un enrichissement mutuel, d’un approfondissement des potentialités du genre humain. À suivre le propos de Thomas Bernhard, il faut percevoir l’origine (titre d’un de ses ouvrages autobiographiques) comme l’affirmation d’un principe répétitif. Aussitôt mis au monde, les mères abandonnent leurs fils et les lèguent à leur propre père :
Plus que chez ma mère, avec laquelle, sa vie durant, j’ai eu une relation difficile, difficile parce qu’en fin de compte mon existence a toujours été inconcevable pour elle et qu’elle n’a jamais pu s’arranger de cette existence, la mienne […] [19].
J’ai grandi entièrement soumis aux soins vigilants de mon grand-père et à son éducation qu’il ne laissait pas apercevoir. Mes plus beaux souvenirs sont ces promenades avec mon grand-père, des marches de plusieurs heures dans la nature, et les observations faites au cours de ces marches, observations qu’il a su peu à peu développer chez moi en un art de l’observation[20].
Dans cet ordre générationnel bousculé, il faut entrevoir un étrange renversement de perspective. Les grands-pères sont nos maîtres, écrira Thomas Bernhard qui met de plus l’accent sur le pouvoir salvateur de la culture. Ces grands-pères « portent » les enfants qui ont été abandonnés par leurs filles. Ils sont de manière répétée des procréateurs de culture. On ne redira jamais assez ce cri du coeur de Thomas Bernhard qui prend l’aspect d’une protestation virile contre une inutile féminisation du monde. Ici, la scène de ménage ne repose pas sur le principe de la différence sexuelle mise en relief par François Flahault. Je me permets de citer l’auteur :
De sorte qu’en toute relation amoureuse s’affrontent deux mouvements contraires. D’une part, une immense attente à l’égard de l’élu, le goût de se confier et de se confondre. C’est cette aspiration dont le mot amour nous propose une image idéalisée. D’autre part, manoeuvres de repli et de camouflage pour que la défaillance intime n’apparaisse pas : si l’autre mettait le doigt sur elle, nous serions à sa merci. C’est cette parade dont la face visible se donne des allures masculines ou féminines, il s’agit de faire impression sur l’autre sexe et de le tenir en respect. Chaque sexe à sa manière et avec ses armes[21].
L’argument mis en valeur par François Flahault est bien connu. La différence sexuelle exprime, pour tout humain, le désir de concilier, sous la forme d’une revendication identitaire (qu’est l’amour), la perception d’une incomplétude. Bien évidemment, les formes de cette incomplétude sont diverses. À ce sujet, François Flahault écrit encore :
Les philosophes appartiennent à la catégorie des gens qui se rebellent contre cet assujettissement. Pour n’avoir de compte à rendre à personne — excepté, le cas échéant, à Dieu —, il leur a fallu également présupposer que chacun jouit naturellement du sentiment d’exister, ou peut le produire par lui-même. Or, aux yeux de n’importe quel être humain ayant fait l’expérience de la scène de ménage, ce présupposé est une fiction. Aussi dérisoire que l’attitude de celui qui croit en gardant le silence échapper à la scène (alors que son mutisme même témoigne qu’il est déjà dans les tensions de celle-ci). Ainsi, la philosophie a gardé un silence obstiné sur la question qui m’intéresse, parvenant même à faire oublier qu’il s’agit de l’une des misères inhérentes à la condition humaine ; donc d’une question philosophique[22].
Le propos de François Flahault est pertinent. Il fait valoir que la scène de ménage est l’excroissance de cette maladie identitaire qui a pour nom amour. Dans cette perspective, les phénomènes d’identification et de projection jouent un rôle central tant ils permettent de favoriser, selon une logique propre à l’inconscient, le sentiment diffus d’avoir choisi l’autre librement, ou encore d’avoir été décrété objet d’élection. Il n’est pas nécessaire d’avoir vécu de grandes passions amoureuses pour constater que l’amour est une machine discursive qui favorise la (re)connaissance de soi selon les règles, avouons-le, fort complexes et en partie secrètes, de l’idéalisation, tribut payé à un narcissisme secondaire — et socialisé — qui accepte l’existence de l’autre au titre d’objet. Cela devrait satisfaire en partie les psychanalystes qui s’intéressent aux configurations de l’identité personnelle. Mais l’oeuvre de Thomas Bernhard obéit en partie à un autre dispositif.
En effet, l’expression littéraire, du moins chez Bernhard, est une lentille grossissante qui permet de constater des lieux de discours soumis à un perpétuel désarroi, comme s’il fallait redoubler d’une inquiétude essentielle la précarité des lieux habités :
Or la Plâtrière semblait prédestinée aux crimes, elle les provoquait en quelque sorte. Il était de notoriété publique que tous les crimes commis jusqu’à présent, à la Plâtrière, étaient des crimes crapuleux, non éclaircis. Le mystère de quatre-vingt-quinze pour cent des délits commis à Sicking et dans les parages — des actes criminels — n’avaient pas été résolus [sic], les centaines de crimes perpétrés à la Plâtrière n’étaient pas plus élucidés que l’assassinat des fermiers de Mussner et de Trattner, dont les domaines étaient d’ailleurs, comme la Plâtrière, complètement abandonnés[23].
Nous avons eu l’occasion de constater que les espaces de vie sont réduits à peu de choses dans l’oeuvre de Thomas Bernhard : chambres dans des auberges de village qui accueillent voyageurs de commerce, travailleurs forestiers ; caves qui protègent à peine lors des bombardements sur la ville de Salzbourg ; asiles et maisons de repos qui justifient une immobilité forcée (comme c’est le cas dans Le neveu de Wittgenstein) :
Mais de ces ponctions je parlerai plus tard. Je me suis réveillé et j’ai repris conscience dans l’une de ces gigantesques salles communes, en partie garnies de voûtes, où il y avait vingt à trente lits de fer autrefois peints en blanc mais depuis bien longtemps, au cours des années et des décennies heurtés et endommagés de tous les côtés, complètement rouillés […][24].
On ne doit pas passer sous silence, pour conclure, ces maisons d’infamie qui, dans La plâtrière et Béton, provoquent ces scènes de ménage renouvelées. Mais revenons à notre propos de départ : que veut dire, dans une perspective littéraire, l’invective ? Nous avons vu que celle-ci est un acte de parole, à cette nuance près que l’efficacité d’un tel discours n’est pas négligeable. Contrairement aux formes mieux connues d’énonciation, qui reposent sur l’observance d’un contrat socio-juridique (du baptême au mariage), l’invective, qui n’est pas d’ailleurs un performatif, n’a aucune légitimité. Pourtant, c’est cet aspect qui retient notre attention. L’illégitimité de l’invective vient du fait que « l’injurié » n’est pas reconnu à sa juste mesure. À ce titre, la réflexion littéraire que nous pouvons extraire de l’oeuvre de Bernhard correspond en partie au propos de François Flahault.
Des sanctuaires de cruauté
La violence de l’invective n’a d’autre objectif que l’anéantissement de toute figure d’altérité. Ainsi, la scène de ménage, qui représente dans l’essai de François Flahault un lieu de conflits à l’apparence bénigne, se transforme chez Bernhard en une réalité dangereuse. En témoigne le fait que ces scènes de ménage, plutôt que d’incarner des théâtres ou des opéras (où les conjoints profèrent et vitupèrent devant un public choisi), deviennent des sanctuaires de cruauté :
Elle demandait toujours pourquoi il ne l’écrivait donc pas une bonne fois. « Depuis des années, elle me corne cela aux oreilles, sur le même ton », avait dit Konrad, « elle n’a toujours pas compris qu’elle peut avoir en tête un essai pendant des années, ou comme moi, pendant des dizaines d’années, sans pouvoir le coucher sur le papier. En cela, toutes les femmes sont les mêmes, elles ne comprennent pas des singularités comme celles-là ; elles ne les acceptent pas, tout simplement ; elles s’y refusent pendant des dizaines d’années »[25].
Dans son essai intitulé La scène de ménage, François Flahault met en relief le pouvoir de l’interlocution qui dénigre, condamne sans justifications. Cherchant à définir ce qu’est une scène de ménage, il écrit :
En gros, mes différents interlocuteurs voient dans la scène une intensité fatale de la parole (je souligne). Fatale parce que les deux protagonistes, en se heurtant l’un à l’autre, se heurtent en fait à ce qui les lie et à ce que ces liens font d’eux (je souligne). Fatale, aussi, parce que là même où chacun souhaite au plus haut point que ses paroles parviennent à changer quelque chose, il constate l’échec, l’impuissance, voire la déchéance. Tous, il est vrai, ne conçoivent pas que la scène soit fatale en ce deuxième sens : certaines scènes, me rappelle-t-on, ont la vertu de « crever l’abcès », de régler son compte à ce qui couvait en silence[26].
Cette « intensité fatale de la parole » marque une passion négative qui voit le jour avec l’invective. Forme extrême du désamour, de la désolidarisation envers les proches, l’invective met à mal toute représentation sereine des lieux habités. À ce sujet, il faut imaginer une parole assassine qui ne connaît ni foi ni loi, qui méprise tout interlocuteur et qui va même jusqu’à piétiner le monde du langage :
Et avant tout, tu te méprises toi-même. Tu accuses tout le monde de tous les crimes, c’est là ton malheur. Voilà ce qu’elle a dit textuellement, et je n’avais pas saisi dans toute son ampleur ce que cela avait d’inouï, c’est maintenant que je comprends qu’elle a en quelque sorte mis le doigt dessus. Moi, la vie m’amuse, bien que j’aie aussi mes peines, chacun a de ces peines, mon cher petit frère, mais toi tu méprises la vie, c’est là ton malheur, c’est pour cela que tu es malade, c’est pour cela que tu meurs. Et tu mourras bientôt si tu ne changes pas, a-t-elle dit[27].
Nous avons vu, à la suite de François Flahault, que la scène de ménage peut être un sain exercice de clarification des « positions » de chacun dans l’espace domestique. En d’autres termes, la scène de ménage, malgré ses excès, ne serait pas l’incarnation d’un dialogue de sourds. Elle aurait une valeur thérapeutique si l’on entend par cette expression le droit à la parole, quelles que soient par ailleurs les difficultés de l’énonciation. Mais le propos de Bernhard ne correspond pas à cette catharsis en mode mineur qui permet à chacun d’expurger ses passions et de projeter, loin devant soi, toute émotion inutilement toxique. L’oeuvre de Bernhard nous dit que l’invective est le fondement du langage, qu’elle représente à certains égards une fonction phatique qui fait appel à la méchanceté.
Nous avons circonscrit, au début de cet article, quelques formes discursives de l’invective. Au premier chef, nous notions l’importance de l’itération. Celle-ci, plus que la mise en jeu abstraite d’une deixis (un cadre propice à l’interlocution) est un véritable ressassement : une déclamation obstinée qui se répète sans aucune gêne, qui rumine puis profère les mêmes arguments. L’itération est une prise de possession hargneuse de la parole :
Et déjà, très tôt, par périodes je n’ai absolument eu personne, tout le monde avait quelqu’un, moi je n’avais personne, tandis que les autres ne cessaient de prétendre que j’avais quelqu’un, disaient tu as quelqu’un, alors j’étais pourtant tout à fait sûr de n’avoir personne, et peut-être cette pensée était-elle la pensée décisive, la plus destructrice, de n’avoir besoin de personne[28].
Elle implique, nous l’avons vu, la répétition d’arguments qui ne doivent rien à une logique cohérente. Enfin, l’invective est matérialisée de manière virulente comme un acte projectif qui cherche à invalider, à disqualifier un destinataire : toutes expressions qui concordent avec l’idée d’une dépréciation du sujet (à l’échelle d’un système de valeurs). Dans cette perspective, l’invective rejoue le scénario de la division sexuelle qui est au coeur de l’oeuvre de Thomas Bernhard. Homme et femme sont faits pour ne pas s’entendre. Ils ne possèdent rien de commun, font chambre à part et se détestent.
Ce propos est certes déprimant, mais il a pour mérite de rompre avec les discours sur l’incomplétude qui valorisent une lecture identitaire des rapports entre homme et femme. Selon ce point de vue qui met en valeur le « caractère » ou la « personnalité » des individus, la scène de ménage serait provoquée par un manque de compréhension des enjeux implicites chers à chacun, une maladresse évidente dans la gestion des fondements relationnels de la vie de couple. À suivre ce fil conducteur, la scène de ménage traduirait un défaut de communication et, en définitive, une négligence des interlocuteurs quant au respect nécessaire de l’autre. C’est avec ce fonds de commerce identitaire que nous naviguons jour après jour dans la sphère des relations interpersonnelles. L’individu est une valeur-refuge dans un monde où la complexité des enjeux intersubjectifs nous laisse pantois. Dans cette perspective, la scène de ménage serait un passage obligé. Et la méchanceté, affect négatif qui s’exprime notamment par l’invective, ajouterait un peu de piquant dans la banalité de la vie quotidienne.
J’avançais un peu plus tôt que la division sexuelle était au coeur de l’oeuvre de Thomas Bernhard. Cela revient à dire que chacun est habité par la nécessité de rejeter l’autre, de s’en défaire. Ce point de vue (évidemment discutable sur le plan pratique) ne serait pas difficile à admettre, si ce n’était de la violence affichée dans ce projet. L’itération de l’invective, sa répétition sont des formes énonciatives qui coïncident avec la mise en valeur de la projection, véritable mécanisme de guerre qui coïncide avec une perception circonstanciée de l’altérité. Dans toutes ces situations, la division sexuelle (qui, chez Bernhard, tient lieu de philosophie) est, de manière paradoxale, l’enjeu principal qui cerne ce que nous voulons dire par la méchanceté littéraire. Plutôt que de s’ignorer, hommes et femmes s’affrontent sans relâche : la guerre des mots est devenue l’expression jouissive de l’absence de relation sexuelle :
Comme Konrad lui demandait de quoi elle avait eu peur, elle avait répondu : brusquement, de tout. Mme Konrad avait toujours jugé monstrueuse la contrainte que son mari exerçait sur elle pour qu’ils s’installassent à la Plâtrière. À ses yeux — selon Fro — Konrad avait toujours été un monstre ; mais d’après tout ce qu’il savait de leur couple, Wieser pense que lui, Konrad, devait fatalement faire l’effet d’un monstre à sa femme ; c’était devenu en quelque sorte pour lui une seconde nature — et pas seulement à l’égard de sa femme. Dans la vie, il s’était complètement installé dans son rôle de monstre[29].
Il faudrait parler à cet égard d’un violent commerce avec les mots (ce qu’est l’invective) qui exprime une appétence dont la vitalité est somme toute mortifère. Toute l’oeuvre de Bernhard plaide pour cette division sexuelle qui est une façon d’en finir avec ce leurre qu’est, pour l’écrivain, la jouissance. À l’instar d’autres écrivains (de René Crevel à Antonin Artaud), il faut aborder ce défaitisme de la sexualité masculine dont le trop évident phallocentrisme masque à peine une impuissance à l’oeuvre dans le monde du langage.
Nous avons fait valoir un peu plus tôt que l’invective était, pour le discours critique, une forme énonciative émergente. Au contraire des expressions emphatiques de la connaissance de soi et des autres, l’invective incarne un discours qui dispose de l’autre sans nul ménagement. À ce titre, l’invective fait de l’autre une cible dans une scénographie cruelle qui n’est pas si différente des praticables de l’univers théâtral cher à Antonin Artaud. Sans doute faut-il prendre en compte cette monstration d’une altérité disqualifiée qui apparaît dans la revendication de l’invective comme forme énonciative. Phénomène qu’il nous faut prendre le temps de mieux comprendre, l’invective fait du destinataire la pièce d’un dispositif, c’est-à-dire d’un univers constructible qu’il est possible de démonter. Nous pourrions y voir la figure d’une logistique guerrière qui promeut l’invective comme une façon d’en finir avec l’autre.
Autrefois, la scène de ménage (l’expression est éloquente) était la forme domestique d’un « clash » appartenant au domaine de la vie privée. Certes, l’invective se faisait parfois entendre hors les murs, dans l’espace public :
Ils avaient souvent, pendant des heures, des disputes dont on ne saurait reproduire les termes (disait l’architecte) pour décider si elle mettait la robe qu’il voulait ou celle qu’il avait choisie. Presque toujours, il imposait sa volonté. Lui Konrad, dans ces cas, profitait de l’épuisement de sa femme[30].
La scène de ménage était alors le fruit d’un débordement ponctuel. Et les passions de la vie amoureuse (de l’adultère à la demande de divorce) voyaient le jour dans des espaces aux frontières clairement balisées. À lire l’oeuvre de Bernhard, il n’en va pas ainsi. Les maisons (en fait tout lieu habité) sont les caisses de résonance de discours injurieux et d’invectives. Nulle protection n’est offerte contre les débordements de la vie domestique.
Bien au contraire, les formes de l’itération (qui sont les mécanismes premiers de l’invective) ont pour objectif de projeter le contenu injurieux, de le rendre dicible au tout-venant. Cela veut-il dire que l’énonciation de l’invective aurait gagné en crédibilité, formulation certes ironique mais qui a le mérite de préciser les enjeux qui balisent notre réflexion ? Certes, la reconnaissance (en témoigne l’existence du présent numéro) de formes liminales d’énonciation ne saurait être passée sous silence. Notre compréhension des nouvelles configurations de la deixis énonciative est partiellement validée par le retour en force d’une méchanceté littéraire dont l’invective est une manifestation. Au-delà des phénomènes de mode, il importe néanmoins d’affirmer que l’invective ne saurait être réduite à un discours sur l’incivilité, l’impolitesse : ces nouvelles formes de rébellion sans grande stature.
Nous avons indiqué précédemment que l’invective apparaît sur fond de guerres de mots et de conflits déclarés entre les sexes :
Quand elle avait fini d’examiner le tas de photos, avec de perpétuels « vois-tu, vois-tu », elle forçait Konrad à lui apporter plusieurs boîtes pleines de lettres, à elle adressées et remontant au moins à cinq ou six ans, mais pour la plupart à dix, vingt et trente ans. Elle commençait à s’en faire lire sans interruption des passages et à dire sans arrêt : « tu entends, tu entends ! »[31]
Un ascétisme douloureux
Nous avons aussi noté que l’invective repose, dans l’oeuvre de Bernhard, sur le principe de l’incommunicabilité totale entre les sexes. À ce constat s’ajoute la valorisation d’un ascétisme exigeant et cruel (dont le rappel de l’oeuvre de Glenn Gould, dans les écrits de Bernhard, est un exemple patent). Pour contrer cette divisibilité, l’homme choisit de se faire ermite. Il se replie sur soi, privilégie l’ascétisme, se contente de peu (si ce n’est de l’acte quotidien d’écrire). De cette filiation dont la figure du grand-père maternel est l’icône, il faut retenir que les hommes sont engendrés spirituellement par leurs ancêtres masculins, qu’ils communiquent peu avec les femmes, et que ces dernières, à l’exception de la poétesse et nouvelliste Ingeborg Bachmann, apparaissent comme des personnages à la fois énigmatiques et reclus dans un univers domestique qui est le signe même de la banalité.
Mais revenons à notre interrogation première : si cette divisibilité décrivait une thèse acceptable, il n’y aurait pas lieu (du moins dans la perspective littéraire que nous défendons ici) de s’en inquiéter. Pourtant, l’invective est le signe évident d’un trouble relationnel de grande ampleur. Vaut-il la peine en effet de s’invectiver si l’indifférence règne et que le constat d’une partition des sexes est une chose entendue ? Dans notre réflexion sur l’invective, il faut noter l’existence d’une érotique cérébrale qui anime, bien plus que les personnages ne veulent le laisser entendre, ce commerce linguistique et sexuel avec les mots. Invectiver, c’est d’abord s’assurer d’une position offensive dans le monde du langage. C’est comme on dit : occuper le terrain, puis poser ses pions.
Fait que nous devrons explorer dans cet article, l’invective apparaît de façon inopinée, tel un coup de tonnerre dans un ciel serein. Bien sûr, une frustration est à l’oeuvre qui agit à la manière d’un facilitateur. Mais il faut pointer du doigt un phénomène énigmatique. Dans La plâtrière et Béton, le registre de l’invective traduit l’existence d’un automatisme langagier. À l’encontre d’un point de vue largement accepté (à savoir que la scène de ménage est le fruit d’une argumentation pathologique), Thomas Bernhard semble mettre en valeur une autre conception de ces altercations domestiques. À lire l’auteur, l’invective serait générée par quelque déficience organique, ce qui justifierait, à l’insu du sujet énonciateur, des emportements de plus en plus systématiques et incoercibles :
Mme Konrad aurait tout essayé pour éviter la Plâtrière — selon Wieser — cette Plâtrière que son mari, de tout temps obsédé par la pensée d’écrire un essai, considérait comme un endroit propice pour cela. Dès l’époque où son mari avait manifesté son intention d’acheter la Plâtrière (elle ne le prenait guère au sérieux), avec cette insistance de plus en plus passionnée, elle craignit bientôt que sa vie à elle, déjà assez triste, ne devint effroyable avec la réalisation du projet. Cette crainte, d’ailleurs, on le sait maintenant, l’événement la justifia[32].
Avec cette thèse, qui met de l’avant l’organisation pathologique de la personnalité humaine, Thomas Bernhard renoue avec l’idée d’une logorrhée injurieuse qui a peu à voir avec une lecture plus classique de la scène de ménage.
Nous avons vu, en effet, à la suite de François Flahault, que la scène de ménage pouvait être comprise comme un dispositif argumentatif possédant ses propres règles. De façon conséquente, François Flahault tente de circonscrire les formes dysphoriques d’une communication entravée. La scène de ménage devient l’envers du discours, sa face cachée. Au contraire des théories linguistiques et cognitives dans le domaine de l’analyse de discours qui mettent l’accent sur la forme collaborative des échanges entre locuteurs, François Flahault adopte un point de vue plus sagace. L’incommunicabilité, voire le dissensus sont des formes dysphoriques légitimes dans le cadre d’une linguistique du discours renouvelée. Ce point de vue implique qu’on prenne au sérieux la fonction d’actes de discours qui interviennent au coeur de la vie quotidienne. Le caractère dysphorique de l’invective, auquel François Flahault n’accorde pas d’attention spécifique, est un bel exemple de ces conventions argumentatives qui n’obéissent pas à des règles intangibles.
Voilà pourquoi il serait futile — et fastidieux — de vouloir établir à dessein une typologie des actes de discours qui convergent vers l’idéal d’une réconciliation. La scène de ménage n’est pas la réalisation d’un tel souhait. Quant à l’invective, elle n’est pas, de manière définitive, le signe d’une rupture de la communication. Par l’étude de ces formes dysphoriques de la communication, nous notons cependant l’existence d’une logique où la confiance envers l’interlocuteur est éprouvée sans relâche.
Plutôt que de valoriser à outrance le principe d’une logique identitaire qui interroge, souvent de manière moraliste, les motifs (conscients et inconscients) qui fondent la personnalité d’un individu, engagé dans l’acte de parole, il me semble plus opportun d’étudier les trajectoires (euphoriques ou dysphoriques) qui voient le jour dans le monde des transactions langagières. Ainsi, l’invective est une mise à l’épreuve de l’autre. Nous pouvons ajouter que sa visée est péjorative (et pourquoi pas dénigrante). Mais ce constat n’apporte pas de réponse à notre interrogation première : au-delà du jugement de valeur (l’invective contrevient aux règles du savoir-vivre), est-il possible, de l’intérieur du domaine littéraire, de mieux comprendre sa portée dans l’oeuvre de Thomas Bernhard ?
Nous avons fait valoir que l’invective, dans l’oeuvre de Thomas Bernhard, obéissait en partie à un discours identitaire prévisible. Tout entier consacré à la rédaction de vagues traités scientifiques, le personnage bernhardien s’en prend à l’autre avec une détermination remarquable. La quiétude, précondition pour que la rédaction de ces traités soit couronnée de succès, est à l’évidence absente. Au premier abord, nous serions tentés de percevoir l’existence de l’autre comme un facteur de distraction et d’irritation. C’est parce que l’autre m’insupporte, qu’il se met en travers de mon chemin, que je réagis avec virulence. Ainsi, l’invective serait la forme, par trop prévisible, d’un excès. Mais la lecture de l’oeuvre de Thomas Bernhard nous engage sur d’autres voies. C’est que le destinataire, objet de l’invective, n’est souvent pour rien dans la mise en oeuvre de ce dispositif cruel. Les scientifiques, affairés à la rédaction de leurs ouvrages savants, ne tolèrent pas le moindre bruit, la moindre rupture de ton dans un univers monotone :
Quand j’arpente ma chambre, dis-je, je crois que tout le monde dans la maison m’entend aller et venir, de même que vous aussi, quand je lis, vous savez que je lis dans ma chambre ; vous savez, quand je pense, que je pense dans ma chambre, et que j’écris, quand j’écris dans ma chambre ; quand je suis au lit, vous savez que je suis au lit… : tous ces gens savent toujours, je crois, ce que je fais, dis-je… ; car écoutez, ces gens savent aussi quand je pense dans ma chambre, que je pense à mon traité, cela m’ôte la possibilité d’y penser dans ma chambre, voilà pourquoi je suis depuis si longtemps privé de pensée…[33]
L’ascétisme de l’écrivain (qui consolide un désir de toute-puissance en se réclamant d’une oeuvre à poursuivre) ne fait pas mystère de sa vindicte. Toute intrusion, en provenance du monde externe, est perçue comme une incroyable violence. Dans cette perspective, la revendication d’un silence de mort est encore une fois au coeur du projet scripturaire :
Le bruit courait à Gmachl que Konrad avait tué sa femme froidement, par-derrière. Après avoir vérifié qu’elle était morte, il s’était constitué prisonnier. À Laska, le bruit court aussi que Mme Konrad a eu la tête fracassée par un coup de feu dans la tempe gauche. Sitôt qu’on parle de la tempe, les uns parlent de la tempe droite, les autres de la gauche. À Lanner, on racontait aussi que Konrad avait d’abord assommé sa femme avec une hache, puis l’avait tuée avec la carabine Mannlicher, ce qui prouverait que Konrad était dément[34].
C’est un autre paradoxe que de noter, à propos de l’invective dans l’oeuvre de Thomas Bernhard, cette interdépendance du bruit et du silence, du fracas et de la quiétude. Une lecture réaliste de l’invective nous convaincrait sans aucun doute qu’elle privilégie la surenchère, la stridence vocale. Ainsi que nous l’avons mentionné un peu plus tôt, l’invective consacre le règne de l’excès. Mais ce tohu-bohu, qui est associé à nos représentations sensorielles de l’invective, n’est pas toujours de mise. Bien sûr, les protagonistes de La plâtrière et de Béton ne cessent de se plaindre d’un univers sensoriel, dont la toxicité est la première caractéristique. Mais le moindre bruit les effraie, le souffle des soeurs et des épouses est un empêcheur de danser en rond. On perçoit à partir de ces remarques à quel point l’invective repose sur la sensation d’un manque, véritable abîme psychique, dont le suicide est la manifestation principale.
Une charge sonore
Nous avons indiqué précédemment que l’oeuvre de Thomas Bernhard mettait en valeur une véritable pathologie de l’invective, la description d’un monde où la seule procréation par les mots est un exercice difficile. Du « Pour en finir avec le jugement de Dieu » d’Antonin Artaud aux imprécations de Pierre Guyotat, l’urgence de la parole se veut invective et condamnation d’autrui. Le destinataire est exécré en ce qu’il représente une présence intangible qu’il faut bousculer. Dans l’invective, il y a, en effet, cette affirmation d’une parole définitive qui fait du destinataire un récepteur passif. Nous ne pouvons sous-estimer cette posture de l’ascète vêtu de mots qui vitupère sans relâche contre un univers dont la sensorialité exubérante l’incommode au plus haut point.
Si l’itération de l’invective est une façon d’occuper le terrain, de circonscrire un cadastre où l’on est propriétaire de la parole, la répétition traduit une charge sonore qui bouscule le destinataire, l’enveloppe dans un univers de mots. On sait que le procédé rhétorique de l’amplification — et de la répétition — est au coeur de l’oeuvre de Thomas Bernhard. Des paragraphes entiers sont composés de segments de phrases commutés dans un nouveau contexte d’énonciation. À partir d’un exercice méthodique (la forme d’une phrase qui tient lieu de point de départ), le protagoniste fabrique une masse de mots qui est déclinée à l’infini. L’usage du discours indirect libre contribue à amplifier la violence de cette charge qui doit beaucoup à la figure de l’irritation, thématique manifeste de l’oeuvre de Bernhard. Un tel usage des variables de la répétition (au coeur de notre réflexion sur l’invective) contribue à mettre en valeur son caractère exponentiel. Tout se passe alors comme si l’itération-répétition de l’invective permettait d’asséner un véritable choc émotionnel dont la projection est le fer de lance.
Sous sa forme la plus explicite, la projection est un mécanisme de défense inconscient qui fait du destinataire le récepteur de motions pulsionnelles refoulées. À ce titre, le destinataire de la projection est un contenant, un réceptacle, voire une « décharge » émotionnelle. C’est le cas des invectives qui abondent dans l’oeuvre de Bernhard, tant les destinataires sont les responsables d’un univers délétère. Il nous faut prendre au sérieux cette idée que le destinataire représente, dans l’oeuvre de Bernhard, un contenant souillé, un réceptacle de contenus émotionnels dénigrants :
Ce qu’elle touchait, elle le détruisait, et toute sa vie elle a essayé de me détruire. D’abord inconsciemment, ensuite consciemment, elle a tout mis en oeuvre pour me détruire. Jusqu’à ce jour il m’a fallu me défendre contre cette effrénée volonté de destruction de ma grande soeur et je ne sais même pas comment j’ai réussi jusqu’à présent à lui échapper[35].
La projection apparaît ainsi comme un mécanisme de défense, bien plus qu’un processus de reconnaissance ambivalent de l’altérité. Au contraire de l’identification projective, chère aux psychanalystes (qui suppose une identification à autrui, même dans le déplaisir ou l’envie), la projection est une réaction pulsionnelle primaire.
À ce titre, l’invective, plus que la manifestation d’un discours subversif (ainsi qu’on se plaît à l’affirmer à propos de Bernhard), est une forme d’éviction de l’altérité. Ce n’est pas sans raisons si le motif de la sexualité est particulièrement ténu dans l’oeuvre de l’écrivain. Nous avons fait valoir qu’une érotique de tête (fondée sur le commerce avec les mots) caractérisait la plupart des récits de l’auteur. Du Naufragé, consacré au pianiste Glenn Gould, sans oublier Ludwig Wittgenstein, référence implicite du roman Corrections, le royaume des hommes repose sur la présentation d’une bien étrange mascarade. La pensée est la source d’une jouissance qui renoue avec l’antique peur du féminin. De René Crevel à Thomas Bernhard, cette jouissance est décuplée par un langage dont la forme mortifère n’est pas ignorée.
Au contraire des représentations littéraires de « l’absolu » et de « l’indicible », l’acte de penser est le siège d’une cérébralité migraineuse. Et « la » femme incarne, dans cette mise en scène, une corporéité ensorcelante. Voilà pourquoi il faut invectiver sans relâche, en n’omettant pas la répétition des injures sous une forme à peine modifiée. Le règne du « même » est à son paroxysme ; et l’invective traduit, par l’agressivité de la parole mise en acte, un pouvoir de vie ou de mort. Ainsi, l’ascétisme, dans l’oeuvre de Thomas Bernhard, est l’expression d’un narcissisme du négatif. Et la projection est une tentative bien inefficace de mettre à l’écart la volonté d’un sujet qui, par l’expression de sa différence, signifie l’existence d’une réalité singulière.
En définitive, l’énonciation de l’invective doit être rapprochée d’une réflexion plus vaste sur ce qu’est la méchanceté littéraire. Nous avons constaté que ce discours gagne en crédibilité. Plus encore, l’expression de la méchanceté littéraire est en voie de devenir un nouveau gadget médiatique. De Maurice Dantec à Michel Houellebecq, l’imprécation semble avoir acquis droit de cité. Pour mieux contrer le caractère fade des thèses académiques sur l’hybridité et le métissage culturels, la méchanceté est devenue l’expression d’un discours ravageur qui ne fait pas de quartier. Complément de cette perspective théorique, la méchanceté littéraire incarne un nouvel éthos. Discours inconvenant, discordant, la méchanceté littéraire permettrait de plus d’en finir avec l’obsession du discours identitaire. Il s’agit donc, par l’éloge de ces imprécations littéraires, de rompre avec un dualisme du sujet et de l’objet qui a l’apparence d’une confrontation stérile.
Aux belles heures du structuralisme (qu’il s’agisse de l’oeuvre de Lévi-Strauss ou de la sémantique chère à Greimas), le dialogue du sujet et de l’objet était à l’avant-plan. Puis, alors que les études culturelles se voyaient popularisées, au détour des années 1980, les problématiques identitaires, sous la forme d’une rencontre du soi et de l’autre, firent l’objet d’études détaillées. Force est cependant d’avouer que cette mobilisation de l’altérité est devenue l’expression d’un conformisme qui tient moins de l’originalité des propositions scientifiques que d’un effet de mode. Dans ce cadre, la revendication de la méchanceté littéraire devient l’occasion d’une fuite en avant. La réhabilitation d’écrivains méchants, injurieux et acariâtres exprime une insatisfaction tranchée à l’égard des thèses du dialogue et de la reconnaissance de l’altérité.
Mais prenons garde à ne pas faire de ce discours sur la méchanceté littéraire un nouvel alibi dans l’univers confortable des logiques du postidentitaire. À cet égard, notre choix de l’oeuvre de Thomas Bernhard a pour projet d’indiquer que toute méchanceté n’est pas bonne à dire, qu’elle peut être une violence sectaire. Si un discours en panne de représentations médiatiques fait de la méchanceté un nouvel art de vivre, il importe d’adopter un point de vue plus mesuré. Cela suppose que nous interrogions avec rigueur ce que veut dire la méchanceté, ce qu’elle implique précisément dans le cadre d’une réflexion sur l’énonciation littéraire de l’invective. Bien que nous soyons très prudent à l’égard d’une valorisation intempestive de la méchanceté littéraire et que la réhabilitation de ce discours correspond en partie à un appétit de nouveautés un peu factice, nous devons questionner avec rigueur ces nouvelles représentations d’une parole violente.
On observe, chez Bernhard, une relation irritée envers un lieu qui incarne toutes les formes honnies du patrimoine, de l’attachement à l’espace natal. De façon assez conventionnelle (au premier abord), le sujet irrité s’oppose au lieu. Mais ce dernier apparaît comme une représentation fantasmatique. Ce n’est donc pas le seul lieu (de l’irritation) qu’il nous faut investiguer avec soin, mais les formes excentriques de lieux de discours. Détruire, mettre à mal, somme toute être cruel, comme l’entendait Artaud, c’est bouleverser les formes établies de la géographie corporelle, affective, tout autant que territoriale. On comprendra que l’écriture de la méchanceté, dans cette perspective, n’a pas pour objectif de répertorier des formes figées (ce que serait l’acte d’habiter son corps, sa ville, son pays : formes diverses de l’espace propre).
Dans son ouvrage consacré à la méchanceté, François Flahault fait valoir que la représentation de cette dernière, dans le cadre de récits littéraires et d’oeuvres de l’imagination, met en péril nos fantasmes d’illimitation primordiale. Par l’utilisation de cette expression, François Flahault fait référence à l’organisation narcissique du sujet. Selon ce chercheur, l’expression de la méchanceté traduirait l’expression d’un désir de toute-puissance puisque la reconnaissance de l’autre, comme réalité singulière, est tout simplement mise de côté. Cela veut dire que l’expression de la méchanceté littéraire caractérise un discours unidirectionnel. À la manière de « l’invectivant » pour qui l’autre est une proie bien commode, l’énonciation de la méchanceté littéraire tenterait de cerner le défaut de la cuirasse chez un interlocuteur qui devient une cible :
Alors que d’autres sont constamment obligés de convaincre pour ne pas sombrer dans le ridicule et s’effondrer, elle se tait tout simplement et remporte son triomphe, ou bien elle dit quelque chose qui vient juste à point, d’où il résulte logiquement qu’elle domine la scène. Je n’ai jamais vu ma soeur vaincue. À l’inverse, elle a souvent assisté à mon échec sur un point quelconque, ridicule même. Nous avons les caractères les plus dissemblables, opposés, qu’on puisse imaginer. Sans doute est-ce justement de là que provient notre dissension[36].
Une altérité corvéable
C’est en toute connaissance de cause que j’identifie la racine belliciste de la méchanceté littéraire. Le fait de cibler, de circonscrire une aire de combat (dont l’autre est la représentation troublée) nous permet de mieux comprendre cette violence qui accompagne l’expression omnipotente d’un narcissisme primaire. Ainsi, la méchanceté littéraire correspondrait à une bien étrange mise sous séquestre de la subjectivité. En d’autres termes, la méchanceté littéraire complexifierait cette idée, par trop rassurante, que l’altérité, bien qu’elle nous échappe par définition, est au coeur de nos préoccupations les plus personnelles. Attentif aux réflexions en provenance du monde psychanalytique, François Flahault sait bien que la mise en exergue de l’altérité est elle-même un processus complexe qui doit beaucoup aux formes dérivées du narcissisme. À ce titre, l’idéalisation, sous la coupe du surmoi, contribue à désigner une altérité corvéable qui tient lieu de modèle, d’exigence de rationalité. Plus que la seule expression d’une reconnaissance généreuse de l’altérité, la mise en relief des formes surmoïques de l’idéalisation est elle-même un processus complexe de sublimation qui fait intervenir la frustration.
En effet, l’altérité peut correspondre à la forme positive d’un narcissisme expansif qui tolère la présence d’un autre-que-soi. Cette même altérité, qui fait de l’idéalisation son principe moteur, peut de plus devenir l’incarnation négative d’un narcissisme défensif qui accepte mal toute présence autonome hors de son aire d’intervention. C’est à cette dernière problématique que nous convie l’oeuvre de Thomas Bernhard. L’invective apparaît, dans ce cas de figure, comme un acte de discours qui se veut d’une précision totale. L’autre se doit d’être identifié comme une entrave qui bouscule la libre circulation d’une subjectivité en circuit fermé. Dans les romans de Thomas Bernhard, l’imprécation concerne à peine celui qui est l’objet de l’injure. Celui qui est invectivé est à vrai dire de peu d’intérêt. Il est tout au plus une chose, un contenant, un réceptacle qui emmagasine les représentations délétères d’une altérité détestée, ce qu’il conviendrait peut-être mieux d’appeler un « hors-identité ».
La thèse de l’illimitation primordiale, caractéristique du narcissisme primaire, est sans aucun doute pertinente dès que l’on veut cerner les formes dysphoriques de la méchanceté. Mais ce propos me semble décidément optimiste. On pourra s’étonner de ce jugement à propos de la méchanceté littéraire. L’étude de l’invective dans l’oeuvre de Thomas Bernhard prend de toute évidence la forme d’un excès. La virulence des actes de parole, l’immédiateté des réparties, tout cela nous convainc que le discours de l’invective prétend à une efficacité absolue. Mais cet excès est l’indication d’un symptôme qu’il faut considérer avec soin.
Dans la surenchère émotionnelle, le locuteur se décharge d’un excès : une irritation insoutenable, une colère qui ne cesse de monter, une rage que l’on ne peut réfréner. Mais cette surcharge émotionnelle camoufle à peine cet ascétisme qui est l’autre caractéristique de l’oeuvre de Bernhard. Le misanthrope de La plâtrière et de Béton ne tolère aucune intrusion en provenance de la réalité externe. Il veut être seul. Tout se passe comme si cette valse-hésitation, de l’irritation latente à sa manifestation sous la forme de l’invective, sans oublier l’évidement affectif qui s’ensuit, avait pour tâche de circonscrire un corps dissocié, un interface de flux libidinaux qui ne convergent pas vers la figure territorialisée du corps propre.
Entre l’ascétisme (de l’écrivain solitaire) et l’invective passionnelle, qui ne vise pas moins que la destruction d’autrui, n’y a-t-il pas d’étranges correspondances à signaler ? Rappelons-nous que le propos de François Flahault dans La méchanceté met l’accent sur la toute-puissance d’un narcissisme qui bute sur la perception d’une altérité malencontreuse. Au nom de cette illimitation primordiale, le sujet tolérerait avec difficulté l’existence d’une subjectivité qui s’oppose à ses visées. Et la méchanceté littéraire traduirait dans les faits un conflit d’altérités. Bien que le propos de François Flahault soit tout à fait conséquent, il nous semble pécher par optimisme. C’est que Flahault suppose que l’énonciateur de la méchanceté (ou celui qui est en proie à une telle passion) peut baliser une scénographie où l’altérité, bien qu’importune, doit faire l’objet d’une négociation.
Une autre perspective, certes moins agréable, consiste à prendre au sérieux l’idée que l’autre est une non-entité qu’il convient d’ignorer, ou dont il faut promouvoir activement la disparition. La méchanceté littéraire correspondrait alors à un court-circuit de la relation intersubjective, à une neutralité émotionnelle qui prend appui sur le caractère violent de l’invective. En d’autres termes, l’étude de la méchanceté littéraire (et de sa variante qu’est l’invective) ne peut se contenter d’une relecture des théories freudiennes sur le narcissisme. Dans le concept d’illimitation primordiale cher à François Flahault, il y a cette idée d’une hypertrophie du soi, tendance « naturelle » de l’humain à justifier ses conduites par la mise en place d’une identité qui est faite à l’égal du monde. Dans cette perspective qui met de l’avant le cosmocentrisme de l’identité personnelle, le sujet est aveuglé par cette omnipotence, de source infantile, qui le conduit à vouloir être le monde. À voir les choses sous cet angle, l’illimitation primordiale, à la source de la méchanceté, serait tout simplement provoquée par un aveuglement involontaire, un défaut de vision. Comme toute pathologie narcissique (qui repose paradoxalement sur l’ignorance d’un narcissisme actif), le sujet ne serait pas conscient des leurres qu’il met en oeuvre. Disons-le autrement : l’énonciation de la méchanceté, plus qu’une transgression des codes de bonne conduite et des règles du savoir-vivre, repose sur l’ignorance de l’existence effective de l’autre.
Une machine délirante
Ce point de vue est satisfaisant en partie. Mais il ne permet pas d’expliquer cette irritation croissante, prélude à la méchanceté, que l’on retrouve dans l’oeuvre de Thomas Bernhard. Comment expliquer, en effet, cette violence, qui appartient au domaine de l’invective et qui fait que le sujet ne maîtrise plus ses actes et paroles, qu’il ne peut contenir cette violence désormais sans objet ? À l’encontre de la description d’un sujet narcissique, qui ne connaît pas de butée à l’expression de sa toute-puissance, il faudrait parler d’une forme maligne de la méchanceté. Celle-ci ne correspondrait pas de manière exacte à la forme narcissique de l’affirmation de soi. Il faudrait plutôt envisager une défaillance partielle des formes balisées de l’intersubjectivité. Ainsi, l’expression du soi et de l’autre laisse place à un monde plus sombre. L’invective apparaît comme une parole « folle », sans lieu d’énonciation circonscrit. Plus que l’expression d’une volonté manifeste de disqualifier autrui, il faut entrevoir, à propos de l’invective, le désir de faire table rase de toute intersubjectivité. On peut évoquer, sur ces questions, un fading du sujet qui délègue toute autorité personnelle à cette invective répétée. Cette lecture de l’oeuvre de Thomas Bernhard nous permettrait de mieux comprendre la forme sans objet de la méchanceté. Tout se passe en effet comme si le sujet était aux prises avec une organisation libidinale inflexible, sorte de machine délirante qui attaque sans relâche un « réel » qui est le véritable ressort de l’invective.
Ce n’est pas parce que l’autre m’insupporte que je lui oppose le démenti cruel de l’invective. Ce n’est pas parce que l’altérité me fait offense que je m’y oppose avec virulence. Chez Bernhard, seul le « réel » (qui fait état de notre compréhension du monde) fait office d’énigme qu’il faut contester sans délai. C’est que le réel est l’aveu d’une promesse : il concrétise cette soif de communication qui est au coeur du pacte intersubjectif que représente tout acte de parole. Par l’usage de l’invective, le sujet (qui habite le monde du langage) tente avant tout d’en finir avec l’espoir d’une parole réconciliatrice. Il provoque, détruit, vitupère, dans l’espoir inavouable que le réel cédera sous l’affront de cette parole injurieuse. Chez Bernhard, l’invective, plus qu’un dénigrement du sujet individuel, est un appel impérieux, parfois désespéré, au Grand Autre de la relation symbolique. À la manière d’un Artaud qui manipule glossolalies et imprécations pour mieux lutter contre un dieu inaccessible, d’un Schreber qui noue une relation directe avec la cosmogonie du ciel et de l’enfer, Thomas Bernhard fait de l’invective la source méchante d’un défi adressé au « réel ». Si la méchanceté est sans objet, c’est qu’elle ne concerne même plus la communauté humaine. Au-delà du sujet (et de l’objet), l’imprécateur de l’invective est à la recherche d’une parole vive qui renoue avec la cruauté du monde.
Un Thomas Bernhard, plus que d’autres, aura éprouvé cette violence native. Les écrits autobiographiques que sont La cave, Le souffle, Le froid décrivent un univers où la maladie, l’abandon et la misère coexistent. Mais il serait simpliste de réduire l’oeuvre de Bernhard à ce seul constat d’un drame personnel. Sans qu’il soit question ici de rêver à quelque transcendance cruelle (où le monde ferait soudainement sens dans un accès de méchanceté), il reste que l’oeuvre de Bernhard, par le recours à l’invective, est un refus du monde coutumier. La parole injurieuse abonde dans cet univers où l’alter ego de la communauté humaine est un piètre interlocuteur. De cette manière, la méchanceté de l’invective, parce qu’elle fait l’impasse sur la souffrance infligée par autrui, devient une nouvelle forme d’idéal : une prière irritée qui désacralise les icônes, qui promeut la désolidarisation des sujets à l’intérieur de la communauté humaine.
Appendices
Note biographique
Simon Harel
Simon Harel est professeur titulaire au département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. Il est le directeur du Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT) à l’UQAM. Parmi ses objets de recherche actuels : l’imaginaire des lieux habités, l’écriture migrante au Québec et les formes actuelles du récit de soi. Il a publié une vingtaine de monographies et d’ouvrages collectifs chez plusieurs éditeurs. Parmi ses publications, on retiendra ses titres récents : Braconnages identitaires. Un Québec palimpseste (VLB, 2006), Les passages obligés de l’écriture migrante (XYZ, 2005), Lieux propices (dir. de publication avec Adelaide Russo, Presses de l’Université Laval, 2005). Ses travaux actuels portent sur l’écriture de la méchanceté dans les oeuvres de V. S. Naipaul et Thomas Bernhard, les relations entre architectures, espaces psychiques et littéraires, le statut de la confiance à l’ère du discrédit. Il fera paraître sous peu un essai intitulé Espaces en perdition. Les lieux précaires de la vie quotidienne.
Notes
-
[1]
Thomas Bernhard, Béton, 1985, p. 24.
-
[2]
Martine Sforzin écrit : « Thomas Bernhard fait peser sur l’âme de ses personnages une douleur d’exister, une incompréhension et un désespoir face à la mort qu’ils contribuent eux-mêmes à intensifier et à exaspérer par la résistance qu’ils leur opposent et l’irritation qu’ils en éprouvent. Réaction physique, l’irritation met en jeu le corps et se retrouve en toute logique au coeur d’une oeuvre dont le point sensible est la lutte entre le corps, ses humeurs, la matière et l’esprit mis sans cesse au défi de les comprendre. Parents proches des héros de Kafka, les personnages de Thomas Bernhard n’en ont pas cependant la docile humilité. Ils sont animés d’une volonté, celle de résister coûte que coûte, fût-ce jusqu’à l’autodestruction » (L’art de l’irritation chez Thomas Bernhard, 2002, p. 27).
-
[3]
« Et j’ai eu l’impression que la sortie du comédien du Burg, loin de les réjouir uniquement sur le moment, avait procuré chez tous ceux qui y avaient assisté une satisfaction plus que momentanée. Bien entendu, ils n’ont pas exprimé ce sentiment, ils n’avaient aucune raison de le faire et ils n’auraient pas pu non plus se le permettre. Le comédien du Burg, en revanche, a pu se le permettre, tout comme j’ai pu me permettre de cautionner, uniquement en me taisant, tout ce que le comédien du Burg a déclaré pour enfoncer Janie » (Thomas Bernhard, Des arbres à abattre, 2002, p. 216).
-
[4]
Thomas Bernhard, Ténèbres. Textes, discours, entretiens, 1986, p. 48-49.
-
[5]
Thomas Bernhard, La cave, 1982, p. 37.
-
[6]
Thomas Bernhard, Béton, op. cit., p. 17.
-
[7]
« Les murs sont les mêmes, les gens sont les mêmes, l’atmosphère, cette atmosphère qui accable et frappe tout à mort chez un enfant impuissant, est la même, j’entends les mêmes voix, ce sont les mêmes sons, les mêmes senteurs, les mêmes couleurs. Le tout réuni, c’est ce processus morbide qui, dès mon arrivée, retrouve son efficacité, qui, lorsque j’avais été absent, n’avait cessé qu’en apparence, ce processus qui progresse sans interruption, contre lequel il n’y pas de remède. En vérité, c’est un processus de mort à petit feu qui reprend dès que je suis là, que je fais mes premiers pas et que je pense mes premières pensées » (Thomas Bernhard, L’origine, simple indication, 1981, p. 158-159).
-
[8]
Thomas Bernhard, Béton, op. cit., p. 41.
-
[9]
Ibid., p. 23.
-
[10]
Ibid., p. 17.
-
[11]
Thomas Bernhard, La plâtrière, 1974, p. 67.
-
[12]
Thomas Bernhard, Béton, op. cit., p. 13.
-
[13]
Ibid., p. 21.
-
[14]
Voir Simon Harel, Un boîtier d’écriture. Les lieux dits de Michel Leiris, 2002.
-
[15]
Thomas Bernhard, La plâtrière, op. cit., p. 91.
-
[16]
Ibid., p. 166-167.
-
[17]
Ibid., p. 180.
-
[18]
Roger Dorey, « La relation d’emprise », 1981.
-
[19]
Thomas Bernhard, L’origine, op. cit., p. 139.
-
[20]
Ibid., p. 141.
-
[21]
François Flahault, La scène de ménage, 1987, p. 148.
-
[22]
Ibid., p. 158.
-
[23]
Thomas Bernhard, La plâtrière, op. cit., p. 38-39.
-
[24]
Thomas Bernhard, Le souffle. Une décision, 1983, p. 14.
-
[25]
Thomas Bernhard, La plâtrière, op. cit., p. 70.
-
[26]
François Flahault, La scène de ménage, op. cit., p. 32.
-
[27]
Thomas Bernhard, Béton, op. cit., p. 28.
-
[28]
Ibid., p. 34.
-
[29]
Thomas Bernhard, La plâtrière, op. cit., p. 185.
-
[30]
Ibid., p. 90.
-
[31]
Ibid., p. 172.
-
[32]
Ibid., p. 18-19.
-
[33]
Ibid., p. 131.
-
[34]
Ibid., p. 15-16.
-
[35]
Thomas Bernhard, Béton, op. cit., p. 15-16.
-
[36]
Ibid., p. 53.
Références
- Bernhard, Thomas, Béton, Paris, Gallimard, 1985 (trad. de G. Lambrichs).
- — — —, Des arbres à abattre, Paris, Gallimard (Folio), 2002 (trad. de B. Kreiss).
- — — —, La cave, Paris, Gallimard (L’imaginaire), 1982 (trad. d’A. Kohn).
- — — —, La plâtrière, Paris, Gallimard (Du monde entier), 1974 (trad. de L. Servicen).
- — — —, Le souffle. Une décision, Paris, Gallimard (Du monde entier), 1983 (trad. d’A. Kohn).
- — — —, L’origine, simple indication, Paris, Gallimard (Du monde entier), 1981 (trad. d’A. Kohn).
- — — —, Ténèbres. Textes, discours, entretiens, Paris, Maurice Nadeau, 1986 (trad. de C. Porcell).
- Dorey, Roger, « La relation d’emprise », Nouvelle revue de psychanalyse, n° 24 (1981), p. 117-140.
- Flahault, François, La scène de ménage, Paris, Denoël, 1987.
- Harel, Simon, Un boîtier d’écriture. Les lieux dits de Michel Leiris, Montréal, Trait d’union (Spirale), 2002.
- Sforzin, Martine, L’art de l’irritation chez Thomas Bernhard, Arras –Valenciennes, Presses de l’Université d’Artois – Presses universitaires de Valenciennes, 2002.