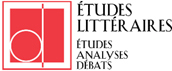Abstracts
Résumé
L’amour et la mort traversent le monde fictif de Marguerite Duras. Dans leur entrelacement, le Temps surgit. L’écriture du deuil et de la perte, L’amant de la Chine du Nord, retraçant le fil d’intrigue de L’amant, marque une narrativité plus mouvante. Le temps cinématographique et le temps narratif se fondent en temps scriptural de l’écriture où a lieu l’événement sublime : non pas une histoire d’amour, mais l’histoire de l’amour, de la mémoire, de l’oubli, sans fin.
Abstract
The fictional world of Marguerite Duras is run through and through by love and death. Time emerges from their intertwining. As the writing of bereavement and loss, L’amant de la Chine du Nord, following the storyline plotted in L’amant, marks a more unstable kind of narrativity. Cinematographic time and narrative time blend into a scriptural time of writing in which the sublime event unfolds : the resulting fiction is not a story of love, but the unending story of love, memory, and forgetting.
Article body
Ce qui, dans le monde de fiction de Marguerite Duras, constitue un leitmotiv, revenant, revenu, poussé à l’extrême, c’est le désir tremblant, la passion endeuillée, c’est l’Amour et c’est la Mort. Si l’amour, dans sa volupté intense, porte l’emblème de « l’approbation » ultime de la vie, déjà, par cette intensité même qui coupe la respiration, il rejoint l’au-delà abyssal de la vie ; déjà, il précipite « jusque dans la mort[1] ». La fusion foudroyante de l’amour fait goûter à l’homme un instant d’éternité — d’immortalité —, instant qui se révèle pourtant radicalement mortel, car illusoire, éphémère. Dans la détresse comme dans la jouissance, l’amour côtoie la mort. L’acte d’amour, à son comble, présente une défaillance, un arrêt brutal de la vie, tout comme la mort — on dit « la petite mort » — qui en marque une rupture violente. En fait, l’amour et la mort se rapprochent en tant que « transgression qui arrache l’homme à sa vie quotidienne[2] ». Et toute transgression, de par ce « passer outre » de la régularité, de la quotidienneté, de la loi, de l’interdit, inspire la fascination et le désir masqués sous le refoulement. Dans ce sens, Thanatos et Éros s’entrelacent : « Le mouvement de l’amour, porté à l’extrême, est un mouvement de la mort[3]. » L’étrange similarité phonique et morphologique de ces deux mots — l’amour, l’amor / la mort — noue un lien secret. La conscience aiguë de la mort — cette « présence absente[4] » intime —, autrement dit, un désir de la mort, accompagne jusqu’au bout l’écriture de Duras, écriture qui fait dépôt, reprenant, retenant, remémorant sans mémoriser l’improbable instant de l’amour. Livre de mort, écriture du deuil, L’amant de la Chine du Nord s’écrit à partir de la mort, depuis la mort, tout en demeurant dans la folie de l’amour.
Dans l’expérience de l’amour et de la mort, le Temps surgit. Car ce n’est pas moins l’expérience du temps. Quand le temps « normal » se suspend ou se bouleverse. Quand il s’accélère vertigineusement, comme lors de la première nuit d’amour, ou se ralentit infiniment, tel le silence du regard de l’amant. Et quand l’expérience du temps prend le relais de l’expérience de l’écriture : écrire, c’est aussi sentir, faire passer, durer ; c’est, dans la durée du temps, endurer, perdurer (perdre-durer / durer-toujours), en se transformant en lieu de la temporalité. C’est la saisie de l’insaisissable, la ré-expérience de l’expérience. C’est répéter mille fois ce qui se passe une fois, et continuer, par ce geste, à tracer et à effacer, sans répit.
Aimer, c’est aspirer à l’autre, un autre absolu qu’incarnent l’amour impossible, mais aussi la mort et le temps, lesquels, hors de notre portée, demeurent pourtant au fond de nous-mêmes. Ce serait donc l’autre-en-soi. L’instant impossible d’aimer et de mourir, le temps absolu de l’écriture. Où la voix basse, continue, anonyme, du narrateur, de la narratrice, du texte, nous transmet, dans un temps infiniment reculé, irrepérable, une expérience de la vie, de la mort, du raconter.
« J’ai écrit l’histoire de l’amant de la Chine du Nord et de l’enfant : elle n’était pas encore là dans L’amant, le temps manquait autour d’eux[5]. » C’est ainsi qu’à la page liminaire de L’amant de la Chine du Nord, Marguerite Duras parle de ce livre qui, sept ans après la parution de L’amant, raconte encore une fois « l’amour entre le Chinois et l’enfant ». Pourtant ce n’est déjà plus la même histoire ou, selon l’écrivain, l’histoire n’avait même pas existé dans L’amant, parce qu’il « manquait » du « temps ». On se demande alors quel est ce « temps » qui « manquait », qui fait que l’histoire tarde à émerger et qu’elle puisse enfin (re)naître dans un autre récit, après des années. Est-ce le temps « après coup », « après » l’événement ? le temps qui a passé depuis ? c’est-à-dire le temps qui dépose, qui décante ? qui donne du recul, de la distance ? est-ce, donc, le temps de l’oubli ? le temps du revenir, du souvenir, de la mémoire ? de la remémoration ? est-ce à dire que, pour narrer, pour que cela fasse histoire, il faut que du temps soit passé ? il faut du délai, de l’attente, de la patience — de la souffrance ? que la narration est donc un acte différé ? donc toujours déjà anamnèse, recherche, reconstitution, reprise… ? est-ce, enfin, la séparation, la mort ? le temps de mourir ? puisque c’est finalement la mort qui déclenche l’écriture ? Mais tout cela revient à dire que l’écriture est travail de mémoire, que narrer / écrire ce serait faire le deuil de l’événement et tisser une mémoire : un texte-mémoire, qui est aussi texte de deuil, tissu de deuil.
C’est pourquoi si l’on discerne, dans L’amant de la Chine du Nord, le même fil d’intrigue que dans L’amant — caractéristique de l’écriture durassienne qui s’enroule et s’origine à l’infini —, on y remarque non moins de nouveaux traits narratifs : narration à la troisième personne au lieu de la première ; récit qui, en apparence, pourrait être celui d’un scénario de film ; place importante des dialogues… Bref, on rencontre toutes les caractéristiques d’une narrativité plus souple, plus mouvante.
Cette narrativité va retenir ci-après l’analyse, laquelle ne se borne pourtant pas aux seuls aspects narratifs : réfléchissant sur la question du Temps et de la Mort, deux dimensions qui s’interpénètrent dans une histoire d’amour, je tente de considérer cette écriture comme un effort compensatoire face à la perte, à la séparation, au tragique de la mort, et de circonscrire l’écriture de Duras comme celle « du désastre[6] », pour reprendre l’expression de Maurice Blanchot.
Écrire à la mort
Marguerite Duras écrit avec la mort. Elle dit déjà dans L’amant :
Je crois que je sais déjà me le dire, j’ai vaguement envie de mourir. Ce mot, je ne le sépare déjà plus de ma vie. […] Je vais écrire des livres. C’est ce que je vois au-delà de l’instant, dans le grand désert sous les traits duquel m’apparaît l’étendue de ma vie[7].
« Écrire des livres » devient donc la seule possibilité de faire durer la vie, dans le désir de la mort : laquelle constitue ainsi le ressort de l’écriture.
Aimer est acte de mourir et de faire mourir ; l’amour et le désir ouvrent, dès le commencement, l’abîme de la violence et de la mort : « Mort du désir d’une enfant. /Martyre[8]. » L’amour fait expérience de vie et de mort, à la fois : « C’est elle qui veut savoir, qui veut tout, le plus, tout, vivre et mourir dans le même temps. Celle qui est au plus près du désespoir et de l’intelligence de la passion[9] », dont le premier goût — qui est amer — relève déjà de la mort : « Ça ne s’appelle plus la douleur, ça s’appelle peut-être mourir[10] » ; l’amour prend l’aspect cruel du meurtre : « Tu m’aurais tuée comment à Long-Hai ? — Comme un Chinois. Avec la cruauté en plus de la mort[11] » ; l’amour porte des marques sinistres, mortuaires : « Sur le fauteuil il y a le peignoir noir de l’amant, funèbre, effrayant[12] » ; aimer fait déjà oeuvre de mourir : « il dit : Que jamais plus il ne connaîtra ce bonheur — il dit : Désespéré, fou, à se tuer[13]. » « Il faut aimer pour détruire[14] » : pour détruire et se détruire ; pour mourir dans l’amour — pour aimer jusqu’à la mort.
Les personnages, tous atteints d’une « maladie de la mort[15] », sont « des êtres déjà radicalement détruits[16] », rendus mourants par un « mouvement infini de mourir[17] » : ils sont en train de mourir, ils se meurent, ils vont mourir, ils sont toujours déjà morts sans être morts : ni vivants ni morts, entre la vie et la mort ; la mort dans la vie, la vie de la mort. La vie, la mort. Inséparables. Vivants — sur-vivants. Condamnés mais en perpétuel sursis. Spectres, fantômes qui reviennent, revenants. Et c’est toujours la scène du récit qui permet de monter les paradoxes, d’unir les contraires et les formes impossibles. Entre eux, entre les amants, entre les personnages, s’enchevêtrent, s’entrelacent la souffrance, la violence, la passion. Cet enchevêtrement, d’un éclat insupportable, les rapproche ; et ce rapprochement même les sépare, les différencie et les distancie — les écrase — dans le désir fou d’aimer, de tuer et de détruire. Dans le vouloir-mourir.
La mort non seulement lance, mais aussi clôt le livre ; la mort traverse l’écriture, la déchire comme une blessure. Et la détruit. C’est une destruction jusqu’au fond de la langue, d’une vieille langue lisse, correcte, douce. Car la langue, elle-même, devient violente, brutale, douloureuse, mal à l’aise. Partout il y a cette « maladresse[18] » langagière — mais justement, quelle est l’adresse ? à qui s’adresse le langage amoureux ? quelle langue peut-on adresser à un mort, à un mourant, quelle langue venant d’un mort, d’un mourant, sinon la langue de la mal-adresse ? — et partout on sent cette interruption, cette coupure, de la parole, du souffle, de la syntaxe : une syntaxe devenue accidentée, incohérente.
Écriture, donc, de ruine, — écriture qui détruit et se laisse détruire —, de désastre, de deuil. Une écriture qui, dans la narration d’une histoire d’amour, s’écrit avec la mort et contre la mort : c’est dire qu’elle en fait un habitat et un lieu de dépôt ; mais aussi qu’elle se dresse, en regard des ruines, de l’érosion, de la dévastation de mourir, comme une force de récupération. Par ce mouvement oxymorique, l’écriture réalise le travail d’une oeuvre sublime : « […] le sublime, quand il se produit au moment opportun, comme la foudre, il disperse tout et sur-le-champ il manifeste, concentrée, la force de l’orateur[19] », c’est donc le coup de foudre qui touche et qui éclate ; qui rassemble et disperse. C’est là où la temporalité est à l’oeuvre, une temporalité qui condense la vision du temps phénoménologique et celle de l’expérience de la vie et de la mémoire dans l’unique — et complexe — temps de l’écriture.
Cristallisation de la temporalité de l’écriture
L’enfant, après le premier amour, « a déjà le visage détruit de toute sa vie. […] vieilli […] en une nuit[20] ». Ce vieillissement trop vite, « brutal[21] », de la jeune fille, cette destruction imprévue, cette mort invisible logée au moment le plus vif de la vie, donnent à sentir une « poussée du temps[22] » inconcevable, qui, jaillissant brusquement de la quotidienneté, rend fou l’ordre des choses. Toute une vie se consume en une nuit, brûle en un éclair : l’amour enseigne la mort qui, à son tour, fondamentalement, est expérience du temps.
Le temps narratif du texte, donc, s’emploie à rendre compte de cette expérience temporelle. Duras rejette le temps verbal conventionnel du « roman » : le passé simple, ce signe de l’Histoire, ce « verbe mince et pur, sans densité, sans volume, sans déploiement[23] ». Car, pour elle, le « passé » n’est jamais « simple », jamais un point enfoui dans l’abstrait grammatical, dépouillé de toute complexité de la temporalité humaine. Bien au contraire, l’auteur prend le parti d’embrasser toutes les dimensions de l’expérience : c’est-à-dire essai, apprentissage, tâtonnements, approximation ; c’est-à-dire risque (periculum : épreuve, danger), au risque de faire des erreurs et des ratures, de reprendre. Tout porte à l’exploration d’une temporalité de la mémoire : rétrospection et anticipation, projection du passé dans le présent de la mémoire qui est toujours un re-présent, et le mouvement dilatoire de l’instant perpétuel. Pour ce faire, le récit fait usage du temps au présent et à l’imparfait, ainsi qu’au plus-que-parfait, lesquels fonctionnent autrement.
Par certains aspects, le récit s’apparente, à l’évidence, à un scénario cinématogra-phique : le temps verbal au présent est moins de l’ordre du « raconter » que du « conter », au fur et à mesure, ce qui est proprement inachevé, inachevable, ce qui se passe, se déroule sur la scène, s’enchaîne sous les yeux, en train de se tracer ; la focalisation narrative n’est ni celle des personnages ni celle de la narratrice, mais celle d’un « on » neutre, de l’oeil de la caméra :
L’enfant sort de l’image. Elle quitte le champ de la caméra et celui de la fête. La caméra balaie lentement ce qu’on vient de voir puis elle se retourne et repart dans la direction qu’a prise l’enfant[24].
La narration montre ainsi les gestes de la narrativité ; autrement dit, la narration se narrativise. La scène, encadrée et rythmée par les mouvements de caméra, devient partie prenante de l’histoire qui est ainsi mise en scène. Par cet emploi, le récit ne se veut plus « représentation », mais bien « présentation » ou « présentification », qui a pour visée de « rendre présent », de « montrer » et de guider le regard du lecteur-spectateur par le cadrage, le champ mobile de la caméra. La distance narrative est notamment d’ordre spatial, car l’événement qu’on relate se déroule devant nous, comme au théâtre, — il y a donc une théâtralisation du récit.
Or, ce n’est pas un déroulement tout à fait direct ni transparent : ce qui se déroule — se dérouler : prendre place dans le temps ; emplacement du temps — au-devant se passe, passant, déjà passé, non seulement sur l’écran, mais déborde celui-ci vers un dehors, vers « un champ aveugle[25] » : sans cesse il y a une superposition fluctuante des images dont l’une succède à l’autre sans s’y substituer totalement. Il y a plutôt effacement en fondu, fade-in et fade-out, qu’une disparition totale. Une surimpression. Et la persistance rétinienne où l’oeil s’attarde encore sur l’image effacée et en garde l’empreinte. Palimpseste mobile du temps humain, de la mémoire humaine. L’écriture, en scène, fait le passage, le tracé, la traversée. C’est pourquoi sur le présent verbal se greffe un autre temps narratif — celui de l’imparfait et du plus-que-parfait, ou, plus précisément, celui du domaine de l’inachevé du parfait imparfait, quand le récit quitte — déborde — le champ de la caméra, nous entraîne vers le hors-champ, faisant de nous des aveugles, des mal-voyants, et abandonne l’effet d’immédiateté porté par le présent, afin de raconter, évoquer, convoquer, remémorer, traverser, projeter, retourner. Car l’imparfait, à la lettre, exprime justement ce sentiment d’imperfection, d’insatisfaction, d’incomplétude, d’inachevé, de manque ; ce temps « cruel » n’est que trop humain, dans lequel la vie et l’amour se présentent dans l’état d’inaccomplissement, qui est, par définition, le leur :
Ils allaient se séparer. Elle se souvient combien c’était difficile, cruel, de parler. Les mots étaient introuvables tellement le désir était fort. Ils ne s’étaient plus regardés. Ils avaient évité leurs mains, leurs yeux. C’était lui qui avait imposé ce silence. Elle avait dit que ce silence à lui seul, les mots évités par ce silence, sa ponctuation même, sa distraction, ce jeu aussi, l’enfance de ce jeu et ses pleurs, tout ça aurait pu déjà faire dire qu’il s’agissait d’un amour[26].
Du coup le temps narratif devient pluriel, combinant et traversant les lieux indéfinis et indissociables du passé, du présent, de l’avenir : la profondeur et la multiplicité de la vie humaine sont ramenées au secret de l’écriture et explorées par elle.
Le texte se voit ainsi sans cesse dédoublé : « C’est un livre. / C’est un film[27]. »
Cette double définition, donc délimitation, justifie en quelque sorte le double temps narratif du texte : d’une manière quelque peu simpliste, je qualifierai, provisoirement, le présent de « temps du film » et l’imparfait de « temps du livre » ou de « temps de la narration », puisque dans ce dernier cas, il s’agit moins de « présenter » que de « raconter », à tous les sens du terme. « Le temps du film », c’est le temps du déroulement narratif, qui marque évidemment la saisie de l’immédiat, de l’ici et du maintenant — du « présent », mais c’est toujours, en fait, un re-présent, où importent le déplacement, le passage, le mouvement, le variable. Par contre, « le temps du livre » est de l’ordre du « raconter », de la « narration », c’est le temps du dépôt narratif et de la construction, où le récit fait un effort pour pallier le manque et assurer la cohérence, mais aussi pour laisser affleurer les empreintes, les trous, les accidents.
C’est l’emboîtement et la superposition de ces deux temps verbaux qui produisent justement un décalage, lequel rend instable et multiple la dimension temporelle narrative du récit. Ce dernier s’ouvre ainsi sur le lieu impondérable et obscur de la mémoire — mémoire en tant que processus d’anamnèse en train de se chercher, se constituer et se perdre : s’oublier, puisque l’anamnèse comporte aussi amnésie, remémoration, oubli. L’écriture est emblématique du travail à l’oeuvre, de la quête du souvenir d’une vie antérieure, immémoriale. Elle porte l’empreinte de l’effort déployé pour prendre le contrôle d’un temps proprement incontrôlable : elle devient le lieu de charge et de décharge. L’écriture, ainsi, garde traces ; elle est le passage, le regard qui s’imprime ; elle temporise. L’écriture incorpore donc le temps : elle se temporalise en temporisant. Par là, le concept du temps déborde largement le domaine narratologique pour passer à la temporalité phénoménologique qui est en fonction de l’expérience humaine : temporalité considérée comme transition, comme passage, comme toujours déjà du présent vivant et de l’extase.
Le temps phénoménologique présente bien « un milieu mouvant[28] », un milieu que nous habitons et qui nous habite : il est la conscience et la subjectivité mêmes, la synthèse des transitions. Il n’est pas la simple succession du passé, du présent et de l’avenir : « L’avenir n’est pas postérieur au passé et celui-ci n’est pas antérieur au présent. La temporalité se temporalise comme avenir-qui-va-au-passé-en-venant-au-présent[29]. » Le présent amorce donc une trame en tant qu’il est le point central du passé et de l’avenir. Les traits d’union accentuent la qualité passagère et mouvante du temps, qui se révèle beaucoup plus complexe qu’une conception linéaire —, en fait, le temps n’est jamais une ligne, mais bien un « réseau » :
À chaque moment qui vient, le moment précédent subit une modification : je le tiens encore en main, il est encore là, et cependant il sombre déjà, il descend au-dessous de la ligne des présents ; pour le garder, il faut que je tende la main à travers une mince couche de temps[30].
Les présents, pluriels, sont donc par essence insaisissables : chaque instant repousse l’instant précédent dans un abîme immensurable, tout en subissant aussitôt la poussée inéluctable du nouvel instant qui advient. Ce « encore là » et ce « sombre déjà » dessinent avec éloquence l’évanescence du temps, lequel est donc réduit à ces instants infiniment infimes, minimes, ne pouvant avancer qu’à perte : tendre la main, c’est tenter une remémoration improbable à travers l’oubli. Dans le texte de Duras, l’enroulement des temps narratifs fait office d’épaisseur, mais c’est une inquiétante — car instable — épaisseur. Elle aboutit à un vertige de l’effet générateur miné d’alternatives : un temps découle de l’autre, et vice versa. Autrement dit, c’est l’incalculabilité de l’expérience qui est rapportée et transposée dans le récit par le biais du temps phénoménologique. Ce faisant, le récit accomplit ce que Paul Ricoeur appelle « la configuration » intelligente de la narration[31], laquelle permet finalement aux temps verbaux de converger vers le lieu de surgissement de tous les temps, à savoir le présent . Donc déjà, « être à présent, c’est être de toujours, et être à jamais[32] ». Ainsi le présent — l’instant mince — recouvre-t-il malgré sa minceur le « toujours » et le « jamais » : le temps qui se présente et le hors champ du temps au présent. C’est ce que l’enfant dit au Chinois : « Tu dis “jamais” comme si tu disais “toujours[33]”. » Le récit joue justement sur cette réversibilité, cette oscillation, ce glissement imperceptible du temps, ou plutôt des temps, où « une fois » égale « plusieurs », un instant est déjà l’éternité — comme dans l’expérience de l’amour : « Il la regarde “pour toujours en une fois” avant la fin de l’histoire d’amour[34]. » C’est déjà le temps inconcevable, le temps de tous les temps et le hors champ du temps. C’est bien une temporalité fabuleuse, fabuleuse parce qu’elle est construite autour de la fabula — la fable, l’histoire d’amour —, donc déjà fondamentalement irréelle, mystérieuse et mythique, et aussi parce qu’elle est transfigurée par le déplacement des figures de style. Trans-figures qui portent à la perversion et à la subversion du temps « naturel » ou « ordinaire » : ellipse, stase (et ek-stase), rupture. Ainsi advient, dans le texte, le transport hors de soi, hors du courant temporel —, le ravissement donc : le sujet ou l’histoire saisi(e), emporté(e), enlevé(e), transporté(e). Tellement fabuleuse que cette temporalité est devenue finalement scripturale : parce que purement livresque, parce qu’elle ne suit plus l’ordre habituel mais prend un cheminement légendaire, archaïque, dans un passé lointain, immémorial, qui n’existe que dans les fables, les livres. Parce qu’elle combine répétition, métabole, pause, silence, raccourci avec prolongement, accélération et ralentissement. C’est la temporalité de l’écriture qui apparaît : elle est à la racine du temps humain et cependant s’ancre en dehors — encrée sur le papier.
La narration est en elle-même minimale : réduite, syncopée, fragmentée, elle est en fait moins maintenue par quelque voix narrative que rapportée par les dialogues ou les « “couches” de conversations juxtaposées[35] » des personnages. Autrement dit, l’histoire d’amour entre le Chinois et l’enfant accueille en fait d’autres histoires, ou des strates d’histoires qui, l’une appelant l’autre, s’enroulent à l’infini. Chacun raconte sa propre histoire ; chaque personnage devient, à tour de rôle, narrateur ou narratrice : ils sont ce que le texte fabrique d’eux, avec eux. Ils sécrètent la narration, comme le ver à soie qui fait fil de son propre corps. Le récit d’ailleurs tient beaucoup à ce que « l’histoire » soit là, soit racontée : très attentivement, l’écrivain nous conduit au raconter de cette « histoire », nous rappelle sans cesse qu’ily a / avait, qu’il existe / existait, indubitablement, l’histoire[36]. C’est bien une hantise de conter et de raconter : une écriture hantée, habitée, possédée par les morts vivants, les vivants morts, les esprits qui continuent à raconter. L’important, c’est qu’on raconte, et non pas ce qu’on raconte ; c’est l’acte de raconter, non pas l’histoire elle-même ; c’est l’énonciation, non pas l’énoncé.
Par là on revient à la temporalité du texte : à l’épaisseur du temps, ou aux « lieux du temps[37] », dont le pluriel décrit bien la complexité qui s’attache au temps phénoménologique réfléchi dans la conscience et l’expérience humaines, donc aussi dans le geste d’écrire et de raconter. Là se réalise une cristallisation : ce qui prend, qui requiert une opération longue, qui prend du temps, qui exige l’esprit patient et travaillant[38]. L’écriture permet alors de faire sentir le temps à l’oeuvre. Il est donc pertinent de dire avec Lyotard que « [l]e temps de ce qui est raconté, le temps de raconter ce temps-là cessent d’être dissociés[39] ». Dans le texte de Duras, « le temps de ce qui est raconté », ce serait « le temps du film », et « le temps de raconter ce temps-là » est « le temps du livre » : c’est alors temps sur temps, temps du temps ; temps de raconter le temps, par le biais de l’histoire à laquelle il faut redonner son double sens : d’une part, « intrigue » ou story, comme on dit en anglais, et d’autre part, Histoire, c’est-à-dire événements mémorables du passé, donc de l’ordre de la mémoire et de la temporalité. D’où cet enchâssement infini chez Duras : le livre dans le livre, le livre dans le film, le film dans le livre, les narrations dans les narrations… Autant de « lieux du temps » qui sont aussi formes du temps. La temporalité ici à l’oeuvre, ce n’est ni le temps de l’histoire-intrigue, ni le temps de la narration de cette histoire, mais bien le temps scriptural de l’écriture : écriture comme lieu du temps. Lieu de dépôt, de cristallisation des temps. Renversant les affirmations convenues, Duras nous dit en somme : le temps, c’est l’écriture. Une écriture qui, dès lors, ne cherche pas la signification, mais son non-lieu, le non-dire, le rien qui n’est pas rien, et raconte l’événement, la contingence, l’occurrence, le commencement toujours recommencé, la venue toujours revenante, infiniment, interminablement. L’acte de raconter trouve son sens dans l’interruption, dans la syncope, qui est la temporalité paradoxale de la narration. C’est une temporalité de l’ordre du toujours déjà, du toutes les fois en une, du n’en pas finir de raconter, du encore et du jamais : « L’histoire est déjà là, déjà inévitable, / Celle d’un amour aveuglant, / Toujours à venir, / Jamais oublié[40] » ; « Mais que ça ne fait mal qu’une seule fois dans la vie, et pour toujours[41] » ; « Pour maintenant, pour ce soir, je ne t’aime pas, et je ne t’aimerai jamais[42]. » Dans la narration de ces temps contradictoires, de ce lieu intenable à la lettre, on trouve l’arrivance de l’événement :
Du fait qu’il est absolu, le présent qu’il présente n’est pas saisissable : il n’est pas encore ou déjà plus présent. Pour saisir la présentation elle-même et la présenter, il est toujours trop tôt ou trop tard. Telle est la constitution spécifique et paradoxale de l’événement[43].
Ces « pas encore » et « déjà plus » marquent précisément l’instance introuvable de la « re-présentation » et expliquent l’obsession de raconter dans l’écriture durassienne : désir de se laisser hanter par les temps de l’incontrôlable narration ; de n’arriver jamais à récupérer pleinement le manque, l’absence, le néant. L’écriture seule demeure, continue à exister, à raconter, à inventer sa propre temporalité, — aspiration et résistance ab-solues à la mort, qui persistent à l’intérieur du temps, du sujet de l’écriture et de ses personnages.
L’écriture : mémoire oublieuse
Blanchot dit : « Mourir, c’est, absolument parlant, l’imminence incessante par laquelle cependant la vie dure en désirant. Imminence de ce qui s’est toujours déjà passé[44]. » Dans la temporalité étrange de ce mouvement perpétuel du mourir dans la vie, la mémoire est à l’oeuvre ; une mémoire immémoriale, « toujours déjà » oubliée, oublieuse : « Son nom à lui, elle avait oublié. […] Après, elle avait préféré taire encore ce nom dans le livre et le laisser pour toujours oublié[45]. » « Elle dit : J’ai déjà oublié[46] » Cet oublier sans objet, intransitif, absolu, n’est donc pas oublier quelque chose, mais cacher, réserver, taire, attendre, différer… Ce n’est pas oublier l’oubli, mais bien tenir la vie, en oubli en mémoire, dans le silence, l’endurance.
Car c’est la mémoire de l’oubli qui travaille l’écriture : « Elle est tout entière dans cette histoire qu’elle raconte. […] Raconter cette histoire c’est pour moi plus tard l’écrire[47]. » D’abord raconter l’histoire en annonçant la venue de l’écriture, puis écrire en racontant encore et l’histoire et ce raconter. Raconter — ramasser des bribes de souvenir, rapporter des histoires effacées, retracer la vie oblitérée —, c’est déjà écrire, laisser des empreintes, marquer et imprimer. Le lieu de l’écriture, c’est effacement tracé et effacé de nouveau, c’est inscription de l’oubli inoubliable. L’enfant veut toujours écrire ; pour elle comme pour Duras, le livre fait état d’éventuelles reprises :
Dans le premier livre elle avait dit que le bruit de la ville était si proche […]. Elle le dirait encore dans le cas d’un film, encore, ou d’un livre, encore, toujours elle le dirait. Et encore elle le dit ici[48].
C’est ainsi qu’elle avait dit / écrit, elle dit / écrit, elle dira / écrira, déjà, encore, dans tous les cas possibles… Toutefois, elle n’arrive jamais à dire juste, à dire tout, à dire à temps : toujours trop tôt ou trop tard, à peine, avec peine — mais elle dit tout le temps. Recommence tout le temps. Réécrire. C’est la seule chose qu’elle puisse faire pour ne pas oublier l’oubli. Parce qu’elle voulait, par ce dire / écrire, l’impossible complétude du désir : dire l’indicible, expérimenter l’expérience de la mort. Et ce, par l’excès : excès de silence, de mutisme ; excès de volubilité, de répétition — de « ressassement éternel[49] », comme le dit encore Blanchot.
La narration est ainsi à la fois dépouillée de toute conjonction et gonflée de paroles « chaotiques[50] » : d’une part, il y a les scènes immobiles, silencieuses, « extrêmement lentes », reliées seulement par des jeux de regards ; d’autre part, le ressassement, la rumination des histoires. Il semble que ce n’est que dans cet excès paradoxal que l’écriture trouvera, en dernier ressort, une certaine consolation de ce qui est en train de partir, se perdre, mourir.
Longtemps elle le regarde. Puis elle lui dit qu’une fois il faudra qu’il raconte à sa femme tout ce qui s’est passé, entre toi et moi elle dit, entre son mari et la petite fille de l’école de Sadec. Tout, il devra raconter, le bonheur aussi bien que la souffrance, aussi bien le désespoir que la gaieté. Elle dit : Pour que ce soit encore et encore raconté par des gens, n’importe qui, pour que le tout de l’histoire ne soit pas oublié, qu’il en reste quelque chose de très précis […].
Le Chinois avait demandé pourquoi sa femme ? […]
Elle avait dit : Parce que, elle, c’est avec sa douleur qu’elle comprendra l’histoire.
Il avait demandé encore :
— Et s’il n’y a pas de douleur ?
— Alors tout sera oublié[51].
Il s’agit donc de la trans-mission des récits, — une autre forme du transitoire, du transit, de l’autre, de la syncope —, par laquelle l’histoire deviendrait conte, fable. Dès lors, on comprend pourquoi le temps du récit, c’est le temps de l’interminable, toujours en répétition, toujours à recommencer, « toujours déjà » présent, passé, à venir. À continuer et à faire passer. Le temps au futur antérieur : « l’instance de ce qui aura déjà eu lieu[52] » ; la narration de l’histoire avant l’« avoir lieu » dans le temps et dans l’espace de l’histoire, un pressentiment, une anticipation nostalgique comme une évocation, une histoire d’amour qui aura déjà pris fin sans avoir commencé, qui est racontée à partir de la fin, avec la fin, avant la fin. Tout est là : l’histoire d’amour et l’imminence de la mort. Écrire ce temps, c’est écrire depuis[53]. Parce que le langage, c’est « la vie qui porte la mort et se maintient en elle[54] ». Ainsi de l’écriture.
Ils pleurent.
Elle dit, elle demande :
— On ne se reverra jamais. Jamais ?
— Jamais.
— À moins que…
— Non.
— On oubliera.
— Non.
[…]
— Puis un jour on parlera de nous, avec des nouvelles personnes, on racontera comment c’était.
— Et puis un autre jour, plus tard, beaucoup plus tard, on écrira l’histoire.
— Je ne sais pas.
Ils pleurent.
— Et un jour on mourra.
— Oui. L’amour sera dans le cercueil avec les corps.
— Oui. Il y aura les livres au-dehors du cercueil.
— Peut-être. On ne peut pas encore savoir.
Le Chinois dit :
— Si, on sait. Qu’il y aura des livres, on sait.
Ce n’est pas possible autrement[55].
Les amants vont se séparer ; ils vivent déjà dans la séparation où ils s’aiment, d’un amour impossible ; où ils s’unissent et se séparent ; où ils refusent d’oublier et de s’oublier, même après la mort quand l’amour gît « dans le cercueil avec les corps » : avec, c’est un mot qui fait séparation et union ; le cercueil est le lieu qui garde les dépouilles humaines — « les corps » — et l’amour. La séparation, justement, constitue le lieu de dépôt du temps ; comme la mort, elle fait différer l’écriture : une écriture toujours au secret et du secret (secretum : séparé). Écrire, c’est toujours le geste du survivant, du revenant, du martyr ; c’est sacré — qui veut aussi dire, au sens ancien, séparé. L’écriture, passant par la voix évocatrice, liturgique, fait appel, convoque les esprits hantés, les morts sans mort de la perpétuelle narration. La litanie, le ressassement incantatoire constituent les lieux de la temporalité à l’oeuvre. Pour que perdure, c’est-à-dire recommence le dépôt, il faut que le récit devienne rite, rituel de la scène qui livre : le livre qui livre et délivre, donc transmet la parole, le récit. Ce qui se dit là n’est donc pas la mort pure et simple, ni l’anéantissement de l’amour et de l’histoire, car, plus tard, « on racontera », « on écrira », « il y aura les livres au-dehors du cercueil ». Or, le livre, avec Duras, n’est pas recueil mais bien cercueil : qui préserve, abrite des traces, des restes sacrés, de l’humain, de l’amour, de l’effacement. Le Chinois et l’enfant, innommés, innommables, seraient toujours l’amant et l’amante, parfaitement anonymes, légendés, non pas d’une histoire, mais de l’histoire ou des histoires d’amour, de tous les temps, de tous les romans, « des livres, du cinéma, de la vie, de tous les amants[56] ». Ce serait un de ces livres « depuis longtemps disparus », qui « évoqueraient seulement un passé effroyablement ancien et comme sans parole, sans autre parole que cette voix murmurante d’un passé effroyablement ancien[57] ». C’est une (re)présentation de l’irreprésentable, à la limite syncopée. Là où on retrouve le temps de l’éclair, du coup de foudre, la fulgurance d’un clin d’oeil, le débordement, la brisure du coeur : sublime. Qui est : « la vie suspendue, le souffle coupé, le coeur battant[58] ». C’est l’instant de l’amour à mort — suspens, évanouissement, interruption de la respiration, de la vie, du temps. Syncope.
Ce qui est sublime c’est que du sein de cette imminence du néant, quelque chose arrive quand même, ait « lieu », qui annonce que tout n’est pas fini. Un simple voici, l’occurrence la plus minime, est ce « lieu »[59].
L’écriture de Duras, dans l’instantanéité de la narration, ressasse sans cesse l’événement, oeuvre à une sublimation de ce « lieu » minimal, intenable, ce « voici » (vois ici) accidentel qui est instant éternel, foudroyé, ce « il arrive » impromptu. Toujours à reprendre. Et à interrompre. À la limite. De surcroît. À bout de souffle. Car « ce n’est pas possible autrement » : autrement ce serait impensable, invivable, ce serait la mort de la mort, l’anéantissement de la mémoire, de l’oubli, de la narration, de l’écriture.
Le livre de Duras, ce n’est pas le livre du souvenir, mais bien le livre-cercueil qui mène le récit du deuil, le livre-offrande qui offre la scène sacrée de l’amour. Il n’a pas de fin.
Appendices
Note biographique
Keling Wei
Keling Wei est étudiante de doctorat en programme de co-tutelle entre Queen’s University et l’Université Paris VIII. Elle est en train de préparer une thèse sur Récits de l’étranger. Elle a publié « Le premier homme : autobiographie algérienne d’Albert Camus », dans Études littéraires, automne 2001 ; « La rythmique dans Truquage en amont de Claude Ollier », à paraître dans Dalhousie French Studies, 2003 ; « Les repentirs autobiographiques : une lecture d’Enfance de Nathalie Sarraute », à paraître dans Études françaises, Montréal.
Notes
-
[1]
Georges Bataille, L’érotisme, 1965, p. 15.
-
[2]
Philippe Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident, du Moyen Âge à nos jours, 1975, p. 52.
-
[3]
Georges Bataille, L’érotisme, op. cit., p. 48.
-
[4]
Paul-Louis Landsberg, Essai sur l’expérience de la mort, suivi du Problème moral du suicide, 1951, p. 23.
-
[5]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, 1991, p. 11.
-
[6]
Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, 1980.
-
[7]
Marguerite Duras, L’amant, 1984, p. 126.
-
[8]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 62
-
[9]
Ibid., p. 72.
-
[10]
Ibid., p. 80.
-
[11]
Ibid., p. 113.
-
[12]
Ibid., p. 179.
-
[13]
Ibid., p. 222.
-
[14]
Maurice Blanchot, L’amitié, 1971, p. 134.
-
[15]
Marguerite Duras, La maladie de la mort, 1982.
-
[16]
Maurice Blanchot, L’amitié, op. cit., p. 134.
-
[17]
Ibid., p. 134.
-
[18]
Julia Kristeva, Soleil noir, dépression et mélancolie, 1987, p. 233.
-
[19]
Pseudo-Longin, Du sublime, 1993, p. 53.
-
[20]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 88.
-
[21]
Marguerite Duras, L’amant, op. cit., p. 10.
-
[22]
Ibid., p. 10.
-
[23]
Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, 1953, p. 47 et 46.
-
[24]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 21.
-
[25]
Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, 1980, p. 90.
-
[26]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 52. Je souligne.
-
[27]
Ibid., p. 17.
-
[28]
Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945, p. 480.
-
[29]
Martin Heidegger, cité dans ibid., p. 31-32.
-
[30]
Ibid., p. 476.
-
[31]
Paul Ricoeur, La configuration du temps dans le récit de fiction, 1984.
-
[32]
Ibid., p. 483.
-
[33]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 76.
-
[34]
Ibid., p. 201.
-
[35]
Ibid., p. 212, dans la note de Duras.
-
[36]
« L’histoire est déjà là, déjà inévitable » (ibid., p. 52) ; « C’est le commencement de l’histoire » (ibid., p. 61) ; « Et puis, devant elle, tout à coup, […] il y a l’histoire » (ibid., p. 61) ; « Et puis ensuite encore plus tard et plus bas et plus seule, cette Valse Désespérée du commencement de l’histoire d’amour » (ibid., p. 155) ; « Déjà l’enfant pressentait que cette histoire était peut-être celle d’un amour » (ibid., p. 172) ; pour ne citer que quelques exemples.
-
[37]
Jean-François Lyotard, L’inhumain, causeries sur le temps, 1988, p. 89.
-
[38]
Stendhal décrit, dans De l’amour, 1980, p. 31, un phénomène de cristallisation : un rameau d’arbre laissé au fond d’une mine de sel pour plusieurs mois est retiré couvert de « cristallisations brillantes » ; d’où il tire une définition de la cristallisation de l’amour : « Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections. »
-
[39]
Jean-François Lyotard, L’inhumain, op. cit., p. 94.
-
[40]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 52.
-
[41]
Ibid., p. 79.
-
[42]
Ibid., p. 173.
-
[43]
Jean-François Lyotard, L’inhumain, op. cit., p. 70.
-
[44]
Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, op. cit., p. 70.
-
[45]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 82.
-
[46]
Ibid., p. 208.
-
[47]
Ibid., p. 101.
-
[48]
Ibid., p. 81. Je souligne.
-
[49]
Maurice Blanchot, Le ressassement éternel, 1970.
-
[50]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 212.
-
[51]
Ibid., p. 223-224. Je souligne.
-
[52]
Jacques Derrida, Demeure : Maurice Blanchot, 1998, p. 60.
-
[53]
Id.
-
[54]
Maurice Blanchot, De Kafka à Kafka, 1981, p. 51.
-
[55]
Marguerite Duras, L’amant de la Chine du Nord, op. cit., p. 194-195.
-
[56]
Ibid., p. 202.
-
[57]
Maurice Blanchot, Le pas au-delà, op. cit., p. 33.
-
[58]
Jean-Luc Nancy, « L’offrande sublime », dans Jean-François Courtine et al., Du sublime, 1988, p. 64.
-
[59]
Jean-François Lyotard, L’inhumain, op. cit., p. 95.
Références
- Ariès, Philippe, Essai sur l’histoire de la mort en Occident, du Moyen Âge à nos jours, Éditions du seuil (Points), 1975.
- Barthes, Roland, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard — Éditions du seuil (Cahiers du cinéma), 1980.
- — — —, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Éditions du seuil, 1953.
- Bataille, Georges, L’érotisme, Paris, Union générale d’éditions (10 / 18), 1965.
- Blanchot, Maurice, De Kafka à Kafka, Paris, Gallimard, 1981.
- — — —, L’amitié, Paris, Gallimard, 1971.
- — — —, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980.
- — — —, Le pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973.
- — — —, Le ressassement éternel, Paris, Gordon & Breach (Sciences humaines et philosophie), 1970.
- Courtine, Jean-François et al., Du sublime, Paris, Belin (L’extrême contemporain), 1988.
- Duras, Marguerite, Détruire, dit-elle, Paris, Union générale d’éditions (10 / 18), 1969.
- — — —, La maladie de la mort, Paris, Éditions de minuit, 1982.
- — — —, L’amant, Paris, Éditions de minuit, 1984.
- — — —, L’amant de la Chine du Nord, Paris, Gallimard, 1991.
- Kristeva, Julia, Soleil noir, dépression et mélancolie, Paris, Gallimard, 1987.
- Landsberg, Pau-Louis, Essai sur l’expérience de la mort, suivi du Problème moral du suicide, Paris, Éditions du seuil, 1951.
- Lyotard, Jean-François, L’inhumain, causeries sur le temps, Paris, Galilée, 1988.
- Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.
- Nancy, Jean-Luc, Une pensée finie, Paris, Galilée, 1990.
- Pseudo-Longin, Du sublime, Paris, Payot & Rivages, 1993 (éd. et trad. de J. Pigeaud).
- Ricoeur, Paul, Temps et récit, Paris, Éditions du seuil, t. 1 et 2, 1983-1984.
- Stendhal, De l’amour, Paris, Gallimard (Folio), 1980.