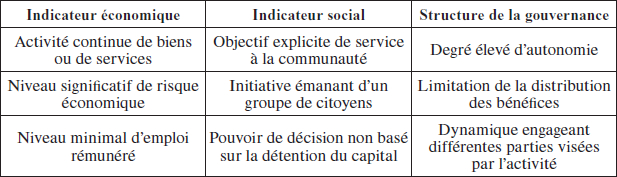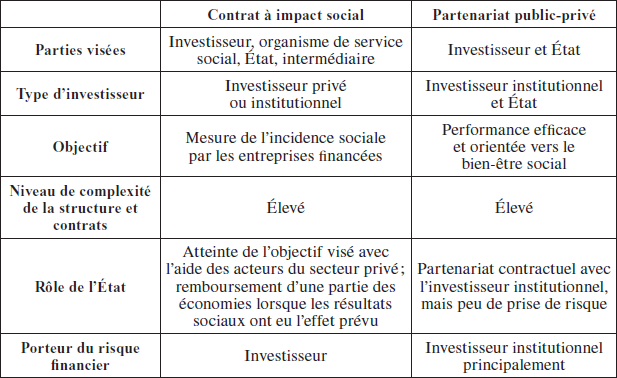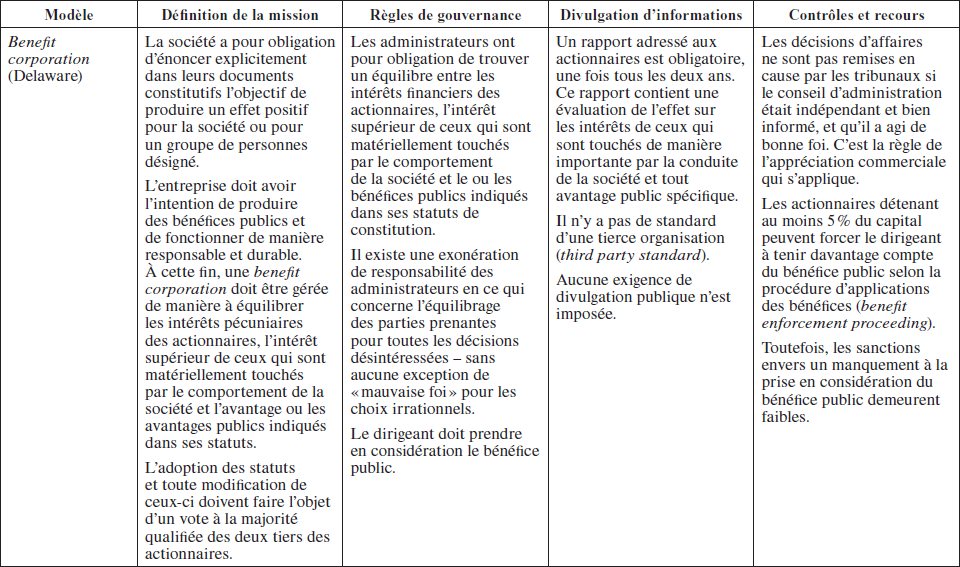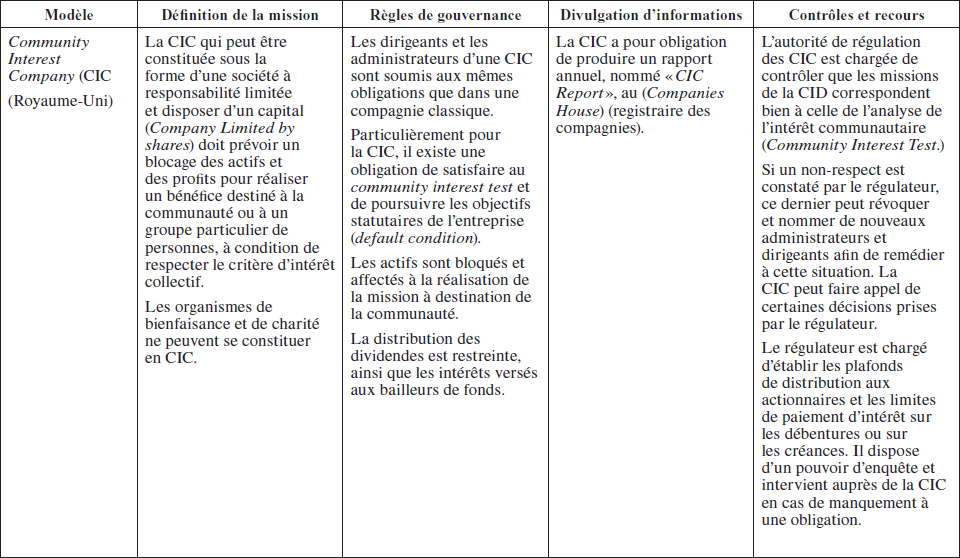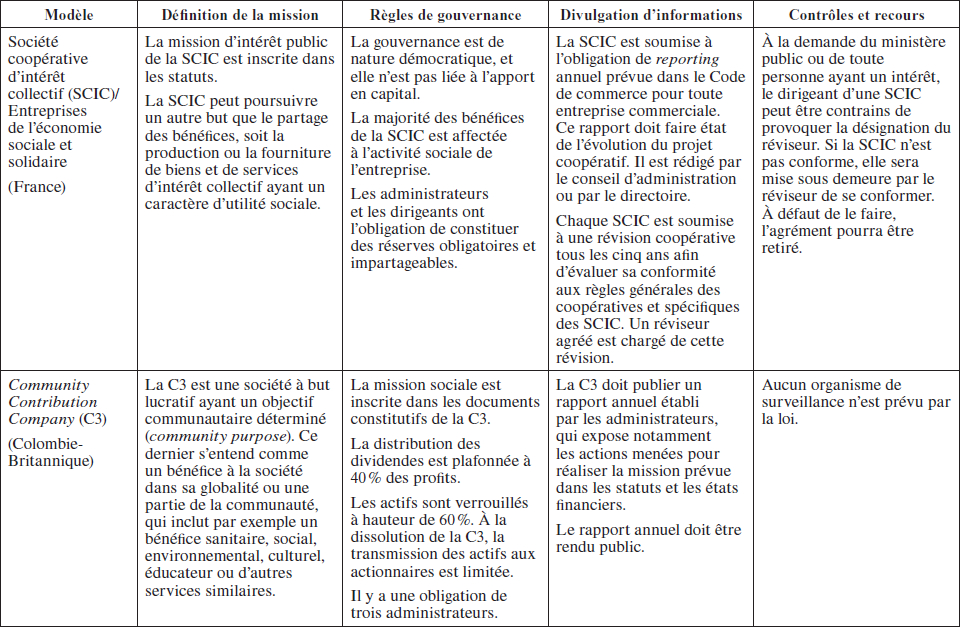Abstracts
Résumé
Au cours des dernières décennies, le capitalisme n’a cessé de transformer le marché, bouleversant chaque fois un peu plus les concepts pourtant acquis des économistes et des juristes du monde des affaires. En dépit du progrès qu’elle occasionne, la financiarisation a mené à des scandales financiers et à des crises économiques majeures en 2000 et en 2007-2008 dont les effets sont encore palpables. Aujourd’hui, une autre financiarisation laisse progressivement son empreinte sur le droit des sociétés par actions et des marchés. Or, le droit s’adapte à ces changements d’orientation qui traversent les entreprises et la finance, celles-ci se montrant de plus en plus soucieuses de leur incidence sur la société. Une des plus récentes évolutions juridiques à cet égard est la création de statuts juridiques propres à certaines entreprises « hybrides » : les entreprises à mission sociétale. L’émergence de ce type d’entreprise donne de la dureté à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et procure une garantie de réalité derrière l’image de la vertu sans constituer pour autant une rupture de l’état du droit. La conception de l’entreprise telle qu’elle a longtemps été admise est par là même révolutionnée. Un pont entre le modèle libéral capitaliste et le modèle alternatif de l’économie sociale est donc en construction. Plus globalement, les dispositions légales se modernisent pour répondre à une demande croissante et permettent d’envisager de nos jours l’avènement d’une économie nouvelle en quête de plus de social et d’éthique. À cette fin, les acteurs de la finance, notamment sociale, poussent à la transformation des outils financiers pour générer un rendement social plutôt que strictement monétaire.
Abstract
In recent decades, capitalism has constantly transformed the market, changing the concepts relied on by economists and business lawyers. Financialization, despite the progress it has engendered, has led to multiple financial scandals and a major economic crisis whose effects are still visible. Today, another type of financialization is gradually leaving its mark on corporate and market law. The law must now adapt to changing corporate and financial trends that increasingly focus on the impact on society. One of the last significant legal evolutions of this change is the creation of a new legal status for certain companies referred to as “hybrids”. The emergence of the hybrid enterprise (even if it blurs the situation) adds resilience to CSR and a guarantee of reality behind the image without constituting a fundamental break in the state of law. The concept of the company as it has been accepted for several decades is considerably revolutionized. A bridge between the liberal capitalist model and the social economy is under construction. More generally, the legal provisions are being modernized to meet a growing demand and make it possible, today, to consider the advent of a new economy with a more social and ethical aim. For this purpose, social finance actors are pushing for the transformation of financial instruments to generate social rather than monetary returns.
Resumen
En las últimas décadas, el capitalismo no ha dejado de transformar al mercado, y cada vez ha logrado conmocionar un poco más los conceptos, que sin embargo, han sido apropiados tanto por los economistas como por los juristas de negocios. A pesar del progreso que ha logrado, la financiarización ha conllevado a escándalos financieros y a una crisis económica mayor en el año 2000 y durante los años 2007 y 2008, cuyas secuelas son todavía palpables. Hoy en día, otra financiarización ha dejado de manera progresiva su huella en el derecho de sociedades por acciones y en los mercados. Ahora bien, el derecho se ha adaptado a estos cambios de orientación que atraviesan las empresas y las finanzas, y que parecen estar cada vez más preocupadas por el impacto que causan en la sociedad. Una de las últimas evoluciones jurídicas de este cambio es la creación de estatus jurídicos propios de algunas empresas « híbridas » : las empresas con una misión social. El surgimiento de la empresa con una misión social ha otorgado fortaleza a la RSE y una garantía de realidad tras la imagen de la virtud, sin que esto constituya una ruptura del estado de derecho. Se ha revolucionado la concepción de la empresa tal cual y como ha sido aceptada desde hace mucho tiempo. Se está construyendo un puente entre el modelo liberal capitalista y el modelo alternativo de la economía social. De manera global, las disposiciones legales se modernizan para así responder a una demanda creciente y que permite hoy en día considerar la llegada de una nueva economía que busca más el aspecto social y la ética. Con este fin, los actores de las finanzas particularmente sociales, incentivan la transformación de las herramientas financieras para generar un rendimiento social, en lugar de uno estrictamente monetario.
Article body
Incroyable ! Je suis riche ! Tout m’appartient ! L’argent, tout le village, les maisons, l’atelier, la boulangerie… Je suis seul !
Le schtroumpf financier[1]
Dès la fin du xxe siècle, l’économie a pris un tournant majeur qui a placé le calcul financier au coeur des sphères privée et sociale[2]. L’orientation des stratégies de gouvernance d’entreprise vers la primauté actionnariale[3] a alimenté le phénomène de financiarisation, qui a dominé le monde des affaires jusqu’à la récente crise financière[4]. Aujourd’hui, la financiarisation peut être vue comme « the tendency for profit making in the economy to occur increasingly through financial channels rather than through productive activities[5] ». Dans cette logique court-termiste[6], qui découle souvent de l’action même des dirigeants[7], l’innovation et les investissements à long terme ont été freinés, notamment sous l’effet des investisseurs institutionnels et de leurs exigences accrues[8]. Le retour rapide sur investissement a largement primé l’investissement stratégique[9]. De leur côté, les objectifs des entreprises ont été orientés pour assurer un retour financier conséquent aux actionnaires. La substitution de l’actionnariat individuel par une gestion collective des investisseurs institutionnels (fonds de pension, fonds d’investissement, sociétés d’assurance, fonds de couverture) a exercé une influence en ce sens : « [W]e have moved from shareholder towards investor capitalism[10]. » Alors que l’entreprise a longtemps été caractérisée par une perméabilité à des préoccupations liées à l’intérêt des tiers et à l’intérêt général, l’ère d’un capitalisme de masse érigeant l’intérêt patrimonial du petit porteur, qui se trouve promu au rang de valeur supérieure par le canal du droit financier, a succédé à cette époque[11].
Bien que les effets de la financiarisation se fassent ressentir depuis plusieurs décennies, sa théorisation est pourtant plus récente, certainement précipitée par l’effondrement banquier et financier de 2007-2008[12]. Au coeur de la financiarisation se situe la théorie de l’agence[13]. Dans cette théorie économique, l’entreprise est perçue comme un « “noeud de contrats” entre les détenteurs de facteurs de production (notamment les actionnaires) et les autres agents (notamment les managers)[14] ». Cet agent, qui agit alors en tant qu’homo economicus, maximise ses propres intérêts en établissant une frontière entre les sphères économique, éthique et sociale[15]. La valeur des actions et la préservation des avoirs des actionnaires sont ainsi priorisées, ce qui permet à l’entreprise de conserver la source importante de financement que constitue l’apport des actionnaires[16]. Comme l’a affirmé la jurisprudence américaine dans l’emblématique décision Dodge v. Ford Motor Co., la raison d’être de l’entreprise a longtemps reposé sur la norme de la suprématie de l’actionnaire (shareholder primacy norm)[17] qui s’est imposée comme dogma[18]. Ce dogme s’est appuyé sur une certaine logique. Dans la théorie positive de l’agence, les actionnaires sont les créanciers résiduels qui supportent le risque entrepreneurial[19]. En outre, ils prennent un risque : celui de ne pas être payés[20]. En tant que propriétaires capitalistes, les actionnaires sont donc les meilleurs garants de la bonne gestion de l’entreprise. Le risque qu’ils courent légitime le pouvoir de contrôle qu’ils revendiquent, mais « [i]t is however important to understand shareholder value as part and parcel of a broader process towards a radically financialized corporate culture and form of corporate governance[21] ». Ainsi, la montée en puissance de la mondialisation a entraîné une régulation de l’économie par les acteurs eux-mêmes, ce qui a mené à un édifice normatif composé essentiellement de droit souple (soft law). La financiarisation s’est traduite par un environnement économique déréglementé, source de l’adoption de règles plus souples, et celles-ci ont favorisé des montages financiers qui se sont complexifiés et qui ont rendu possible une dissémination du risque à l’échelle mondiale[22]. Les mécanismes et les institutions ont fait dès lors de la finance un secteur à part entière, désincarné du reste de l’économie et, plus largement, du droit[23]. Le modèle anglo-saxon de la primauté actionnariale illustre et croise les intérêts prônés par cette idéologie[24] : la place centrale accordée aux actionnaires et relayée par les dirigeants d’entreprise — qui profitent de la prospérité temporaire des premiers pour généreusement se rémunérer, notamment par l’octroi d’options sur actions (stock options)[25] — a conduit à une recherche de la maximisation des profits[26]. De facto, de nouvelles normes de gestion se sont imposées[27] qui ont leur propre mérite (celui de la simplicité[28]) : « [A] short-term agenda has been imposed on corporation[29]. » En réalité, le capitalisme a changé de nature pour devenir patrimonial, institutionnel ou encore actionnarial, avec un seul objectif : atteindre un rendement financier[30].
Au regard de ces pratiques contestables[31], les pathologies du système néolibéral se sont peu à peu révélées. Les cas d’Enron ou de WorldCom ont contribué à une prise de conscience majeure des conséquences d’une action des dirigeants orientée à court terme (action allant parfois à l’encontre même de la gouvernance d’entreprise)[32], voire à une remise en cause de la légitimité de l’entreprise en tant que telle. Il a fallu repenser le rôle de cette dernière pour regagner la confiance des parties prenantes. Déjà fortement présente dans la doctrine, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) s’est positionnée en tant que solution à ces problématiques. Dans un contexte d’économie financiarisée encore bercée par des normes souples, la RSE s’est intégrée dans ce modèle non contraignant. Peu à peu, la primauté actionnariale a ouvert la porte à des engagements volontaires des entreprises prenant en considération les intérêts des parties prenantes et intégrant des préoccupations sociales et environnementales dans les processus décisionnels, tout en dépassant les obligations légales qui s’imposaient déjà aux entreprises[33]. Dans le même temps, les investisseurs ont adopté une vision élargie de l’économie et ont intégré une dimension non marchande échappant a priori à l’économie[34] dans leurs décisions financières[35]. Cet objectif de création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes avait pourtant déjà été consacré par la jurisprudence canadienne avant que survienne la crise[36]… mais sans doute n’a-t-elle pas été assez entendue. Pourtant, l’entreprise se responsabilise aujourd’hui[37] et tente de répondre aux préoccupations exprimées par les parties prenantes[38]. Sa finalité se trouve redéfinie (bien au-delà du droit[39]), et la responsabilité des administrateurs évolue en même temps. Celle des actionnaires, notamment en matière de RSE, s’invite aussi de plus en plus dans les discussions[40]. À l’image des concepts élaborés par Jacques Defourny et Marthe Nyssens, la financiarisation a mené à la confrontation entre une économie « arrivée », s’intéressant au rendement financier, et une économie « arrivante », portée par la finance sociale[41], ses innovations et son ambitieux objectif d’effet positif pour la société et les parties prenantes[42].
Durant les trois dernières décennies, la financiarisation a donc transformé l’entreprise[43]. Une gouvernance guidée par les nombres s’est imposée graduellement[44]. Plutôt qu’une crise conjoncturelle, il faut entrevoir une crise structurelle qui amène à repenser les modèles d’affaires et le système socioéconomique dans sa globalité[45]. En effet, l’intégration des préoccupations extrafinancières sur la base d’une démarche volontaire des entreprises n’a pas eu l’effet escompté. Les grands enjeux sociaux et environnementaux n’ont su trouver de réponses efficaces, et le manque d’éthique des entreprises a refait surface dans leurs gouvernances. Malgré un retrait de l’État, les autorités publiques ont dû réglementer la RSE[46]. Par exemple, la France a adopté des lois en matière de divulgation extrafinancière des entreprises cotées et non cotées[47], et elle a mis en place un devoir de vigilance[48]. Le Canada a récemment fait évoluer sa jurisprudence au travers de décisions symboliques[49], ce qui a ainsi remis en question son statut de paradis judiciaire des grandes entreprises[50]. Se multiplient parallèlement les recommandations et les guides sur la nature des informations que devraient divulguer lesdites entreprises[51]. Pourtant, les recours offerts aux parties prenantes qui pourraient être lésées par un manquement à des engagements volontaires sont peu dissuasifs envers les dirigeants et les administrateurs qui ne les respecteraient pas. Pour démontrer son engagement et sa vocation, une entreprise qui souhaite dépasser ses obligations fiduciaires, tout en réalisant des profits, peut se tourner vers une solution nouvelle : l’entreprise à mission sociétale[52]. Nées en Europe dès la fin du xxe siècle, ces sociétés par actions à but pourtant lucratif ont pour particularité d’inscrire dans leurs statuts juridiques une mission sociale. Désignées aussi par les expressions « société à objet social étendu[53] » ou « entreprise à mission[54] », ces sociétés ont une vocation qui n’est plus uniquement de verser des dividendes. En vue de parvenir à accomplir leur mission, elles écartent les principes du capitalisme contemporain pour laisser place à des considérations sociales, économiques et de gouvernance qui évoquent, par exemple, la constitution de réserves impartageables, un niveau significatif de risque économique et une gouvernance participative[55] :
[À cette fin,] les résultats financiers dégagés doivent être partagés équitablement entre les différentes parties prenantes. Les objectifs financiers ne doivent pas être atteints par de la spéculation sur les marchés financiers, mais par le financement de l’économie réelle. Pour résoudre les conflits d’agence, leur gestion repose sur les principes fondamentaux de transparence et de gouvernance[56].
Progressivement, l’entreprise à mission sociétale prend sa place dans l’économie. Après avoir séduit la Belgique, l’Angleterre et la France, elle a atteint le continent nord-américain. Tant aux États-Unis qu’au Canada, elle a su convaincre certains législateurs. Outre qu’elles offrent aux entrepreneurs une chance de se protéger contre une éventuelle crise, les entreprises à mission sociétale (et les instruments de la finance sociale) connaissent une croissance supérieure à celles du secteur privé[57].
Les entreprises à mission sociétale ne peuvent être pensées isolément. Alors que la financiarisation de l’économie avait pour objet une accumulation du capital, la finance sociale et ses acteurs cherchent à maîtriser les mécanismes financiers en vue d’atteindre un certain rendement social, dont le capital pour l’investisseur est plus symbolique que monétaire, voire plus expressif qu’utilitaire[58]. La recherche de rendement social devient alors impérative pour apporter de la viabilité au nouveau modèle économique qui émerge. Ses caractéristiques favorisent une stratégie à long terme des entreprises de la finance sociale, à l’inverse de la « dictature des actionnaires » et du retour rapide sur investissement[59]. Cette finance, également appelée « positive », cherche à créer de la valeur pour la société et pour l’ensemble des parties prenantes à travers des investissements à portée sociale et environnementale qui influent sur la gouvernance et l’éthique du capitalisme afin de construire un capitalisme dit « patient[60] ». C’est dans ce débat que l’investissement à impact social (impact investing) et le contrat à impact social (social impact bonds) apparaissent. L’objectif de notre étude est non seulement d’éclairer sous l’angle juridique de nouveaux concepts (entreprises à mission sociétale, contrats à effet social, investissements à impact social, engagement actionnarial, etc.), mais encore de proposer une relecture de notions plus connues que l’on pensait bien établies (finalité de l’entreprise, investissement socialement responsable, etc.). Notre article trace ainsi un portrait des évolutions récentes, ainsi que de celles qui sont actuellement discutées, en y apportant un regard critique. La comparaison des positions réglementaires entre l’Amérique, l’Europe et certains de ses États (France et Royaume-Uni notamment) offre des éléments de réflexion précieux pour le législateur canadien sur la pertinence de sa position actuelle et la nécessité de faire évoluer le paysage juridique afin d’apporter une réponse appropriée à la financiarisation.
Le monde de l’entreprise est en plein questionnement sur sa raison d’être : « Si l’on définissait l’entrepreneur de manière plus large, nous pourrions changer le visage actuel du capitalisme, et résoudre les problèmes sociaux et économiques dans le cadre du libre marché[61]. » Après les multiples remises en question provoquées par une financiarisation non régulée, l’urgence est aujourd’hui celle d’une transformation profonde de la gouvernance d’entreprise et des modèles d’affaires[62]. En parallèle, la RSE, longtemps laissée aux mains du marché et de son autorégulation, se judiciarise progressivement[63], même si le chemin se révèle encore long. Le droit est sollicité en vue d’offrir aux entrepreneurs des outils pour mener à bien leur mission et mettre à profit les mécanismes financiers traditionnels dans le but d’avoir une incidence positive sur la société : « Si le mouvement général des sociétés développées a poussé à son paroxysme la logique de l’homo economicus, il est impératif de s’interroger sur l’avenir éthique de nos sociétés et de replacer l’Homme et l’Humanité au centre des valeurs de la Société[64]. » Dans ce contexte, l’entreprise à mission sociétale donne aux entrepreneurs sociaux un véhicule innovant, qui soulève néanmoins des incertitudes juridiques (partie 1). Une évaluation des résultats obtenus ou à atteindre est nécessaire pour rendre des comptes aux investisseurs. Cependant, elle repose sur des indicateurs parfois peu adaptés à de tels enjeux. Pour accéder au financement, les entrepreneurs sociaux ont dû innover. Le contrat à impact social, qui connaît de plus en plus de succès et qui est progressivement reconnu par les législateurs dans le processus de modernisation de l’économie vers des pratiques responsables, illustre cette innovation[65]. Il en va de même de l’investissement à impact qui permet de réorienter l’investissement en faveur de projets sociétaux et qui s’inscrit dans une perspective à long terme (partie 2). Nous conclurons nos propos en rappelant que le droit des sociétés par actions et des marchés de part et d’autre de l’Atlantique innove et favorise l’émergence d’une financiarisation sociale avec pour coeur la RSE.
1 L’entreprise à mission sociétale : véhicule privilégié de la finance sociale
Afin de pallier la séparation entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif, l’entreprise à mission sociétale s’impose comme une alternative prometteuse en Europe (1.1) et en Amérique du Nord (1.2). L’entreprise à mission sociétale, par sa finalité et son intégration d’enjeux nouveaux, s’éloigne en effet des considérations financières ayant longtemps dominé la philosophie entrepreneuriale. Dans ce contexte, le débat entourant l’intérêt social des entreprises a refait surface au sein d’une doctrine depuis longtemps divisée sur le sujet (1.3).
1.1 Les modèles européens de l’entreprise à mission sociétale
L’entreprise à mission sociétale est d’abord née en Belgique en 1995. La société à finalité sociale (SFS) a vu le jour alors qu’un vide juridique persistait entre les secteurs lucratif et non lucratif. Consacrée dans le Code des sociétés, cette structure est une modalité organisationnelle pour toutes les formes d’entreprises. Afin de combler l’interdiction d’activité lucrative des associations, la SFS propose le meilleur des deux mondes aux entrepreneurs. À partir de ce modèle juridique, les chercheurs du réseau consacré à l’émergence de l’entreprise sociale (EMES) ont mis au point une catégorisation de l’entreprise sociale. Trois indicateurs sont nécessaires à cette qualification (voir le tableau 1).
Tableau 1
Les indicateurs de l’organisation d’économie sociale et solidaire
L’innovation réside principalement dans l’inscription statutaire de la mission sociale de l’entreprise. Avec cette inscription, l’entreprise à mission sociétale oriente son objet social vers des objectifs autres que le retour sur investissement. Au Royaume-Uni, dans un contexte où la culture du « sans but lucratif » (nonprofit) est bien ancrée dans l’économie, la société d’intérêt communautaire (community interest company ou CIC) a été créée en 2005 par une modification apportée à la Companies Act of 2004[66]. Cette société à mission sociétale trouve son fondement dans le droit des sociétés par actions, puisque la CIC doit revêtir soit la forme d’une société par actions, soit la forme d’une société à responsabilité limitée par garantie. Pour contrôler la mission d’intérêt général qu’elle doit poursuivre, la CIC est soumise au CIC Regulator (The Office of the Regulator of Community Interest Companies). La CIC est considérée à l’heure actuelle comme la forme à mission sociétale la plus solide d’Europe[67]. En France, c’est en 2001 que le législateur a reconnu une possibilité identique avec la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Grâce à la réforme en 1947 de la Loi sur les coopératives[68], une société anonyme ou une société à responsabilité limitée peut se constituer en SCIC. Les règles de gouvernance ont été adaptées pour consacrer le principe « Un homme, une voix » malgré une pondération des voix dépendant de la qualité et de la contribution des associés à l’activité de la structure[69]. La gouvernance de la SCIC est avant tout partenariale : elle octroie une place aux parties prenantes dans la prise de décisions[70]. Avec la législation propre à l’économie sociale et solidaire de 2014 ainsi que la création de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)[71] », les entreprises lucratives sont de plus en plus reconnues comme des acteurs de la socialisation de l’économie et de l’investissement en France[72]. À ce titre, les récentes discussions sur le sujet montrent clairement une volonté politique d’élargir le rendement au-delà du retour financier. Le projet de loi français du Plan d’action pour la croissance et la transformation de l’économie déposé en 2018 a pour objet de contrer les effets de la financiarisation avec l’avènement des sociétés à mission[73]. Ces évolutions traduisent la nécessité de repenser la finalité de l’entreprise, impératif d’autant plus important que le cloisonnement des branches du droit a conduit à une neutralisation de l’intérêt de certaines parties prenantes[74] et à une prise en considération insuffisante des objectifs sociaux et environnementaux.
1.2 Les modèles nord-américains de l’entreprise à mission sociétale
Plus récents que leurs homologues européens, des modèles d’entreprises à mission sociétale nord-américaines ont été récemment mis en place[75]. S’ajoutant au B Lab (organisation privée sans but lucratif), la certification B Corp permettait déjà aux entreprises d’inscrire une mission sociale dans leurs statuts pour faire apparaître les préoccupations extrafinancières dans les décisions d’affaires. La philosophie de cette association sans but lucratif est la suivante : « power of business [can] solve social and environmental problems[76] ». La B Corp reflète la volonté d’individus qui ont essayé d’apporter une réponse à un vide juridique, et ce, pour rediriger les capitaux vers des projets en rapport avec l’effet social. Les États américains se sont intéressés à cette nouvelle voie de l’entrepreneuriat. En 2010, le Maryland a adopté la benefit corporation[77], structure juridique fortement inspirée de la certification B Corp. La finalité de l’entreprise est de générer du « general public benefit[78] » par l’entremise d’un ou de plusieurs bénéfices publics. Les parties prenantes sont intégrées dans le processus décisionnel, malgré leur manque de recours juridiques directs contre les administrateurs[79]. À l’été 2013, l’État du Delaware a opté pour ce modèle[80], ce qui a contribué au succès qu’a connu par la suite la benefit corporation[81]. Toutefois, le modèle d’entreprise à mission sociétale est peu flexible. Lorsque l’entrepreneur choisit cette forme sociétaire, il doit se conformer à plusieurs exigences. Mais, l’obligation de prise en considération des parties prenantes ne fait peser sur les administrateurs qu’une obligation de moyens[82]. Comme tous les modèles, la benefit corporation est soumise à une obligation de divulgation extrafinancière. Toutefois, à l’inverse de la société à finalité sociale (social purpose corporation), autre forme d’entreprise à mission sociétale américaine consacrée par la Californie, seul État américain à avoir choisi cette structure, l’unanimité des actionnaires est requise pour modifier la mission statutaire de cette entreprise. La social purpose corporation présentant des règles de gouvernance moins strictes, la protection de la mission sociale y est donc moins forte que dans la benefit corporation. En ce sens, la prise en considération des parties prenantes n’est pas une obligation, mais seulement une possibilité pour les administrateurs et les dirigeants ce qui leur permet de s’écarter de l’objectif de rentabilité financière. Pour une modification des statuts, l’accord des deux tiers des actionnaires est requis[83].
Certaines provinces canadiennes se sont inspirées de leur voisin du sud pour bâtir leurs propres modèles d’entreprise à vocation sociale[84]. À l’instar du Delaware, la Colombie-Britannique a opté en juillet 2013 pour la société à contribution communautaire (community contribution company ou C3) en modifiant la Business Corporations Act[85]. La C3 a trois caractéristiques majeures qui la différencient des formes de sociétés à but lucratif traditionnelles : l’importance d’un objectif communautaire, la restriction au versement de dividendes et le verrouillage des actifs. L’objectif du législateur était de limiter les retours financiers sur investissement. Le ministre des Finances a alors affirmé que, au-delà du bénéfice public que devait engendrer la C3, la loi entendait limiter le rendement financier des investisseurs[86]. La Nouvelle-Écosse est la seconde province à avoir fait ce choix d’entreprise. En 2016, la Community Interest Companies Act[87] a institué la CIC selon un régime analogue à celui de la C3. La nouveauté réside dans la création d’un organisme de régulation. En effet, la Nouvelle-Écosse a mis au point un registre des sociétés d’intérêt communautaire (registrar of community interest company) chargé d’admettre les entreprises à ce statut, de surveiller le respect de ses obligations et de sanctionner, par une dissolution judiciaire, les entreprises qui ne se conformeraient pas aux exigences réglementaires[88]. Récemment, la Colombie-Britannique a fait un pas supplémentaire en faveur d’un nouveau modèle d’entreprise à mission sociétale en déposant en mai 2018 un projet de loi (Bill M 216) consacrant une structure proche de la benefit corporation américaine : la benefit company[89]. Alors qu’une restriction au versement de dividendes et un verrouillage des actifs s’ajoutent à la définition d’une mission plus inclusive dans le modèle de la C3, aucune disposition équivalente ne figure dans le projet de loi qui impose essentiellement la définition d’une mission ouverte à la société par actions.
Divers modèles d’entreprises à mission sociétale émergent donc dans la législation des États. Ces entreprises doivent assumer une double vocation inédite dans le monde entrepreneurial traditionnel : avoir une activité lucrative, tout en limitant la distribution de dividendes, et ce, pour servir une politique de réinvestissement d’une partie des profits dans une mission sociale. Alors que les conceptions capitalistes de l’entreprise avaient tendance à s’opposer à une conception à long terme, désormais, l’entreprise se pérennise et se responsabilise. La loi, en permettant la constitution des entreprises sociales et en prévoyant une limitation de la distribution des bénéfices, s’inscrit dans une logique contraire à celle de la financiarisation. Plus que jamais, les mécanismes financiers sont utilisés pour produire non pas du profit, mais de la valeur « sociale » qui fait ressentir ses effets positivement sur la communauté. La théorie du contrat social[90], qui accorde un rôle économique et social à l’entreprise, avait déjà légitimé les obligations de RSE[91] : ce contrat trouve maintenant un champ d’application nouveau. Afin d’optimiser leur poids social, les acteurs de la finance sociale mobilisent désormais les instruments financiers traditionnels en les orientant vers une nouvelle vocation extrafinancière.
1.3 La redéfinition de la finalité de l’entreprise
Les entreprises à mission sociétale remettent en cause les acquis du droit des sociétés. Ainsi, la conception « capitaliste » de l’intérêt social, qui pouvait se prévaloir de la finalité originelle de la société commerciale historiquement conçue comme un instrument de rassemblement des capitaux[92], change progressivement[93]. Notion fondamentale des sociétés, l’intérêt social est la boussole des administrateurs et des dirigeants pour prendre leurs décisions d’affaires et du juge pour trancher les intérêts en présence et apprécier l’excès ou le détournement de pouvoirs entachant une décision[94]. Les tribunaux et une partie de la doctrine se réfèrent à une conception plurielle de l’intérêt social[95] et en font un vecteur de la RSE[96]. Rappelons que la société par actions n’est pas qu’un pur produit financier, car elle fournit une armature juridique à l’entreprise[97], des résultats desquels dépend la possibilité de distribuer des revenus sous la forme de dividendes ou autrement[98]. Bien que l’entreprise en tant que telle n’existe pas en droit[99], ou si peu[100], cette autre financiarisation (et les nouvelles préoccupations qu’elle place en son centre) entraîne une redéfinition de sa finalité[101].
Alors qu’aux États-Unis la jurisprudence a reconnu une place centrale aux actionnaires[102] et que la France semble avoir cristallisé sa conception dans un code civil quasi intouchable, cette vision est peu à peu rejetée[103]. Aux États-Unis, l’affaire Smith Manufacturing v. Barlow[104] démontre que les juges avaient déjà compris dès 1953 que le but de l’entreprise était de prospérer à long terme et que, en ce sens, les actionnaires devaient tenir compte de cette réalité. Une telle vision a été réaffirmée par les juges de la Cour du Delaware dans l’affaire Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V. v. Pathé Communications Corp. Ils ont considéré que les devoirs des dirigeants imposent une obligation envers la communauté d’intérêts qui soutient l’entreprise[105]. De plus, les juges, au-delà du fait de ne jamais avoir sanctionné une décision faisant primer les parties prenantes au détriment des actionnaires, ont admis que des objectifs à long terme s’imposent devant des décisions court-termistes hasardeuses[106]. Certains experts relèvent finalement que « directors’ supposed duty to “maximize” shareholder wealth is a toothless one. No courts actually require management to maximize shareholder wealth[107] ». En France, les juges ont aussi rendu quelques décisions intéressantes, même si elles demeurent peu nombreuses. Dans l’arrêt Fruehauf de 1965[108], l’intérêt de l’entreprise ne protège pas seulement les intérêts catégoriels, mais aussi ceux de la société elle-même en ce qui concerne sa pérennité, sa stabilité et son bon fonctionnement[109]. Bien que cet arrêt soit demeuré isolé[110], le débat français sur l’intérêt social ne rejette pas la conception élargie[111]. À titre d’illustration, le professeur Jean-Jacques Daigre voit dans l’intérêt social « l’intérêt supérieur de l’entreprise dépassant les intérêts catégoriels de tous ses membres[112] ». Comme le précise François-Guy Trébulle, « valeur actionnariale contre responsabilité sociale de l’entreprise, le choc est frontal et assumé, mais certains dessinent les contours d’une voie médiane accordant une place centrale à la société prise dans la richesse de sa personnalité morale[113] ». La « troisième » voie de l’économie est prise de plus en plus au sérieux par les États, ainsi que le montrent les débats européens. Avec le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) dévoilé le 22 octobre 2017, le législateur français souhaite réformer le Code civil en en réécrivant les articles 1832 et 1833 dans le but de « neutraliser ou [de] sanctionner des actes préjudiciables à la société, voire susceptibles de compromettre son existence même[114] ». De l’autre côté de la frontière française, en Belgique, la discussion est tout aussi vive. La décision de première instance dans l’affaire Fortis[115] et certaines positions doctrinales[116] confirment que l’assimilation de l’intérêt social à celui des actionnaires n’est pas une évidence. À l’échelon européen, la signification de l’intérêt social se révèle également source de discussions. Dès 2003, une communication de la Commission européenne sur la modernisation du droit des sociétés[117] a affirmé que le rôle des administrateurs indépendants n’était pas uniquement de privilégier la valeur actionnariale, et qu’il importait d’assurer une protection appropriée des tiers pour protéger les intérêts des actionnaires et des parties prenantes[118]. Les États membres ont suivi cette ligne de conduite et ont progressivement intégré la prise en considération de parties prenantes dans leur droit national. Un guide publié conjointement par la Confédération européenne des associations d’administrateurs (European Confederation of Directors’ Associations ou ecoDA) et la Société financière internationale (International Finance Corporation ou IFC) souligne ceci :
The role of stakeholders (employees, financiers, suppliers, local communities, and government) varies considerably across companies, sectors, and countries. In some European countries, the rights of stakeholders are enshrined in company law or other related legislation, such as codetermination and employment-protection legislation. By contrast, companies in other countries have a tradition of focusing more narrowly on the interests of shareholders[119].
Si le Canada a développé une attitude proche de celle qui règne aux États-Unis[120], la vision plurielle de l’intérêt social y est couplée à l’existence de règles protégeant les parties prenantes. D’abord, sur la base d’une jurisprudence récente, toute décision d’affaires qui occasionnerait des dommages aux parties prenantes pourrait être sanctionnée sur le fondement d’une violation au devoir de loyauté des administrateurs[121]. La Cour suprême du Canada, dans un arrêt de principe, a consacré cette vision. Dans l’affaire Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, elle considère en 2004 qu’« il est évident qu’il ne faut pas interpréter l’expression “au mieux des intérêts de la société” comme si elle signifiait simplement “au mieux des intérêts des actionnaires”. D’un point de vue économique, l’expression “au mieux des intérêts de la société” s’entend de la maximisation de la valeur de l’entreprise » et que, « pour déterminer s’il agit au mieux des intérêts de la société, il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des circonstances dans un cas donné, de tenir compte notamment des intérêts des actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de l’environnement[122] ». Cette position jurisprudentielle a été réaffirmée et renforcée en 2008 par la décision BCE inc. c. Détenteurs de débentures de 1976[123]. Ensuite, le droit canadien connaît de nombreuses dispositions statutaires qui conduisent à sanctionner les comportements qui occasionnent des dommages aux parties prenantes[124] et il a été, à ce titre, pionnier « among the common law jurisdictions to include non-shareholder groups in the framework of corporate law[125] » au travers de l’attribution aux parties prenantes de recours tels que le recours oblique[126] ou celui en oppression (aussi appelé recours en « redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité[127] »). Bien que dans ces cas les intérêts des parties prenantes soient reconnus a posteriori, des lacunes persistent. En effet, la Cour suprême « par omission ou inadvertance […] ne remédie pas aux lacunes de la [Loi canadienne sur les sociétés par actions] en matière de recours[128] ». L’effectivité de cette reconnaissance reste donc contestable tant les parties prenantes ne se voient pas protégées par l’existence de recours spécifiques qui leur seraient ouverts[129].
Ainsi, l’autre financiarisation conduit à repenser la conception de l’entreprise[130] et le droit des sociétés par actions (dans ses mutations contemporaines) y contribue. Ce dernier reconnaît désormais que la gouvernance d’entreprise doit établir un équilibre entre la recherche de la maximisation du retour financier au profit des actionnaires et la prise en considération de l’intérêt des autres parties prenantes[131].
2 Le rendement social attendu des instruments financiers
De nos jours, l’investissement à impact social et le contrat à impact social placent les investisseurs institutionnels devant leur responsabilité en les rendant coresponsables d’un monde économique et financier à la stabilité relative et à l’intégrité duquel ils ont un intérêt vital. Après avoir présenté le concept d’investissement à impact social et sa croissance continue au Canada et ailleurs (2.1), nous détaillerons les contrats à effet social (2.2).
2.1 L’investissement à impact social
L’investissement à impact social est apparu récemment dans la littérature et dans les pratiques. Pourtant, le concept a émergé dès les années 90. Il prendra une ampleur considérable lorsqu’en 2007 la Fondation Rockefeller l’emploiera pour inviter les leaders de la finance, de la philanthropie et du développement à générer un retentissement positif sur la société et l’environnement[132].
L’émergence de ces considérations a d’abord pris racine dans l’investissement socialement responsable (ISR), investissement individuel ou collectif intégrant les critères économiques, sociaux et de gouvernance[133]. L’ISR s’est métamorphosé progressivement pour devenir une véritable philosophie suivie par des institutions au poids financier non négligeable[134]. Cet investissement, dit durable ou éthique[135], a légitimé sa place dans la sphère financière en se structurant, en s’institutionnalisant et en étant notamment encouragé par les pouvoirs publics[136]. Au Québec, pendant la seule période 2013-2016, l’investissement responsable a connu une hausse de 26 %, et la finance solidaire, une progression de 32 % (voir le tableau 2)[137]. En 2016, la Responsible Investment Association a recensé un total de 2 milliards de dollars investi dans les fonds d’investissement à impact social pour le Canada[138].
Tableau 2
L’investissement responsable au Québec de 2013 à 2016
* Les montants d’actifs et d’investissements de 2013 ont été rétroactivement modifiés pour la présente édition du portrait. Nous avons reconsidéré la couverture des actifs et des investissements inclus dans notre enquête, tout particulièrement ceux provenant des sociétés d’État (Investissement Québec et Fonds d’investissement pour la culture et communication). Comme vu précédemment, la frontière entre le capital de développement et la finance solidaire est mouvante. Aussi, nous avons profité de ce nouveau portrait pour reclasser certaines institutions entre les deux composantes de l’investissement responsable, plus spécifiquement les fonds locaux de solidarité.
En tant qu’approche financière de la RSE, l’ISR n’est plus extérieur au droit[139], ce qui est à signaler tant des études démontrent que l’avenir de ce type d’investissement dépend de l’intervention gouvernementale et de la redéfinition de la régulation en ce domaine[140] : « Failing to consider long-term investment value drivers, which include environmental, social and governance issues, in investment practice is a failure of fiduciary duty[141]. » Récemment, l’Union européenne a fait part de son voeu d’aller plus loin par la voix du High-Level Expert Group on Sustainable Finance qu’elle chapeaute en proposant de clarifier les devoirs des investisseurs ainsi que de mieux embrasser l’horizon à long terme et les préférences pour la durabilité : « Explicitly linking the duties of investors to the investment horizons and sustainability preferences of the individuals and institutions they serve is key to achieving a more sustainable financial system. An EU omnibus proposal would ensure that this change takes place simultaneously across the entire investment chain[142]. »
La particularité des ISR repose sur un système d’exclusion en fonction des critères économiques, sociaux et de gouvernance. En comparaison, l’investissement à impact social a une logique plus profonde puisqu’il repose précisément sur l’objectif de résoudre les problématiques sociales et environnementales, selon la taille et la nature des investissements, mais surtout sur le retour de l’investissement prévu et le profil de l’investisseur[143]. Alors que l’ISR allait déjà au-delà des investissements classiques, l’investissement à impact social cherche à créer, volontairement et directement, de la valeur sociale selon trois dimensions : la rentabilité financière, l’effet social et le risque[144]. Considéré comme une démarche active de l’ISR, l’investissement à impact social « seek[s] opportunities for financial investments that produce social or environmental benefits[145] ». Devant les diverses définitions qui figurent dans les textes tant des universitaires que des praticiens, Anna Katharina Höchsdäter et Barbara Scheck ont mené une étude afin de clarifier cette situation terminologique :
[I]mpact investing is generally defined around two core elements : financial return ans some sort of non-financial impact. The return of the invested principal appears to be a minimum requirement. Generally, however, there are no limitations with regard to the expected level of financial return, that is, whether it must be below, at, or above market rates. With regard to the non-financial impact, impact investing is typically defined around a social and/or environmental impact. In addition, a number of definitions further require that the non-financial return be intentional and measurable or measured, respectively[146].
La progression de l’investissement à impact social est impressionnante puisque, pendant la seule période 2013-2015, il a montré une augmentation de 385 %, soit un montant total de 98 milliards d’euros[147]. Dans la sphère entrepreneuriale, ce type d’investissement traduit les engagements de RSE des entreprises commerciales traditionnelles et appuie le développement des entreprises sociales considérées comme des acteurs multidimensionnels créateurs de valeur extrafinancière[148]. En ce sens, certains dirigeants ont d’ores et déjà perçu les avantages à se concentrer sur des biens et des services sociétaux positifs[149]. Au total, 52 p. 100 d’entre eux estiment que les initiatives sur la société réduisent généralement la rentabilité, tandis que 48 p. 100 déclarent que de telles initiatives améliorent les résultats de l’entreprise[150]. Ce constat reste encourageant pour l’avenir de l’investissement à impact social, qui progresse autant dans les mentalités entrepreneuriales que dans les flux financiers, ceux-ci se redirigeant de plus en plus vers des objectifs de rendement social. La financiarisation semble ainsi perdre de son ampleur au profit d’une tentative de répondre aux grands défis du xxie siècle car, « [w]hile the explicit goal to yield a financial return differentiates impact investing from grant funding and philanthropy, the explicit focus on some level of non-financial impact delimits it from traditional investments[151] ».
Toutefois, les dix années d’existence du concept montrent encore qu’il y a des défis de taille à relever. En France, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective souligne dans un document de travail :
-
l’insuffisance de l’intermédiation entre l’offre des investisseurs et la demande de capitaux par les porteurs de projets ;
-
le manque d’outils d’évaluation reconnus pour accroître la transparence des données ;
-
la nécessité de lever les contraintes réglementaires pour favoriser l’investissement social[152].
Par ailleurs, il faut aussi que les grands investisseurs se mettent sérieusement en mouvement[153]. La montée en puissance d’un investissement différent est liée de près à un engagement croissant en vue d’influencer le comportement d’une entreprise à moyen terme et à long terme en faisant valoir l’importance de la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance[154]. Or, d’après une étude de MSCI, les investisseurs institutionnels ne semblent malheureusement pas assez engagés dans la gouvernance des émetteurs. Sur les 2 000 investisseurs institutionnels sollicités par MSCI pour réaliser une étude sur l’application des règles de gouvernance, seule une centaine d’entre eux ont accepté de répondre au questionnaire. MSCI souligne que le faible taux de réponse des investisseurs suggère qu’il existe deux catégories d’investisseurs institutionnels : une minorité d’investisseurs actifs et une majorité d’investisseurs plus passifs dans la gouvernance des sociétés[155].
Une solution est cependant envisageable pour pallier ces lacunes : l’engagement actionnarial[156]. Cette approche permet à l’investissement à incidence sociale de gagner en importance chez les investisseurs. Aujourd’hui, l’engagement s’illustre plus particulièrement au sein de l’investissement socialement responsable, puisque l’investissement à incidence sociale repose sur une sélection d’entreprises en fonction de leur retentissement précis sur la société et l’environnement[157]. Sur les marchés d’actions cotées, l’engagement actionnarial est non seulement une stratégie complémentaire des pressions exercées par les investisseurs, mais il est devenu avec le temps un moyen incontournable de parvenir à obtenir des changements concrets dans l’orientation des stratégies des entreprises[158]. Le rôle des actionnaires prend à l’heure actuelle de plus en plus de place. Alors que la France a adopté récemment la loi dite « Sapin 2[159] » afin d’instaurer un vote contraignant sur la rémunération des dirigeants, deux directives européennes (2007 et 2017[160]) sont venues élargir les droits des actionnaires dans le but de favoriser l’exercice du droit de vote, de leur donner davantage d’informations et de pouvoir, et de développer les interactions entre une société donnée et ses actionnaires[161].
2.2 Le contrat à impact social
Depuis leur création en 2010 au Royaume-Uni, les contrats à effet social (CIS)[162] (social impact bonds[163]) ont permis de faire émerger d’audacieux projets. Par exemple, dans le projet de la prison Peterborough, les capitaux privés ont permis au gouvernement britannique de créer un service de réinsertion des délinquants purgeant de courtes peines dans un contexte de réforme massive du système judiciaire et carcéral[164]. À la fin du mois de juillet 2017, le projet a été qualifié de succès[165]. Cet instrument se définit comme « an innovative financing mechanism in which governments or commissioners enter into agreements with social service providers, such as social enterprises or non-profit organisations, and investors to pay for the delivery of pre-defined social outcomes[166] ». L’investissement de capital est alors utilisé pour répondre à un besoin social dont l’État s’est dessaisi au profit du secteur privé et pour résoudre l’asymétrie croissante entre l’augmentation des obligations gouvernementales et la stagnation des fonds publics[167]. Un tel outil a plusieurs avantages. « Les investisseurs peuvent profiter de manière financière, tout en collaborant au bien-être de la société […] les diverses communautés peuvent en tirer avantage par les progrès sociaux réalisés […] [et] cette méthode de financement permet aux organismes de bienfaisance et aux OBNL d’avoir un accès aux marchés de capitaux », tandis que les contrats à effet social, « s’ils parviennent aux résultats escomptés, permettent la réalisation d’économies au profit des diverses structures gouvernementales[168] ». Les investisseurs ont ainsi entre leurs mains le pouvoir de prévoir des projets à long terme, ce que les gouvernements peinent parfois à garantir. L’avantage majeur pour les institutions publiques réside d’ailleurs dans le fait qu’un contrat à impact social n’est pas une dette publique (public debt) telle qu’elle est couramment appelée dans le milieu financier. En effet, une obligation au sens du terme anglais bond (comme dans l’expression social impact bond) signifie généralement qu’une entreprise ou un organisme public collecte des fonds propres en émettant des titres négociables alors nommés « dette publique » (public debt)[169]. Ce n’est pas le cas avec le contrat à impact social, puisque ce capital de risque est fondé sur un partenariat multipartite[170]. Au Canada, la Saskatchewan est la première province à avoir opté pour ce type de financement[171]. Pour sa part, l’Ontario a mis en place un projet pilote dont elle a tiré quelques enseignements, notamment la grande complexité des enjeux (qui a altéré la fiabilité du projet) et le manque d’accessibilité et de disponibilité des données (qui a empêché de bien connaître les répercussions du projet[172]). Ces constats n’ont pas freiné pour autant l’élan des contrats à effet social, ceux-ci étant désormais présents au Manitoba[173]. D’une façon générale, les contrats à effet social connaissent un essor dans le monde (voir la figure).
Depuis 2010, 108 contrats à effet social ont permis de collecter jusqu’à 400 millions de dollars, et ce, dans 24 pays[174]. Leur succès a même convaincu de leur pertinence les experts de la Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique qui proposent dans leur rapport de recourir à ce mode de financement pour les réformes à venir[175].
Figure
Le lancement des contrats à effet social : Royaume-Uni et reste du monde
La forme juridique des contrats à effet social nécessite un éclairage. Alors que ces derniers sont souvent qualifiés de partenariat public-privé (PPP), ils reposent pourtant sur une construction différente (voir le tableau 3). En effet, dans un PPP, l’institution publique endosse le rôle de partenaire contractuel principal envers le partenaire privé, et ils partagent alors ensemble les risques associés au projet[176]. Dans un contrat à impact social, l’institution publique ne supporte aucun risque financier en cas d’échec dudit contrat et transfère ainsi les risques à l’investisseur privé.
La qualification fiscale des contrats à effet social laisse planer certains doutes. Voici ce que mentionne Orly Mazur :
SIB [Social Impact Bonds] have the potential to provide an additional source of capital to finance critical social services. However, the current law creates substantial tax uncertainty for potential SIB investors. With respect to private investors, this uncertainty primarily arises because a SIB arrangement does not clearly constitute debt or equity, but instead is a hybrid instrument that contains debt, equity and charitable features[177].
La porte est aujourd’hui ouverte pour les gouvernements. Au niveau financier, ils peuvent envisager d’améliorer l’attractivité des contrats à effet social en modifiant le régime fiscal applicable et en offrant un système de subvention approprié[178].
Tableau 3
Synthèse comparative entre un contrat à impact social et un partenariat public-privé
Ce tableau est inspiré de celui figurant dans T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, aux pages 167 et 168.
Devant le succès des contrats à effet social, les critiques apparaissent en parallèle de leur progression dans les pratiques et dans la littérature. Certains vont même jusqu’à qualifier ces contrats d’« arnaque », d’« innovation capitaliste conçue pour ponctionner la richesse sociale » ou encore de « nouveau type de fraude institutionnalisée[179] ». À l’heure actuelle, rien ne peut prédire si les contrats à effet social deviendront une nouvelle niche fiscale[180]. Il est évident qu’une réticence envers un nouveau mécanisme fondé sur des bases capitalistes rappelle les dérives que peut connaître ce type de flux de capitaux. Les contrats à effet social demeurent cependant un moyen financier de parvenir à la résolution de problématiques sociales en offrant un mécanisme novateur répondant à des problématiques qui persistent. Bien que la privation du secteur public représente un risque évident, la réalité est telle que les problématiques sociales se poursuivent et qu’une pluralité d’acteurs privés tentent d’y répondre par l’entremise de l’innovation[181]. À travers la collaboration d’acteurs variés, les mécanismes capitalistes sont utilisés maintenant aux fins de la finance sociale et contrent l’effet massif de la financiarisation sur la société.
Conclusion
Depuis dix ans, la financiarisation a été décriée : d’ailleurs, elle se trouve au coeur même des récentes crises économiques et financières qui ont ébranlé la planète en ce début de millénaire[182]. Parmi ses effets, elle engendre le court-termisme qui est porteur de nombreux risques soulignés dans le rapport du professeur John Kay produit en 2012 à la demande du ministère britannique de l’Industrie :
Short-termism in business may be characterised both as a tendency to under-investment, whether in physical assets or in intangibles such as product development, employee skills and reputation with customers, and as hyperactive behaviour by executives whose corporate strategy focuses on restructuring, financial re-engineering or mergers and acquisitions at the expense of developing the fundamental operational capabilities of the business[183].
La financiarisation pose également la question de la place du droit dans l’économie… et mutatis mutandis de celle de l’État (et aussi des instances internationales)[184].
De son côté, le droit est en marche et se modernise autour d’une autre financiarisation de nature plus sociale[185]. Celle-ci est portée par une économie sociale qui entend établir les bases d’une transition en vue d’abandonner le capitalisme outrancier et l’économisme[186]. Devant la dictature du court-terme, sur laquelle la finance moderne est actuellement polarisée, l’adaptation du droit à l’économie « arrivante » constitue une solution de rechange sérieuse pour éviter un statu quo préjudiciable et réformer un capitalisme devenu injuste et inhumain. Rappelons cette observation sur le droit des sociétés par actions fait par les professeurs Paul Le Cannu et Bruno Dondero :
Le droit positif édifie […] une hiérarchie des intérêts, les apporteurs de capitaux étant au sommet ; plus on apporte, plus on reçoit de pouvoirs (en principe). La difficulté vient du fait que les arbitrages sont difficiles et que les outils juridiques sont très imprécis, voire inexistants sur des questions de très grande importance, comme celle des « licenciements boursiers » ou des acquisitions « à effet de levier », qui maltraitent la collectivité humaine au bénéfice du rendement des actions et, plus largement, de l’investissement[187].
La lecture du phénomène de la financiarisation à travers le prisme du droit des sociétés par actions et des marchés démontre des avancées du droit pour responsabiliser les entreprises et met en lumière des défis auxquels il doit faire face. Il faut ici considérer que « le problème fait […] partie de la solution[188] », ce qui signifie que la crise est celle de la finance et du système néolibéral dans son ensemble[189]. En effet, « [w]ith social finance, impact investors put their capital behind enterprises that profitably cater to underserved populations by expanding access to critical goods and services[190] ». La main invisible d’Adam Smith[191] est encore d’actualité tant les acteurs ont été capables de se réguler et de répondre aux attentes des parties prenantes. Cependant, l’autoréglementation qui a caractérisé un effacement de l’État de l’espace économique (et la vision qui faisait de lui l’unique auteur de normes)[192] a démontré ses limites. Le droit doit être présent et il le fait de plus en plus. En réalité, le droit s’empare actuellement de la nouvelle finalité des entreprises[193] pour créer des outils innovants et il consacre ainsi une transition économique qui s’appuie sur la RSE[194], sans procéder à une inversion radicale des priorités (la « lucrativité » restant en principe l’objectif ultime de toute société de capitaux[195]). Comme le relève la professeure Mireille Delmas-Marty, « le modèle Société sans État comporte des modes de régulation autonomes, mais qui finissent toujours par être articulés avec des formes étatiques[196] ». En outre, les marchés plus ou moins appuyés (selon des pays) par l’intervention des pouvoirs publics constituent un puissant relais à cette innovation en structurant, en institutionnalisant et en encourageant l’investissement à incidence sociale. La reconnaissance juridique de ce type d’investissement contribue à dynamiser la nouvelle économie en lui permettant de repérer des entreprises porteuses de changement sur le plan social et environnemental. De manière complémentaire, les contrats à effet social démontrent que des instruments de marché différents et des manières autres d’appuyer le financement font leur apparition. Si ces contrats constituent un montage financier original, ils témoignent également de la possibilité de conjuguer logique économique et retour financier sur investissement social, tout en faisant travailler ensemble divers acteurs (investisseurs financiers, entreprises, État, etc.). Les nombreux exemples présents aujourd’hui tant aux États-Unis ou en Europe que dans les provinces canadiennes illustrent ainsi la faisabilité d’un investissement à impact social bâti sur la structure des contrats à effet social[197].
En ce qui concerne le juriste, il se doit de participer à cette manière de civiliser les processus de mondialisation en vue de placer l’entreprise devant ses responsabilités. Force est de constater qu’à l’heure actuelle il y prend part, que le regard soit tourné vers l’Amérique du Nord ou l’Europe. Les États avancent progressivement dans leur réflexion sur les problématiques que nous venons d’exposer, même si la méthode d’intervention et le rythme se révèlent différents d’un endroit à l’autre. Le droit est, en d’autres mots, le révélateur d’une mutation[198] qui se joue dans les sociétés actuelles : l’émergence d’une finance différente (de nature sociale) qui interagit avec la finance plus traditionnelle. Cette nouvelle finance ne fait que rappeler plus lointainement le principe de solidarité qui parcourt le droit[199]. Il en va ainsi au Canada où l’encadrement réglementaire de l’investissement à incidence sociale et des contrats à effet social se met progressivement en place. Cependant, le chantier n’est pas terminé, et un travail considérable reste à accomplir. À ce titre, les entreprises à mission sociétale font l’objet d’un intérêt mesuré de la part du législateur au Canada. Mis à part les changements observés en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, ce type d’entreprise reste largement dans l’ombre et relève uniquement de la certification privée B Corp[200]. Pourtant, le temps est sans doute venu d’envoyer un signal[201]. En effet, le signal provenant de l’intervention du législateur n’est pas à négliger en ce domaine[202]. Certaines valeurs humaines qu’il vient appuyer devraient s’imposer avec vigueur[203]. La défense de ces valeurs s’avère d’autant plus importante dans un système juridique qui tend, sur le plan anthropologique, à approcher d’une vision juste des sociétés et du monde[204]… justice dont la crise démontre le besoin pressant.
L’hybridité de la finance sociale témoigne de l’innovation croissante qui cherche à diversifier les ressources[205] de ce « coeur invisible des marchés[206] ». Cependant, le droit fait plus que détourner des instruments financiers pour créer de la richesse immatérielle : il tente de répondre aujourd’hui aux besoins d’une société en « réinventant un modèle de développement » économique[207]. Le droit des sociétés par actions et des marchés est ainsi soumis à l’épreuve de la modernité[208] !
Appendices
Annexe
Synthèse comparative des entreprises à mission sociétale
Notes
-
[1]
Peyo, Le schtroumpf financier, Bruxelles, Le Lombard, 2007, p. 44.
-
[2]
Dick Bryan et Michael Rafferty, Capitalism with Derivatives. A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class, New York, Palgrave Macmillan, 2006, p. 32.
-
[3]
Ce modèle apparaît dans la littérature anglo-saxonne sous l’expression shareholder value (valeur actionnariale) : voir William W. Bratton, « Enron and the Dark Side of Shareholder Value », (2002) 76 Tul. L. Rev. 1275, 1284.
-
[4]
Jean-Jacques Daigre, « La financiarisation du droit des sociétés », dans Isabelle Urbain-Parleani et Pierre-Henri Conac (dir.), Regards sur l’évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Paris, Dalloz, 2018, p. 61 ; Costas Lapavitsas, « Theorizing Financialization », Work, Employment & Society, vol. 25, no 4, 2011, p. 611 ; Natascha Van der Zwan, « Making Sense of Financialization », Socio-economic Review, vol. 12, no 1, 2014, p. 99.
-
[5]
Greta R. Krippner, Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Cambridge, Harvard University Press, 2011, p. 4.
-
[6]
Ivan Tchotourian, « Art, finance et gouvernance d’entreprise. Essai sur le tournant court-termiste de la fin du XXe siècle », R.R.J. 2015.571.
-
[7]
Grégory Denglos, Création de valeur, risque de marché et gouvernance des entreprises, Paris, Economica, 2010, p. 58.
-
[8]
Florence Palpacuer et autres, « Financiarisation et globalisation des stratégies d’entreprise : le cas des multinationales agroalimentaires en Europe », Finance Contrôle Stratégie, vol. 9, no 3, 2006, p. 165, à la page 166.
-
[9]
Jacques Attali, Pour une économie positive, Paris, Fayard, 2013, p. 40.
-
[10]
Michael Useem, Investor Capitalism. How Money Managers Are Changing the Face of Corporate America, New York, BasicBooks, 1996, p. 7. Voir aussi Thomas Clarke, International Corporate Governance. A Comparative Approach, Londres, Routledge, 2007, p. 109 et suiv.
-
[11]
Xavier Dieux, Droit, morale et marché, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 273.
-
[12]
Ben Fine, « La financiarisation en perspective », Actuel Marx, no 51, 2012, p. 73, à la page 74.
-
[13]
Simon Deakin, « The Corporation in Legal Studies », dans Grietje Baars et André Spicer (dir.), The Corporation. A Critical, Multi-Disciplinary Handbook, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 47, aux pages 52 et suiv. ; Beate Sjaefell, « Shareholder Primacy : The Main Barrier to Sustainable Companies », dans Beate Sjaefell et Benjamin J. Richardson (dir.), Company Law and Sustainability, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 79, à la page 83 ; I. Tchotourian, préc., note 6, 482 et suiv. ; William Lazonick et Mary O’Sullivan, « Maximizing Shareholder Value : A New Ideology for Corporate Governance », Economy and Society, vol. 29, no 1, 2000, p. 13, aux pages 15 et 16.
-
[14]
Pour un résumé, voir Ivan Tchotourian, avec la collaboration de Jean-Christophe Bernier, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE. Approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 208.
-
[15]
Jean-Laurent Viviani, « Investissement à impact social : une approche financière », Marché et organisations, no 31, 2018, p. 173.
-
[16]
Emmanuelle Létourneau, Gouvernance d’entreprise : aspects juridiques et pratiques, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 232.
-
[17]
Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668 (Mich. 1919). Cette position a notamment été réaffirmée par les arrêts suivants : Katz v. Oak Industries Inc., 508 A.2d 873, 878 (Del. Ch. 1986) ; Gans v. MDR Liquidating Corp., No. 9630, 1998 WL 294006 (Del. Ch. 1998) ; Pittelman v. Pearce, 8 Cal. Rptr.2d 359, 361 (Cal. Ct. App. 1992) ; Cont’l Ill. Nat’l Bank & Trust Co. v. Hunt Int’l Res. Corp., Nos. 7888, 7844, 1987 WL 55826, 4 (Del. Ch. 1987).
-
[18]
Mathias M. Siems, Convergence in Shareholder Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. Pour l’Allemagne, voir : Jeffrey N. Gordon, « Pathways to Corporate Convergence ? Two Steps on the Road to Shareholder Capitalism in Germany : Deutsche Telekom and Daimler Chrysler », (1999) 5 Columbia J. Eur. L. 219 ; Thomas J. André, Jr., « Cultural Hegemony : The Exportation of Anglo-Saxon Corporate Governance Ideologies to Germany », (1998-1999) 73 Tul. L. Rev. 69. Pour la France, voir Jean-Jacques Caussain, Le gouvernement d’entreprise. Le pouvoir rendu aux actionnaires, Paris, Litec, 2005.
-
[19]
Michael C. Jensen, A Theory of the Firm. Governance, Residual Claims and Organizational Forms, Cambridge, Harvard University Press, 2000 ; John C. Coffee, Jr., « The Future as History : The Prospects for Global Convergence in Corporate Governance and its Implications », (1998-1999) 93 Nw. U.L. Rev. 641 ; Frank H. Easterbrook et Daniel R. Fischer, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, Harvard University Press, 1991 ; Eugene F. Fame et Michael C. Jensen, « Agency Problems and Residual Claims », (1983) 26 J.L. & Econ. 327 ; Michael C. Jensen et William H. Meckling, « Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure », Journal of Financial Economics, vol. 3, no 4, 1976, p. 305.
-
[20]
Gavin Kelly et John Parkinson, « The Conceptual Foundations of the Company : A Pluralist Approach », dans John Parkinson, Andrew Gamble et Gavin Kelly (dir.), The Political Economy of the Corporation, Oxford, Hart Publishing, 2000, p. 113, à la page 122.
-
[21]
Laura Horn, « The Financialization of the Corporation », dans G. Baars et A. Spicer (dir.), préc., note 13, p. 281, à la page 283 (l’italique est de nous).
-
[22]
J. Attali, préc., note 9, p. 37 et 38.
-
[23]
Yves D. Somé, « Le grand renversement. De la crise au renouveau solidaire, Jean-Michel Servet (2010), Paris, Desclée de Brouwer », Économie et Solidarités, vol. 40, nos 1-2, 2009, p. 103, à la page 104.
-
[24]
« Financialization engenders, and intersects with, shareholder value ideologies » : L. Horn, préc., note 21, à la page 284.
-
[25]
Le principal et l’agent se sont donc entendus, non seulement pour faire de la valeur boursière leur préoccupation première en favorisant des taux de profit démesurés ou des politiques d’investissement court-termistes, mais encore pour limiter la répartition de la valeur ajoutée des entreprises à leur seul bénéfice : Ivan Tchotourian, « La loi Grenelle II ou le temps de réviser la gouvernance actionnariale : propos iconoclastes d’un juriste sur l’avenir des théories économiques et financières », Revue du financier 2011.61, 66.
-
[26]
Milton Friedman, « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits », The New York Times Magazine, 13 septembre 1970, p. 33 et 122-126.
-
[27]
Jérôme Bourdieu, Johan Heilbron et Bénédicte Reynaud, « Les structures sociales de la finance », Actes de recherche en sciences sociales, vol. 146-147, 2003, p. 3, à la page 3.
-
[28]
Jill E. Fisch, « Measuring Efficiency in Corporate Law : The Role of Shareholder Primacy », (2006) 31 J. Corp. L. 637, 644.
-
[29]
D. Bryan et M. Rafferty, préc., note 2, p. 32.
-
[30]
F. Palpacuer et autres, préc., note 8, aux pages 167 et 168.
-
[31]
La question demeure également de savoir si seul le principe de maximisation de la valeur actionnariale mérite la critique dont il a été l’objet en raison de l’accumulation des richesses qu’il permet et si la réflexion ne devrait pas être aussi poursuivie sur la manière dont la création de valeur est répartie entre dirigeants, actionnaires et parties prenantes.
-
[32]
Douglas M. Branson, « Enron – When All Systems Fail : Creative Destruction or Roadmap to Corporate Governance Reform ? », (2003) 48 Villanova L. Rev. 989 ; Jeffrey N. Gordon, « Governance Failures of the Enron Board and the New Information Order of Sarbanes-Oxley », Columbia Law and Economics Working Paper, no 216, 2003 ; Jeffrey N. Gordon, « What Enron Means for the Management and Control of the Modern Business Corporation : Some Initial Reflections », (2002) 69 U. Chicago L. Rev. 1233 ; Douglas G. Baird et Robert K. Rasmussen, « Four (or Five) Easy Lessons From Enron », (2002) 55 Vanderbilt L. Rev. 1787 ; Stuart Gillan et John D. Martin, « Financial Engineering, Corporate Governance, and the Collapse of Enron », University of Delaware Center for Corporate Governance Working Paper, no 2002-001, 2002.
-
[33]
Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Doc. COM(2001) 366 final ; Initiative pour l’entrepreneuriat social. Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au coeur de l’économie et de l’innovation sociales, Doc. COM(2011) 682 final.
-
[34]
Cependant, le caractère non marchand d’une telle dimension n’exclut pas que cette dernière puisse avoir une influence sur la valeur d’une entreprise, comme l’illustrent les travaux sur l’effet financier de la responsabilité sociale. Pour une synthèse sur les débats dans la littérature et une conclusion établissant un lien entre performance financière et sociétale : Marc Orlitzky, « Corporate Social Performance and Financial Performance. A Research Synthesis », dans Andrew Crane et autres (dir.), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 113, aux pages 116 et suiv.
-
[35]
J.-L. Viviani, préc., note 15.
-
[36]
Voir : Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC 68, par. 42 ; BCE inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 R.C.S. 560, 2008 CSC 69, par. 81-83.
-
[37]
Pia Imbs, L’entreprise exposée à des responsabilités élargies, Colombelles, Éditions EMS, 2005.
-
[38]
R. Edward Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, New York, Cambridge University Press, 1984 ; Archie B. Carroll, « The Pyramid of Corporate Social Responsibility : Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders », Business Horizons, vol. 34, no 4, 1991, p. 39.
-
[39]
La tenue du Sommet mondial des groupes de réflexion économiques (International Summit of Business Think Tanks) les 17 et 18 juin 2013, sur le thème de : « L’entreprise qui transforme le monde – Relever les défis du 21e siècle », met en lumière les intenses débats dont l’entreprise est l’objet dans son rapport avec l’environnement.
-
[40]
François-Guy Trébulle, « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises », Gaz. Pal. 2016.hors série 2.55 :
L’actionnaire n’a pas que des droits, il a également des devoirs. Au-delà de l’analyse la plus classique, ils doivent également intégrer la responsabilité sociale et environnementale […].
Pour ce qui est des conséquences à tirer pour les actionnaires de cette évolution, peut-on considérer qu’ils auraient le devoir de demander à la société d’adopter une démarche RSE ? Il peut paraître excessif de le formuler de la sorte […] mais il apparaît bien qu’il est en effet de leur devoir de s’assurer que les risques liés à la RSE, environnementaux, sociaux et de gouvernance, en matière de droits de l’Homme ou de corruption, sont effectivement pris en compte et que des procédures adaptées permettraient de faire face à la révélation d’une ampleur significative de ceux-ci sur la situation ou les résultats de l’entreprise.
-
[41]
La finance sociale est définie comme un « investissement actif de capitaux dans des entreprises et des fonds qui produisent un bien social et/ou environnemental et (au moins) un capital symbolique pour l’investisseur. Les investisseurs d’impact cherchent à maîtriser les mécanismes du marché pour créer un impact social ou environnemental » : Groupe d’étude canadien sur la finance sociale, « La mobilisation de capitaux privés pour le bien collectif », 2010, p. 43, [En ligne], [www.mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/07/MobilizingFR.pdf] (11 février 2019).
-
[42]
J. Defourny et M. Nyssens, préc., note introductive, p. 57.
-
[43]
France, Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république, sur la proposition de loi Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances, par Dominique Potier, rapport no 544, 10 janvier 2018, p. 7 ; Claude Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise : sortir de la crise du financialisme, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 155 et suiv.
-
[44]
Alain Supiot, La gouvernance par les nombres : cours au collège de France (2012-2014), Paris, Fayard, 2015, p. 221 et suiv.
-
[45]
Danièle Demoustier et Gabriel Colletis, « L’économie sociale et solidaire face à la crise : simple résistance ou participation au changement ? », Revue internationale de l’économie sociale, vol. 325, 2012, p. 21.
-
[46]
En Europe, voir la synthèse de la Commission européenne, « Corporate Social Responsibility National Public Policies in the European Union. Compendium », 2014.
-
[47]
En France, les dispositions de la Loi no 2010-788 du 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environnement, J.O. 13 juill. 2010, p. 12905, dite Loi « Grenelle II », ainsi que la Loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, J.O. 16 mai 2001, p. 7776, dite Loi « NRE », ont imposé aux sociétés de communiquer les informations relatives aux engagements RSE dans le rapport annuel du conseil d’administration. En 2014, la Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, J.O. L 330/1, a été transposée en France par l’Ordonnance no 2017-1180 du 19 juill. 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises ainsi que par le Décret no 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l’application de l’ordonnance no 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises. Désormais, le rapport RSE s’intitule « déclaration de performance extra-financière ». La déclaration doit contenir des informations sur le plan social, environnemental et sociétal, et certaines sociétés doivent également produire des informations relatives aux droits de la personne et à la lutte contre la corruption. Cependant, ce dispositif ne s’impose qu’aux grandes entreprises, et aux PME cotées, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux sociétés par actions simplifiées non cotées et hors du secteur financier et de l’assurance de même qu’aux filiales françaises dont la société mère a déjà produit des informations de manière consolidée sont exemptées : Béatrice Héraud, « Reporting RSE : Tout savoir sur la nouvelle déclaration de performance extra-financière », Novethic, 2 octobre 2017, [En ligne], [www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/transposition-de-la-directive europeenne-sur-le-reporting-extra-financier-ce-qui-est-demande-aux-entreprises-144778.html] (14 septembre 2018).
-
[48]
France, Assemblée nationale, « Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », no 924, 21 février 2017. Pour des commentaires, voir : E. Gambert et Nicolas Cuzacq, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et des donneurs d’ordre », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, vol. 142, 2015, p. 453-455 ; Alain Pietrancosta et Étienne Boursican, « Vigilance : un devoir à surveiller ! », J.C.P. 2015.553 ; Nicolas Cuzacq, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : Acte II, scène 1 », D. 2015.1049 ; Yann Queinnec et Stéphane Brabant, « De l’art et du devoir d’être vigilant », R.L.D.A. 2013.48.
-
[49]
Les décisions Choc v. Hudbay Minerals Inc., 2013 ONSC 1414, et Chevron Corp. v. Yaiguaje, [2015] 3 R.C.S. 69, 2015 CSC 42, rendues respectivement par la Cour supérieure de l’Ontario et par la Cour suprême du Canada, révèlent une judiciarisation des questions de RSE sur la base de nouveaux fondements juridiques.
-
[50]
Delphine Abadie, « Le Canada, paradis judiciaire de l’industrie minière », Le Devoir, 27 avril 2009, [En ligne], [www.ledevoir.com/non-classe/247622/le-canada-paradis-judiciaire-de-l-industrie-miniere] (14 septembre 2018).
-
[51]
Alan Willis, Pamela Campagnoni et Wesley Gee, L’évolution de l’information d’entreprise. Exposé sur l’information sur le développement durable, l’information intégrée et l’information sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, Toronto, CPA Canada, 2015 ; TMX et CPA Canada, Informations à fournir sur les questions environnementales et sociales : guide d’introduction, Toronto, 2014 ; Autorités canadiennes en valeurs mobilières, « Indications en matière d’information environnementale », Avis 51-333 du personnel des ACVM, 2010, [En ligne], [www.lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2010/2010oct27-51-333-acvm-fr.pdf] (12 février 2019).
-
[52]
Urs P. Jäger et Andreas Schröer, « Integrated Organizational Identity : A Definition of Hybrid Organizations and a Research Agenda », Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 25, no 5, 2014, p. 1281. Dans la suite de notre texte, nous employons les termes « entreprise à mission sociétale » pour désigner les nouvelles formes de sociétés par actions qui ne limitent pas leur objectif à la seule poursuite de fins lucratives. Ainsi, l’expression « entreprise à mission sociétale » renvoie non à l’idée économique de ce qu’est une entreprise, soit une unité de décision économique qui réunit des ressources pour produire et vendre des biens et des services sur le marché dans un but de profit et de rentabilité (Claude-Danièle Échaudemaison, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Paris, Nathan, 1989, p. 160), mais au véhicule juridique exploitant une entreprise que constitue la société par actions. Dès 1967, le professeur Jean Paillusseau, La société anonyme. Technique d’organisation de l’entreprise, Paris, Sirey, 1967, p. 4 et suiv., a relevé que le droit « donne à l’entreprise une structure, des règles de fonctionnement et une vie juridique pour […] permettre [à l’entreprise] de s’affirmer, de s’exprimer et de s’épanouir […] le droit des sociétés apporte à l’entreprise l’organisation des droits des personnes qui sont en rapport avec elle ».
-
[53]
Sur cette appellation, voir Blanche Segrestin et autres, La « société à objet social étendu ». Un nouveau statut pour l’entreprise, Paris, Presses des Mines, 2016.
-
[54]
Voir : France, Assemblée nationale, « Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises », texte adopté no 179, 9 octobre 2018, art. 61 septies ; France, Sénat, « Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises », no 255, 17 janvier 2019.
-
[55]
Jacques Defourny et Marthe Nyssens, « L’approche EMES de l’entreprise sociale dans une perspective comparative », EMES Working Papers, no 13/02, 2013, p. 13-15.
-
[56]
J.-L. Viviani, préc., note 15.
-
[57]
Académie des entrepreneurs sociaux, « Baromètre des entreprises sociales en Belgique », 2016, [En ligne], [www.ces.uliege.be/wp-content/uploads/2017/12/Baromètre2016AES_PUBLI.pdf] (20 février 2019) ; Conseil national des chambres françaises de l’économie sociale et solidaire, « Panorama de l’économie sociale et solidaire en France », 2015, [En ligne], [base.socioeco.org/docs/blobserver1.pdf] (14 mai 2018).
-
[58]
Groupe d’étude canadien sur la finance sociale, préc., note 41 ; J.-L. Viviani, préc., note 15.
-
[59]
D. Demoustier et G. Colletis, préc., note 45.
-
[60]
J. Attali, préc., note 9, p. 53.
-
[61]
Muhammad Yunus, discours de réception du prix Nobel, 10 décembre 2006, cité dans Daniel Hurstel, La nouvelle économie sociale. Pour réformer le capitalisme, Paris, Odile Jacob, 2009, p. 19.
-
[62]
Voir notamment : Catherine Malecki, Responsabilité sociale des entreprises. Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Paris, L.G.D.J., 2014 ; Ivan Tchotourian, « Embrace the Coming Changes in Corporate Governance : Lessons from Developments in Corporate Law – A Comparative View », (2014) 65 Rev. Faculdade Direito Universidade Federal Minas Gerais 321 ; Güler Aras et David Crowther, A Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility, Farnham, Surrey, 2010 ; Beate Sjåfjell, « Responsible Corporate Governance », (2010) 7 Eur. Company L. 4 ; Douglas M. Branson, « Corporate Governance Reform and the “New” Corporate Social Responsibility », (2001) 61 U. Pittsburgh L. Rev. 605.
-
[63]
Kathia Martin-Chenut, « Juridicisation et judiciarisation de la RSE. Le rôle du droit international des droits de l’homme », dans Jean-Pierre Chanteau, Kathia Martin-Chenut et Michel Capron (dir.), Entreprise et responsabilité sociale en questions. Savoirs et Controverses, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 239, aux pages 250 et suiv. ; Gaëtan Marain, La juridicisation de la responsabilité sociétale des entreprises, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2016 ; Ivan Tchotourian, Valérie Deshaye et Romy Mac Farlane-Drouin, « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? », (2016) 57 C. de D. 635, 665 ; Béatrice Héraud, « Responsabilité sociale d’entreprise : une entreprise sur cinq sanctionnée », Novethic, 29 juin 2015, [En ligne], [www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/responsabilite-sociale-d-entreprise-une-entreprise-sur-cinq-sanctionnee-143445.html] (14 mai 2018) ; François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 113.
-
[64]
Louis-Daniel Muka Tshibende, Yann Queinnec et Ivan Tchotourian, « Articles 224 et s. de la loi Grenelle II : vers un droit de la gouvernance d’entreprise (enfin ?) responsable », (2012) 89 R.D.I.D.C. 97, 164.
-
[65]
L’innovation est une notion connue des juristes de droit des affaires : Cristie Ford, Innovation and the State. Finance, Regulation, and Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 16 et suiv. Voir aussi : Susan Watson et P.M. Vasudev (dir.), Innovations in Corporate Governance. Global Perspectives, Cheltenham, Edward Elgar, 2017 ; Katharina Pistor et autres, « Innovation in Corporate Law », Journal of Comparative Economics, vol. 31, 2003, p. 676.
-
[66]
Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004, c. 27 (R.-U.).
-
[67]
Robert T. Esposito, « The Social Enterprise Revolution in Corporate Law : A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States and the Case for the Benefit Corporation », (2013) 4 William & Mary Bus. L. Rev. 639, 674.
-
[68]
Loi no 47-1775 du 10 sept. 1947 portant statut de la coopération, J.O. 11 sept. 1947, p. 9088, art. 19.
-
[69]
Marc Hérail, « Coopérative », dans Véronique Magnier (dir.), Répertoire de droit sociétés, Paris, Dalloz, 2002, spéc. no 140.
-
[70]
Nicolas Cuzacq, « Quelle place peut-on octroyer aux parties prenantes dans le puzzle de la gouvernance des sociétés ? », D. 2017.1844.
-
[71]
Loi no 2014-856 du 31 juill. 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, J.O. 1er août 2014, p. 12666, art. 11 et suiv.
-
[72]
Frédéric Hanin et Lilia Rekik, « Investisseurs institutionnels publics, socialisation de l’investissement et emploi : les apports d’une analyse comparée France-Québec », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail, vol. 6, no 1, 2011, p. 100.
-
[73]
France, Ministère du Travail, « Lancement de la mission “Entreprise et intérêt général” », communiqué de presse de Muriel Pénicaud, 2018, [En ligne], [www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-mission-entreprise-et-interet-general] (14 mai 2018).
-
[74]
Marilyse Léon, Frédérique Lellouche et Emilie Durlach, « Repenser l’entreprise », Revue de droit du travail 2018.21.
-
[75]
Par l’entremise de la sénatrice Élizabeth Warren, les États-Unis ont déposé, le 15 août 2018, le projet de loi S.3348 intitulé « Accountable Capitalism Act » (S.3348, 115th Cong., Accountable Capitalism Act (2017-2018) ; pour un commentaire, voir Matthew Yglesias, « Elizabeth Warren Has a Plan to Save Capitalism », Vox, 15 août 2018). Cette loi a pour objet de réformer la gouvernance de certaines grandes entreprises, notamment en ouvrant leur mission à des aspects sociaux et en repensant la composition de leur conseil d’administration.
-
[76]
Dana B. Reiser, « Benefit Corporations – A Sustainable Form of Organization ? », (2011) 46 Wake Forest L. Rev. 591, 594.
-
[77]
L’entrée en vigueur de cette structure juridique a eu lieu le 1er octobre 2010. B Lab, « Maryland First State in Union to Pass Benefit Corporation Legislation », 2010, [En ligne], [www.csrwire.com/press_releases/29332-Maryland-First-State-in-Union-to-Pass-Benefit-Corporation-Legislation] (14 septembre 2018).
-
[78]
Maryland Code, Corporations and Associations, § 5-6C-01 a) (1)-(2) et 5-6C-06 b) (1).
-
[79]
Mystica M. Alexander, « Benefit Corporations – The Latest Development in the Evolution of Social Enterprise : Are They Worthy of a Taxpayer Subsidy ? », (2014) 38 Seton Hall Legis. J. 219, 248 ; Ivan Tchotourian et Dom Mannella, « Quand l’État du Delaware adopte la Benefit Corporation : mythe ou réalité de la redéfinition des devoirs des administrateurs ? », Journal des sociétés 2013.49, 55.
-
[80]
Jessica Bruder, « For “B Corps,” a New Corporate Structure and a Triple Bottom Line », The New York Times, 14 mars 2012 ; Liam Pleven, « When Doing Good Meets Investing », The Wall Street Journal, 12 juillet 2013.
-
[81]
Bill S. 47, 147th Leg., (Del., 2013). Sur le plan statistique, 55 % des sociétés par actions cotées et 63 % des sociétés de l’indice Fortune 500 sont enregistrées dans l’État du Delaware. De plus, le droit des sociétés de l’État du Delaware sert de modèle pour beaucoup d’autres États américains.
-
[82]
Rugger Burke et Samuel P. Bragg, « Sustainability in the Boardroom : Reconsidering Fiduciary Duty under Revlon in the Wake of Public Benefit Corporation Legislation », (2014) 8 Virginia L. & Bus. Rev. 59, 75.
-
[83]
Pour comparer les différences de régimes entre les structures américaines, voir J. Haskell Murray, « Corporate Forms of Social Enterprise : Comparing the State Statutes », 2015 [inédit].
-
[84]
Ivan Tchotourian, « Légiférer sur l’article 1832 du Code civil : une avenue pertinente pour la RSE ? », Revue des sociétés 2018.211 ; Carol Liao, For-Profit, Non-Profit, and Hybrid : The Global Emergence of Legally “Good” Corporations and the Canadian Experiment, thèse de doctorat, Vancouver, University of British Columbia, 2016 ; Ivan Tchotourian, Marion Racine et Olivier Sirois, « Entreprise et finance sociales : perspectives canadienne et québécoise », dans Jean-Marc Moulin (dir.), Droit de la finance alternative, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 417 ; Carol Liao, « The Next Stage of CSR for Canada : Transformational Corporate Governance, Hybrid Legal Structures, and the Growth of Social Enterprise », (2013) 9 McGill Int. J. Sust. Dev. L. & Pol. 53.
-
[85]
Business Corporations Act, S.B.C. 2002, c. 57.
-
[86]
Colombie-Britannique, « Province Consults on Community Interest Companies », 20 octobre 2010, [En ligne], [archive.news.gov.bc.ca/releases/news_releases_2009-2013/2010fin0056-001292.htm] (14 mai 2018).
-
[87]
Community Interest Companies Act, S.N.S. 2012, c. 38, modif. par S.N.S. 2014, c. 34, s. 3.
-
[88]
Anne Drost, Shannon Consedine et Ivana Cescutti Blake, « Comprendre les benefit corporations et leur potentiel au Québec », dans S.F.C.B.Q., vol. 435, Développements récents en droit des affaires (2017), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 185, aux pages 12 et 13 de la version électronique.
-
[89]
Business Corporations Amendment Act, Bill M 216 – 2018 (débat en 2e lecture – 17 mai 2018), 3e sess., 41e légis. (C.-B.). Si ce projet de loi n’est plus d’actualité depuis le changement d’assemblée intervenue en janvier 2019, le projet M 209 a été déposé le 10 avril 2019 avec le même objectif : introduire une benefit company (Business Corporations Amendment Act (No. 2), Bill M 209 – 2019, 4e sess., 41e légis. (C.-B.)).
-
[90]
Thomas Donaldson et Thomas W. Dunfee, « Toward a Unified Conception of Business Ethics : Integrative Social Contracts Theory », The Academy of Management Review, vol. 19, no 2, 1994 p. 252.
-
[91]
Inès Dhaouadi, « La conception politique de la responsabilité sociale de l’entreprise : vers un nouveau rôle de l’entreprise dans une société globalisée », Revue de l’organisation responsable, vol. 3, 2008, p. 19.
-
[92]
X. Dieux, préc., note 11, p. 248, par. 45.
-
[93]
Pour plus de détails, voir Ivan Tchotourian, « L’art de la juste équivalence en droit : discussion autour du mot “corporate” de l’expression corporate governance », R.R.J. 2015.455, 494 et suiv.
-
[94]
Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit des sociétés, Paris, Litec, 2003, p. 194.
-
[95]
Pour la jurisprudence australienne, voir les décisions suivantes : The Bell Group Ltd. (in liq) v. Westpac Banking Corporation, [2008] WASC 239, conf. par [2012] WASCA 157 ; Walker v. Wimborne, [1976] HCA 7, 137 CLR 1, 6 et 7.
-
[96]
Yves de Cordt, L’intérêt social comme vecteur de la responsabilité sociale, Louvain-la-Neuve, Academia, 2008.
-
[97]
J. Paillusseau, préc., note 52.
-
[98]
X. Dieux, préc., note 11, p. 281.
-
[99]
La France est le témoin privilégié de cette absence d’existence en droit. Pour une analyse récente, voir Antoine Lyon-Caen, « Le droit sans l’entreprise », dans Blanche Segrestin, Baudoin Roger et Stéphane Vernac (dir.), L’entreprise : point aveugle du savoir, Paris, Éditions Sciences Humaines, 2014, p. 23 ; et pour un ouvrage classique : Jean-Philippe Robé, L’entreprise et le droit, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 10.
-
[100]
Au Québec, l’entreprise est un concept fondamental du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 : Nabil Antaki et Charlaine Bouchard, Droit et pratique de l’entreprise, t. 1, Cowansville, Yvon Blais, 1999, p. 171 ; aussi : Patrice Vachon, « La notion d’“entreprise” de l’article 1525 C.c.Q. et son impact sur les transactions immobilières », dans S.F.C.B.Q., vol. 66, Développements récents en droit commercial (1995), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 117 ; Pierre J. Dalphond, « Entreprise et vente d’entreprise en droit civil québécois », (1994) 54 R. de B. 35. Lors de la réforme du Code civil, le législateur a remplacé la notion de commercialité par celle d’entreprise comme élément déterminant du champ d’application de régimes dérogatoires destinés à s’appliquer aux acteurs du monde des affaires. Au Québec, l’entreprise existe donc en droit, tout autant que dans les faits : Édouard Onguene Onana, « La notion d’entreprise en droit québécois : aspects de droit positif et vision prospective », (2017) R.I.D.C. 605, 633. Dans ce contexte, l’article 1525 du Code civil est à souligner puisque son alinéa 3 propose une définition de l’entreprise, soit « l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité, économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services ». En dehors du Code civil, le recours à l’entreprise est également significatif en droit canadien du travail sur le plan des rapports individuels et collectifs : Pierre Verge et Sophie Dufour, Configuration diversifiée de l’entreprise et droit du travail, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, p. 20 ; Pierre Verge, Le droit de grève – fondements et limites, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1985, p. 191. En droit québécois du travail, plusieurs décisions judiciaires intervenant dans les rapports privés et collectifs ont pris également en considération l’intérêt de l’entreprise : P. Verge et S. Dufour, p. 11, à leur note 40.
-
[101]
Richard L. Levine, Lauren Hoelzer et Jay Minga, « Governance Goes Green », Weil, Gotshal & Manges LLP, 2016, [En ligne], [www.weil.com/~/media/files/pdfs/160295_corporate_sustainability_newsletter_april2016_v5.pdf] (14 septembre 2018) ; Cynthia A. Williams, « Corporate Social Responsibility and Corporate Governance », dans Jeffrey N. Gordon et Wolf-Georg Ringe (dir.), The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 634.
-
[102]
Jean-François Gaudreault-DesBiens, « La légitimation de l’avarice dans la théorisation nord-américaine du droit des sociétés par actions », dans Véronique Fortin, Myriam Jézéquel et Nicholas Kasirer (dir.), Les sept péchés capitaux et le droit privé, Montréal, Éditions Thémis, 2007, p. 209. En tant que propriétaires capitalistes, les actionnaires seraient les meilleurs garants de la bonne gestion de l’entreprise. Ils seraient les créanciers résiduels qui supportent le risque entrepreneurial (F.H. Easterbrook et D.R. Fischel, préc., note 19), le contrat d’entreprise ne spécifiant aucune rémunération ex ante (William A. Klein, John C. Coffee et Frank Partnoy, Business Organization and Finance : Legal and Economic Principles, New York, Foundation Press, 2010, p. 123). À ce titre, les actionnaires devraient pouvoir influencer l’entreprise et la contraindre à maximiser le profit : Henry Hansmann et Reinier Kraakman, « Toward a Single Model of Corporate Law ? », dans Joseph A. McCahery et autres (dir.), Corporate Governance Regimes. Convergence and Diversity, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 56. Voir aussi I. Tchotourian, préc., note 93, 482 et suiv., par. 15.
-
[103]
Ivan Tchotourian, « La compagnie, instrument futur d’un “capitalisme stakeholder” ? La perception nouvelle du concept d’“intérêt social” en droit nord-américain et européen au service d’un management en charge d’âmes », dans Christoph Ebarhard (dir.), Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 447.
-
[104]
Smith Manufacturing v. Barlow, 98 A.2d 581 (1953), affaire citée dans Tom L. Beauchamp et Norman E. Bowie, Ethical Theory and Business, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2003, p. 85. Voir aussi l’affaire Schlensky v. Wrigley, 237 NE2d 776 (Ill. App. Ct. 1968).
-
[105]
Crédit Lyonnais Bank Nederland N.V. c. Pathé Communications Corp., No. 12150, 1991 Del. Ch., 215 108 (1991).
-
[106]
J.E. Fisch, préc., note 28, 651 ; E. Norman Veasey et Christine T. Di Guglielmo, « What Happened in Delaware Corporate Law and Governance from 1992-2004 ? A Retrospective on some Key Developments », (2005) 153 U. Pennsylvania L. Rev. 1399, 1429 et 1430.
-
[107]
Thomas W. Joo, « Race, Corporate Law, and Shareholder Value », (2004) 54 J. Leg. Education 351, 361. Plusieurs décisions judiciaires rendues dans le contexte du devoir de loyauté des administrateurs rejettent la position proactionnariale. Il en est ainsi par exemple des cas suivants : Murray v. Conseco Inc., 795 N.E.2d 454, 458-59 (Ind. 2003) ; Thompson v. Cent. Ohio Cellular Inc., 639 N.E.2d 462, 469 (Ohio 1994) ; Georgia-Pacific v. Great N. Nekoosa, 727 F. Supp. 31, 33 (D. Me. 1989) ; Keyser v. Com. Nat. Financial Corp., 675 F. Supp. 238, 241, 265 (M.D. Pa. 1987) ; Baron v. Strawbridge & Clothier, 646 F. Supp. 690, 697 (E.D. Pa. 1986). En matière de changement de contrôle, la Cour suprême du Delaware a rendu une décision où il peut être lu que « a board of directors […] is not under any per se duty to maximize shareholder value » : Paramount Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140, 1150 (Del. 1989).
-
[108]
Paris, 22 mai 1965, D. Jurisp. 1968.147, note Contin. Voir aussi : Reims, 24 avril 1989, J.C.P. 1990.677, note Viandier ; Caussain, Gaz. Pal. 1989.431, note Fontbressin ; R.T.D. com. 1989.683, note Reinhard ; R.S. Som. 1990.77, note Guyon.
-
[109]
Benoist Delecourt, « L’intérêt social », mémoire pour le diplôme d’études approfondies, Lille, Université de Lille II, 2000/2001, p. 13.
-
[110]
Philippe Bissara, « Le gouvernement d’entreprise en France : faut-il légiférer encore et de quelle manière ? », Revue des sociétés 2003.51.
-
[111]
I. Tchotourian, préc., note 14, p. 154, par. 103.
-
[112]
Jean-Jacques Daigre, « Le gouvernement d’entreprise : feu de paille ou mouvement de fond ? », Dr. & pat. 1996.22, 24.
-
[113]
François-Guy Trébulle, « Stakeholder Theory et droit des sociétés (deuxième partie) », Bull. Joly Soc. 2007.7.
-
[114]
France, Assemblée nationale, préc., note 43, p. 25 ; ces deux articles devraient se lire respectivement comme ceci :
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter des actifs, sous la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie, à une entreprise commune en vue de développer un projet d’entreprise et de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie susceptible d’en résulter.
Toute société doit avoir un projet d’entreprise licite et être gérée dans l’intérêt commun des associés et des tiers prenant part, en qualité de salariés, de collaborateurs, de donneurs de crédit, de fournisseurs, de clients, ou autrement, au développement de l’entreprise qui doit être réalisée dans des conditions compatibles avec l’accroissement ou la préservation des biens communs.
Voir I. Tchotourian, préc., note 84.
-
[115]
Si la décision d’appel est venue consacrer la primauté des actionnaires sur tout autre intérêt, la décision de première instance se montrait plus ouverte pour prendre en considération les différents intérêts en présence quant à la décision de bloquer la vente de la participation de l’État belge dans la banque Fortis à la BNP Paribas (déposants, fournisseurs, etc.) : Comm. Bruxelles (réf.), 18 novembre 2018, R.K. 212/2008, no 124.
-
[116]
Jean-Marc Gollier, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Yves de Cordt (dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 295, aux pages 316 et suiv.
-
[117]
Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne – Un plan pour avancer, COM(2003) 264 final.
-
[118]
François-Guy Trébulle, « Stakeholder Theory et droit des sociétés (première partie) », Bull. Joly Soc. 2006.1337.
-
[119]
ecoDA et IFC, A Guide to Corporate Governance Practices in the European Union, 2015, p. xii. Voir aussi la diversité des situations établie par l’étude comparative menée par la London School of Economics sur la législation et la jurisprudence des 27 États membres en matière de devoirs des administrateurs : Carston Gerner-Beuerle, Philipp Paech et Edmund P. Schuster, Study on Directors’ Duties and Liability, Londres, The London School of Economics and Political Science, 2013, p. 66 et suiv.
-
[120]
Peoples Department Stores Inc. (Trustee of) c. Wise, [2003] J.Q. no 505 (C.A.) ; Palmer v. Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd., [1989] 67 O.R. (2d) 161 (Ont. S.C.) ; Re Olympia & York Enterprises and Hiram Walker Resources Ltd., [1986] 59 O.R. (2d) (Ont. S.C.). En doctrine, voir : Francis Beaufort Palmer et Geoffrey Morse, Palmer’s Company Law, 25e éd., t. 1, Londres, Sweet & Maxwell, 1992 ; E.E. Palmer, « Directors’ Powers and Duties », dans Jacob S. Ziegel (dir.), Études sur le droit canadien des compagnies, Toronto, Butterworths, 1967, p. 365, à la page 371.
-
[121]
Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2011, p. 421. En parallèle de cette décision, une école doctrinale en droit anglo-canadien prône la prise en considération de l’intérêt de ceux dont le sort est étroitement lié à celui de la société, tels les employés, les créanciers, les clients, les fournisseurs et la collectivité en général : Janis Sarra, « Corporate Governance Reform : Recognition of Workers’ Equitable Investments in the Firm », (1999) 32 Can. Bus. L.J. 384 ; Alan E. Garfield, « Special Issue on the Corporate Stakeholder Debate : The Classical Theory and Its Critics », (1993) 43 Am. J. Comp. L. 150.
-
[122]
Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, préc., note 36, par. 42.
-
[123]
BCE inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, préc., note 36. Pour des commentaires sur cette décision, voir : Anita Anand, « Flexibility vs. Certainty : The Law Relating to Arrangements after BCE », (2009) 48 Can. Bus. L.J. 174 ; Jeff Bone, « Corporate Environmental Responsibility in the Wake of the Supreme Court Decision in BCE Inc. and Bell Canada », (2009) 27 Windsor Rev. of Leg. & Soc. Issues 5 ; Sarah P. Bradley, « BCE Inc. v. 1976 Denbentureholders : The New Fiduciary Futies of Fair Treatment, Statutory Compliance and Good Corporate Citizenship ? », (2010) 41 Ottawa L. Rev. 325 ; Jeremy D. Fraiberg, « Fiduciary Outs and Maximizing Shareholder Value Following BCE », (2009) 48 Can. Bus. L.J. 213 ; Edward Iacobucci, « Indeterminacy and the Canadian Supreme Court’s Approach to Corporate Fiduciary Duties », (2009) 48 Can. Bus. L.J. 232 ; Jeffrey G. MacIntosh, « BCE and the People’s Corporate Law : Learning to Live in Quicksand », (2009) 48 Can. Bus. L.J. 255 ; J. Alex Moore, « BCE Inc. (RE) : An Unexamined Question Considered », (2009) 48 Can. Bus. L.J. 273 ; James C. Tory, « A Comment on BCE Inc. », (2009) 48 Can. Bus. L.J. 285 ; J. Anthony VanDuzer, « BCE v. 1976 Debentureholders : The Supreme Court’s Hits and Misses in its most Important Corporate Law Decision since Peoples », (2009) 43 U.B.C. L. Rev. 205 ; Edward J. Waitzer et Johnny Jaswal « Peoples, BCE, and the Good Corporate “Citizen” », (2009) 47 Osgoode Hall L.J. 439.
-
[124]
R. Crête et S. Rousseau, préc., note 121, p. 421, par. 921, note 132.
-
[125]
P.M. Vasudev, « Corporate Stakeholders in Canada – An Overview and a Proposal », (2013-2014) 45 Ottawa L. Rev. 137, 141.
-
[126]
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44, art. 239 ; Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1, art. 445.
-
[127]
Loi canadienne sur les sociétés par actions, préc., note 126, art. 241 ; Loi sur les sociétés par actions, préc., note 126, art. 450.
-
[128]
E. Létourneau, préc., note 16, à la page 238.
-
[129]
P.M. Vasudev, préc., note 125, 142 : « the formal recognition of the stakeholder model of governance has not translated into an effective legal regime that can protect the interests of non-shareholder groups, and identifies the business judgment rule as a major impediment ». Voir aussi Stéphane Rousseau et Ivan Tchotourian, « La gouvernance d’entreprise, autrement », dans Corinne Gendron et Bernard Girard (dir.), Repenser la responsabilité sociale de l’entreprise. L’école de Montréal, Paris, Armand Colin, 2013, p. 91, à la page 101.
-
[130]
Cette vision de l’entreprise correspond à une approche postlibérale où la grande entreprise se considère comme une « institution permanente, investie de fonctions qui dépassent la réalisation du profit maximum, et sont parfois même incompatibles avec elles » : Andrew Shonfield, Le capitalisme d’aujourd’hui, Paris, Gallimard, 1967, p. 389. Voir aussi Pierre Rosanvallon, La société des égaux, Paris, Seuil, 2011, p. 279 et suiv.
-
[131]
Yves de Cordt, « Le droit des sociétés cotées : question d’équilibre », dans Vincent Dujardin et autres (dir.), La crise économique et financière de 2008-2009. L’entrée dans le 21e siècle ?, Bruxelles, Peter Lang, 2010, p. 213. Voir aussi Maria Bonnafous-Boucher et Yvon Pesqueux, Décider avec les parties prenantes, Paris, La Découverte, 2006, p. 268.
-
[132]
Karim Harji et Edward T. Jackson, « Accelerating Impact. Achievements, Challenges and what’s Next in Building the Impact Investing Industry », The Rockefeller Foundation, 2012, p. 1, [En ligne], [assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20120707215852/Accelerating-Impact-Full-Summary.pdf] (14 septembre 2018).
-
[133]
Julie Biron et Géraldine Goffaux Callebaut, « La juridicité des engagements socialement responsables des sociétés : regards croisés Québec-France », (2016) 57 C. de D. 457, 483 ; Alexandra Demoustiez, « Évolution sémantique de l’ISR », Réseau de financement alternatif, 2007, p. 3 et 4, [En ligne], [www.financite.be/sites/default/files/references/files/226.pdf] (14 mai 2018).
-
[134]
À titre d’exemple : Chris Gribben et Matthew Gitsham, « Will UK Pension Funds Become More Responsible ? A Survey of Trustees », Just Pensions, 2006.
-
[135]
Élisabeth Forget, « L’investissement éthique : implications en droit des sociétés », Revue des sociétés 2015.559.
-
[136]
I. Tchotourian, préc., note 25 ; Gilles L. Bourque et Corinne Gendron, « Une finance responsable à l’ère de la mondialisation économique », L’économie politique, no 18, 2003, p. 50, à la page 53.
-
[137]
Dans notre étude, les termes « finance responsable » et « finance socialement responsable » sont définis comme un concept désignant deux types de pratiques : le placement sur les marchés financiers et l’investissement par l’intervention financière directe dans des entreprises. La « finance solidaire », quant à elle, comprend plusieurs institutions, acteurs et outils destinés au financement des entreprises d’économie sociale (coopérative et OBNL) et du développement économique communautaire, et ce, en incluant le capital patient ou la quasi-équité afin de répondre aux besoins en investissement à long terme des entreprises collectives. Voir Claude Jr. Dostie, « Portrait 2016 de la finance responsable », Institut de recherche en économie contemporaine, 2017, p. 29, [En ligne], [www.irec.quebec/ressources/publications/pfr2016_vf_pdf.pdf] (12 février 2019).
-
[138]
Responsible Investment Association, « 2016 Canadian Impact Investment Trends Report », 2016, p. 8, [En ligne], [www.riacanada.ca/content/uploads/2018/10/Canadian-Impact-Investment-Trends-Report-final-v4-1.pdf] (12 février 2019).
-
[139]
Cela est encore plus vrai que divers travaux d’envergure ont démontré qu’il n’existe aucun obstacle à investir les champs environnementaux, sociaux et de gouvernance : United Nations Global Compact, « The Fiduciary Duty in the 21st Century », [En ligne], [www.unepfi.org/fileadmin/documents/fiduciary_duty_21st_century.pdf] (14 septembre 2018) ; Asset Management Working Group of the United Nations Environment Programme Finance Initiative, « Fiduciary Responsibility. Legal and Practical Aspects of Integrating Environmental, Social and Governance Issues into Institutional Investment », 2009, [En ligne], [www.unepfi.org/fileadmin/documents/fiduciaryII.pdf] (14 septembre 2018) ; Freshfields Bruckhaus Deringer, « A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social and Governance Issues into Institutional Investment », produit pour l’Asset Management Working Group of the United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2005, [En ligne], [www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf] (14 septembre 2018).
-
[140]
Benjamin J. Richardson, Socially Responsible Investment Law. Regulating the Unseen Polluters, New York, Oxford University Press, 2008.
-
[141]
United Nations Global Compact, préc., note 139, p. 9.
-
[142]
EU High-Level Expert Group on Sustainable Finance, Financing a Sustainable European Economy, 2018, p. 20. Au Canada, voir les recommandations (notamment la no 6) faites dans le rapport final du groupe d’experts sur la finance durable publié en juin 2019 (Gouvernement du Canada, rappport final du groupe d’experts sur la finance durable, 2019).
-
[143]
Anna Katharina Höchsdäter et Barbara Scheck, « What’s in a Name : An Analysis of Impact Investing Understandings by Academics and Practioners », Journal Business of Ethics, vol. 132, no 2, 2015, p. 449, à la page 456.
-
[144]
J.-L. Viviani, préc., note 15.
-
[145]
Paul Brest et Kelly Born, « When can Impact Investing Create Real Impact ? », Stanford Social Innovation Review, 2013, p. 22.
-
[146]
A.K. Höchsdäter et B. Scheck, préc., note 143, à la page 454.
-
[147]
Eurosif, « European SRI Study 2016 », 2016, [En ligne], [www.eurosif.org/wp-content/uploads/2016/11/SRI-study-2016-HR.pdf] (14 septembre 2018). À propos de la croissance de l’ISR, voir Russell Sparkes, « A Historical Perspective on the Growth of Socially Responsible Investment », dans Rory Sullivan et Craig Mackenzie (dir.), Responsible Investment, Sheffield, Greenleaf Publishing, 2006, p. 39.
-
[148]
J.-L. Viviani, préc., note 15.
-
[149]
David Cruickshank, « Societal Impact : Moving from “Nice-to-consider” to “Business Imperative” », Forbes, 22 janvier 2019, [En ligne], [www.forbes.com/sites/deloitte/2019/01/22/societal-impact-moving-from-nice-to-consider-to-business-imperative/#110dff6f4990] (5 février 2019).
-
[150]
Id.
-
[151]
A.K. Höchsdäter et B. Scheck, préc., note 143, aux pages 449 et 450.
-
[152]
Camille Guézennec et Guillaume Malochet, « L’impact investing pour financer l’économie sociale et solidaire ? Une comparaison internationale », Commissariat général à la stratégie et à la prospective, document de travail no 2013-02, p. 27-31.
-
[153]
Antoine de Salins, « L’investissement responsable, élément de réponse à la crise ? », dans Rapport moral sur l’argent dans le monde, Paris, Montchrestien, 2009, p. 197.
-
[154]
Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), « L’engagement en France et à l’étranger : exercice du droit de vote et dialogue. Montée en puissance des critères extra financiers », étude documentaire, 2011, p. 6.
-
[155]
RiskMetrics Group et autres, « Study on Monitoring and Enforcment Practices in Corporate Governance in the Member States », 2009, p. 15, [En ligne], [www.ecoda.org/uploads/media/REPORT_-_2009_09_23_CoE_RiskMetrics.pdf] (13 février 2019).
-
[156]
Filip Bekjarovski et Marie Brière, « Engagement actionnarial : pourquoi les investisseurs doivent-ils s’en préoccuper ? », Discussion Paper. CROSS ASSET Investment Strategy, 2017 ; Bennani Zineb, « État des lieux de l’engagement actionnarial en Europe », Mirova, 5 septembre 2014 ; Carine Girard et Julien Le Maux, « De l’activisme à l’engagement actionnarial », R.F.G.E. 2007.113. L’engagement doit être distingué de l’activisme. Contrairement à ce dernier, dont l’objectif premier demeure d’imposer un changement dans la gestion ou au sein de la direction ou du conseil, l’engagement implique un dialogue constructif entre l’entreprise et ses actionnaires sur un vaste champ de sujets : performance, rémunération, risque, rémunération des hauts dirigeants, gouvernance.
-
[157]
Novethic, « Les investisseurs en quête d’impacts. Stratégies, innovations et défis », 2017, p. 2, [En ligne], [www.novethic.fr/finance-durable/publications/etude/les-investisseurs-en-quete-d-impacts-strategies-innovations-et-defis.html] (13 février 2019).
-
[158]
Id., p. 10 : le fonds de pension suédois AP7 combine même l’investissement dans des projets d’effet social et l’engagement dans des entreprises pour les sensibiliser à ces enjeux.
-
[159]
Loi no 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, J.O. 10 déc. 2016.
-
[160]
Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, J.O. L 184/17 ; Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, J.O. L 132/1.
-
[161]
Patricia Charléty, « L’activisme actionnarial dans l’assemblée générale : quels bénéfices pour les actionnaires et les entreprises ? », Revue d’économie financière 2018.195, 198.
-
[162]
Christine Cooper, Cameron Graham et Brendan O’Dwyer, « Social Impact Bonds : Can Private Finance Rescure Publics Programs ? », dans Accounting, Organizations and Society Conference on “Performing Business and Social Innovation Through Accounting Inscriptions”, 2013 ; Ron Davies, « Social Impacts Bonds. Private Finance that Generates Social Returns », European Parliamentary Research Service, 2014, [En ligne], [www.europarl.europa.eu/EPRS/538223-Social-impact-bonds-FINAL.pdf] (14 septembre 2018).
-
[163]
Groupe d’étude canadien sur la finance sociale, préc., note 41.
-
[164]
Hans Deblieck et Denis Stokkink, « Social impact bonds : pour ou contre ? », dans Pour la solidarité, Européen think & do tank, note d’analyse, 2016, p. 4 ; Benjamin Le Pendeven, « Social Impact Bonds et Nouveau Management Public », Finance Contrôle Stratégie, no 5, 2019, p. 15.
-
[165]
Thomas Holtfort, Andreas Horsch et Martin Oehmichen, « Social Impact Bonds as a Financial Innovation – An Evolutionary Approach », International Public Management Review, vol. 18, no 2, 2018, p. 162, à la page 162.
-
[166]
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), « Understanding Social Impact Bonds », Working Paper, 2016, p. 4, [En ligne], [www.oecd.org/cfe/leed/UnderstandingSIBsLux-WorkingPaper.pdf] (14 septembre 2018).
-
[167]
T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, à la page 163.
-
[168]
I. Tchotourian, M. Racine et O. Sirois, préc., note 84, aux pages 455 et 456.
-
[169]
T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, à la page 163.
-
[170]
Id.
-
[171]
Saskatchewan, « New Home for Single Mothers Opens in Saskatoon ; Funding First of its Kind in Canada », 2014, [En ligne], [www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2014/may/12/social-impact-bond] (14 septembre 2018).
-
[172]
Ontario, « Projet pilote d’obligations à impact social en Ontario : démarche d’élaboration et leçons tirées », [En ligne], [www.ontario.ca/fr/page/projet-pilote-dobligations-impact-social-en-ontario-demarche-delaboration-et-lecons-tirees#fn1] (14 septembre 2018).
-
[173]
Corwyn Friesen, « Province Invites Ideas for Landmark Social Impact Bond », 2018, [En ligne], [www.mysteinbach.ca/news/2358/province-invites-ideas-for-landmark-social-impact-bond/] (14 septembre 2018).
-
[174]
Social Finance, « Social Impact Bonds Reach Global Mass : 108 Projects Launched in 24 Countries », [En ligne], [www.socialfinance.org.uk/sites/default/files/news/sf_gn_100_sibs_press_release_final_30_jan_18_1.pdf] (14 septembre 2018).
-
[175]
Commission de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique, « Rapport final du groupe d’experts », Organisation mondiale de la santé, 2016, p. 43, [En ligne], [apps.who.int/iris/bitstream/10665/250132/1/9789242511284-fre.pdf] (14 septembre 2018).
-
[176]
T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, à la page 167.
-
[177]
Orly Mazur, « Taxing Social Impact Bonds », (2017) 20 Florida Tax Review 431, 60.
-
[178]
T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, à la page 181.
-
[179]
Julia Posca, « L’arnaque des obligations à impact social », IRIS, 30 novembre 2018, [En ligne], [www.iris-recherche.qc.ca/blogue/l-arnaque-des-obligations-a-impact-social] (3 février 2018).
-
[180]
T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, à la page 181.
-
[181]
Daniel Edmiston et Alex Nicholls, « Social Impact Bonds : The Role of Private Capital in Outcome-based Commissioning », Journal of Social Policy, vol. 47, no 1, 2018, p. 57, à la page 58.
-
[182]
Pour certains, le court-termisme serait ainsi le responsable principal de la crise économique et financière de 2007-2008 : Alfred Rappaport, Saving Capitalism from Short-Termism. How to Build Long-Term Value and Take back our Financial Future, New York, McGraw-Hill, 2011.
-
[183]
John Kay, The Kay Review of UK Equity Markets and Long-term Decision Making, 2012, p. 10, [En ligne], [www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253454/bis-12-917-kay-review-of-equity-markets-final-report.pdf] (14 septembre 2018). Le Parti travailliste a aussi fait établir un rapport sur le même sujet : Sir George Cox, « Overcoming Short-termism within British Business. The Key to Sustained Economic Growth », Labour Policy Review, 2013, [En ligne], [www.yourbritain.org.uk/uploads/editor/files/Overcoming_Short-termism.pdf] (14 septembre 2018).
-
[184]
Pierre Vercauteren, « Crise financière et crise multiple : la gouvernance globale et l’intervention de l’État », dans V. Dujardin et autres (dir.), préc., note 131, p. 177.
-
[185]
Christian de Perthuis et Jean-Pierre Petit, La finance, autrement : mécanismes, acteurs et dérives de la finance contemporaine, Paris, Dalloz, 2005.
-
[186]
Albert Jacquard, J’accuse l’économie triomphante, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
-
[187]
Paul Le Cannu et Bruno Dondero, Droit des sociétés, 6e éd., Paris, Lextenso, 2015, no 281, p. 191 et 192.
-
[188]
Catherine Caron, « Halte au capitalisme vert », Relations, no 777, 2015, p. 12, à la page 13.
-
[189]
Y.D. Somé, préc., note 23, à la page 103.
-
[190]
Sarah Dadush, « Regulating Social Finance : Can Social Stock Exchanges Meet the Challenge ? », (2015) 37 U. Pennsylvania J. Int’l L. 139, 140.
-
[191]
Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Paris, Gallimard, 1976, p. 256.
-
[192]
J. Defourny et M. Nyssens, préc., note introductive. Voir aussi les écrits suivants : Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la mondialisation, Montréal, Éditions Thémis, 2008 ; Boaventura de Sousa Santos, « Droit : une carte de la lecture déformée. Pour une conception post-moderne du droit », (1988) 10 Droit et société 363 ; Jacques Chevallier, « Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique », R.D.P. 1988.659 ; Robert C. Ellickson, Order without Law, Cambridge, Harvard University Press, 1991.
-
[193]
Sur un sujet à la périphérie du droit des sociétés par actions stricto sensu, l’émergence de la question de l’acceptabilité sociale des projets miniers est en effet étroitement liée à la montée du discours de la RSE et de la prise en considération de parties prenantes : David Bursey, « Rethinking Social Licence to Operate – A Concept in Search of Definition and Boundaries », Environment and Energy Bulletin, vol. 7, no 2, 2015 ; Sara L. Seck, « Home State Responsibility and Local Communities : The Case of Global Mining », (2008) 11 Yale Human R’ts & Dev. L.J. 177, 198. L’acceptabilité sociale est le résultat d’un processus par lequel les parties visées construisent ensemble les conditions minimales à mettre en place pour qu’un projet, un programme ou une politique s’intègre harmonieusement, et à un moment donné, dans son milieu naturel et humain : Julie Caron-Malenfant et Thierry Conraud, Guide pratique de l’acceptabilité sociale : pistes de réflexion et d’action, Montréal, Éditions D.P.R.M., 2009, p. 14.
-
[194]
Alain Delmas, La RSE : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale, Paris, Éditions des journaux officiels, 2013.
-
[195]
X. Dieux, préc., note 11, p. 162.
-
[196]
Mireille Delmas-Marty, Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme, Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 245 et 246.
-
[197]
T. Holtfort, A. Horsch et M. Oehcmichen, préc., note 165, à la page 181.
-
[198]
Sur ce rôle du droit, voir Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, Paris, Gallimard, 2015, p. 25.
-
[199]
Alain Supiot, « Introduction », dans Alain Supiot (dir.), La solidarité. Enquête sur un principe juridique, Paris, Éditions Odile Jacob, 2015, p. 8, aux pages 24 et suiv.
-
[200]
La certification B Corp connaît de plus en plus de succès auprès des entreprises canadiennes. Le Canada fait partie des plus grandes communautés du mouvement B Corp. « En effet, avec ses quelque 167 entreprises certifiées, le Canada est la seconde plus grande communauté au monde. La Colombie-Britannique et l’Alberta représentent 35 % d’entre elles. Ce mouvement est aussi en train de gagner peu à peu le Québec […] En l’espace d’à peine quatre ans, le Québec est passé à une dizaine d’entreprises ayant obtenu la certification B Corp » : Delphine Poiré Turcotte, La place de B Corp au Québec : analyse comparative de normes et référentiels de développement durable, essai de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 2017, p. 20.
-
[201]
La théorie du signal trouve ses origines dans les sciences économiques et financières : Michael Spence, « Job Market Signaling », The Quarterly Journal of Economics, vol. 87, no 3, 1973, p. 355. Selon cette théorie, en raison de l’asymétrie sur le marché pour l’information, les organisations se pensant les meilleures en font la preuve aux investisseurs dans le but d’améliorer leur réputation : David Campbell, Philip Shrives et Heike Bohmbach-Saager, « Voluntary Disclosure of Mission Statements in Corporate Annual Reports : Signaling what and to whom ? », Business & Society Review, vol. 106, no 1, 2001, p. 65.
-
[202]
À propos précisément des entreprises à mission sociétale, voir : J. Haskell Murray, « Defending Patagonia : Mergers and Acquisitions with Benefit Corporations », (2013) 9 Hastings Bus. L.J. 485, 505-507 ; Joseph W. Yockey, « Does Social Enterprise Law Matter ? », (2015) 66 Alabama L. Rev. 767.
-
[203]
Sur cette idée, voir Emmanuel Dockes, « La résistance des valeurs humaines », dans Éric Loquin et Catherine Kessedjian (dir.), La mondialisation du droit, Paris, Litec, 2000, p. 461.
-
[204]
Alain Supiot, Homo juridicus : essai sur la fonction anthropologique de droit, Paris, Seuil, 2005, p. 31.
-
[205]
H. Deblieck et D. Stokkink, préc., note 164, à la page 10.
-
[206]
Social Impact Investment Taskforce, « Impact Investment : The Invisible Heart of Markets. Harnessing the Power of Entrepreneurship, Innovation and Capital for Public Good », 2014, [En ligne], [impactinvestingaustralia.com/wp-content/uploads/Social-Impact-Investment-Taskforce-Report-FINAL.pdf] (14 septembre 2018).
-
[207]
D. Demoustier et G. Colletis, préc., note 45, à la page 34.
-
[208]
Charley Hannoun, « Le droit des sociétés à l’épreuve de la modernité », dans Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit, Paris, Litec, 2009, p. 309, à la page 311.
List of figures
Figure
Le lancement des contrats à effet social : Royaume-Uni et reste du monde
List of tables
Tableau 1
Les indicateurs de l’organisation d’économie sociale et solidaire
Tableau 2
L’investissement responsable au Québec de 2013 à 2016
* Les montants d’actifs et d’investissements de 2013 ont été rétroactivement modifiés pour la présente édition du portrait. Nous avons reconsidéré la couverture des actifs et des investissements inclus dans notre enquête, tout particulièrement ceux provenant des sociétés d’État (Investissement Québec et Fonds d’investissement pour la culture et communication). Comme vu précédemment, la frontière entre le capital de développement et la finance solidaire est mouvante. Aussi, nous avons profité de ce nouveau portrait pour reclasser certaines institutions entre les deux composantes de l’investissement responsable, plus spécifiquement les fonds locaux de solidarité.
Tableau 3
Synthèse comparative entre un contrat à impact social et un partenariat public-privé
Synthèse comparative des entreprises à mission sociétale