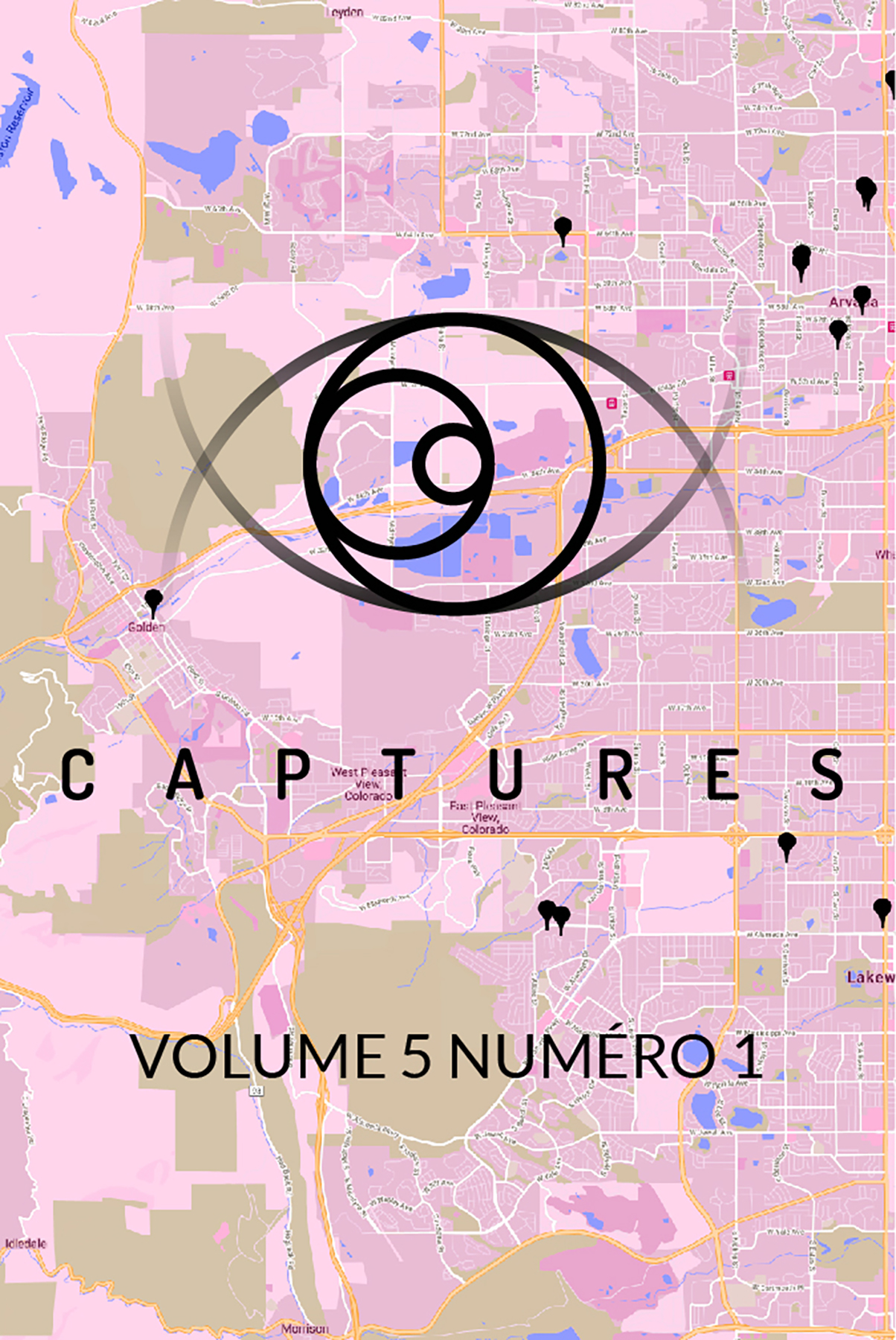Abstracts
Résumé
Cet article analyse le film How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File qui, au-delà de ses apparences absurdes et humoristiques, offre une réflexion sur deux concepts émergents en art vidéo, celui du seuil de visibilité et celui d’inforensique. Pour ce faire, l’auteur retrace l’origine des images assemblées et problématise leurs liens avec l’histoire de la photographie aérienne et avec celle de la cartographie. Il examine également le sens des références symboliques et métaphoriques qui indiquent les échanges entre les mondes réel et virtuel.
Abstract
This article explores the fact that the film How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, beyond its absurd and humorous appearances, offers a reflection on two emerging concepts in video art, that of the threshold of visibility and the inforensic. To do this, the author traces the origin of the assembled images and problematizes their attachment to the histories of surveillance photography and cartography. He also examines the symbolic and metaphorical references which indicate the exchanges between the real and the virtual worlds.
Article body
How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File est une oeuvre vidéo réalisée en 2013 par l’artiste et théoricienne Hito Steyerl. Ce film, d’une durée de 15 minutes et 52 secondes, est composé de tutoriels humoristiques pour échapper au regard, à l’enregistrement et, donc, à la surveillance opérés grâce aux technologies numériques. L’oeuvre offre une vision évocatrice dans laquelle le monde des images se superpose au monde réel, jusqu’à le remplacer. Ainsi, cet article propose une analyse de la manière dont How Not to Be Seen illustre le dédoublement des mondes virtuel et réel, ainsi que leurs interactions à travers des repères cartographiques présents sur des lieux physiques spécifiques. Il s’agit de montrer comment le film soulève en parallèle des questions géopolitiques concernant l’omniprésence des caméras dans les pratiques de surveillance militaire et étatique.
Le titre de la vidéo fait référence à l’épisode « How Not to Be Seen » (saison 2, épisode 11, 1970) de la célèbre série humoristique Monty Python’s Flying Circus (Ian MacNaughton et John Howard Davies, 1969-1974). Ce sketch est réalisé dans les années 70, alors que les effets spéciaux commencent à être médiatisés sur petit écran. Parodiant des films d’intérêt public du gouvernement britannique (Public information films) qui étaient diffusés à la télévision, les Monty Python y sensibilisent les spectateurs sur l’importance d’être invisible. Le narrateur, John Cleese, demande à des personnages cachés d’apparaitre à l’image, suite à quoi une explosion est déclenchée, provocant leur « extermination » virtuelle et les faisant ainsi disparaitre.
Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (2 min 21 s) (2013), Capture d'écran par Fanny Bieth tirée de l’oeuvre vidéo How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, 15 min 10 s, Image numérique | 2560 × 1440 px
Dans les sociétés occidentales, la collecte de données et d’images est de plus en plus importante et elle est très souvent le fruit de la coopération des États avec des entreprises telles que Google. Les technologies de surveillance aérienne, ainsi que les profils de reconnaissance biométrique et numérique, font partie des sources de renseignements sur les individus et peuvent servir de preuves judiciaires. Les données et les images sont actualisées quotidiennement et ont des répercussions tant dans la sphère virtuelle que dans le monde réel :
Data, sounds, and images are now routinely transitioning beyond screens into a different state of matter. They surpass the boundaries of data channels and manifest materially. […] Images become unplugged and unhinged and start crowding off-screen space. They invade cities, transforming spaces into sites, and reality into realty. They materialize as junkspace, military invasion, and botched plastic surgery.
Steyerl, 2013b
Dans How Not to Be Seen le montage des images est foisonnant et rythmé par des références à des éléments de la culture visuelle numérique contemporaine. L’atmosphère générale peut être qualifiée d’humoristique. L’artiste établit des analogies entre des signifiants des cultures japonaise et anglo-saxonne et des instruments de surveillance. La vidéo est structurée en cinq chapitres, cinq « leçons » introduites par Steyerl mimant des manières d’échapper aux objectifs omniprésents des appareils de prise de vues. L’artiste apparait vêtue d’une tenue traditionnelle japonaise, qui rappelle le samue des moines shintoïstes, la tenue des karatékas ou encore celle portée par les samouraïs lors de leur entrainement au tir à l’arc (kyūjutsu).
Une grande partie de la vidéo a été réalisée à l’aide d’un écran d’incrustation vert, outil facilitant l’intégration dans l’image d’autres éléments, filmés ou créés séparément. À ces images se superposent des voix de synthèse générées par ordinateur, l’une masculine, l’autre féminine. Leur prosodie s’éloigne des intonations et des rythmes naturels de la parole, ce qui crée une distance entre l’auteure, Steyerl, et les voix robotiques des deux narrateurs. Afin d’accentuer la tension dramatique provoquée par l’écriture du film, souvent elles se font entendre seules, dégagées d’autres effets sonores : « Today most important things want to remain invisible: love is invisible, war is invisible, capitalism is invisible. » (3 min 10 s) Ce faisant, Steyerl s’inscrit dans une mouvance actuelle en art vidéo qui adopte délibérément la tessiture et l’esthétique anonyme de la synthèse vocale pour interroger la surveillance étatique moderne. On peut citer notamment l’oeuvre Facial Weaponization Communiqué: Fag Face (2012) de l’artiste et enseignant à la Goldsmiths University of London, Zach Blas. Dans cette vidéo, une voix de synthèse déclare : « Today, in our world of information, capital and global empire, biometric control has emerged as a golden frontier for global governments. » (0 min 20 s)
Dans le deuxième chapitre de son film, intitulé « Making Something Invisible in Plain Sight » (1 min 58 s), les mouvements de Steyerl miment ceux nécessaires à la manipulation des images dans les dispositifs numériques tels que les téléphones cellulaires, créant une chorégraphie dont les effets sont accentués par le décalage de la trame sonore rappelant une musique cérémoniale japonaise. La chorégraphie de Steyerl évoque les gestes des agents de bord montrant les étapes à suivre lors de l’évacuation d’un avion. Mais cette autoreprésentation robotique et absurde donne surtout l’impression que l’artiste a été remplacée par un avatar virtuel, un corps dont les gestes ne sont plus naturels. À l’origine, un avatar est une figure religieuse hindoue qui désigne l’incarnation d’un dieu sur Terre, mais, avec l’arrivée du numérique, le terme s’emploie désormais aussi pour parler d’un double virtuel, dans les jeux vidéo surtout.
Dans le quatrième chapitre, « How to Be Invisible by Disappearing » (7 min 15 s), le film parodie une publicité pour une communauté fermée. Les images de synthèse en trois dimensions simulent une vie de quartier idéalisée. Ce choix esthétique rappelle les jeux vidéo de simulation de vie, tels que The Sims (Will Wright, 2000-). La ville reprend les codes d’urbanisme des quartiers sécurisés, disposant de vidéosurveillance et de gardiennage. Des personnages vêtus de tenues inspirées à la fois des kimonos et des burqas cohabitent avec des silhouettes translucides. Ensemble, ils déambulent dans cet espace hybride, apparemment sans but précis. Les affiches publicitaires 3D, imitant grossièrement celles des enseignes de luxe, accomplissent une fonction de mise en abyme des centres commerciaux contemporains. L’esthétique sommaire de ces architectures 3D semble ainsi caricaturer la société de consommation. La juxtaposition d’une esthétique numérique avec des éléments matériels problématise l’étanchéité entre les mondes réel et virtuel, notamment à travers la surveillance qui s’opère depuis les dispositifs technologiques. En effet, on a l’impression, dans le film, que le monde virtuel de la communauté fermée vient d’être pollué et dénaturé par des mercenaires, qui s’y faufilent tout en cherchant à dissimuler leur identité. La problématisation est double : la vidéo nous propose des possibilités d’échapper au monde réel, mais le monde virtuel n’y semble pas plus rassurant. Steyerl s’interroge sur le dédoublement du monde contemporain et le franchissement constant de la frontière entre le réel et le virtuel. Cette vidéo offre une réflexion approfondie sur deux concepts émergents en art vidéo, ceux de « seuil de visibilité » et d’« inforensique » (Keenan et Steyerl, 2014).
Le seuil de visibilité dans le champ artistique
Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (11 min 05 s) (2013), Capture d'écran par Fanny Bieth tirée de l’oeuvre vidéo How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, 15 min 10 s, Image numérique | 2560 × 1440 px
Le terme de « seuil » fait référence à une frontière entre deux espaces, deux organes, deux entités, deux états. Le « seuil de visibilité » désigne la limite à partir de laquelle une chose devient invisible, ne peut plus être captée par l’oeil ou par l’objectif (le seuil de visibilité est différent pour un oeil humain et pour un appareil photo, par exemple). Dans le champ de la photographie cartographique, ce concept est apparu dans le langage militaire dans les années 60 avec les débuts de l’utilisation de la photographie analogique aérienne. Il désigne alors le calibrage au sol nécessaire à la mise au point pour qu’un territoire apparaisse net sur l’image. L’évolution rapide des technologies de captation photographique a entrainé un repoussement incessant du seuil de visibilité dans les champs de la numérisation, de la modélisation 3D ou encore de la cartographie. Ces technologies sont d’abord utilisées par les entités militaires et étatiques, avant d’être diffusées dans la sphère publique, à travers la plateforme de cartographie Google Maps par exemple.
Les mires de calibrage sont des instruments servant à régler la mise au point des appareils d’enregistrement afin d’en augmenter la précision lors des prises de vues. Elles recèlent un pouvoir politique au-delà de leur utilité pratique. La surface des mires de calibrage peut comprendre des marques et des formes variées, des références de couleur, une barre graphique métrique, des motifs géométriques pour l’étalonnage de la profondeur et un objet d’échelle avec une référence de taille. Ces paramètres varient en fonction des modèles (Greicius, 2012). Les mires peuvent être peintes au sol, pour effectuer des calibrages aériens, ou prendre la forme de panneaux plus petits, pour faire des mises au point en studio photographique. Les premières mires destinées au calibrage aérien étaient analogiques et leur seuil de visibilité était égal à douze mètres, puisqu’en dessous de cette dimension les objets photographiés (maisons, chemins, hangars, etc.) n’apparaissaient pas à l’image. La photographie numérique a entrainé la création de nouvelles mires, qui mesurent désormais le seuil de visibilité en pixels. Un pixel peut correspondre à plusieurs mesures réelles, dépendamment de la résolution de l’appareil photographique et des lois de chaque pays. En 2014, la société de satellites états-uniennes Digital Globe a obtenu l’autorisation de produire des images ayant une résolution d’environ 31 centimètres par pixel (s.a., 2014. Elles sont parvenues à convaincre que l’identité des individus resterait masquée à cette résolution. Le satellite européen Pléiades, non concerné par la levée des restrictions états-uniennes, continue de fournir depuis 2011 des images de 50 centimètres par pixel.
Le seuil de visibilité émerge dans le discours et dans la pratique en art numérique au cours des années 2010. Parmi ses théoriciens, on compte l’architecte israélien Eyal Weizman qui offre une définition de ce concept prenant en compte sa dimension politique et judiciaire. Il décrit des fissures géographiques comme des espaces permettant d’échapper à la visibilité. Weizman est l’un des fondateurs du groupe de recherche Forensic Architecture, avec lequel ont travaillé Hito Steyerl et le chercheur Thomas Keenan. Les travaux du groupe prennent comme point de départ les rapports entre architecture et géopolitique, mais les champs de recherche et les projets sont multiples. Les pratiques de reconstitution cartographique de Forensic Architecture sont faites avec les mêmes outils de modélisation et de photogrammétrie que ceux utilisés par beaucoup d’artistes contemporains pour créer, entre autres, des environnements 3D, des cartographies 2D et 3D, ainsi que des oeuvres en réalité virtuelle. Quelles sont, pour les artistes, les implications et possibilités plastiques de ces outils de création numérique et cartographique?
Weizman introduit le concept « forensic » dans le cadre de sa pratique d’une architecture forensique, qui envisage les environnements bâtis et naturels comme des pièces à conviction (Weizman, 2012). Il propose de lire la surface de la Terre comme un document en transformation constante. La Terre posséderait ainsi une « capacité sensorielle » qui, selon lui, peut être interrogée par le biais des images photographiques, des cartographies et des témoignages. Pour mieux saisir les questionnements liés à l’architecture forensique, Eyal Weizman et le photographe Fazal Sheikh, dans The Conflict Shoreline (2016), s’intéressent à la manière dont des populations bédouines échappent aux appareils photographiques des forces aériennes grâce à la métamorphose constante du territoire saharien. Les conditions climatiques et la transformation des espaces par la main de l’Homme reconfigurent régulièrement le désert et, par conséquent, font passer les populations bédouines sous le seuil de visibilité, dans ces fissures physiques. Weizman s’intéresse aussi aux fissures présentes sur la surface de la Terre, telles que les traces de bombardements ou d’incendies, qu’il comprend comme les témoignages de mécanismes de violence (Weizman, 2015). Ces fissures sont visibles et invisibles en même temps : enregistrées par le biais de la photographie aérienne, elles demeurent floues. Quand les pouvoirs étatiques nient l’existence des violences à travers l’invisibilisation des documents photographiques et que les victimes ne peuvent pas prouver les violences subies, telles que les déterritorialisations forcées, une relation émerge entre le seuil du désert et le seuil de la loi (Thiermann, 2016).
Si des données telles que le changement climatique, l’érosion ou encore des évolutions démographiques permettent aux chercheurs d’expliquer la transformation d’un territoire et peuvent, dans certains cas, faire office de pièces à conviction dans des affaires judiciaires, dans la sphère artistique, les créateurs numériques se servent des outils de reconstitution des espaces architecturaux et cartographiques pour mener une recherche plastique qui problématise notre rapport au territoire et la manière dont on le conceptualise. Ainsi, Hito Steyerl, particulièrement dans How Not to Be Seen, bouleverse le rapport au seuil de visibilité : plutôt que de nous montrer comment certaines populations échappent à la surveillance, elle crée un monde dans lequel les images numériques sont des territoires à part entière, des espaces architecturaux spéculatifs. Le seuil de visibilité devient un outil qui permet de montrer la porosité de la frontière entre le monde des images et le monde réel. Cette porosité métaphorique opère grâce à une série de points cartographiques réels se trouvant dans des endroits où des opérations liées à la surveillance étatique ont eu lieu.
Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (1 min 16 s) (2013), Capture d'écran par Fanny Bieth tirée de l’oeuvre vidéo How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, 15 min 10 s, Image numérique | 2560 × 1440 px
En effet, dans son oeuvre, Steyerl témoigne de son intérêt pour le concept de seuil de visibilité en inventant un langage métaphorique et pédagogique à partir de plusieurs éléments, dont une mire de calibrage. La corrélation entre développements technologiques et seuil de visibilité est explicitée à travers la monstration de ces artefacts. Deux mires de calibrage au sol apparaissent dans How Not to Be Seen. La première est fabriquée par Gurley Precision Instruments et est utilisée par les forces aériennes états-uniennes depuis 1951 (Rees, 2012 [2001]). Toutes deux se situent dans le désert de Mojave en Californie, un endroit que l’on peut apercevoir également dans le film In Free Fall réalisé en 2010 par Hito Steyerl. Le désert de Mojave est une grande étendue de 40 000 km2, au coeur de laquelle se trouve la Edwards Air Force Base, qui héberge plusieurs organisations telles que la United States Air Force et le Neil A. Armstrong Flight Research Center de la NASA. C’est l’une des principales zones de développement et d’essais pour les avions de surveillance (Zhang, 2013). Certains avions fabriqués par les États-Unis, comme le sophistiqué Blackbird, sont non armés, et conçus uniquement pour être utilisés comme des caméras volantes. Quinze mires de calibrage se trouvent réparties sur une zone de 32 kilomètres de long dans la Edwards Air Force Base. Leurs tailles varient entre 15 et 25 mètres de largeur et leurs marquages sont composés à partir d’un recouvrement de peinture noir et blanc. La disposition des mires permet à un seul avion d’en utiliser plusieurs sans avoir à changer de cap. Ces cibles ont été principalement utilisées pendant les années 50 et 60 pour faire la mise au point des prises de vues aériennes, mais certaines d’entre elles sont encore utilisées pour calibrer des drones (Zhang, 2013). Certaines zones à proximité des mires de calibrage apparaissant dans la vidéo de Steyerl sont floutées sur Google Maps. Malgré leur accessibilité apparente sur cette plateforme numérique, elles appartiennent à une administration étatique et sont destinées à l’usage des forces militaires.
Le paradoxe du désert. Entre invisibilité et fiction
Dans How Not to Be Seen, le désert, avec la présence des mires et des bases militaires, semble être un lieu favorisant la surveillance étatique aérienne; tandis que pour Weizman et Fazal Sheikh (2016), il est un lieu de transhumance et de résistance. Ces deux exemples exposent les paradoxes de ce type de territoire. Mais Steyerl montre le désert comme potentiellement opaque et résistant à la surveillance en y installant un studio photographique nomade avec un écran vert (10 min 45 s), comme si le désert pouvait contenir une « oasis » d’invisibilité; tandis que Weizman montre que la situation des peuples bédouins, au seuil de la visibilité du fait de leur existence nomade, est saisie comme une excuse de la part des États pour exercer davantage de contrôle. La relation entre pouvoir étatique et développement des technologies cartographiques est une problématique constante depuis l’invention de la photographie (Azoulay, 2019). Au fur et à mesure du développement photographique numérique, de nouvelles technologies de captation émergent, repoussant les seuils de visibilité et déterminant parfois arbitrairement ce qui doit demeurer invisible. Le langage plastique d’Hito Steyerl pourrait être interprété comme une approche archéologique des technologies cartographiques. Sa pratique réinsère des enjeux politiques et historiques dans le champ photographique, dont on considère souvent que les implications esthétiques devraient primer.
Dans les deux premiers chapitres de sa vidéo, Steyerl a ajouté des effets qui indiquent visuellement le seuil entre le réel et le virtuel. Grâce à l’alternance et à la juxtaposition des images, une mire de calibrage miniature se transforme en surface d’incrustation (1 min 08 s) puis le fond vert devient lui-même mire de calibrage (2 min 05 s). Le montage crée ensuite un effet de contraste entre la réalité matérielle des mires miniatures, dont l’aspect est propre et industriel, et les mires au sol, craquelées et travaillées par les actions de la nature. En effet, ces mires de calibrage ont subi un vieillissement et ne semblent dès lors plus fonctionnelles (3 min 04 s). Dans le désert de Mojave, en dehors de la Edwards Air Force Base, seules trois mires peintes au sol sont encore présentes et elles apparaissent dans la vidéo de Steyerl. Se trouvant à Cuddeback Lake, ces mires sont des reliques de l’histoire de la photographie aérienne et de la cartographie. Parmi l’ensemble des mires, celles-ci sont les seules auxquelles on peut accéder sans avoir besoin d’une autorisation de l’armée et que l’on peut voir sur la plateforme Google Maps. Leur documentation permet d’en interroger les enjeux politiques et de les comprendre comme des vestiges géologiques que les avancées photographiques ont laissés derrière elles.
On pourrait considérer le deuxième chapitre de la vidéo comme une réappropriation métaphorique de cet espace : Steyerl s’empare de la mire de calibrage, qui, débarrassée de son utilité première, se retrouve réinvestie par une esthétique contemporaine. En effet, on constate, dans la vidéo, un colmatage des fissures à la surface grâce à l’incrustation d’autres images (14 min 30 s). Si, pour Weizman, les fissures sont des espaces flous et insaisissables, qui échappent aux visées totalitaires du contrôle aérien cartographique, pour Steyerl, elles sont une preuve de l’obsolescence des systèmes cartographiques. À travers son langage plastique utilisant les nouvelles technologies, elle nous invite à nous questionner sur notre place actuelle dans le flux de cartes, d’images et de divertissements.
Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (7 min 04 s) (2013), Capture d'écran par Fanny Bieth tirée de l’oeuvre vidéo How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, 15 min 10 s, Image numérique | 2560 × 1440 px
Dans la vidéo, l’énonciation d’une posture critique par rapport à la surveillance « totalitaire » est parodiée à travers une danse burlesque où des comédiens portent des masques que l’on pourrait qualifier de « ready-made » : il s’agit en effet de rangements cubiques en tissu convertis en masques. Les danseurs incarnent trois pixels disposés devant une mire de calibrage numérique (6 min 11 s). « To become invisible, one must become equal or smaller than one pixel », affirme le narrateur de la vidéo (6 min 10 s). Est-ce pour indiquer qu’une des clés pour réussir sa disparition, si tel est notre désir, serait de tromper les capteurs de la surveillance photographique? Comment traiter l’incidence des images virtuelles dans le réel? Comment qualifier les points de concomitance entre le réel et le virtuel? Où se situe le seuil séparant l’un et l’autre? Comment franchir le seuil de la visibilité? L’écran vert et la mire de calibrage : voilà des exemples d’éléments qui permettent aux images d’être plus précises, voire d’être métamorphosées, d’acquérir une autre nature, et dans le cas de How Not to Be Seen, de disparaitre. Ils agissent comme des portes d’accès au monde immatériel des images.
D’autres fissures d’invisibilité nous sont proposées par Steyerl, ce sont les moments créés par le détournement de l’utilité première des outils numériques (9 min 55 s). Cependant, nous sommes invités à nous méfier de ces espaces intangibles, car l’invisibilité est toujours relative, elle pourrait être rompue si une nouvelle technologie venait à repousser le seuil de visibilité. Hito Steyerl n’appelle pas seulement à disparaitre pour éviter d’être surveillé, il ne s’agit pas uniquement de franchir le seuil entre les espaces physiques et les univers virtuels, mais d’utiliser le vide créé par ces interstices, ces fissures numériques depuis lesquelles les personnages, humains et animaux virtuels, s’immiscent dans le monde réel, le transforment (Thiermann, 2016).
L’inforensique. À la limite de l’acte performatif?
Nous pouvons ainsi réfléchir aux fissures proposées par Steyerl non seulement comme des entités spatiales, mais aussi comme des matériaux forensiques, des documents. Le mot anglais « forensic » vient du latin « forum » et fait référence à la capacité de présenter un argument devant une instance politique ou légale (Weizman, 2012: 15). Dans la rhétorique classique, l’orateur présentait des objets devant une instance et les faisait parler en ayant recours à une figure de style appelée « prosopopée », qui consiste à faire parler un objet en lui prêtant sa voix. Il s’agit là, selon Weizman d’un processus de traduction, de médiation et d’interprétation entre la langue des choses et celle des humains :
The forum, in turn, is a composite apparatus. It is constituted as a shifting triangulation between three elements: a contested object or site, an interpreter tasked with translating “the language of things,” and the assembly of a public gathering. Forensis thus establishes a relation between the animation of material objects and the gathering of political collectives.
9
L’image photographique entre dans les tribunaux au XIXe siècle, rapidement après son invention. Elle a longtemps été considérée comme un document objectif en soi, jusqu’à ce que d’autres indices criminalistiques et biométriques se développent et relèguent l’image au champ esthétique. Ainsi, à l’ère numérique, l’image photographique soulève de la méfiance et n’est plus synonyme de preuve incontestable, notamment à cause des outils permettant de modifier l’image, souvent de manière quasi imperceptible.
Richard Helmer, Montage réalisé à partir de la superposition d'un portrait de Josef Mengele et de l'image de son crâne (1985), Image tirée du montage vidéo réalisé dans les laboratoires de l’Institut médico-légal de São Paulo en Juin 1985, Reproduction numérique | 962 × 1358 px
Dans Mengele’s Skull. The Advent of a Forensic Aesthetics (2012), Eyal Weizman et Thomas Keenan analysent le jugement des tribunaux concernant la reconnaissance du crâne de Josef Mengele durant le procès qui a eu lieu en 1985. Les nouvelles technologies ont joué un rôle décisif dans la reconnaissance du crâne et l’inculpation post-mortem de Mengele : la technique de superposition d’images a produit de nouvelles formes d’argumentation et de preuves. En 1977, le scientifique forensique et photographe amateur allemand Richard Helmer, en collaboration avec le scientifique Oskar Grüner, avait mis au point un système de superposition électronique d’images vidéo permettant l’identification d’un crâne. C’est cette technique qui a été employée dans le cas de Josef Mengele. Le système repose sur deux caméras montées sur des rails, l’une est focalisée sur le crâne et l’autre sur la photo du sujet présumé. Les signaux des deux appareils se mélangent, superposant les deux images pour produire une image hybride et translucide, qui, à son époque, fut présentée comme une preuve formelle. L’aspect du portrait, mi-défunt, mi-vivant, à la fois fantomatique et réaliste, faisait apparaitre le crâne comme une présence spectrale devant la cour (Keenan et Weizman, 2012: 38). La prosopopée effectuée par certains intervenants dans les tribunaux n’est plus simplement un geste de rhétorique : l’objet devient par l’intermédiaire de l’orateur, ici le scientifique, une sorte de super-objet.
Ce processus d’identification des restes est à l’origine d’un changement de paradigme historique, juridique et esthétique dans les recherches criminalistiques. Celles-ci se basent dès lors non plus seulement sur un document mais sur un type d’expertise nouveau, automatisé ou semi-automatisé, portant sur un « objet », ici les ossements. Ce processus spéculatif et d’analyse des pièces à conviction a ainsi changé la manière dont les faits juridiques sont construits et son résultat a inauguré une sensibilité culturelle, une éthique et une esthétique politique qui se sont étendues depuis le champ juridique jusque dans la sphère artistique (Keenan et Weizman, 2012: 14).
Weizman signale l’ambigüité des objets tels que les os lorsqu’ils sont présentés comme preuves. Malgré les informations objectives qu’on peut en tirer, une subjectivité les hante encore et, par conséquent, ils ne permettent pas l’affirmation d’une vérité absolue (62-63). Ceci est éclairant pour comprendre la manière dont les artefacts photographiques du passé, tels que les mires de calibrage du désert de Mojave, viennent hanter et interroger les technologies cartographiques et de surveillance. La forensique n’est pas simplement de la science, mais comprend également la présentation d’une découverte scientifique : « The making of facts depend on a delicate aesthetic balance, on new images made possible by new technologies, not only changing in front of our very eyes – affecting the way we see and comprehend things. » (Keenan et Weizman, 2012: 24) La forensique, de même que la science en général, peut être comprise comme un art de persuasion et, par conséquent, un acte performatif, au sens de la performance artistique. Cela nous amène à repenser notre conception de la science et à en reconnaître le caractère subjectif.
Pour sa part, Vincent Lavoie transpose la forensique à la sphère artistique et affirme que l’image n’est plus le siège de la croyance absolue, notamment depuis l’affaire du crâne de Mengele. Dans l’article « Forensique, représentations et régimes de vérité » (2013), il étudie certaines propositions artistiques, surtout des oeuvres photographiques qui se présentent sous la forme métaphorique de scènes de crime, et s’interroge sur le rôle de l’image dans les discours de vérité et sur celui du spectateur en tant qu’arbitre ou juge. Aujourd’hui, les images sont mises au service de la surveillance et l’attestation de leur authenticité est soumise à des protocoles précis. La mise en pratique de ces protocoles d’investigation relève de l’« inforensique », contraction des termes « informatique » et « forensique ». Pour Pierre Fargeaud, « [l]’inforensique peut se définir comme l’ensemble des connaissances et méthodes qui permettent de collecter, conserver et analyser des preuves issues de supports numériques en vue de les produire dans le cadre d’une action en justice » (Fargeaud, 2007). Les instruments de l’inforensique cherchent des détails enfouis dans les composants des fichiers et documents, ce sont, entre autres, les garants et les sentinelles de la vérité en image.
Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (5 min 01 s) (2013), Capture d'écran par Fanny Bieth tirée de l’oeuvre vidéo How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, 15 min 10 s, Image numérique | 2560 × 1440 px
Dans How Not to Be Seen, les éléments relevant de l’inforensique sont renversés. Contrairement au cas de Mengele — pour lequel le scientifique Helmer se transforme en « artiste », produisant des images ayant une dimension esthétique —, c’est en prenant un rôle d’experte que la plasticienne étaye et examine les documents que sont les lieux géographiques du développement cartographique numérique. Dans cet objet hybride qu’est How Not to Be Seen plusieurs registres d’images sont juxtaposés : images d’archives, reproductions 3D et prises de vue de l’auteure. Steyerl se sert de l’esthétique particulière et parodique du film pour évoquer des questions actuelles. Le film opère comme document, comme preuve et comme archive des enjeux politiques et esthétiques qu’il soulève. La vidéo nous permet de saisir l’ampleur de la surveillance aérienne en même temps qu’elle est un document de divulgation auprès du public. Comme on l’a vu, les limites de la démarche inquisitrice de l’artiste sont réelles et juridiques, et Steyerl n’apporte pas plus d’informations sur la Edwards Air Force Base. Mais ce manque d’élucidation devient une force plastique et argumentative par le biais de la fiction et de la narration, ainsi que par la superposition constante entre des esthétiques vidéo très variées.
Les objets tels que les mires ont besoin d’avoir un correspondant qui les fasse parler afin d’exposer leur rôle et l’ambigüité de celui-ci au sein de l’histoire du développement photographique. L’exécution de signaux et de mouvements chorégraphiés, similaires à ceux réalisés par les agents de bord des avions lors des démonstrations de sécurité, répond à ce besoin, tandis que les images incrustées grâce aux écrans verts peuvent, pour leur part, être comprises comme des preuves de la porosité de la frontière entre les mondes réel et virtuel. Hito Steyerl agit comme médiatrice entre le monde matériel et un monde immatériel. En tant qu’auteure et protagoniste de ce film, elle est le chef d’orchestre de ces super-objets que sont les mires de calibrage peintes au sol (2 min 22 s). Elle pondère la brutalité du monde réel en proposant de disparaitre, en devenant « image » et en échappant à la reconnaissance d’une individualité.
Hito Steyerl, How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (13 min 16 s) (2013), Capture d'écran par Fanny Bieth tirée de l’oeuvre vidéo How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, 15 min 10 s, Image numérique | 2560 × 1440 px
L’artiste apporte une esthétique de lieu de tournage en construisant un décor de façon à proposer un regard spécifique, subjectif, sur les mires de calibrage. Il s’agit d’un dispositif dans lequel les mires de calibrage sont les sujets du tournage autant que des outils de prise de vues (11 min 08 s). Dans How Not to Be Seen, Steyerl reprend les codes esthétiques des représentations de scènes de crime : il y a une froideur lors la prise de vue, cependant, dans le film, ce style objectif sert une fiction. Le cliché Tri-Bar Photo Resolution Targets, Cuddeback Lake, California, réalisé par le photographe Cris Benton à l’hiver 2013, représente le lieu de tournage de How Not to Be Seen. Cette image fait partie de la base de données du Center for Land Use Interpretation, un organisme d’éducation et de recherche basé en Californie, qui cherche, entre autres, à comprendre et documenter la nature de l’interaction humaine avec la surface de la Terre. Sur la photo, on aperçoit les fissures dendritiques qui brisent l’uniformité des barres, leurs surfaces sont écaillées et effritées. La végétation présente ici dans les interstices n’apparait pas dans la vidéo de Steyerl. De plus, l’image de Benton est une prise aérienne qui écrase l’espace, contrairement à celle de Steyerl, qui est réalisée depuis la terre ferme. Ces éléments participent, au sein du film, d’une esthétique cherchant à immerger le spectateur dans l’environnement représenté. La caméra parcourt la surface de la mire craquelée en suivant un mouvement précis, obtenu grâce à un bras mécanique. Ce geste de tournage crée une image froide et soignée, qui fait référence aux prises de vue collectées par la police sur le terrain d’un crime. Les images numériques obtenues par l’appareil de Steyerl sont mises en parallèle avec des images plus anciennes, analogiques, sur lesquelles la surface de la mire est encore intacte (3 min 58 s). Le rythme du montage, ainsi que la confrontation des sources analogiques et numériques sont des opérations cinématographiques servant à rendre explicite la détérioration matérielle de ces mires.
Enfin, certaines images de How Not to Be Seen montrent une figure dont la chair translucide nous rappelle l’esthétique des images hybrides du crâne de Mengele. Ainsi, dans le chapitre « How to Become Invisible by Becoming a Picture » (4 min 29 s), la peau du visage de l’artiste est maquillée de façon à ce qu’elle devienne elle-même un écran d’incrustation : « To camouflage, to conceal, to cloak, to mask, to be painted, to disguise, to mimicry » (4 min 46 s). Les effets visuels évoluent de sorte qu’on ne sait plus s’ils sont dus à des techniques de maquillage ou à des outils numériques de retouche photographique. Par toutes ces opérations, Steyerl essaie de saisir ce que serait un monde virtuel qui viendrait remplacer le monde réel, tout en exposant son lien théorique avec Eyal Weizmann et Thomas Keenan. Ces manipulations agissent comme des pièces à conviction et permettent à l’artiste d’exprimer des idées politiques. Présentées de manière inspirante et ludique, elles questionnent notre rapport aux images numériques, notre jugement esthétique et notre positionnement face aux technologies de surveillance.
***
L’arrivée et l’utilisation des concepts liés à la surveillance dans le travail des artistes vidéastes élargissent les problématiques esthétiques et politiques de l’image. How Not to Be Seen présente une vision ambivalente des rapports entre le réel et le virtuel. Cette vision est en partie optimiste : on perçoit, dans la réflexion qu’elle propose par rapport au seuil de visibilité et à son impact géopolitique, un espoir que tout un chacun puisse agir dans le monde réel à travers le virtuel. C’est un appel à investir l’esthétique de la fissure à des fins politiques, à chercher la ligne de moindre résistance et à se réfugier sous le seuil de toute captation possible.
Dans les propositions de How Not to Be Seen, on ne parvient pas à savoir si l’artiste cherche à représenter un monde virtuel et lointain, ou si elle souhaite montrer que ce monde va se superposer au monde existant jusqu’à le remplacer. Les représentations cartographiques intégrées dans nos outils numériques physiques élargissent notre perception du monde actuel en rendant tangibles des choses invisibles. Mais il s’agit d’une vision presque dystopique, où les réseaux de surveillance sont présents partout. Au-delà d’une démonstration du dédoublement du monde, la vidéo semble nous avertir des dangers de la collecte de données sur nos mouvements et nos trajectoires, créant de véritables cartographies de contrôle.
Le gigantisme du monde virtuel exposé dans How Not to Be Seen résonne avec celui imaginé par Jorge Luis Borges dans sa courte nouvelle « De la rigueur de la science » : « [L]es collèges de Cartographes levèrent une Carte de l’Empire, qui avait le Format de l’Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. » (1982 [1946]: 199) Son processus cartographique est invisible mais omniprésent. La seule issue pour échapper à une surveillance absolue se trouverait dans les craquelures des images. La vidéo de Steyerl est une invitation poétique et politique à détourner les technologies étatiques en devenant nous-mêmes invisibles : « Resolution determines visibility. Whatever is not captured by resolution is invisible. » (1 min 37 s)
La fin du dernier chapitre du film, « How to Become Invisible by Merging Into a World Made of Pictures », transforme la mire de calibrage en piste de danse improbable avec, en fond sonore, la chanson « When Will I See You Again » du groupe The Three Degrees (1974). Or, cette mire a été répertoriée sur Google Maps comme étant une discothèque, ajoutant à la démonstration de la porosité entre les deux mondes. Pourrait-il s’agir d’une action de l’artiste elle-même?
Appendices
Bibliographie
- [s. a.]. 2014. « US Lifts Restrictions On More Detailed Satellite Images ». BBC News, 16 juin. https://www.bbc.com/news/technology-27868703.
- Azoulay, Ariella Aïcha. 2019. Potential History. Unlearning Imperialism. Londres : Verso Books, 656 p.
- Benton, Cris. 2013. Tri-Bar Photo Resolution Targets, Cuddeback Lake, California, photographie numérique, The Center For Land Use Interpretation. http://clui.org/Page/Tri-Bar-Photo-Resolution-Targets-Cuddeback-Lake-California.
- Blas, Zach. 2012. Facial Weaponization Communiqué: Fag Face, vidéo, 8 min. https://vimeo.com/57882032.
- Borges, Jorge Luis. 1982 [1946]. « De la rigueur de la science », dans L’auteur et autres textes. Paris : Gallimard, p. 199.
- Fargeaud, Pierre. 2007. « La preuve informatique en droit français. Les aspects juridiques de l’inforensique ». Thèse de doctorat. Droit privé, Université de Limoges, 436 f.
- Greicius, Tony. 2012. « Calibration Target for Curiosity’s Arm Camera ». NASA. https://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16132.html. Consultée le 1er août 2019.
- Keenan, Thomas et Eyal Weizman. 2012. Mengele’s Skull, The Advent of a Forensic Aesthetics. Berlin : Steinberg Press, 88 p.
- Keenan, Thomas et Hito Steyerl. 2014. « What Is a Document? An exchange between Thomas Keenan and Hito Steyerl ». Aperture, no 214, printemps, p. 58-64.
- Lavoie, Vincent. 2013. « Forensique, représentations et régimes de vérité ». Ciel Variable, no 93, p. 8-20.
- MacNaughton, Ian et John Howard Davies. 1970. « How Not to Be Seen », dans Monty Python’s Flying Circus. Royaume-Unis : BBC, saison 2, épisode 11.
- Rees, W. G.. 2012 [2001]. Physical Principles of Remote Sensing. Cambridge : Cambridge University Press, 494 p.
- Steyerl, Hito. 2010. In Free Fall, vidéo. Allemagne, 32 min.
- Steyerl, Hito. 2013a. How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File, vidéo, 15 min. https://www.artforum.com/video/hito-steyerl-how-not-to-be-seen-a-fucking-didactic-educational-mov-file-2013-51651.
- Steyerl, Hito. 2013b. « Too Much World. Is the Internet Dead? ». E-flux Journal, Journal #49, novembre. https://www.e-flux.com/journal/49/60004/too-much-world-is-the-internet-dead/.
- Thiermann, Alfredo. 2016. « Land as Forensic Evidence. Eyal Weizman Interviewed by Alfredo Thiermann ». ARQ, no 93. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962016000200003&lng=en&tlng=en.
- Weizman, Eyal. 2012. Forensic Architecture. Notes From Fields And Forums. Ostfildern : Hatje Cantz, 42 p.
- Weizman, Eyal. 2015. « Violence at the Threshold of Detectability ». E-flux Journal, Journal #64, avril. https://www.e-flux.com/journal/64/60861/violence-at-the-threshold-of-detectability/.
- Weizman, Eyal et Fazal Sheikh. 2016. The Conflict Shoreline. Colonialism as Climate Change in the Negev Desert. Göttingen : Steidl, 96 p.
- Zhang, Michael. 2013. « There Are Giant Camera Resolution Test Charts Scattered Across the US ». PetaPixel, 15 février. https://petapixel.com/2013/02/15/there-are-giant-camera-resolution-test-charts-scattered-across-the-us/. Consultée le 1er août 2019.