Abstracts
Résumé
Dans son texte pour le théâtre Tout comme elle (2006), Louise Dupré raconte toute la complexité du rapport entre mère et fille, une relation marquée par un « amour maladroit avec des échardes sous les ongles » (Dupré, 2006 : 57). Si, dans les quatre actes de l’oeuvre, le corps féminin n’apparaît jamais seul, unique, mais il appartient à une « généalogie infinie des filles et des mères » (Dupré, 2006 : 9), il est en même temps traversé par les sentiments frustrants de rage, peur et douleur. L’opposition entre les deux femmes, dont la séparation est creusée dans la chair, va pourtant révéler l’essence profonde d’un amour primordial et parfois mystérieux, transmis de génération en génération et de corps en corps.
Mots-clés :
- Louise Dupré,
- Tout comme elle,
- maternité,
- filiation,
- corps
Article body
Depuis son exorde en 1983 avec La peau familière, Louise Dupré a consacré la plupart de sa vaste et hétérogène production littéraire à une exploration méticuleuse de la double thématique de la maternité et de la filiation, toujours en l’abordant d’une perspective féminine et féministe. Après l’image tendre et rassurante des « vêtements de femme et de fillette qui s’entremêlent sur la corde [à linge] » (Dupré, 1983 : 55) évoquée dans son premier recueil poétique, la figure maternelle, souvent aux contours autobiographiques, revient en effet tant dans ses poésies – il suffit de penser au portrait de la mère, presque barthésien[1], montré sur la « photo jaunie » (Dupré, 1996 : 11) dans l’incipit de Chambres – que dans ses romans – dont L’album multicolore, récit de deuil écrit en mémoire de sa propre mère, est l’exemple le plus emblématique.
« J’ai l’impression que tout ce que j’ai fait porte sur le rapport mère-fille » (Dupré, 2006 : 80), avoue-t-elle, limpide, en réfléchissant sur la genèse de sa pièce Tout comme elle (2006), l’oeuvre qui, plus que toutes, présente efficacement « l’identification problématique à l’autre semblable » (Watteyne, 2009 : 87, l’auteure souligne). Dans Tout comme elle, la complexité du rapport maternel et filial met en effet en scène « un dialogue qui dénoue avec beaucoup de maturité la parole empêchée » (Watteyne, 2009 : 96), une parole qui, en excluant toute intrusion masculine, naît d’une opposition, parfois violente, des corps. Autour de cet antagonisme physique et identitaire primordial se développent donc les « quarante-huit tableaux, comme des poèmes en prose » (Corriveau, 2006 : 34), de la pièce, qui racontent et mettent hardiment à nu « cette figure bicéphale[,] puisque la mère est aussi la fille, et la fille, la mère, selon des codes et des comportements, des sentiments constamment flambés » (Corriveau, 2006 : 35). Si la problématique du corps de la femme, conjuguée aux sous-thématiques de la vieillesse (premier acte : 11-26), de la séparation (deuxième acte : 27-42) et de l’héritage familial (troisième et quatrième actes : 43-74), apparaît indéniablement centrale, on peut en même temps identifier, dans les quatre actes, trois mouvements émotionnels différents et complémentaires : le corps de la mère est vu et vécu, par les yeux de la fille, avec une rage subtile et silencieuse, tandis que le corps de la fille, dès la grossesse, perturbe le corps maternel avec un sentiment de peur croissant ; d’ailleurs, les corps des deux femmes semblent être destinés à partager le même parcours de douleur. En croisant études féministes et psychanalyse, mon article vise donc à réfléchir sur ce corps-à-corps[2] au féminin – marqué par le triptyque rage-peur-douleur – dans les pages du texte dupréen, une oeuvre richissime et puissante qui, seize ans après sa publication, a encore beaucoup à nous dire sur cet amour incontournable et complexe qu’est le rapport entre mère et fille.
Tout comme elle, un texte métaféministe
Dans ses ouvrages, Dupré, toujours fidèle au courant métaféministe[3], aborde le thème de la maternité et du lien mère-fille en mettant en évidence ses lumières et ses ombres, bien consciente que « [l]a fonction maternelle, longtemps utilisée pour assujettir les femmes, est à redéfinir de même que, plus largement, la question de la filiation » (Boisclair, Dussault Frenette, 2014 : 44). En se référant aux romans de Nicole Houde (La maison du remous, 1986), de Monique Larue (La cohorte fictive, 1979), de Madeleine Ouellette-Michalska (La maison Trestler ou le 8e jour d’Amérique, 1984) et d’Anne Hébert (Premier jardin, 1988), qui décrivent la figure et l’expérience maternelle avec une franchise jusque-là inédite, Lori Saint-Martin a en effet constaté que « l’expérience même de la maternité donne naissance et forme à l’oeuvre, remettant en question de vieilles idées reçues sur les femmes et la création par le biais d’un nouveau discours de mère » (Saint-Martin, 1992 : 86). C’est justement la sincérité, parfois crue, associée à l’aspect le plus physique de la maternité, dans la lignée de Suzanne Jacob (L’obéissance, 1991 ; Rouge mère et fils, 2001), d’Élise Turcotte (Le bruit des choses vivantes, 1991) et de Ying Chen (L’ingratitude, 1995 ; Un enfant à ma porte, 2008), qui importe ici. Le corps maternel est très souvent imprégné de douleur et de souffrance, alors que la relation entre mère et fille, dépouillée de son aura utopique et idyllique, est racontée.
Dans les quatre actes de Tout comme elle, « texte poétique [...] qui trait[e] d’un sujet douloureux » (Lelarge, 2007 : 15), publié en 2006 dans la collection « Mains libres » de la maison d’édition montréalaise Québec Amérique, l’écrivaine inscrit le sujet-femme au centre d’une « généalogie infinie des filles et des mères » (Dupré, 2006 : 9) aux caractéristiques multiples et nuancées, bien qu’elles appartiennent au même trinôme identitaire de femme-mère-fille. Le thème de la maternité, ainsi que la dimension corporelle, émergent visuellement dès la couverture du volume grâce à la contribution photographique d’Angelo Barsetti : l’image en noir et blanc, qui est répétée à plusieurs reprises dans le livre, montre deux corps nus de femmes – mère et fille –, épaule contre épaule, en dévoilant leurs différentes caractéristiques physiques. Un choix graphique simple mais puissant : selon Hugues Corriveau, « [c]ette mise à nu des corps et des âmes, si bellement représentée par la magnifique photo d’Angelo Barsetti en couverture et reprise comme un leitmotiv oraculaire dans le corps du texte, dévoile l’aimée absolue, la première, l’irremplaçable » (Corriveau, 2006 : 35).
L’intervention de Brigitte Haentjens, dramaturge québécoise qui a assuré la mise en scène du spectacle et à laquelle l’auteure a d’ailleurs voulu dédier l’oeuvre[4], confirme que le corps féminin, dans Tout comme elle, est un corps qui n’est jamais seul, unique, mais toujours choral : Haentjens choisit en effet cinquante actrices de tous les âges pour défiler sur le plateau et, par conséquent, la dimension identitaire et physique apparaît, même au niveau scénique, brisée en de multiples projections, donnant lieu à une double fragmentation, tant de la parole que du geste[5]. Dupré aussi a insisté sur cette structure textuelle particulière au cours de la « Conversation » en annexe de l’ouvrage : « Je ne voulais pas faire un texte “psychologique”. Et c’est pour ça, je pense, que la forme fragmentaire ou par petits tableaux, mais qui restent de toute façon fragmentaires, m’a semblé la seule forme possible », tandis que Haentjens a souligné que « [s]on texte est comme la vie, fait de fragments, d’instants contradictoires » (Dupré, 2006 : 87). Il en résulte une « disseminazione corporea[6] » (Scotto 2019 : 53) continue, au niveau textuel, scénique et visuel, d’un corps singulier et en même temps pluriel, une dissémination que, sur scène, la dramaturge transpose par « la démultiplication d’une même silhouette caractérisée par fonction » (Ryngaert et Sermon, 2006 : 101), c’est-à-dire le double et complémentaire rôle de mère et de fille. Lectrice, lecteur, spectatrice et spectateur sont donc submergés et absorbés par le mouvement oxymoronique et synergique d’un « kaléidoscorps[7] » composé de mots, voix et corps au féminin :
les voix ne sont pas synchrones, chacune des actrices ayant un débit, une vitesse, un ton et un timbre qui lui sont propres, le décalage entre les voix qui en découle sied parfaitement à la désynchronisation des corps. Ainsi, une voix plus grave pour prononcer « maman » pourra signifier qu’il y a quelque chose de dramatique dans les retrouvailles, une voix haute donnera l’impression qu’elles sont empreintes de légèreté, confirmant, en complémentarité avec le langage corporel déployé, que chacune de ces silhouettes raconte sa propre histoire.
Jobin, 2011 : 71
Rage. Le corps de la mère : un corps étranger, un corps à éloigner
Le premier acte de Tout comme elle s’ouvre sur une scène quelconque, mais qui place dès le début le corps maternel au premier plan :
Elle est là, assise à table, près de la fenêtre. Elle boit son thé, le regard perdu dans le ciel assombri, elle reprendra du thé, et encore du thé, jusqu’à ce que la théière soit vide comme un ventre vide. Elle ne dit rien, ne demande rien, n’exige rien. Elle rêve, le regard perdu dans le ciel qui tombe peu à peu.
Dupré, 2006 : 15
« Elle est là », annonce une narratrice anonyme, se référant à sa mère qui, assise placide à la fenêtre, boit une tasse de thé, le regard perdu qui sait où, incapable de s’opposer, comme l’écrit Élise Turcotte, au « scandale de vieillir et d’être une femme » (Turcotte, 2002 : 11). La voici, la femme qui lui a donné la vie, désormais âgée et sans force : elle vide lentement la théière jusqu’à ce qu’elle soit vide comme son ventre désormais infécond. Recroquevillée, presque froissée sur elle-même, « grise, grise comme une grisaille de novembre », elle a perdu la vivacité et la loquacité d’antan et ennuie maintenant sa fille en visite avec « les mêmes histoires, dans les mêmes mots » (Dupré, 2006 : 16). L’anaphore « Elle est là », soumise à de légères variations[8] et reprise tout au long du premier acte, nous montre une figure maternelle épuisée, fanée, « une petite vieille comme on ne peut pas imaginer sa mère » (Dupré, 2006 : 20), avec ses mains ratatinées et « ses vieux doigts » (Dupré, 2006 : 18), observée avec consternation et nostalgie par « une fille avec des rides et des cheveux teints » (Dupré, 2006 : 24), arrivée elle aussi, presque sans s’en apercevoir, à l’âge adulte.
« Ce n’est plus la mère de mon enfance, mais une vieille femme maintenant » (Dupré, 2006 : 20), admet la narratrice, plongeant dans des réminiscences lointaines et rappelant l’image encore fraîche et vivante de la mère de sa jeunesse, vue avec ses yeux de petite fille :
Elle est […] belle, si belle qu’on croirait qu’elle n’est pas une mère. C’est une fée, une icône, une étoile, un diamant, une forêt enchantée. Pas de rides, pas de petits sacs sous les yeux, la peau lisse et ferme, de beaux bras durs, un peu dorés, juste ce qu’il faut pour les robes d’été. Si belle que je ne comprends pas comment j’ai pu mériter une mère comme elle.
Dupré, 2006 : 19
Subtilement, la fille commence à se poser la question qui la hantera pour le reste de la pièce : qui est ma mère? Qui est, en somme, cette figure complexe et parfois mystérieuse résumée à la hâte dans le pronom « elle », désormais si vieille et différente de la femme rayonnante de ses souvenirs d’enfance? Comme déjà anticipé dans La peau familière[9], l’image du visage maternel revient à la fois comme énigme et comme clé identitaire : cependant, dans la pièce, le visage de la mère n’est que le visage de la mère, bien que l’identité maternelle ne soit évidemment pas que l’un de ses « masque[s] » (Dupré, 2006 : 23). Contrairement à Barthes, qui, en proie à la douleur de la mort de sa mère, dans La chambre claire parvient finalement à retrouver son essence éphémère dans une photo de quand elle était enfant[10], la fille de Tout comme elle observe sceptique le portrait de la femme qu’elle a toujours appelée « maman » immortalisée dans un instantané désormais jauni, se demandant qui elle est réellement :
Elle est là, sur la photo, elle regarde droit devant elle, dans sa petite robe brodée. On ne dirait pas qu’elle deviendra une mère. Pour l’instant, elle est toute à son enfance [.] […] J’ai beau dire que j’ai renoncé, et pourtant, certains jours je cherche encore, une mimique, un geste, une phrase qui me permettraient de savoir qui était ma mère quand elle n’était pas encore ma mère.
Dupré, 2006 : 26
Au deuxième acte, la distance entre le corps de la mère et le corps de la fille se fait encore plus évidente, en révélant l’étrangeté totale, la séparation brutale entre le sujet maternel et sa créature « malgré et à travers les fragilités, les espaces de silence, les violences inavouées (inavouables) qui fondent le lien mère-fille » (Cyr, 2006 : 19) : « il faudrait accepter de tracer l’une après l’autre les cinq lettres du seul mot que je n’accepterai pas de tracer, les cinq lettres du mot haine » (Dupré, 2006 : 31, l’auteure souligne), admet une cynique Dupré dans le premier cadre. Haïr la mère : la voici, la vérité la plus effrayante et inconfortable révélée, non sans hésitation, par l’écrivaine, car, comme l’écrit Massimo Recalcati, « Il legame devastante tra madre e figlia non ha mai fine ; è un amore senza limiti, è un odio che vincola per sempre[11] » (Recalcati, 2016 : 167).
Haïr la mère pour réussir, enfin, à s’en séparer, à gagner son indépendance, à délimiter les périmètres spatiaux de sa propre identité loin de l’ombre maternelle par « la redécouverte d’un corps à corps avec la mère, avec l’autre femme. Parole hystérique se faisant parole d’identité, travail subversif qui s’acharnera à défaire les structures mentales pour inventer de nouveaux espaces » (Dupré, 1989 : 27, l’auteure souligne). Une réflexion pivot de la pièce, qui débouche inévitablement sur le concept d’origine lacanienne du « ravage » et qui, comme le suggère le titre de l’essai de la psychanalyste française Marie Magdeleine Lessagna, Entre mère et fille : un ravage (2000), est essentiel pour comprendre et étudier ce type de relation :
con il termine ravage Lacan vuole mettere in evidenza come in ogni figlia vi sia una difficoltà specifica nell’elaborazione del lutto che permetterebbe lo scioglimento simbolico del legame che la vincola alla madre e come il perdurare di questo legame sia sempre fonte di una passione fortemente ambivalente : la figlia reclama la sua separazione dalla madre ma non può vivere senza la presenza della madre[12].
Recalcati, 2016 : 168, l’auteur souligne
À cet égard, ce que signale Anne-Marie Jézéquel au sujet du titre de l’oeuvre apparaît emblématique : « À titre anecdotique mais significatif, le titre initial “Ravages” jugé trop destructeur a été remplacé par le nouveau titre révisé Tout comme elle, illustrant mieux la dichotomie du rapport mère-fille et la complexité de leur union » (Jézéquel, 2006 : 155). Une union, donc, qui porte en elle, dès la grossesse, les symptômes latents de l’inexorable division : d’ailleurs, « on sort du corps de cette femme-là » (Dupré, 2006 : 89), car, bien sûr, la première et véritable séparation entre mère et fille a lieu, en réalité, dès l’accouchement. Dupré décrit ce passage essentiel, qui condense le triomphe même de la vie, avec une violence subtile, où, à la douleur physique, se superpose la douleur psychologique, constellée de peurs, de doutes, d’insécurités lourdes comme des rochers :
Elle, ma mère. Si belle sous ses paupières quand elles s’alourdissent jusqu’à ne plus me recueillir. Elle me pousse hors d’elle comme si, pendant un moment, elle voulait croire que je n’existais pas. […] Elle rêve peut-être d’une autre vie, celle qu’elle aurait pu se donner si je ne m’étais pas agrippée si fort à la paroi de son ventre. […] Peut-être est-elle seulement un corps renfermé sur son propre oubli. […] L’enfant, on ne le choisit pas. On pousse, on pousse, on crie, on se déchire le ventre à pousser, on pousse jusqu’à ce qu’on voie apparaître un petit crane rose, et on se demande si un amour viendra.
Dupré, 2006 : 32
Les deux corps sont donc destinés à se diviser, à se briser, à s’éloigner précisément à partir de la rupture des eaux, étape cathartique qui marque la fin de la grossesse et la première véritable séparation entre la mère et la nouveau-née : « Il ventre materno ha ceduto il suo contenuto, si è svuotato ; è la prima esperienza di perdita che segnala la fine di una continuità dei corpi e di un godimento della madre senza paragoni ; è una sottrazione che attraversa sia il corpo che la mente e impone l’alterità e la trascendenza del[la] figli[a][13]. » (Recalcati, 2016 : 99)
Cependant, la vraie « sépartition[14] » de ce « corps semblable » (Dupré, 2006 : 89) se réalisera plus tard, au moment où la fille atteindra l’âge adulte et ressentira le besoin de s’éloigner définitivement du nid maternel, bien que le lien avec la mère survive toujours, malgré les disputes, malgré les frictions, malgré la rage :
Moi, à jamais séparée de la haine, à jamais séparée d’elle, ma mère, à jamais séparée. […] Un jour, il faut partir sans se retourner. J’ai marché, on marche jusqu’à ce que le corps refuse un pas de plus, jusqu’à cette fatigue qu’on confond avec l’oubli. […] On prend dans ses mains le portrait de sa mère et on se fait croire qu’elle nous a aimée. C’est alors la tentation folle de revenir.
Dupré, 2006 : 41
Le processus d’éloignement décrit par Dupré est donc extrêmement physique : la fille se sépare de la mère en se déplaçant, en marchant, en entreprenant un chemin qui est tracé par son propre corps, en accueillant cette « blessure qui ne se refermera jamais » (Dupré, 2006 : 33), mais qui assurera leur indépendance respective. L’incommunicabilité entre les deux femmes se traduit donc par une rage profonde et inconfessable, par un regard venimeux et tranchant, par un « silence terrifié dans les yeux de [l]a mère […], la violence du regard terrifié de [l]a mère » (Dupré, 2006 : 40), « [l]e regard blanchi de [l]a mère, ce regard à la chaux qui […] tue [sa fille], chaque fois » (Dupré, 2006 : 42), un regard qui ne sait plus transmettre d’amour, mais qui manifeste la blessure insurmontable et déchirante de leur sépartition définitive.
Le deuxième acte confirme donc Tout comme elle comme « un texte de la séparation », n’hésitant pas à montrer « toute la douleur qu’implique la séparation, mais avec les possibilités qu’offre toute séparation et qui nous conduisent à considérer la mère comme une femme qui n’est pas parfaite. Qui n’est plus une figure mythique. Qui est une femme avec ses défauts, ses qualités, ses possibilités » (Dupré, 2006 : 88).
Peur. Le corps de la fille : un corps semblable, un corps à protéger
À partir du troisième acte, le point de vue glisse pourtant vers la perspective maternelle. Le premier tableau propose en effet une confrontation audacieuse avec celle qui, selon la tradition chrétienne, est la mère de toutes les mères, ainsi qu’un exemple vertueux de la résilience typiquement féminine : Marie. Dupré dépouille donc la figure mystique de la Vierge de son aura de sacralité, la dépeignant au contraire comme une femme quelconque, effrayée et résignée face à l’inéluctabilité du destin maternel, qui engloutira toute son existence en la changeant, à partir de son nom, pour toujours ; le corps est, une fois de plus, un corps souffrant, bouleversé par un « miracle » qu’elle n’a pas demandé :
Mère, c’est ainsi qu’on m’appelle. J’ai bien eu un prénom à la naissance, mais je l’ai oublié. Mère comme ma mère, comme la mère de ma mère, mère d’une lignée immémoriale de mères. C’était inscrit, déjà, dans l’enfance, les poupées qui s’ajoutaient aux poupées, puis le sang, les amoureux, et un jour, on se rend compte que le sang n’a pas coulé entre les jambes, on attend, on espère, on angoisse, on ne veut pas y croire, mais il faut se rendre à l’évidence. Les seins gonflent, et le ventre, et les jambes. C’est l’enfant, déjà. L’enfant qu’on ne veut pas, mais qu’on désire, malgré soi, depuis qu’on sait désirer. […] Il s’appellera Jésus.
Dupré, 2006 : 47
L’extrait proposé fait écho aux idées exposées par France Théoret dans plusieurs textes, notamment dans Vertiges (1979) et Nous parlerons comme on écrit (1982) ; dans ce dernier, en effet, l’écrivaine constate : « Un corps grossit démesurément au moment de la puberté. Un corps est envahi, une fille ne se reconnaît plus. Elle n’est plus elle, elle est investie d’une mission » (Théoret, 1982 : 109, je souligne). Selon Aurore Turbiau, le choix de ce type de lexique « met en avant un rappel brutal à l’espèce et au fonctionnement biologique du corps mais surtout, à considérer l’allusion manifeste aux textes de Beauvoir et l’idée d’une guerre menée contre la jeune femme […], l’idée d’un siège collectif de son corps » (Turbiau, 2020), dénonciation reprise également par une autre grande auteure québécoise protagoniste de la deuxième vague féministe, Louky Bersianik, qui nous rappelle que « Votre destin corporel, femmes de la Terre, est individuel. Il n’est pas le destin de la collectivité. [...] Refusez de vous faire massacrer au profit de l’espèce » (Bersianik, 2012 : 508).
Dans Tout comme elle, d’ailleurs, le moment de l’accouchement, à nouveau crucial, n’est pas marqué positivement, mais il est condensé dans l’image concise et sombre d’un « visage de suppliciée » (Dupré, 2006 : 48), en confirmant cet avertissement insupportable répété en toute impunité par le curé le dimanche à la messe – « Tu accoucheras dans la douleur » (Dupré, 2006 : 63, l’auteure souligne) –, mots cruels qui résonnent avec colère et frustration également dans les pages de L’album multicolore (Dupré, 2014 : 71-72). Le rêve de donner naissance à un garçon, de mettre fin à la chaîne de la douleur réservée aux seules femmes, se brise cependant à l’annonce tant redoutée – « C’est une fille » –, immédiatement suivie de la plus grande des craintes : « Comment aimer un enfant condamné à la répétition », en espérant que, « la prochaine fois, ce serait un garçon » (Dupré, 2006 : 48, l’auteure souligne)?
Une mère, avant d’être mère, a été fille de sa mère et connaît donc la difficulté d’habiter un corps féminin dans un monde exclusivement à taille d’homme : « les filles souffrent tôt ou tard d’une longue maladie, depuis que les mères lasses ont cédé aux violences. Et cela s’appelle le privé » (Dupré, 1982 : 50), écrit la poète dans La peau familière, où le terme « privé » reprend explicitement le précepte féministe « The personal is political » (Hanisch, 1970) (en français, « Le privé est politique »). D’où son chagrin, sa peur d’avoir donné la vie à une autre femme qui, tout comme elle, se trouvera à lutter contre son apparence physique, incapable de l’accepter, incapable de l’aimer :
Mère d’une fille. Qui déjà me ressemblait. On se retrouvait à nouveau petite bête poilue qui ne sait pas se défendre, à nouveau on se verrait grandir avec un corps qu’il faudrait affamer, l’ingratitude d’un visage ingrat, et cette horreur de soi devant les miroirs. Elle aurait voulu être élancée, et blonde, et belle, la fille, elle n’aurait pas voulu nous ressembler.
Dupré, 2006 : 49
Ainsi commence, dans un lit d’hôpital avec sa propre petite créature attachée à son sein, le chemin de la mère : « On se dit alors : Je suis mère, oui, je suis même plus mère que ma mère » (Dupré, 2006 : 51, l’auteure souligne). Pour Adrienne Rich, il s’agirait de symptômes typiques de la « mathrophobie », attitude récurrente qui « n’est pas la peur de notre mère ou celle de maternité, mais notre peur de devenir notre mère » (Rich, 1980 : 233) et qui, selon l’approche psychanalytique, rappelle le mécanisme des boîtes chinoises :
Come nelle scatole cinesi, il volto di una madre contiene il volto di sua madre. In ogni gravidanza la futura madre si confronta con il fantasma della propria madre ; l’accesso alla potenza della generatività è una forma radicale (la più radicale ?) dell’eredità; inscriversi nella catena generazionale come madre significa anche dover morire come figlia rendendo ancora più ampio il solco che l’evento del menarca ha tracciato nel corpo di ogni femmina separandola dal suo essere stata figlia[15].
Recalcati, 2016 : 43
Pour Dupré, l’amour maternel est d’ailleurs décrit comme une sorte d’habileté acquise avec le temps, la patience et l’expérience, l’habileté d’offrir généreusement, inconditionnellement, « aveuglément » son propre corps pour nourrir et élever son enfant :
L’amour, ce n’est pas un don. Une longue patience, plutôt. Les cartes qu’on retourne lentement, trèfle, carreau, pique, pique. […] On détache sa blouse, aveuglément, on offre sa mamelle, l’enfant boit, l’enfant nous vide, l’enfant s’endort sous ses paupières impossibles. Et on ne bouge pas, on la regarde dormir sans bouger, incrédule, on pense, c’est ma fille cette enfant qui n’a pas choisi d’être ma fille, même morte je serai sa mère, je serai sa mère immortelle, je serai sa mère pour l’éternité.
Dupré, 2006 : 56
Le corps de la mère, accompli sa fonction de nid pendant la grossesse, se fait maintenant nourriture pour le corps de la fille : une expérience qui résume la sacralité laïque de la maternité et le mystère de l’extase amoureuse maternelle, cet « amour maladroit avec des échardes sous les ongles[16] » (Dupré, 2006 : 57) tant redouté mais, en même temps, si viscéralement attendu et désiré.
Douleur. Le corps de la mère et de la fille : une généalogie infinie
Le quatrième et dernier acte de la pièce représente finalement le climax de ce parcours ascendant de la douleur mis graduellement à nu pendant l’évolution de l’oeuvre : entre le corps de la mère et de la fille, désormais, ne semble survivre rien qu’un silence assourdissant ou un regard désintéressé perdu dans le vide.
La répétition de la périphrase « Elle fume », adaptée, dans plusieurs cadres, sous forme d’anaphore (Dupré, 2006 : 63, 64, 66, 68, etc.), est emblématique : si la mère, dès le début du texte, « boit son thé, le regard perdu dans le ciel assombri » (Dupré, 2006 : 15), la fille se contente maintenant de l’écouter distraitement, sans véritable intérêt, la cigarette serrée « du bout de ses lèvres peintes », elle aussi « le regard perdu, silencieuse du poids de son silence » (Dupré, 2006 : 63). La relation entre les deux femmes se noie ainsi dans « le plus parfait silence, […] en s’efforçant de ne pas [se] ressembler » (Dupré, 2006 : 68), bien que cet éloignement espéré et nécessaire ne soit pas dépourvu de douleur.
Au contraire : la douleur est conçue, dans les pages de Tout comme elle, comme un caractère héréditaire universel du genre féminin, non seulement physique et, dans un certain sens, biologique, comme suggèrent le sang des menstruations et l’acte même de l’accouchement, mais aussi, et surtout, psychologique et de nature socioculturelle : « chez les femmes, la douleur est dans le corps » (Dupré, 2006 : 90), écrit l’auteure. La répétition du terme « douleur » se fait donc de plus en plus exaspérée dans les tableaux finaux, où le dialogue entre mère et fille prend l’aspect d’un interrogatoire déchirant et sans réponse : « Que fais-tu de ma douleur? […] Ma douleur, que fais-tu de ma douleur? […] Que fais-tu de ma douleur? » (Dupré, 2006 : 72, l’auteure souligne), « Je suis sans réponse face à la douleur, […] Je resterai toujours sans réponse face à la douleur » (Dupré, 2006 : 73, l’auteure souligne).
La vie de la femme, de toutes les femmes, est en effet « [u]ne vie dont il faut à chaque jour recoller les morceaux » (Dupré, 2006 : 65) : chaque mère voudrait que sa fille ne vive pas, comme sa mère avant elle, la violence verbale et charnelle, la discrimination de genre à l’école et au travail, la peur de rentrer seule le soir. Dupré, par son texte, devient la porte-parole de ce malaise commun, au point de permettre à une spectatrice ou lectrice quelconque de se reconnaître dans les mêmes situations poignantes proposées dans la pièce, où, comme le souligne Catherine Cyr,
l’effet de choralité est puissant – d’où, sans doute, le risque de tendre à l’universalité –, mais, paradoxalement, il permet de révéler une différence, un écart dans la répétitivité du même. Un surgissement de subjectivité qui, sur fond d’expérience partagée – le féminin comme territoire miné, la relation mère-fille comme champ de bataille et lieu de transmission d’une douleur indicible –, traduit bien la singularité de toute quête identitaire, la difficulté d’accéder à soi pour enfin pouvoir dire « je ».
Cyr, 2006 : 22
Le « moi » individuel fusionne donc avec un « moi » collectif de plus grande envergure, en brisant le cinquième mur et en atteignant, idéalement, toutes les femmes du monde :
Comment briser la chaîne des générations? Couper une fois pour toutes cet enchevêtrement de paroles et de gestes qu’on reprend, comme une poupée mécanique, sans s’apercevoir qu’il appartient à une lignée infinie de paroles et de gestes? […] On voudrait que sa fille échappe à une douleur à laquelle on n’a pas réussi à échapper. Mais en vain. Les filles répètent les mères, et les mères leur propre mère, dans la commune impuissance des mères et des filles.
Dupré, 2006 : 65
Depuis la nuit des temps, le corps de la mère, comme celui de la fille, se fait donc « réceptacle de la douleur » (Dupré, 2006 : 71), incapable toutefois d’éviter de se demander : « Est-ce moi? Ou ma mère? Ou ma fille? » (Dupré, 2006 : 69). Cette question, qui apparaît plusieurs fois au cours du dernier acte, revient, autoritaire, pendant le monologue final, où il n’est plus possible de distinguer l’instance maternelle de la filiale, fusionnées en une seule voix puissante et déchirante : « Est-ce moi? Est-ce bien moi cette femme qui porte en elle toutes les mères du monde, ou une fille anonyme qui apprend à se dresser contre la mort? » (Dupré, 2006 : 74).
Amour. Les mains de la mère (en guise de conclusion)
Et pourtant, que reste-t-il, du corps de la mère et de la fille, après la rage, la peur et la douleur?
Je reviens sur la photo de couverture du volume signée par Barsetti et je regarde à nouveau ces deux corps de femme, parfaits dans leur imperfection : le corps doux et généreux de la mère, le corps mince et lisse de la fille. Les visages sont coupés de l’image, qui met pourtant en évidence leurs seins, leur ventre, leur nombril. Le corps anonyme de la mère entoure délicatement avec son bras le corps silencieux de la fille : coude à coude, elles se touchent. Cependant, mon attention est frappée par leurs mains : les mains de la mère, qui cherchent celles de la fille, semblent savoir très bien qu’elles devront, tôt ou tard, lâcher la prise, libérer sa créature de l’étreinte maternelle, lui assurer son indépendance[17]. Voilà, alors, que Tout comme elle me rappelle cette criante vérité : malgré la rage, la peur et la douleur, les mains de la mère accompagnent, protègent et libèrent les mains de la fille, en lui apprenant à être une femme – « On ne naît pas femme, on le devient » (Beauvoir, 2013 : 13), nous suggère Simone de Beauvoir –, génération après génération, mère après mère, fille après fille, « comme dans un amour désormais libre de toute éternité » (Dupré, 2006 : 74). Et toute cette rage, cette peur et cette douleur acquièrent maintenant une nouvelle valeur : elles sont chargées du mystère de la vie elle-même.
Appendices
Note biographique
Elena Ravera est Docteure de recherche en Études Humanistes Transculturelles de l’Université de Bergame (Italie) avec une thèse sur la représentation du corps de la femme chez Louise Dupré et Ken Bugul. Ses recherches s’intéressent à la littérature comparée de langue française, aux études de genre et aux postcolonial studies. Elle collabore régulièrement à plusieurs revues littéraires, dont Ponti/Ponts et Studi francesi, par la rédaction de notes de lectures et articles consacrés à l’espace francophone.
Notes
-
[1]
Barthes aussi, comme Dupré, recherche, dans La chambre claire (1980), l’image de sa mère dans les photos de famille.
-
[2]
Le titre de l’article se veut également un hommage au texte Le corps-à-corps avec la mère (1981) de Luce Irigaray, où la philosophe et psychanalyste belge conçoit la relation maternelle comme base fondamentale de l’identité féminine.
-
[3]
Au Québec, ce terme est employé pour désigner la troisième vague féministe débutant dans les années 1980 : « le beau préfixe “méta-” signifie “après”, tout comme son rival “post-” ; mais il va bien plus loin. […] L’au-delà qu’il suggère implique donc l’intégration du passé plutôt que son abandon » (Saint-Martin, 1992 : 83).
-
[4]
« À Brigitte Haentjens, qui a suscité ce texte. Pour la complicité, le partage et l’amitié. » (Dupré 2006 : 7), annonce en effet la dédicace.
-
[5]
Le spectacle, mis en scène pour la première fois du 17 au 28 janvier 2006 à Montréal, a ensuite été reproposé en occasion du Carrefour international de théâtre du Québec, au Théâtre de la Bordée, les 16 et 17 mai de la même année.
-
[6]
« dissémination corporelle » (je traduis). Scotto, avec cette expression, réfère au texte Ecuador (1929) du poète belge Henri Michaux.
-
[7]
Néologisme issu de l’union entre les lemmes français « kaléidoscope » et « corps », le terme donne le titre à l’étude de Philippe St-Germain, Kaléidoscorps. Sur quelques métamorphoses corporelles dans la littérature québécoise (2019).
-
[8]
« Elle est là, assise à table » (15) ; « Elle est là, devant moi » (16) ; « Elle est là, à côté de moi » (19), etc.
-
[9]
Surtout dans la troisième section, « Les désordres du privé » (41-63), où le symbole lacanien du miroir devient le point de rencontre entre mère et fille, projetées vers d’« inévitables dédoublements » (Dupré, 1983 : 43).
-
[10]
Il s’agit de la célèbre photographie du « Jardin d’hiver », où Barthes annonce avoir retrouvé la vraie essence de sa mère, en exclamant : « C’est elle! C’est bien elle! C’est enfin elle! » (Barthes, 1980 : 155)
-
[11]
« Le lien dévastateur entre mère et fille n’a pas de fin ; c’est un amour sans limites, c’est une haine qui lie pour toujours » (je traduis).
-
[12]
« avec le terme ravage Lacan veut mettre en évidence que chez chaque fille il y a une difficulté spécifique dans l’élaboration du deuil qui permettrait la dissolution symbolique du lien qui la lie à la mère et que la persistance de ce lien est source d’une passion hautement ambivalente : la fille réclame la séparation d’avecsa mère mais ne peut vivre sans la présence de la mère. » (Je traduis.)
-
[13]
« Le ventre maternel a cédé son contenu, il s’est vidé ; c’est la première expérience de perte qui signale la fin d’une continuité des corps et d’une jouissance de la mère incomparables ; c’est une soustraction qui traverse à la fois le corps et l’esprit et impose l’altérité et la transcendance d[e la] fil[le]. » (Je traduis.)
-
[14]
Le terme « sépartition » est introduit par Lacan pour souligner le double processus de séparation à l’intérieur d’une relation : l’individu, au moment de son éloignement, ne se sépare pas seulement de l’Autre, mais aussi d’une partie de lui-même, c’est-à-dire de cette projection de son identité opérée et soutenue par l’Autre (dans ce cas, par la mère). Lacan en parle dans son séminaire sur L’angoisse dans la séance du 15 mai 1963 (voir Lacan, 2004 ; Recalcati, 2012 : 389).
-
[15]
« Comme dans les boîtes chinoises, le visage d’une mère contient le visage de sa mère. Dans chaque grossesse, la future mère est confrontée au fantôme de sa propre mère ; l’accès à la puissance de la générativité est une forme radicale (la plus radicale?) de l’héritage ; s’inscrire dans la chaîne générationnelle en tant que mère signifie aussi devoir mourir comme fille en élargissant encore le sillon que l’événement du ménarque a tracé dans le corps de chaque femelle en la séparant de son être d’enfant. » (Je traduis.)
-
[16]
Cette image puissante est reprise par Dupré pour le titre de l’un de ses recueils poétiques, Une écharde sous ton ongle (2004).
-
[17]
En effet, selon Recalcati, « la vita in quanto vita umana ha necessità di incontrare queste mani, le nude mani della madre, le mani che salvano dal precipizio dell’insensatezza » (Recalcati, 2016 : 23) (« la vie en tant que vie humaine a besoin de rencontrer ces mains, les mains nues de la mère, les mains qui sauvent du précipice de l’absurdité », je traduis.)
Bibliographie
- BARTHES, Roland (1980), La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Seuil.
- BEAUVOIR, Simone de (2013 [1949]), Le deuxième sexe, vol. 2, Paris, Gallimard.
- BERSIANIK, Louky (2012 [1976]), L’Euguélionne : roman triptyque, Montréal, Typo.
- BOISCLAIR, Isabelle et Catherine DUSSAULT FRENETTE (2014), « Mosaïque : l’écriture des femmes au Québec (1980-2010) », Recherches féministes, vol. 27, no 2 : 39-61.
- CYR, Catherine (2006), « Mater Dolorosa : Tout comme elle », Jeu, no 120 : 19-23.
- CORRIVEAU, Hugues (2006), « Tout comme le corps parle », Lettres québécoises, no 122 : 33-36.
- DUPRÉ, Louise (1983), La peau familière, Montréal, Remue-ménage.
- DUPRÉ, Louise (1989), Stratégies du vertige. Trois poètes : Nicole Brossard, Madeleine Gagnon, France Théoret, Montréal, Remue-ménage.
- DUPRÉ, Louise (2006), Tout comme elle, Montréal, Québec Amérique, coll. « Mains libres ».
- DUPRÉ, Louise (2016 [2014]), L’album multicolore, Montréal, Héliotrope.
- HANISCH, Carol (1970), « The personal is political », dans Shulamith Firestone et Anne Koedt (dir.), Notes from the Second Year: Women’s Liberation, New York, Radical Feminism : 76-78.
- IRIGARAY, Luce (1981), Le corps-à-corps avec la mère, Montréal, Pleine Lune.
- JÉZÉQUEL, Anne-Marie (2006), « Louise Dupré : Les espaces de l’écriture », thèse de doctorat, University of Cincinnati.
- JOBIN, Émilie (2011), « Un corps à soi : Socio-anthropologie des corps vulnérables au féminin dans La cloche de verre (2004), Malina (2000) et Tout comme elle (2006) de Sibyllines », mémoire de maîtrise, Université de Montréal.
- LACAN, Jacques (2004), Le Séminaire. Livre X. L’angoisse (1962-1963), texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil.
- LELARGE, Isabelle (2007), « Rideau : entrevue avec Brigitte Haentjens », ETC, no 80 : 15-19.
- LESSAGNA, Marie Magdeleine (2000), Entre mère et fille : un ravage, Paris, Pauvert.
- RECALCATI, Massimo (2012), Jacques Lacan. Desiderio, godimento, soggettivazione, vol. I, Milano, Raffaello Cortina.
- RECALCATI, Massimo (2016 [2015]), Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del materno, Milano, Feltrinelli.
- RICH, Adrienne (1980 [1976]), Naître d’une femme, Paris, Denoël/Gonthier.
- RYNGAERT, Jean-Pierre et Julie SERMON (2006), Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition, Montreuil-sous-Bois, Éditions théâtrales.
- SAINT-MARTIN, Lori (1992), « Le métaféminisme et la nouvelle prose féminine au Québec », Voix et Images, vol. 18, no 1 (52) : 78-88.
- SCOTTO, Fabio (2019), Le corps écrivant. Saggi sulla poesia francese contemporanea da Valéry a oggi, Torino, Rosemberg & Sellier.
- ST-GERMAIN, Philippe (2019), Kaléidoscorps. Sur quelques métamorphoses corporelles dans la littérature québécoise, Longueuil, L’Instant même.
- THÉORET, France (1982), Nous parlerons comme on écrit, Montréal, Les herbes rouges.
- TURBIAU, Aurore (2020), « “Le privé est politique” comme paradoxe littéraire : révolution et intimité chez les Québécoises Louky Bersianik et France Théoret », Textes et contextes, no 15-2 [en ligne], https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=3022&lang=en (consulté le 28 août 2022).
- TURCOTTE, Élise (2002), La maison étrangère, Montréal, Leméac.
- WATTEYNE, Nathalie (2009), « Tout comme elle : L’intime et le non-dit », Voix et images, vol. 34, n° 2 : 87-96.

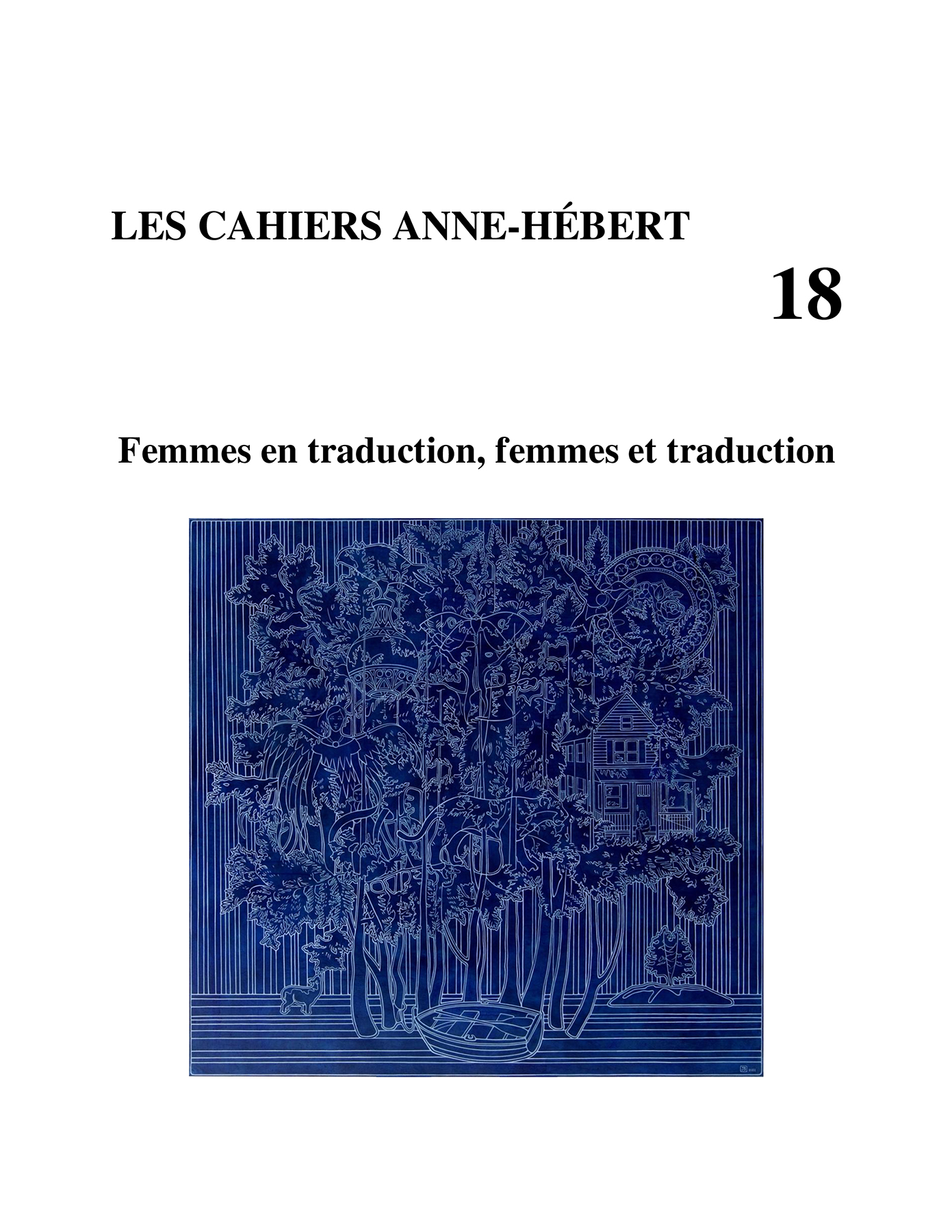

 10.7202/1027917ar
10.7202/1027917ar