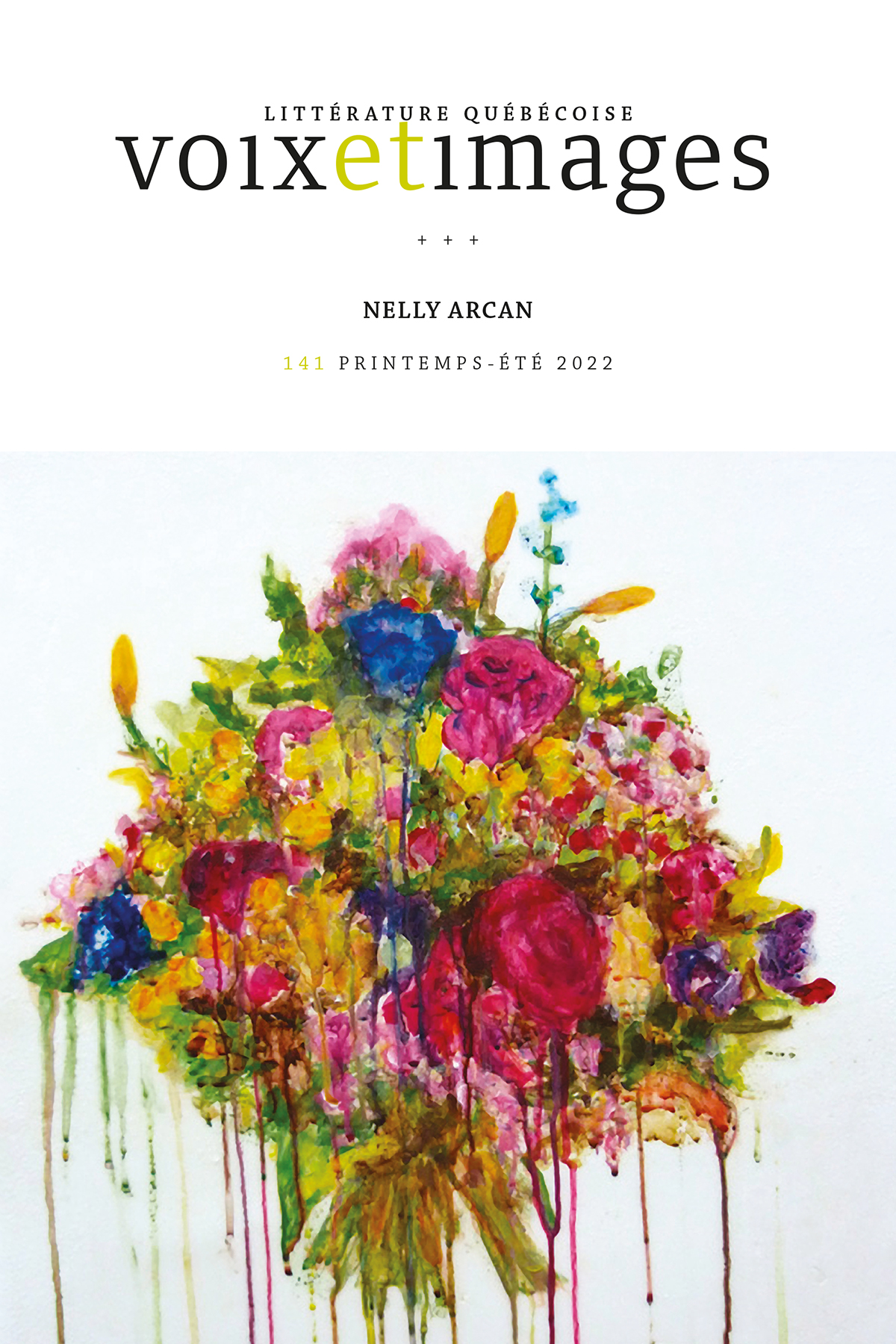Le son peut-il nous apprendre quelque chose en littérature ? Nous n’aurons jamais fini de nous questionner sur le sens des discours, cela va de soi. Un paragraphe de littérature, si tant est qu’on adopte les bonnes dispositions, peut contenir des mondes. Mais combien parmi nous s’essaient à lire leurs livres à voix haute ? Je veux dire dans la solitude, sans public ni rien qui ferait basculer la chose du côté de la performance. C’est ainsi, paraît-il, qu’on lisait en Occident jusque vers le haut Moyen Âge, en prêtant attention au mouvement de ses propres lèvres dans la prononciation. On lisait en même temps qu’on balbutiait. C’était pratique courante pour les lettré·es que de s’appliquer à faire vibrer quelque chose de son propre corps au contact de cet objet au demeurant on ne peut plus désincarné qu’est le texte. Aujourd’hui, on trouve encore des avatars de ces lettré·es à l’ancienne, capables d’un ravissement sans trêve devant le souffle de la parole vive ou toute autre variation de ces termes. Mais quand on les croise, c’est à croire qu’ils ont oublié leur corps à la maison. Plus grave peut-être, la Grande Littérature serait jugée à cette aune : celle d’une espèce de souffle plénier qui passe dans les oeuvres et qui n’a cure des accidents de parcours. Le souffle est universel. La littérature est universelle. Quant au corps, dans son abstraction, ça peut toujours aller. Mais votre corps ? Alors là, un instant. Votre corps, le mien, le leur sont des encombrements. Un corps, ça se salit vite, ça pulse de désirs sans nom, ça mute au cours d’une vie, et qui plus est ça tombe malade sans crier gare. Sans compter qu’un corps a fréquemment le malheur de ne pas être masculin, ou d’être non clairement genré, ou encore d’être visiblement différent de ce que le consensus veut désigner comme la majorité. Bref un corps, en littérature, a intérêt à être sublimé dans un plus grand ensemble, ou au minimum à se tenir tranquille. J’ignore si Charlotte Biron et Edem Awumey, lorsqu’ils écrivent, ont l’impression de faire de la Grande Littérature. J’en doute. Mais je suis convaincu d’une chose : ils savent ce qu’est un corps. Ils savent les liens concrets qu’entretient un corps avec l’univers sonore. Ils savent aussi combien la manifestation la plus éclatante de ces liens – la voix – demeure en quelque sorte l’enfant pauvre de la pensée littéraire. À l’heure où j’écris ces lignes, Charlotte Biron n’en a pas fini d’essuyer la pluie d’éloges et de mises en nomination tombée sur son premier roman, Jardin Radio. C’est un livre assez bref, composé en fragments. L’intrigue n’y est pas primordiale, et ce pour une très bonne raison puisqu’il s’agit avant tout d’un récit de convalescence. Biron l’écrit sans détour : « Tendre les jours, les semaines, les mois pour organiser ce qui arrive en reprenant les coupures, les convalescences et les pertes dans une séquence dramaturgique cohérente ne sert à rien. » (24) La convalescence est celle d’une jeune femme habitant Montréal, étudiante en littérature, impliquée auprès de la radio universitaire, ayant dû subir une série d’opérations chirurgicales à la mâchoire et qui, entre des jours très longs immobilisée dans sa chambre, des visites de contrôle à l’hôpital et quelques conversations téléphoniques de loin en loin, conçoit le projet non pas de mettre son expérience à l’épreuve de la littérature, mais bien l’exact contraire : essayer de voir si l’idée et la pratique de la littérature peuvent conserver leurs pouvoirs intacts face à son épreuve qui ne menace pas que le corps, mais d’abord …
Les chambres d’écoute[Record]
…more information
Daniel Laforest
Université de l’Alberta