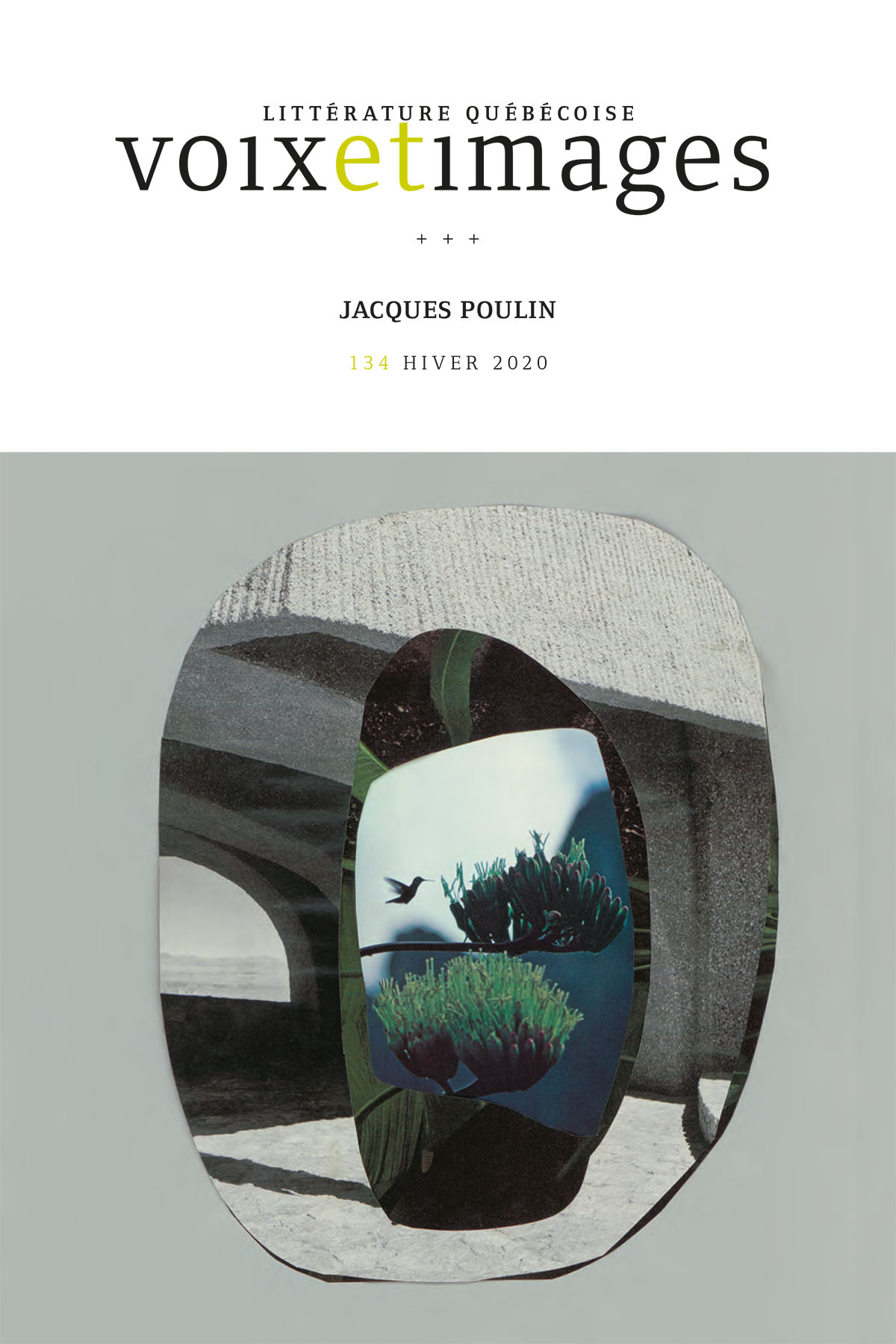Abstracts
Résumé
En s’appuyant sur les trois grandes tendances qui informent les romans de Poulin (l’américanité, la francité et la franco-américanité), cet article vise à mettre en lumière comment la pratique de la série et du cycle romanesques a guidé l’écrivain dans la construction de son oeuvre. Cette sérialité, qui est caractérisée par le paradoxe résidant entre l’ambition secrète du grand roman et la modestie apparente du discours romanesque, a accompagné l’élaboration de ce qu’on a appelé le cycle de Jack Waterman, qui regroupe les romans publiés dans le sillage de Volkswagen Blues. Toutes ces oeuvres expriment bien les apories qui sont constitutives du grand roman américain et plus largement encore franco-américain.
Abstract
Focusing on three major elements that shape Poulin’s novels—the condition of being American, of being French, and of being Franco-American—this article tries to understand how the construction of Poulin’s work has been guided by his use of the series and the novelistic cycle. Seriality—which paradoxically combines a secret ambition to produce a great novel with a seemingly modest novelistic discourse—is a feature of what we may call the Jack Waterman cycle, i.e., the novels published in the aftermath of Volkswagen Blues. All of these works express the aporias that are basic elements of the great American novel, and, more widely, of the great Franco-American novel.
Resumen
Apoyándose en las tres grandes tendencias que informan a Poulin para sus novelas (la americanidad, la francidad y la franco-americanidad), este artículo aspira a poner en evidencia cómo la práctica de la serie y del ciclo novelesco ha guiado al escritor en la construcción de su obra. Esta serialidad, que se caracteriza por la paradoja que se sitúa entre la ambición secreta de la gran novela y la aparente modestia del discurso novelesco, ha acompañado la elaboración de lo que llamamos el ciclo de Jack Waterman, que reúne las novelas publicadas en las huellas de Volkswagen Blues. Todas estas obras expresan bien las aporías que son constitutivas de la gran novela estadounidense, y aún más ampliamente, franco-americana.
Article body
Chez Jacques Poulin, la question de l’entre-deux se pose tout naturellement au regard des références littéraires et des sources d’influence pleinement reconnues et assumées. La critique a montré que Poulin est sans doute le romancier québécois de sa génération le plus marqué par la lecture des auteurs américains, notamment Ernest Hemingway. Dans Chat sauvage, le personnage de Jack fait ainsi l’éloge d’Une saison ardente de Richard Ford, qu’il qualifie de « réussite complète », de « véritable merveille[1] » sur le plan esthétique. On pourrait multiplier les exemples de cet attachement de longue date envers les romanciers américains, qui se double d’une grande admiration pour des écrivains français que la modestie apparente de leur écriture caractérise, comme Patrick Modiano, qui est l’un des écrivains de prédilection du personnage de Marine dans La traduction est une histoire d’amour : « Ses livres ressemblent à la vie. Ils contiennent des souvenirs imprécis, des photos jaunies, des sentiments vagues, des chansons d’autrefois, des rencontres de hasard, des conversations dans les cafés[2]… » Il va sans dire que Marine pourrait affirmer la même chose des romans de Jack Waterman, dont l’oeuvre semble osciller entre une américanité pleinement revendiquée et une francité plus discrète, qui se manifeste à la fois sur les plans littéraire et musical, d’innombrables chansons françaises berçant l’écriture de Poulin et contribuant à la « petite musique » qui habite ses romans. Entre ces deux pôles, l’américanité et la francité, se profile une franco-américanité qui est perceptible dans l’admiration que voue Poulin à des auteures comme Anne Hébert et surtout Gabrielle Roy, cette dernière ayant exprimé de façon exemplaire la manière dont la condition canadienne-française a évolué dans le contexte nord-américain, comme l’a noté François Paré : « Nulle écriture romanesque n’est plus magistralement façonnée par l’imaginaire de l’espace migratoire que celle de Gabrielle Roy, car cette écriture, édifiée par une éthique de la mémoire, résume magistralement les tensions qui président au façonnement du sujet identitaire dans l’espace diasporal[3]. » Ces trois tendances, qui informent tous les romans de Poulin, expliquent aussi comment s’est développée son esthétique romanesque au fil de son oeuvre. L’article qui suit vise ainsi à révéler la perspective d’ensemble ayant guidé Jacques Poulin dans la construction de son oeuvre, celle de la sérialité, caractérisée par le paradoxe résidant entre l’ambition secrète du grand roman et la modestie apparente du discours romanesque.
LA SÉRIE ET LE CYCLE : UNE TRAVERSÉE DE L’OEUVRE DE JACQUES POULIN
Les romans de Jacques Poulin, qui se distinguent par leur unité d’inspiration et par une tonalité à nulle autre pareille, ne vont pas sans évoquer l’idée de la série et du cycle romanesques, au sens où l’entend Anne Besson dans son étude portant sur les ensembles romanesques de la paralittérature[4]. Selon Besson, la totalité des volumes prime dans le cycle, tandis que, dans la série, chaque volume est indépendant : « La série insiste davantage sur l’indépendance des volumes, qui forment un ensemble discontinu ; le cycle, lui, insiste davantage sur la totalité réalisée par l’ensemble, en instaurant une discontinuité entre les volumes[5]. » Néanmoins, cette « bipartition nette du champ des ensembles romanesques représente un idéal théorique, et s’avère largement battue en brèche par les pratiques individuelles[6] » :
Il n’y a donc pas un type de série et un type de cycle, mais des investissements divers du principe dominant de l’ensemble dans différents modes de liaison des volumes : de la linéarité au fractionnement en passant par l’enchaînement, selon qu’ils sont plus ou moins indépendants les uns des autres, et imposent donc au public une contrainte de suivi plus forte ou plus faible[7].
La pratique de la série se manifeste rapidement dans l’oeuvre de Poulin, dès ses trois premiers romans en fait, Mon cheval pour un royaume (1967), Jimmy (1969) et Le coeur de la baleine bleue (1970). Elle se précise et s’amplifie dans les deux romans subséquents de l’auteur, Faites de beaux rêves (1974) et Les grandes marées (1978), qui forment en fait le socle de la grande entreprise cyclique de Poulin, le premier mettant en scène la figure emblématique du frère aîné, prénommé Théo ; le second, celle de l’Auteur, qui annonce de façon ironique, distanciée, le projet esthétique de Poulin, celui d’écrire le « grand roman de l’Amérique » — une idée sur laquelle je reviendrai plus en détail. Tous ces romans nous renvoient à des personnages fortement typés, comme le « commis aux écritures », la « mère poule » ou « l’homme ordinaire », qui reviennent d’un roman à l’autre sous des vocables différents et confèrent progressivement à l’écriture de Poulin une tonalité familière dans laquelle se retrouveront vite ses lecteurs. Gilles Dorion notait ainsi, dans le Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, que chez Poulin « un roman en annonce un autre, sans pour autant s’y répéter. Il en contient l’amorce, que signalent des indices aisément repérables de thèmes, d’espaces, de personnages[8] ». Cette forme particulière de sérialité, qui a contribué à la popularité des romans de Poulin, est déjà en soi l’indice d’une ambition totalisante, qui ne se dissimule sous l’apparente modestie du propos et du style que pour mieux s’exprimer dans l’élaboration d’une oeuvre perçue comme un tout. Dorion écrit d’ailleurs à ce propos qu’une « étude approfondie des innombrables récurrences des romans de Poulin révélerait un univers complet, organisé, dans lequel évoluent les personnages du romancier[9] ».
Il n’est donc pas étonnant de constater que l’idée du cycle se soit peu à peu imposée dans l’élaboration de l’oeuvre de Jacques Poulin, notamment à partir de Volkswagen Blues[10], d’une part avec le retour de la figure emblématique de Théo, le grand frère disparu depuis Faites de beaux rêves, et surtout avec l’émergence du personnage de Jack Waterman, qui se définit désormais comme un écrivain à part entière et non plus comme un modeste « commis aux écritures », comme le faisait le personnage d’Amadou dans Faites de beaux rêves. Dans le roman suivant de Poulin, Le vieux Chagrin (1989), l’écrivain reste d’ailleurs au centre du récit, même s’il est prénommé Jim, comme si Poulin avait tenu à garder, pour un temps du moins, ses distances avec le personnage de Jack Waterman, sans y parvenir tout à fait puisque, de toute évidence, Jim reste un avatar de Jack. Une nouvelle stratégie se manifeste dans La tournée d’automne (1993), la figure de l’écrivain passant tout à coup au second plan, le personnage de Jack n’y faisant qu’une brève apparition, tandis que le rôle principal est confié à un chauffeur de bibliobus qui, s’il n’est pas écrivain, est néanmoins quelqu’un qui favorise la lecture, qui propage à sa façon la bonne nouvelle, au volant d’un véhicule qu’on peut considérer comme un nouvel avatar du minibus Volkswagen. Avec ce roman, Jacques Poulin inaugure une nouvelle manière, en cantonnant l’écrivain dans un rôle secondaire ou de moindre importance après l’avoir mis au centre du récit, comme c’était le cas dans Volkswagen Blues. À l’image du Vieux Chagrin et de La tournée d’automne, Chat sauvage est un roman qu’on peut considérer comme intercalaire, dans la mesure où il met en scène non plus un écrivain proprement dit, mais un « écrivain public », lequel, s’il est prénommé Jack, n’est jamais identifié comme l’écrivain Jack Waterman.
Ce n’est qu’à partir des Yeux bleus de Mistassini[11] qu’on entre pleinement dans ce qu’il est convenu d’appeler le « Cycle de Jack Waterman », puisque la silhouette de ce dernier, sans occuper toujours la place centrale, s’y profile partout. D’autres personnages principaux — un assistant libraire et apprenti écrivain, une traductrice de métier et un lecteur professionnel — prennent alors la relève de l’écrivain et se voient confier le rôle de narrateur[12]. Ce cycle réunit cinq romans : Les yeux bleus de Mistassini, La traduction est une histoire d’amour, L’anglais n’est pas une langue magique[13], L’homme de la Saskatchewan[14] et Un jukebox dans la tête (2015). Dans un sens plus large, il englobe aussi Faites de beaux rêves et Volkswagen Blues, ainsi que les trois romans intercalaires que sont Le vieux Chagrin, La tournée d’automne et Chat sauvage. Le cycle et la série s’entrelacent ainsi dans la deuxième phase de production de Jacques Poulin, celle qui suit son grand succès populaire, Volkswagen Blues, dont Gilles Marcotte avait bien pressenti la rupture qu’il effectue avec ses romans précédents, en multipliant les effets de réel et en accordant une place centrale à Théo, « le héros de l’aventure vécue, du récit réaliste[15] » : « Volkswagen Blues est donc par excellence, dans l’oeuvre de Poulin, le roman de l’acceptation, de l’accord enfin obtenu avec une histoire sans fin ni commencement ; mais il est en même temps celui où ressurgit, où se pose avec le plus d’acuité et de violence la question de la vérité, de la présence[16]. »
Ces considérations nous permettent de saisir sous un autre jour l’oeuvre de Jacques Poulin, qui entremêle une écriture en mode mineur et une ambition totalisante, laquelle consiste d’une part à raconter la suite de l’histoire de Jack Waterman, telle qu’elle s’est déployée après son grand voyage en Californie, et d’autre part à tenter de faire le point sur l’évolution du projet esthétique qui a animé l’essentiel de sa vie. Il convient donc de suivre pas à pas l’écrivain dans chacun des romans qui composent le cycle de Jack Waterman, dans le but de découvrir quelle est sa vérité en tant qu’être humain et, surtout, quelle est la nature exacte de son projet littéraire.
LE CYCLE DE JACK WATERMAN ET LE GRAND ROMAN FRANCO-AMÉRICAIN
À la fin de Faites de beaux rêves, on voit le personnage de Théo disparaître dans l’espace américain, en direction des États-Unis, puis du Mexique, et possiblement jusqu’en Amérique du Sud. Ce motif de la disparition, inscrit par ailleurs dans le déplacement qui transporte l’action du roman loin des murs du Vieux-Québec et des berges du Saint-Laurent, sur le circuit de course automobile du Mont-Tremblant, nous renvoie en filigrane à l’imaginaire même de l’Ouest américain, tel qu’il est exprimé, par exemple, dans les romans de James Fenimore Cooper. Comme l’a bien montré Jacques Cabau dans La prairie perdue, cet imaginaire se fonde sur l’effacement progressif du personnage de Natty Bumppo devant l’établissement des pionniers, et sur sa disparition finale dans le soleil couchant :
Seul avec Hector, son vieux chien édenté qui va le devancer dans la mort, il a fui la civilisation jusqu’au plus profond de la Prairie, sur les contreforts des montagnes Rocheuses où, acculé au Pacifique, il se dresse soudain dans l’éclat du soleil couchant et meurt en criant ce mot cryptique et splendide : Here![17].
Ce motif de la disparition est aussi présent dans l’histoire du Canada français et du Québec, dont de larges pans racontent l’évanescence des populations françaises installées dans l’ouest du continent. On peut d’ailleurs supposer que c’est une des raisons pour lesquelles Jacques Poulin parlera, de façon mi-sérieuse, mi-ironique, dans L’homme de la Saskatchewan, du rêve de l’écrivain Jack Waterman d’écrire « le chef-d’oeuvre immortel de Fenimore Cooper » (HS, 31). En ce sens, la finale de Faites de beaux rêves annonce le projet qui anime Jack Waterman dans Volkswagen Blues, soit de retracer, aux sens propre et figuré, son frère disparu, en se lançant à sa recherche sur les routes de l’Amérique. Le motif de la trace viendra pallier, dans Volkswagen Blues, le motif de la disparition, et se dédoublera dans un autre motif très puissant, celui de l’apparition, improbable et inattendue, du francophone dans les solitudes de l’espace américain.
D’autre part, Volkswagen Blues viendra relancer un épisode important des Grandes marées, qui nous montre le personnage de l’Auteur en train d’expliquer aux participants d’une séance de « dynamite de groupe » son rêve d’écrire le « Grand Roman de l’Amérique », en opérant la synthèse entre deux grandes esthétiques romanesques, la française et l’américaine :
En deux mots, voici : le roman français s’intéresse plutôt aux idées, tandis que le roman américain s’intéresse davantage à l’action. Or, nous sommes des Français d’Amérique, ou des Américains d’origine française, si vous aimez mieux. Nous avons donc la possibilité, au Québec, d’écrire un roman qui sera le produit de la tendance française et de la tendance américaine. C’est ça que j’appelle le grand roman de l’Amérique[18].
Même si, dans ce roman, la figure de l’Auteur tranche singulièrement avec celle, à venir, de Jack Waterman[19], elle n’en annonce pas moins cette ambition totalisante qui animera Jacques Poulin dans Volkswagen Blues et dans les romans qui forment le cycle de Jack Waterman. En fait, si le personnage de l’Auteur évoque bien plus le stéréotype de l’écrivain national, façon Victor-Lévy Beaulieu, que le commis aux écritures, il exprime néanmoins la tentation qui habite Poulin d’écrire à sa façon le grand roman américain, ou pour être plus précis le grand roman franco-américain, qui en proposerait une autre version, une autre déclinaison. Mais cette ambition d’essence romantique sera sans cesse tenue à distance, remise en question, minée de l’intérieur par une écriture tournée vers le mineur, le singulier, le fragment, pour ne pas dire vers la fragmentation et la pulvérisation. Les deux tendances coexistent chez Jacques Poulin, comme l’exprime chacun des romans qui composent le cycle de Jack Waterman.
Volkswagen Blues nous en donne une démonstration éloquente. D’une part, ce roman prend les dimensions de tout un continent, qui s’étend de la Gaspésie à San Francisco, en relatant son histoire et en mettant en lumière le rôle déterminant qu’y ont joué les Français puis les Canadiens. Il se déploie ainsi comme une grande fresque qui explore les routes de l’Amérique et les événements qui jalonnent son histoire. Dans une tendance opposée, l’ambition du grand roman ne cesse d’être contestée par l’intrusion du fragmentaire, du discontinu : c’est moins la fluidité qui caractérise le voyage sur la grand-route que son aspect décousu, tandis que le grand récit historique fait place à la récitation, par les protagonistes qui se définissent eux-mêmes comme « les deux plus grands menteurs de l’Amérique du Nord » (VB, 79(, d’une série de petites histoires qui viennent déconstruire la grande Histoire, ou du moins la contester. Jack Waterman et la Grande Sauterelle n’empoignent pas à bras-le-corps, comme dans le fantasme du grand roman américain, le continent ; ils ne font que le parcourir avec la plus grande légèreté possible, s’intéressant moins aux réalités tangibles qu’aux traces laissées par Théo et, à travers elles, aux reliques de la présence française sur ce territoire. De la même façon, ils ne se saisissent pas du grand récit de l’exploration et de la colonisation de l’Ouest américain, mais ils se montrent attentifs à une foule de micro-récits qui le redoublent et lui confèrent son sens véritable. Au cours de leur périple américain, Jack Waterman et la Grande Sauterelle lisent beaucoup, visitent des musées, découvrent des lieux de mémoire et se racontent toutes sortes d’histoires, de telle manière que le trajet qu’ils effectuent dans l’espace du continent se fragmente progressivement, pour faire place à une série de rencontres qui s’apparentent soit à des rémanences, soit à des révélations, ou encore à des apparitions qui mettent en lumière la présence française et canadienne-française sur le continent américain[20]. C’est de cette façon que Jacques Poulin transpose, dans Volkswagen Blues, l’ambition du personnage de l’Auteur exprimée dans Les grandes marées. Il ne s’agit plus d’opérer une synthèse entre la littérature d’action et celle d’idées, mais de raconter comment a perduré une autre dimension, française et métissée, de l’Amérique.
Sans doute en raison de son succès populaire, mais assurément en vertu de sa réussite esthétique, Volkswagen Blues est devenu une étape importante dans l’oeuvre de Jacques Poulin. Et s’il ne s’est pas directement appuyé sur ce roman dans la rédaction de ses romans intercalaires, Le vieux Chagrin, La tournée d’automne et Chat Sauvage, Poulin est resté fidèle à sa manière et à ses thématiques. Ainsi, dans Le vieux Chagrin, le personnage de l’écrivain joue un rôle central, même s’il ne se nomme plus Jack Waterman. Le thème du voyage donne tout son sens à La tournée d’automne, qui constitue le pendant maritime, océanique de Volkswagen Blues. Quant à Chat sauvage, il met en scène le personnage de Jack devenu (ou redevenu) écrivain public dans ce quartier du Vieux-Québec dont il est, au fond, indissociable.
Mais c’est avec Les yeux bleus de Mistassini que Poulin va relancer véritablement le projet qui animait Volkswagen Blues, en revenant explicitement sur la figure de Jack Waterman, désormais âgé de soixante-deux ans, l’âge atteint par son écrivain modèle Ernest Hemingway au moment de son suicide. Victime de pertes de mémoire et de divers problèmes de santé, Jack songe à passer le relais à Jimmy, un jeune homme de 25 ans qui travaille pour lui dans sa librairie de la rue Saint-Jean. Convaincu que les oeuvres littéraires sont « le fruit d’un travail collectif » (YB, 41), Jack défend l’idée « que les vieux écrivains, au lieu de se répéter ou de rédiger leurs mémoires, [auraient] intérêt à trouver des auteurs plus jeunes et aptes à prendre la relève » (YB, 41). Le roman gravite ainsi autour de la relation entre un mentor et un écrivain en herbe, établissant au passage un lien improbable entre Jack Waterman et le personnage éponyme de Jimmy, un roman publié en 1969. Un calcul rapide tend par ailleurs à montrer que Jimmy aurait plus de 25 ans au moment où se déroule l’action du roman, soit en 1998 ou 1999, donc presque 30 ans après la publication du roman qui porte son nom. Comme je l’ai mentionné dans un article récent[21], Les yeux bleus de Mistassini propose une illustration saisissante, à travers la mise en scène par l’auteur de trois de ses romanciers de prédilection, Ernest Hemingway, Gabrielle Roy et Philippe Sollers, de l’américanité, de la franco-américanité et de la francité de ses sources d’inspiration. Mais ce roman relance aussi le projet romanesque de Poulin en mettant à l’avant-plan la figure de Jack Waterman, même si ce dernier s’est aigri avec l’âge et est devenu de plus en plus intransigeant, notamment à l’endroit des médias et du monde de l’édition. Les yeux bleus de Mistassini donne ainsi l’occasion à l’auteur de revenir sur le succès de Volkswagen Blues et sur la postérité de ce roman. Selon son éditeur, « le livre se vend encore très bien » (YB, 66), « [l]es gens continuent de l’acheter » (YB, 66), ce à quoi Jack rétorque : « Tant pis pour eux ! » (YB, 66) Cette mise à distance par l’écrivain du roman qui a contribué à sa célébrité témoigne de sa propension à déconstruire son oeuvre au fur et à mesure de son élaboration, comme si le roman qui vient d’être publié tombait automatiquement dans le discrédit, quand ce n’est pas dans l’oubli. Autre problème : Jack en est arrivé à confondre son personnage de Théo avec celui de Majorique, qu’on retrouve dans une nouvelle de Gabrielle Roy, De quoi t’ennuies-tu, Éveline ? (1982), qui raconte elle aussi un voyage vers la Californie à la recherche d’un frère disparu, ce qui fait dire à Jimmy : « Où allions-nous […] si le vieux Jack en arrivait à confondre ses personnages avec ceux qui avaient été mis au monde par un autre écrivain ? » Ce rapport établi avec Gabrielle Roy[22] met en lumière la force d’attraction qu’exerce l’idée du cycle chez Jacques Poulin, dans la mesure où cette réalité en arrive à transcender l’écrivain en l’inscrivant dans une sérialité non plus individuelle mais collective. Jack Waterman échafaude ainsi « une théorie suivant laquelle les oeuvres littéraires [sont], contrairement aux apparences, le fruit d’un travail collectif » (YB, 41).
Dans le roman subséquent de Poulin, La traduction est une histoire d’amour, l’action se déroule une dizaine d’années avant Les yeux bleus de Mistassini, soit en 1988 environ. Volkswagen Blues en informe toute la trame narrative puisque c’est ce roman plutôt que tout autre que Marine a choisi de traduire en anglais. Certes, elle ne l’affirme jamais explicitement, parlant plutôt du roman consacré à la piste de l’Oregon, mais l’allusion est claire. Comme Jack Waterman, Marine a voyagé jusqu’en Californie, mais par un autre chemin, en longeant la côte atlantique jusqu’à Key West, puis en se dirigeant vers La Nouvelle-Orléans et San Diego ; elle a séjourné ensuite à San Francisco, avant de revenir au Québec en empruntant en sens inverse la piste de l’Oregon. Mais tout comme Jack Waterman, Marine est restée attachée à la France, à sa langue et à sa culture ; c’est d’ailleurs au moment d’un passage dans le Midi, à Arles, qu’elle a rencontré par hasard l’éditeur français[23] de Jack, qui lui a recommandé la lecture d’un roman se déroulant sur la piste de l’Oregon, Marine spécifiant que c’est « à ce moment précis que l’idée [lui] est venue de traduire monsieur Waterman en anglais » (TH, 19). Or, elle va peu à peu prendre conscience de l’importance que représente Volkswagen Blues dans l’oeuvre de Poulin : « Plus j’avançais dans la traduction de ce roman, plus je comprenais une chose : le livre que j’avais en main constituait la dernière étape de son oeuvre. Celle-ci était à présent terminée. Tout ce qui allait venir ensuite, si je peux me permettre, ne pouvait être qu’un hors-d’oeuvre. » (TH, 54 ; l’auteur souligne) La formule est intéressante mais quelque peu énigmatique, puisque dans le langage courant, le hors-d’oeuvre vient avant le plat principal, et non ensuite ; or Marine semble vouloir désigner par cette expression tout ce qui se situe hors de l’oeuvre véritable, Volkswagen Blues en constituant manifestement l’apogée ou l’aboutissement. L’importance dévolue par Marine à ce roman tend à montrer qu’il représente quelque chose de spécial pour elle, ce qui s’explique peut-être par l’envergure de son projet et par le fait qu’il incarne à sa façon l’ambition du grand roman américain, mais dans sa version française. C’est sans doute ce qui détermine sa volonté de le traduire en anglais, parce que si, comme le titre du roman l’indique, la traduction est une histoire d’amour, c’est qu’elle suppose la rencontre entre deux êtres, ce que semble souhaiter Marine : « S’il existait un moyen de rejoindre quelqu’un dans la vie — ce dont je n’étais pas certaine —, la traduction allait peut-être me permettre d’y arriver. » (TH, 12)
Publié en 2009, L’anglais n’est pas une langue magique va développer la réflexion non pas tant sur la traduction que sur la place du français en Amérique, une question qui occupe d’ailleurs une place centrale dans Volkswagen Blues. Tout au long de leur périple américain, Jack Waterman et la Grande Sauterelle sont confrontés à la fragilité, mais aussi à la résilience du français, que ce soit à Toronto, à Détroit, à Chicago, à Saint-Louis ou à San Francisco. Ils marchent aussi dans les nombreuses traces de la présence française sur le continent, trop souvent occultées dans le grand récit que les nations ont élaboré au fil des années, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. Volkswagen Blues est ainsi le roman par excellence de la franco-américanité. Il n’est donc pas étonnant de constater que, dans L’anglais n’est pas une langue magique, Jack Waterman caresse le projet d’écrire un roman « sur la place du français en Amérique » (AL, 23) en s’appuyant sur le traumatisme de la Conquête et ses effets à long terme :
Il avait étudié à fond la défaite des plaines d’Abraham. La bataille, qui n’avait duré qu’une demi-heure, s’était déroulée à quelques mètres derrière moi. Le marquis de Montcalm avait été tué, le Canada était devenu un pays britannique et, depuis lors, nous avions tous la mort dans l’âme : c’étaient les mots de mon frère.
AL, 24
Le roman comporte d’ailleurs une scène saisissante montrant une femme qui traverse le champ de bataille, passe à travers les blessés et descend la falaise de l’anse au Foulon, avant d’embarquer sur un grand voilier : « Mon rêve se figeait sur une dernière image : la femme était à la proue du voilier, et celui-ci, doublant la pointe de l’île d’Orléans, mettait le cap sur le golfe et la vieille Europe. » (AL, 40) En un sens, cette image reconduit le poncif, présent dans l’historiographie, de l’abandon du petit peuple par les élites au lendemain de la Conquête, mais elle traduit aussi la nostalgie des origines, voire du paradis perdu. En fait, le roman cherche à résoudre l’impasse qui est souvent faite, dans le roman contemporain, sur la mémoire collective du Québec, personne ne sachant trop de quoi on doit se souvenir ni même si la chose est souhaitable. En direction de l’île d’Orléans, Jack Waterman rappelle ainsi à son frère l’épisode de la possession de la Louisiane, qui « occupait presque la moitié du territoire américain : elle s’étendait des Grands Lacs au golfe du Mexique, et du Mississippi aux Rocheuses » (AL, 48). Le roman à venir de Jack Waterman prend donc une portée didactique, en cherchant à remédier à l’amnésie collective, par exemple en rappelant l’importance des toponymes et des patronymes français dans le récit des explorateurs Lewis et Clarke :
De mon côté, je me réjouissais de constater que le parcours des explorateurs était jalonné de noms français. Noms de villages, de cours d’eau, de collines, mais aussi de voyageurs, de guides, d’aventuriers, de traiteurs de fourrures. Ils s’appelaient Loisel, Dorion, Laliberté, Lepage… Leurs noms avaient des consonances familières et je les prononçais avec d’autant plus de respect que l’Histoire les avait oubliés.
AL, 81
Le roman imaginaire sur lequel planche Jack Waterman rebrasse ainsi la matière traitée dans Volkswagen Blues, tout en redoublant l’action du roman que le lecteur a sous les yeux, qui traite à sa façon de la coexistence difficile du français et de l’anglais, et de la lutte de pouvoir qui les oppose, le premier étant investi subrepticement par le second, notamment dans le langage courant. Dans l’épisode qui donne tout son sens au titre au roman, Francis, le petit frère de Jack, est outré qu’un mot comme deal ait remplacé le mot marché, ce qui lui fait dire que « l’anglais n’est pas une langue magique », c’est-à-dire une langue qui serait en mesure de mieux exprimer la réalité que le français. L’anglais est plutôt une langue de pouvoir, qui exerce progressivement son empire sur les locuteurs du français, lesquels sont en voie de l’intérioriser. C’est pourquoi le projet littéraire de Jack Waterman s’avère aussi vital ; en un sens, il participe de la survie du français en Amérique. Mais ce projet semble menacé, miné de l’intérieur par l’incapacité de l’écrivain de le mener à terme et par le geste même d’une écriture qui a tendance à partir dans tous les sens :
Au début, il entrevoyait une sorte d’épopée. Ils étaient tous là dans sa tête : Champlain et ses projets d’alliance avec les Indiens ; les explorateurs qui élargissaient le territoire jusqu’aux Rocheuses et au golfe du Mexique ; les coureurs des bois et les aventuriers qui parcouraient les régions en tous sens ; les hommes politiques, de Louis-Joseph Papineau à René Lévesque, qui protégeaient la langue et les institutions ; les gens ordinaires, et surtout les mères de famille qui assuraient la survivance du pays par leur labeur quotidien […]. Toutes ces personnes, Jack voulait les inclure dans son livre. Mais lorsqu’il se mettait à écrire, les mots venaient au compte-gouttes et, chaque jour, le récit perdait de sa force et de son ampleur.
AL, 110
L’épopée rêvée par Jack laisse ainsi la place à l’histoire racontée par Francis, qui prend conscience peu à peu, au fil de ses lectures, de sa propre franco-américanité et de son appartenance à une lignée qui a été oubliée par l’Histoire, et presque effacée de la mémoire. Il en arrive ainsi à faire l’éloge des petites gens, des citoyens obscurs, des gens ordinaires, qui ont fait la petite histoire de l’Amérique française, de concert avec les grandes figures du passé qui sont présentes dans le discours historiographique :
Je pensais à Charbonneau, Drouillard, Cruzatte et à tous les autres, les obscurs et les sans-grade ; aux grands explorateurs, Jolliet, La Salle et La Vérendrye ; et même à mon père, qui était capable de bâtir une maison. À propos de tous ces gens-là, je voulais dire qu’un peu de leur sang, mélangé à du sang indien, coulait dans mes veines.
AL, 144
Cette prise de conscience culmine dans L’homme de la Saskatchewan, un roman consacré lui aussi à la place du français en Amérique du Nord et à la question du métissage, qui sont abordées cette fois à travers le personnage d’Isidore Dumont, un joueur de hockey métis qui est né à Batoche et qui est le petit-neveu de Gabriel Dumont, le compagnon d’armes de Louis Riel. Jack Waterman, qui a accepté de rédiger pour lui le plaidoyer qu’il compte diffuser en faveur du français, confie finalement cette tâche à son frère Francis. Comme son ancêtre Gabriel Dumont, Isidore est un résistant, qui est révolté par le peu de place qui est accordé au français dans la Ligue nationale de hockey et surtout dans le Grand Club, le Canadien de Montréal. Le roman marque aussi le retour de la Grande Sauterelle, qui rapporte à Québec le vieux Volkswagen de Jack, au terme d’un séjour de dix ans à San Francisco. Avec Isidore Dumont et la Grande Sauterelle, ce sont la réalité métisse et l’imaginaire des grandes plaines qui investissent le faubourg Saint-Jean-Baptiste, d’autant plus que la Grande Sauterelle a fait un arrêt à Batoche en revenant de San Francisco, où elle a pris connaissance de l’histoire des Métis. Elle en a ramené tout un récit prenant les dimensions d’une épopée, qu’elle livre à Francis :
Cette fille était une Métisse de l’Est, le sang indien qui coulait dans ses veines était celui des Montagnais de la Côte-Nord, et pourtant, rien qu’à l’écouter, j’imaginais facilement le long cortège des charrettes bâchées qui s’éloignaient de la rivière Rouge ou de la Saskatchewan-Sud pour se rendre aux endroits où les éclaireurs avaient signalé la présence des immenses troupeaux.
HS, 29
L’homme de la Saskatchewan vient ainsi mettre un point d’orgue à Volkswagen Blues et au cycle de Jack Waterman, en en soulignant la portée épique, fût-elle menacée par les aléas de l’écriture et l’impossibilité intrinsèque du grand roman. Francis constate d’ailleurs que pour certaines personnes, comme Isidore Dumont, « le passé ne s’arrête jamais » (HS, 109) ; englobant la mémoire du Québec, du Canada français et de l’Amérique française, le roman de Poulin fait écho à un discours historique tombé dans l’oubli et à une mémoire collective défaillante, qui semble avoir fait l’impasse sur son passé.
Quant à un Un jukebox dans la tête, il est venu clore le cycle de Jack Waterman en mettant l’accent non plus sur la place du français en Amérique du Nord, mais sur des considérations esthétiques, notamment sur l’influence déterminante exercée conjointement sur l’écrivain par Ernest Hemingway et Gabrielle Roy, un peu comme dans Les yeux bleus de Mistassini. Le dernier roman publié par Jacques Poulin, du moins jusqu’à ce jour, marque aussi le retour du narrateur-écrivain, comme si plus personne ne devait venir interférer entre lui et son projet esthétique. Jack révèle en effet : « Chaque fois que les mots me font défaut, ou encore que les événements de la vie me détournent de mon travail, je demande à Gabrielle Roy ou bien à Ernest Hemingway de venir à mon secours[24]. » L’écrivain envisage même l’idée de travailler à établir un parallèle entre les observations de Gabrielle Roy sur l’écriture et les propos d’Ernest Hemingway sur le même sujet : « J’en étais à me demander si ce genre d’essai ne serait pas plus intéressant que mes courts romans écrits avec tant de difficultés […]. » (JT, 29) En dernier recours, l’essai menace ainsi de phagocyter l’oeuvre romanesque en mettant à jour ses fondements mêmes, sa genèse la plus intime, associée à l’influence conjointe de Gabrielle Roy et d’Ernest Hemingway, deux des plus grands romanciers de l’américanité, entendue ici dans son sens le plus large.
+
Le cycle de Jack Waterman oscille ainsi entre l’ambition de son projet d’ensemble et le fractionnement que lui infligent les aléas mêmes de son écriture. D’une part, Poulin semble hanté par l’idée d’un grand roman franco-américain qui serait le réceptacle d’une mémoire autrement défaillante, un peu à la manière de Victor-Lévy Beaulieu et de son ambition dévorante d’écrire le roman total de cette grande tribu qu’est le Québec. D’autre part, l’auteur de Volkswagen Blues reste éminemment conscient, sinon de la futilité de cette ambition, du moins des difficultés de la concrétiser. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi Poulin se plaît tant à jouer avec certains codes du roman, notamment ceux du roman policier, dans ses derniers livres, qui juxtaposent aux réflexions menées sur la place du français en Amérique du Nord et sur la transmission de sa mémoire des intrigues policières volontairement invraisemblables. Un roman comme L’homme de la Saskatchewan est révélateur de cette tendance, dans la mesure où il oppose à un questionnement teinté de gravité sur la réalité franco-métisse une intrigue qui confine au grotesque, particulièrement avec le duo formé par le commissaire de la Ligue nationale de hockey, en qui il est facile de reconnaître Gary Bettman, et son homme de main surnommé Mad Dog en référence au célèbre lutteur Maurice Mad Dog Vachon. Comme dans Les grandes marées, le grand roman côtoie ainsi le cartoon, comme si Jacques Poulin voulait signifier à ses lecteurs que toute oeuvre s’inscrit au fond dans un espace interstitiel, dans une esthétique de l’entre-deux. En fin de compte, l’entreprise de Poulin ne se situe pas très loin de celle d’un Philip Roth, qui proposait en 1973, dans son roman The Great American Novel, une lecture distanciée, ironique, du grand roman américain.
Appendices
Note biographique
JEAN MORENCY est professeur titulaire au Département d’études françaises de l’Université de Moncton. Son principal champ de recherche est la question de l’américanité de la littérature québécoise, à laquelle il a consacré deux ouvrages, Le mythe américain dans les fictions d’Amérique. De Washington Irving à Jacques Poulin (1994) et La littérature québécoise dans le contexte américain (2012) ainsi que plusieurs articles savants et chapitres d’ouvrages collectifs. Il est membre de l’Académie des arts, des lettres et des sciences humaines de la Société Royale du Canada.
Notes
-
[1]
Jacques Poulin, Chat sauvage, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 1998, p. 26.
-
[2]
Jacques Poulin, La traduction est une histoire d’amour, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2006, p. 22. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle TH suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[3]
François Paré, Le fantasme d’Escanaba, Québec, Nota bene/CEFAN, 2007, p. 38-39.
-
[4]
Anne Besson, D’Asimov à Tolkien. Cycles et séries dans la littérature de genre, Paris, CNRS Éditions, coll. « Littérature et linguistique », 2004, 256 p.
-
[5]
Ibid., p. 22.
-
[6]
Ibid., p. 23.
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Gilles Dorion, « Jimmy », Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec, Maurice Lemire (dir.), t. IV : 1960-1969, Montréal, Fides, 1984, p. 470. Pour une analyse plus détaillée du phénomène, on consultera le travail de Karine Vachon, La transfictionnalité dans l’oeuvre de Jacques Poulin, mémoire de maîtrise, Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi, 2009, 105 f.
-
[9]
Gilles Dorion, « Jimmy », p. 470.
-
[10]
Jacques Poulin, Volkswagen Blues, Montréal, Québec/Amérique, coll. « Littérature d’Amérique », 1984, 290 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle VB suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[11]
Jacques Poulin, Les yeux bleus de Mistassini, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2002, 187 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle YB suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[12]
Consulter à ce sujet mon article intitulé « Une histoire dont vous n’êtes pas le héros. Le vieux Chagrin de Jacques Poulin », Frances Fortier et Andrée Mercier (dir.), La transmission narrative. Modalités du pacte romanesque contemporain, Québec, Nota bene, coll. « Contemporanéités », 2011, p. 97-110.
-
[13]
Jacques Poulin, L’anglais n’est pas une langue magique, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2009, 160 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle AL suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[14]
Jacques Poulin, L’homme de la Saskatchewan, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 2011, 120 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle HS suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[15]
Gilles Marcotte, « Histoires de zouaves », Études françaises, vol. XXI, no 3, hiver 1985, p. 15.
-
[16]
Ibid., p. 17 ; l’auteur souligne.
-
[17]
Jacques Cabau, La praire perdue. Le roman américain, édition revue et augmentée, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1981 [1966], p. 122.
-
[18]
Jacques Poulin, Les grandes marées, Montréal, Leméac, coll. « Roman québécois », 1978, p. 175-176.
-
[19]
Dans Les grandes marées, celui qui évoque le plus Jack Waterman est plutôt Teddy Bear, le modeste traducteur de bandes dessinées.
-
[20]
Gilles Marcotte remarque à ce propos : « Ce qui devait ou aurait pu être, dans une tout autre perspective, à la suite de Théo, une histoire de la pénétration du continent américain, devient une collection discontinue d’histoires, de visites, de rencontres — chacune plus importante que le sens général de l’entreprise. Traversant en diagonale toute l’Amérique du Nord, de Gaspé à San Francisco, Jack Waterman et la Grande Sauterelle ne retrouvent que “des parcelles du vieux rêve”, du “Grand Rêve de l’Amérique” qui “s’était brisé en miettes comme tous les rêves” (VB, 101). Ils vivent l’Amérique non comme un Tout, dans la gloire du sens et de l’aventure, mais comme des “miettes”, des “parcelles”, des fragments. Non pas l’Histoire, mais des histoires. Et c’est là, dans cette dispersion, dans cette succession discontinue d’images, que s’invente le bonheur, le plus fragile qui se puisse imaginer (et pour la première fois peut-être accepté sans arrière-pensée par un personnage de Poulin), d’un récit livré aux seules grâces de l’instant. » Gilles Marcotte, « Histoires de zouaves », p. 16.
-
[21]
Jean Morency, « Entre américanité et francité : Les yeux bleus de Mistassini, de Jacques Poulin », Interculturel francophonies, no 32, novembre-décembre 2017, p. 147-159.
-
[22]
Consulter à ce sujet le travail de Rébecca A. S. Richardson, Gabrielle Roy dans l’univers de Jacques Poulin, mémoire de maîtrise, Montréal, Université McGill, 2006, 123 f., ainsi que mon article intitulé « La figure de Gabrielle Roy chez Jacques Poulin et Michel Tremblay », Canadian Literature, no 192, printemps 2007, p. 97-109.
-
[23]
Marine parle de sa rencontre impromptue avec un « monsieur moustachu », en qui il est facile de reconnaître Hubert Nyssen, le fondateur d’Actes Sud.
-
[24]
Jacques Poulin, Un jukebox dans la tête, Montréal, Leméac, 2015, p. 28. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle JT suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.