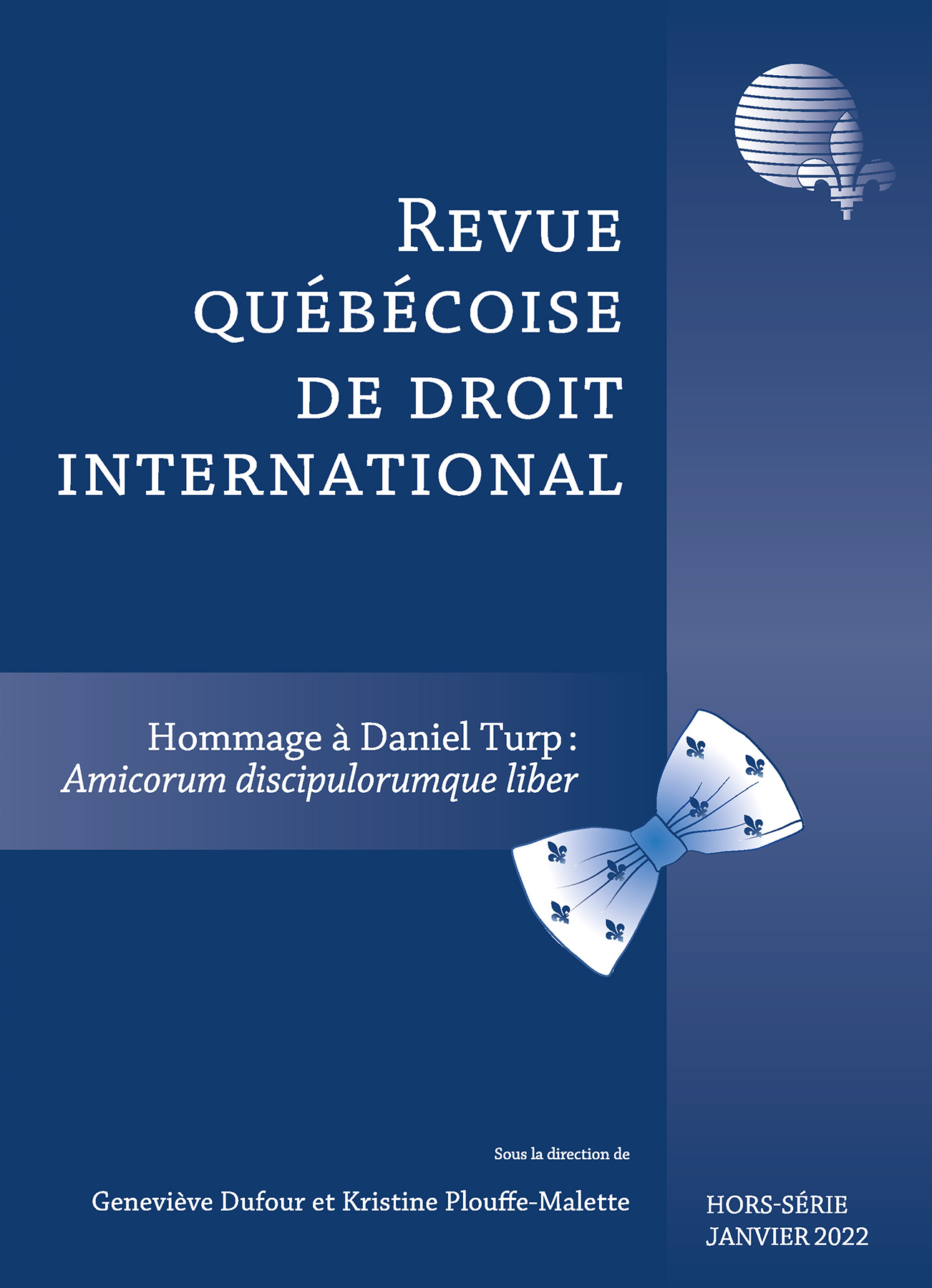On connaît la première phrase de À la recherche du temps perdu : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Longtemps aussi – et sans qu’il soit évidemment question de me comparer à Marcel Proust –, j’ai recherché un concertorondo de Mozart qui avait enchanté ma plus tendre enfance, à l’âge de trois ans, d’après ce que me disait ma mère. Je me fie à cette dernière, car les souvenirs d’un tel âge se limitent généralement à ceux qu’on reconstruit sur la base de vieilles photos d’albums de famille. Ce rondo, gravé depuis toujours dans ma mémoire et, jadis, sur la cire des fragiles 78 tours de l’époque (fin des années quarante), a dû contribuer au bonheur des disquaires de l’époque, car, en voulant apporter le disque à ma mère pour qu’elle le fasse jouer sur le gramophone familial, les mains maladroites d’un gamin de trois ans ont plus d’une fois laissé échapper le précieux objet qui se fracassait sur le sol, un souvenir resté, lui, bien vivace! Ce n’était pas encore l’heureux temps du vinyle et encore moins celui des CD à peu près incassables. Ma mère était donc obligée de racheter un nouvel exemplaire du disque réclamé (probablement à grands cris…), pour que je puisse réécouter le morceau magique qui enchantait mes oreilles. Aujourd’hui, miracle d’Internet, j’ai réussi à retrouver le morceau en question : un Rondoen ré pour piano et orchestre K 382… Merci, YouTube! La question que je me suis posée beaucoup plus tard et qui m’obsède encore est de savoir pourquoi j’aimais tant ce morceau et, de manière plus générale, comment s’explique le mécanisme d’attachement de l’être humain à une oeuvre d’art – musique, peinture, danse, littérature… – : pourquoi aime-t-on ceci ou cela? Cet hommage au professeur et ami, Daniel Turp, me fournit d’autant plus l’occasion d’y réfléchir que je partage avec le destinataire de ces brèves réflexions deux passions, le droit international des droits de la personne et la musique. En ce qui concerne les droits de la personne et la musique, on trouve parfois des liens étranges entre les premiers et la seconde : ainsi, certains nazis jugés par le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945-1946 étaient des mélomanes avertis et parfois même, des musiciens de haut niveau. Lors du procès de Nuremberg, un psychiatre américain, le docteur Leon Goldensohn avait pu s’entretenir avec la plupart des accusés dans les locaux du centre de détention de Nuremberg. Il ressort de ces entretiens que trois des dix-neuf accusés rencontrés par Goldensohn avaient eu une formation musicale classique : Funk, l’ancien ministre de l’Économie et président de la Reichsbank, jouait du piano (en concert), du violon et du violoncelle, l’examiral Dönitz, de la flûte, l’exgouverneur général de Pologne, Frank, du piano et de l’orgue; de son côté, Göring déclare qu’il aimait Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Wagner; toujours selon Göring, Hitler, mélomane lui aussi, préférait Wagner, Mozart, Verdi et Beethoven… Dans le bunker où il s’est suicidé, le 30 avril 1945, les Soviétiques ont retrouvé des 78 tours avec la musique de compositeurs russes : Tchaïkovski, Borodine, Rachmaninov. Apparemment, Hitler leur pardonnait d’être des Slaves et donc, selon lui, d’appartenir à « la race des soushommes »! Bref, on le voit, la musique n’adoucit pas nécessairement les moeurs : même des monstres peuvent y être sensibles ce qui permet de conclure que la musique classique ne contribue pas, en soi, au respect des droits de la personne. Ceci ne répond cependant pas à la question initiale de savoir pourquoi on est spécialement touché par des sons, des …
Pourquoi aime-t-on une musique ?[Record]
Professeur émérite de droit international public, Université libre de Bruxelles (ULB).