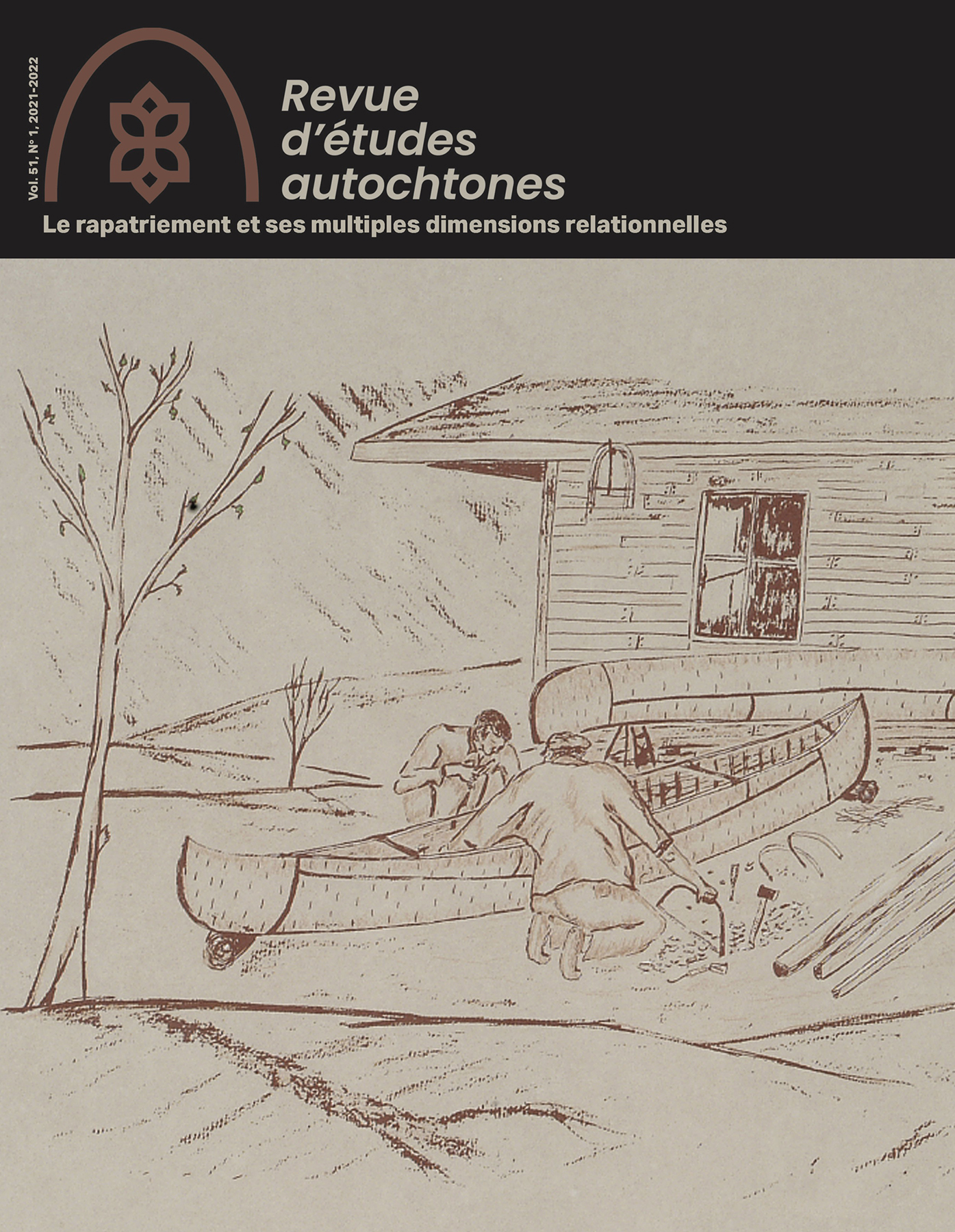Article body
À l’instar de son opus précédent (Viau 2005), cette nouvelle parution de l’ethnohistorien Roland Viau constitue en quelque sorte un recueil d’essais portant sur le sort réservé aux habitants du village d’Hochelaga, en particulier, et aux Iroquoiens du Saint-Laurent en général, après leurs premiers contacts avec les Français dans la Plaine laurentienne au cours du xvie siècle. Le coeur de l’ouvrage s’articule autour des textes remaniés de trois grandes conférences présentées auprès du grand public en 2017 et 2018. Chacune de ces conférences comporte une thèse que l’auteur détaille et appuie par une analyse précise et approfondie des sources ethnohistoriques, fidèle à la marque de commerce de l’auteur.
Ces thèses sont précédées de trois chapitres introductifs qui visent à les situer dans leur contexte géographique, historique et culturel. Dans le premier, l’auteur dépeint l’environnement naturel dans lequel s’est déployée la chronique d’une dispersion tragique. Les modes d’exploitation des ressources par les Iroquoiens y sont brièvement passés en revue, parmi d’autres sujets. Le deuxième chapitre s’intéresse aussi à la géographie, culturelle celle-là. L’auteur y présente en effet un portrait socioculturel des Iroquoiens du Saint-Laurent, en mettant l’accent sur leur organisation sociale et, plus accessoirement, politique. Le rôle des femmes et de la guerre y est notamment abordé, reprenant en cela les propos développées antérieurement par l’auteur dans ses deux remarquables synthèses portant sur ces deux sujets importants (Viau 1997 et 2000). En fait, certains verront dans ces longs chapitres la principale critique que l’on peut faire à cette parution : l’auteur y passe beaucoup de temps à reprendre des idées développées ailleurs et à mettre la table pour la présentation d’idées nouvelles qui viendront beaucoup plus tard dans l’ouvrage. Certes, les néophytes et, surtout, ceux et celles qui n’ont pas lu les précédents livres de Viau, y trouveront sans doute les éléments primaires nécessaires à la compréhension des thèses développées plus loin, mais d’autres y verront une certaine redondance.
Quoi qu’il en soit, le troisième chapitre de cette longue section introductive de l’ouvrage s’attarde pour sa part à décrire la physionomie du village d’Hochelaga, que visitera Jacques Cartier en coup de vent, le 3 octobre 1535. Lors des célébrations du 50e anniversaire de la Société Recherches amérindiennes au Québec, à l’automne 2021, le réalisateur et animateur culturel innu André Dudemaine soulignait à juste titre que, dans les déclarations de reconnaissance territoriale autochtone émises en sol montréalais, on oublie systématiquement de mentionner ces Iroquoiens du Saint-Laurent. Il déplorait par la même occasion le regrettable empressement de Cartier à trouver la route des Indes, négligeant ainsi la plus élémentaire des politesses qui aurait consisté à demander à ses hôtes comment ils se nomment. L’aurait-il fait, nous n’aurions pas eu à leur imposer plusieurs siècles plus tard cet ethnonyme assez bâtard d’« Iroquoiens du Saint-Laurent », (Laurentian Iroquois) créé par l’archéologue Bruce Trigger (voir Trigger 1966). Mais, aussi importante soit-elle, c’est là une toute autre question qui nous fait digresser.
Nous voilà donc, 150 pages plus tard, prêts à découvrir les résultats des trois investigations minutieuses et passionnantes menées par l’auteur, en commençant par « une enquête sur une disparition », celle de ces Iroquoiens du Saint-Laurent bien sûr, « l’une des plus grandes énigmes de l’archéologie amérindienne » (p. 151). Y sont détaillées les trois principales hypothèses traditionnellement invoquées pour expliquer cette disparition (qui, en réalité, consiste davantage en une dispersion vers des voisins accueillants, comme en convient l’auteur) : les conflits armés, les changements climatiques associés au petit âge glaciaire qui s’amorce vers l’an 1350 de notre ère, et les épidémies de maladies apportées par les Européens et contre lesquelles les Autochtones n’avaient aucune immunité naturelle. S’inspirant des travaux de l’historien Jon Parmenter, Viau apporte ici une réflexion intéressante permettant de mieux comprendre comment et pourquoi les populations autochtones voisines, iroquoiennes surtout, ont pu aussi aisément accueillir des contingents parfois imposants d’Iroquoiens du Saint-Laurent en leur sein. En effet, ces derniers n’arrivaient pas les mains vides, mais avec tout un bagage de connaissances géographiques, linguistiques et culturelles précieuses à propos des nations autochtones et européennes établies dans la vallée du Saint-Laurent et ses alentours, riches en ressources, au moment où le commerce avec les premiers Européens prenait forme. Il y aurait donc eu plus qu’une simple hospitalité convenue envers une nation voisine.
Se fiant aux écrits des jésuites Jean de Brébeuf et Jérôme Lalemant, et faisant contrepoids à la thèse récente voulant que les Hurons-Wendat auraient de tout temps occupé la vallée du Saint-Laurent, Viau suggère pour sa part que les Arendahronons et les Tahontaenrats, deux nations qui se joignirent plus tardivement à la confédération wendate, constitueraient en réalité des réfugiés de la Laurentie iroquoienne fuyant les attaques des Haudenosaunee. De la même manière, il explique que les ressemblances entre les poteries mohawks et iroquoiennes du Saint-Laurent ne signifient pas que les deux nations n’en formaient en réalité qu’une seule, mais plutôt que des échanges avaient lieu entre elles, plus simplement. Ces scénarios, à mon avis vraisemblables, viennent alimenter un débat de très grande importance, auquel je reviendrai.
Mais ni ces conflits armés, ni les aléas climatiques – ces derniers formant le coeur d’une « hypothèse hardie » faisant preuve de « déterminisme environnemental sans nuance » (p. 165) – ne suffisent à expliquer la dispersion des Iroquoiens du Saint-Laurent et leur intégration au sein des nations autochtones voisines, selon Viau. D’après lui, l’hypothèse à retenir serait plutôt celle du choc microbien causé par des « microbes inédits », une explication développée dans les deux chapitres suivants. Viau nous y explique, chiffres à l’appui, que les expéditions de Cartier et de Roberval comportaient « une ménagerie d’animaux domestiques inconnus au Canada (chapons, coqs et poules, pigeons, canards, boeufs, porcs, moutons, chèvres et chevaux) » (p. 178), sans parler des rats, des chats et des chiens (p. 179), et que ces animaux auraient constitué les vecteurs de transmissions de maladies contagieuses. Il serait toutefois étonnant que toutes ces espèces aient pu se trouver dans les navires de Cartier et de Roberval, certaines n’ayant été introduites que bien plus tard dans ces contrées nouvelles. De plus, Cartier et Roberval ne mentionnent explicitement dans leurs écrits que le boeuf, le porc, les chèvres et le cheval, et les deux premières espèces sont d’ailleurs les seules identifiées dans l’assemblage faunique du site archéologique Cartier-Roberval (Ostéothèque de Montréal 2009). Le reste du bestiaire énuméré par Viau est donc plus spéculatif. Il demeure que, selon lui, ces animaux domestiques auraient constitué le vivrier au sein duquel se seraient développés des virus inédits dans le Nouveau Monde – où ils auraient ainsi fait des ravages, peut-être de manière encore plus foudroyante qu’on ne le croyait jusqu’à maintenant, nous dit-il. Sans nier l’apport des épidémies pour expliquer la dispersion des Iroquoiens du Saint-Laurent, un événement historique très certainement multifactoriel, je dois dire que la démonstration de l’auteur n’est pas ici pleinement convaincante. Ainsi, alors que l’auteur nous a toujours habitués à des démonstrations et interprétations solidement appuyées par les sources, qu’elles soient historiques, archéologiques ou autres, ici les propositions sont plus spéculatives et moins bien soutenues. Par exemple lorsqu’il explique que « [m]ême si aucun document historique ne fait état d’une épidémie survenue dans la vallée du Saint-Laurent durant le premier hivernement de Cartier, en 1535-1536, l’absence de sources de première main autorise-t-elle pour autant à conclure sans autre forme de procès que ce phénomène ne s’est pas bel et bien produit ? » (p. 183)
Il y a au moins une autre raison de demeurer circonspect face à cette hypothèse – que cependant je ne peux, ni ne souhaite réfuter complètement. Si des épidémies dévastatrices ont réellement affecté les Iroquoiens laurentiens si dramatiquement, on peut alors se demander pourquoi les nations voisines n’ont pas été touchées, du moins pas autant. Sans répondre directement à cette objection, Viau semble laisser entendre que les populations algonquiennes, nomades et dispersées, n’avaient pas les densités démographiques nécessaires à la propagation des virus à grande échelle, contrairement aux Iroquoiens du Saint-Laurent habitant des villages sédentaires et populeux, où régnait une certaine promiscuité plus propice à l’éclosion des épidémies. Viau indique bien que des infections auraient pu « déborder au-delà » de la vallée laurentienne (p. 222) mais sans plus. Or, pourquoi les autres nations iroquoiennes voisines, tout aussi sédentaires et populeuses sinon plus encore, auraient-elles été épargnées ? Outre la proximité géographique, comme l’explique Viau lui-même, toutes ces nations étaient toujours, après tout, en contacts étroits, même en période d’hostilités. On doit certes être reconnaissants envers Viau d’avoir creusé cette question plus que beaucoup d’autres avant lui et de nous éveiller à la possibilité que les épidémies puissent avoir joué un rôle plus important qu’on ne le croit généralement pour expliquer la dispersion des Iroquoiens du Saint-Laurent à la fin du xvie siècle. Il demeure que la démonstration de Viau n’incite pas à croire qu’il s’agit du seul ni même du principal facteur en cause, tant les conflits armés entre les nations autochtones, en grande partie provoqués par la nouvelle présence européenne et leurs marchandises convoitées, semblent toujours avoir joué un rôle plus fondamental encore, à mon avis.
Rappelant par ailleurs que le franciscain André Thévet aurait eu en sa possession les archives inédites de Jacques Cartier pendant trente ans (1557-1587) avant de les vendre à l’historien Richard Hakluyt, Viau évoque l’étonnante possibilité que les pages manquantes de la troisième et dernière relation de Cartier aient pu en être retirées par Thévet avant la vente. Ce dernier, selon Viau, aurait ainsi voulu camoufler le récit des tensions entre Français et Autochtones dans la vallée laurentienne, témoignage d’un échec français qu’il valait mieux ne pas trop répandre outre-Manche. Cette éventualité invite à investiguer les archives de Thévet conservées à la Bibliothèque nationale de France et qui pourraient contenir de précieux documents inédits relatifs à cette rencontre entre deux mondes. Thévet aurait peut-être aussi eu en sa possession une carte dressée par Cartier et indiquant possiblement la localisation du village d’Hochelaga, dont il sera question plus loin. Mais ce qui importe ici davantage, c’est qu’une telle tension s’expliquerait, selon Viau, par les épidémies létales dont les Iroquoiens auraient évidemment tenu les Français responsables. Il fallait donc, d’après lui, que ces épidémies soient de très grande ampleur pour expliquer la dégradation des relations entre Français et Iroquoiens, au point de mener Cartier et Roberval à quitter le territoire et à abandonner le projet colonial.
La deuxième des trois grandes thèses que défend Viau dans son livre est nettement plus convaincante, et aussi passionnante qu’intrigante. Elle concerne les « Yroquet », ethnonyme aux étranges consonances iroquoiennes pour désigner une nation algonquine de la vallée de l’Outaouais. Les Hurons-Wendat les nommaient pour leur part Onontchataronons, qui signifierait « Habitants de la Montagne », en référence au mont Royal selon Viau. Ce dernier dissèque aussi trois mentions distinctes des jésuites Barthélemy Vimont et Jérôme Lalement, rappelant toutes trois que les ancêtres des Onontchataronons cultivaient autrefois les sols autour du mont Royal. La conclusion de Viau est claire et nette : les Onontchataronons formaient une société hybride ayant accueilli un fort contingent d’Iroquoiens du Saint-Laurent, après leur dispersion de la vallée laurentienne. Les Relations des Jésuites rapportent d’ailleurs que certains Kichesipirinis et Weskarinis auraient eux aussi jadis habité l’île de Montréal, et la présence d’artefacts aux styles typiques des Iroquoiens du Saint-Laurent dans la région appuient également cette hypothèse. Par conséquent, il devient manifeste que les Anishinaabeg (Algonquins) étaient en meilleure posture que toute autre nation autochtone pour revendiquer la région de Montréal comme territoire ancestral, selon Viau – une hypothèse qui ne manquera pas d’alimenter le débat récurrent, et combien sensible, à ce sujet. L’auteur a raison d’espérer que de futures recherches archéologiques en Outaouais permettront sans doute d’éclairer cette question, et une initiative en ce sens est d’ailleurs déjà en cours d’élaboration. Je ne suis pas aussi optimiste que lui, cependant, concernant les données génétiques tirées d’ossements humains provenant de sites archéologiques, car elles ne permettent que très rarement d’y reconnaître des identités ethniques ou culturelles précises, malheureusement.
Enfin, la troisième thèse au coeur de cet ouvrage stipule, sur la base de données géographiques, historiques, toponymiques et archéologiques, que le fameux village d’Hochelaga ne se situait ni au sud, ni au nord du mont Royal, comme le voudraient les deux hypothèses dominantes, mais à l’ouest ou, plus précisément, au sud-ouest, c’est-à-dire dans le secteur de Westmount et du chemin de la Côte-des-Neiges. Cette hypothèse peut sembler tout aussi plausible que les deux précédentes, mais en attendant que l’une ou l’autre soit confirmée, celle de Viau ne manquera pas raviver cet autre débat.
On peut bien sûr adhérer ou non aux thèses de Viau, ou encore y souscrire en partie, comme c’est mon cas. Mais à mon avis, nous devons lui être redevables de fournir de nouveaux éléments de réflexion sur des sujets hautement débattus et dont la présentation détaillée et raisonnée témoigne à nouveau de son érudition. De même, je ne peux que souscrire à la conclusion générale de l’ouvrage, qui se veut un plaidoyer pour la réconciliation par le biais de recherches qui devront être plus inclusives envers les populations autochtones et leurs savoirs, incluant la tradition orale, citant en cela le Projet Tiohtià:ke auquel il a contribué et qui devrait prochainement connaître une nouvelle phase en lien avec les prospectives proposées par l’auteur. C’est sans compter la plume élégante qui caractérise aussi les écrits de Roland Viau et que j’ai été heureux de retrouver ici.
En somme, la lecture de cet ouvrage est hautement recommandée à quiconque s’intéresse à l’histoire de la Laurentie iroquoienne. Il s’agira du dernier opus de Viau sur le sujet, selon une confidence récente de l’auteur, qui souhaite lui aussi poser désormais son regard sur l’univers algonquien. Roland Viau poursuivra donc une retraite active, et nous pouvons espérer de nouvelles contributions de sa part, fort heureusement.
Appendices
Références
- Ostéothèque de Montréal. 2009. Analyse zooarchéologique des restes osseux du site Fort Cartier-Roberval (CeEu-4), Cap-Rouge (Québec). Rapport inédit soumis à la Commission de la capitale nationale du Québec.
- Trigger, Bruce. 1966. « Who Were the “Laurentian Iroquois”? ». Canadian Review of Sociology 3(4) : 201-213.
- Viau, Roland. 1997. Enfants du néant et mangeurs d’âme : Guerre, culture et société en Iroquoisie ancienne. Montréal : Boréal.
- Viau, Roland. 2000. Femmes de personne : sexes, genres et pouvoirs en Iroquoisie ancienne. Montréal : Boréal.
- Viau, Roland. 2005. Amerindia : essais d’ethnohistoire autochtone. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.