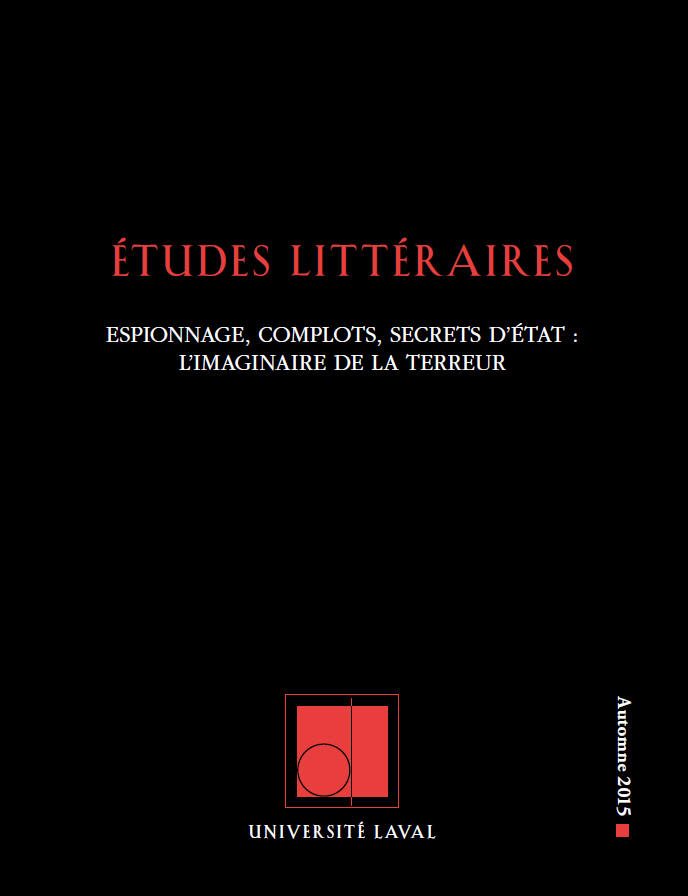En une manière de post-scriptum à mon Camarade Mallarmé et en guise de réponse au commentaire de Giulia Agostini, je voudrais convoquer deux scènes, l’une et l’autre absentes de mon essai, qui présentent chacune une activation du texte mallarméen. On considérera ces scènes non comme des allégories d’une quelconque vérité de l’oeuvre de Mallarmé, mais comme des exemples de la plasticité des textes littéraires, qui peuvent se prêter à différents usages dans les domaines éthiques et politiques, revêtir des significations variées, parfois contradictoires, et s’intégrer à toute une gamme de situations existentielles, comme l’ont suggéré les travaux de Pierre Bayard, Yves Citton ou Marielle Macé. L’évocation du destin de Mallarmé dans l’oeuvre de Michel Leiris me sera donc le prétexte à rappeler ce que j’entends par « politique de la lecture » et à en préciser l’ancrage dans la longue durée de l’histoire littéraire. La première scène sur laquelle je m’arrêterai provient de Frêle bruit, quatrième et dernier volume de La Règle du jeu, qui paraît en 1976. Dans l’un de ses fragments, Leiris confie sa tentation, aussitôt réprimée et abandonnée, de composer une oeuvre poétique (des « Vers dorés », ironise-t-il) avec « un certain nombre de phrases que les étudiants rebelles de 1968 écrivirent sur les murs de la Sorbonne ou dans les autres locaux qu’ils occupaient, et jusque dans les rues, sur les murailles propices ». On sait que Leiris, happé par le souffle contestataire de mai, avait pris part à la fondation du Comité d’action étudiants-écrivains, à l’assaut contre l’hôtel de Massa avec l’Union des écrivains, à l’occupation de l’appartement du ministre de l’Intérieur au Musée de l’homme, en plus de prêter assistance aux émeutiers pendant la deuxième nuit des barricades. Dans Frêle bruit, c’est surtout l’extraordinaire inventivité poétique des étudiants qui retient son attention. Quelques-unes des « fusées » glanées au fil des « événements » sont reproduites et commentées, certaines devenues célèbres (« Soyez réalistes demandez l’impossible »), d’autres demeurées obscures (« Plus jamais Claudel »), d’autres encore condensant une leçon morale à la manière d’une maxime (« Intellectuels apprenez à ne plus l’être »). En conclusion de ce florilège d’inscriptions sauvages et de slogans politiques surgissent deux formules de Mallarmé, que Leiris imagine scandées par une foule insurgée dans les rues dépavées du Quartier latin. À l’évidence, Leiris ne cherche pas à identifier l’intention de Mallarmé derrière ses formules les plus mémorables, ni à en analyser les caractéristiques formelles, comme le ferait un philologue ou un exégète. Ce n’est pas Mallarmé sous la Troisième République qui l’intéresse, ni le poète qui avance une « explication orphique de la Terre », mais bien Mallarmé sous la Cinquième République, quand le régime gaulliste paraît vaciller. Même si le « coup de dés » appelle une lecture « à voix haute » à la manière d’une « partition », Leiris n’interprète pas l’oeuvre de Mallarmé à proprement parler ; il en active certaines formules en leur attribuant une signification politique. Le geste herméneutique de Leiris suppose une double opération, qui peut résumer ce que j’appelle une politique de la lecture. D’une part, la convocation des textes de Mallarmé, même réduits à quelques slogans, provoque une littérarisation de la vie politique, laquelle se trouve ainsi interrogée à partir de schèmes de perception et d’interprétation issus de la littérature, créant par là un effet de défamiliarisation. D’autre part, le détournement des textes de Mallarmé, arrachés à leur temps et transposés dans une autre époque, engendre une politisation de la littérature, qui se trouve mise au service d’une lecture du présent et d’une reformulation de ses enjeux …
Appendices
Références
- Bayard, Pierre, Enquête sur Hamlet. Le dialogue de sourds, Paris, Éditions de Minuit (Double), 2014 [2002].
- Chartier, Roger, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Éditions du Seuil (Points), 2000 [1990].
- Citton, Yves, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi des études littéraires ?, Paris, Éditions Amsterdam, 2007.
- Guyotat, Pierre, Coma, Paris, Mercure de France (Traits et portraits), 2006.
- Hamel, Jean-François, Camarade Mallarmé. Une politique de la lecture, Paris, Éditions de Minuit (Paradoxe), 2014.
- Hamel, Jean-François, « Émanciper la lecture. Formes de vie et gestes critiques d’après Marielle Macé et Yves Citton », Tangence, no 107 (2015), p. 89-107.
- Leiris, Michel, La Règle du jeu, édition sous la direction de Denis Hollier, Paris, Gallimard (Pléiade), 2003.
- Macé, Marielle, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard (NRF essais), 2011.
- Ponge, Francis, « Le dispositif Maldoror-Poésies », Oeuvres complètes I, édition sous la direction de Bernard Beugnot, Paris, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1999, p. 633-635.
- Roger, Thierry, « Camarade Mallarmé : mallarmisme, anachronisme, présentisme » [en ligne], Acta fabula, vol. 15, n° 6 (2014) [http://www.fabula.org/acta/document8799.php].
- Schaeffer, Jean-Marie, « La religion de l’art : un paradigme philosophique de la modernité », Revue germanique internationale, no 2 (1994), p. 195-207.
- Schaeffer, Jean-Marie, L’Art de l’âge moderne. L’esthétique et la philosophie de l’art du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Gallimard (NRF essais), 1992.