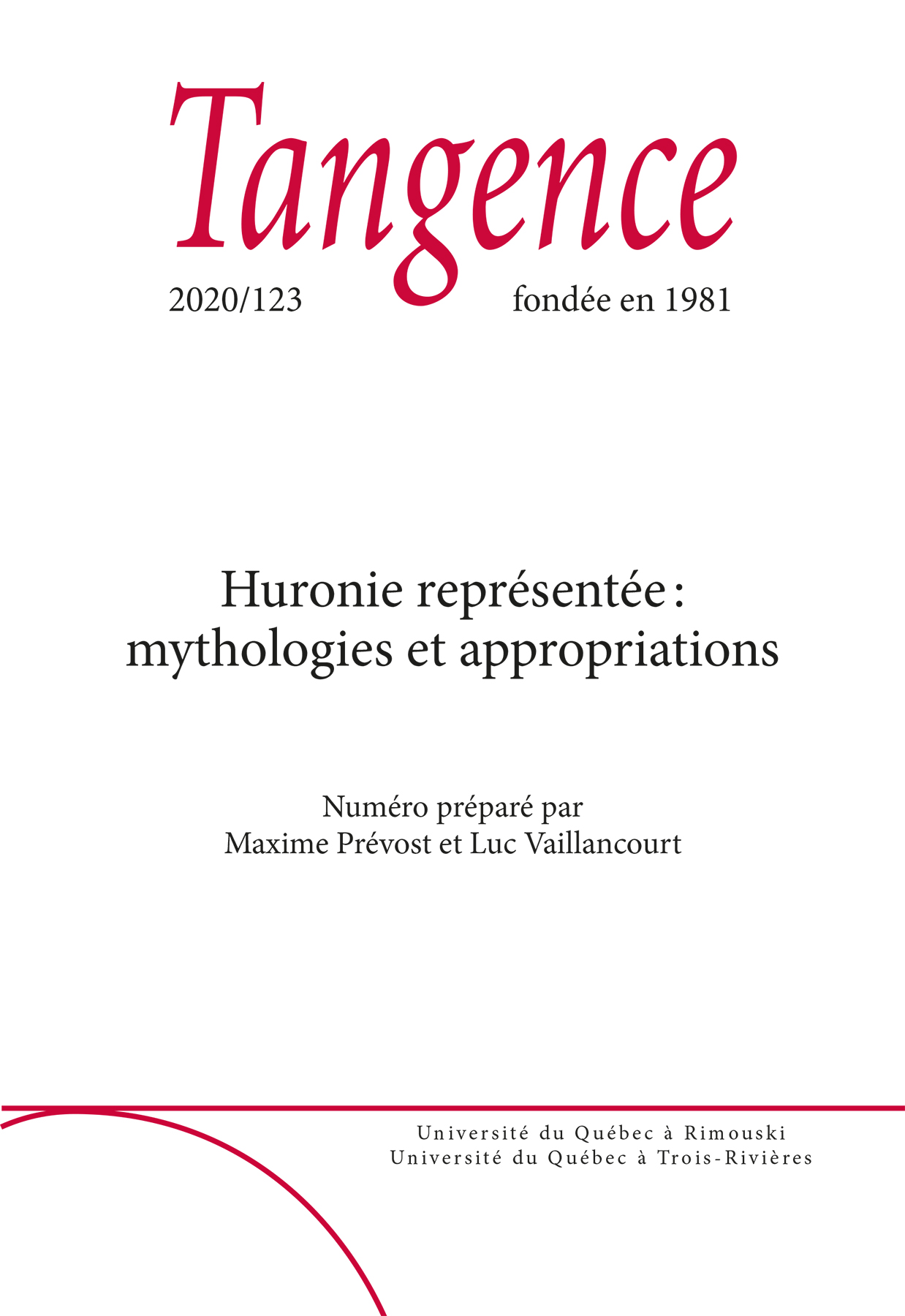Résumés
Résumé
Afin d’étudier les représentations françaises de la Huronie et des Hurons dans les textes anciens, je souligne d’abord l’envers de la construction discursive jésuite, grâce à l’analyse de « la vision de l’intérieur » offerte par l’abondante correspondance de Marie de l’Incarnation, la fondatrice des Ursulines de Québec. Puis, afin d’éviter les pièges de l’hétérohistoire, je change de perspective et, en confrontant la parole d’en bas à celle d’en haut, je tente de reconsidérer les lieux communs du complexe discursif et imaginaire qui perpétuent les divisions.
Abstract
To study French representations of Huronia and the Hurons in the old texts, I begin by emphasizing the reverse of Jesuit discursive construction via an analysis of “la vision de l’intérieur” (religious vision) that one finds in the prolific correspondence of Marie de l’Incarnation, founder of the Ursulines of Quebec. Next, to avoid the pitfalls of heterohistory, I change perspective by comparing the writings from above with those from below in an attempt to reconsider the commonplaces of the discursive and imaginary complex that perpetuate the divisions.
Corps de l’article
Invitée à étudier les représentations françaises de la Huronie et des Hurons, j’ai d’abord voulu suivre mes propres brisées, en revisitant un article, paru il y a longtemps, qui soulignait l’envers de la construction discursive jésuite du Sauvage, grâce à l’analyse de « la vision de l’intérieur » offerte par la fondatrice des Ursulines de Québec dans son abondante correspondance[1]. Mais, devant les pièges de l’hétérohistoire, j’ai changé de perspective. C’est pourquoi dans le présent texte, je rappelle d’abord la lucidité de Marie de l’Incarnation face à l’altérité autochtone ; puis, en confrontant la parole d’en bas à celle d’en haut, j’invite à reconsidérer les lieux communs du complexe discursif et imaginaire qui perpétuent les divisions entre eux et nous, barbarie et civilisation, infériorité infantile et supériorité adulte, jusque dans l’historiographie.
Lucidité de Marie de l’Incarnation devant l’altérité autochtone
Témoin essentielle de la rencontre franco-autochtone, Marie Guyart de l’Incarnation est sans doute la plus lucide des missionnaires face à l’altérité autochtone[2]. De fait, les observations qu’elle fait sur la mission et les missionnés, dans son abondante correspondance, restituent la « vision de l’intérieur » chère à Lucien Febvre[3]. Comme elle n’écrit pas pour être publiée, elle échappe à la censure parisienne qui élague des Relations des Jésuites toute référence jansénisante à la nature mauvaise de l’être humain. Ce qui fait qu’on peut observer une évolution discursive inversée chez les Jésuites et chez Marie de l’Incarnation : alors que les discours des Relations évoluent du « Sauvage sans foi sans loi sans roi » au « Noble Sauvage », celui de Marie de l’Incarnation, au contraire, va de l’enthousiasme au désenchantement[4]. Ainsi, au début de sa mission, ses propos frisent l’exaltation — avec, entre autres, la conversion exemplaire de la Wendat Oionhaton (Thérèse) en 1641 — et, quelque trente ans plus tard, l’Ursuline avoue qu’elle ne peut retenir les jeunes Autochtones qui, telles des « écurieux », grimpent la « palissade,… haute comme une muraille et vont courir dans les bois[5] ».
Une telle évolution discursive inversée s’explique par le fait que ce que raconte Marie de l’Incarnation, dans ses lettres, se fonde non seulement sur ses remarques et constatations personnelles, mais aussi sur les conversations avec les missionnaires et sur la lecture non censurée des Relations, dont elle recopiait souvent de longs passages au bénéfice de ses correspondants. Ce faisant, l’ursuline lève le voile sur le pessimisme qui les gagne, elle et les autres missionnaires, devant les résistances à leur fol effort d’intégrer à la société euro-chrétienne « l’infinité de peuples » qu’ils rencontrent en Amérique.
Ses constats sont lucides. Devant l’irréductible altérité autochtone, elle souligne que s’il est tout à fait possible de convertir les Autochtones, il est, en revanche, impossible d’en faire des Français : comme elle l’écrit à son fils en 1668 à propos de ses élèves amérindiennes, « [j]e n’attens pas cela d’elles, car elles sont Sauvages, et cela suffit pour ne le pas espérer ». Elle explique, comme elle le fait toujours avec un étonnant discernement et beaucoup de finesse : « La vie sauvage leur est si charmante à cause de sa liberté, que c’est un miracle de les pouvoir captiver aux façons d’agir des François qu’ils estiment indignes d’eux […] Jugez de là, s’il est aisé de les changer après des habitudes qu’ils contractent dès l’enfance, et qui leur sont comme naturelles[6]. » Elle considère délétère la fréquentation des Français — surtout avec l’arrivée, en 1669, de beaucoup de « canaille de l’un et l’autre sexe qui cause beaucoup de scandale » en s’ensauvageant et en faisant le trafic de l’alcool pour s’enrichir dans la traite des fourrures aux dépens des Autochtones[7]. Devant les méfaits de la « civilisation », elle souligne combien le mauvais exemple des Français mène à leur perte les Autochtones qui, sous sa plume, paraissent infantilisés et victimisés. En particulier la nation algonquine, qui, comble du comble pour une missionnaire, « se perdoit autrefois sans la Foi, [et] si Dieu n’y met la main, se va perdre dans la Foi[8] ».
On peut s’interroger sur la part qu’auront ces remarques amères dans la critique ultérieure de la « civilisation », dans le complexe discursif et imaginaire en cours de pétrification, depuis François-Xavier de Charlevoix qui cite abondamment ses lettres, et qui lui-même inspirera fortement les philosophes[9]. Mais toutes ces interrogations n’alimentent-elles pas une fois de plus l’hétérohistoire[10] ? Alors, changeons de perspective. Regardons vers le bas et revisitons les lieux communs d’hier et d’aujourd’hui qui continuent de diviser entre eux et nous, entre barbarie et civilisation entre infériorité infantile et supériorité adulte.
Revisiter les lieux communs en s’intéressant à la « parole d’en bas »
Nous connaissons tous la recette du festin qu’offrent les Ursulines aux membres des Premières Nations afin de préparer le terrain de l’enseignement religieux et de la conversion. En 1640, Marie de l’Incarnation la décrit : « Pour en traiter splendidement soixante ou quatre-vingt on n’y employe qu’environ un boisseau de pruneaux noirs, quatre pains de six livres pièce, quatre mesures de farine de pois ou de bled d’Inde, une douzaine de chandelles de suif fondues, deux ou trois livres de gros lard, afin que tout soit bien gras, car c’est ce qu’ils aiment[11] ». On a ri, depuis, de cette description peu ragoûtante aux palais « civilisés » contemporains. Mais c’est toujours en coupant la suite de la phrase et en se méprenant sur le ton employé par l’ursuline, qui utilise cette recette pour faire aux riches une très sérieuse leçon à la fois morale et socio-économique afin de les inciter à contribuer à sa mission :
[I]l me semble, dis-je, que l’on doit déplorer les grandes superfluitez du monde, puisque si peu de chose est capable de contenter et de ravir d’aise ces pauvres gens, parmi lesquels néanmoins il y a des Capitaines qui à leur égard passent pour des Princes et pour des personnes de qualité. Et cependant ce festin que je viens de décrire et qui leur sert tout ensemble de boire et de manger, est un de leurs plus magnifiques repas[12].
De fait, l’ursuline ne se moque pas du tout de cet appétit autochtone pour le gras, puisqu’il est partagé par la majorité de ses contemporains européens[13] ! Elle prend d’ailleurs une concession de pêche à l’anguille pour s’assurer de nourrir son couvent avec ce poisson bien gras dont « l’odeur infectoit tout » mais dont la pêche par les « Hurons de Québec » causait toujours « une joie universelle à tout le païs[14] ». Cet exemple montre comment les citations prises et reprises à l’emporte-pièce contribuent à créer et perpétuer des jugements de valeur — comme ici, celui du goût exotique des Autochtones pour le gras.
Ce qui nous mène à reconsidérer notre approche du passé. Par un étrange paradoxe, nous le savons, c’est parce que les missionnaires se sont approprié·e·s les cultures autochtones en apprenant leurs langues et en s’adaptant à leurs divers modes de vie, dans le but spécifique de les convertir, les changer, « renverser leur pays[15] », c’est parce que ces Français se sont « ensauvagés » qu’il nous reste échos, traces et voix des nations autochtones d’autrefois. Tout le travail des historiens, ethno-historiens, anthropologues et littéraires a été et demeure de démêler le vrai du faux dans les écrits coloniaux, en lisant entre les lignes sans toujours se rendre compte que se produit parfois une connivence cognitive entre les auteur·e·s d’hier et d’aujourd’hui : ainsi, sur cette base, où l’écrit règne en maître, se forme une république intemporelle, élitiste, car issue du même cursus occidental moderne et nourrie des mêmes privilèges matériels et civilisationnels. Ce qui fait que ces lettrés et « civilisés », par-delà les siècles, en arrivent à partager les mêmes exotismes, les mêmes amalgames imaginaires. De la sorte, les chercheur·e·s continuent d’être guidé·e·s anachroniquement par les mêmes trivialités, lieux communs qui perpétuent des mythologies devenues si familières qu’on n’y prend plus garde.
Pour extraire de cette gangue interprétative pérenne à la fois les sujets représentés et ceux qui les représentent, je propose de croiser les écrits coloniaux avec d’autres sources, les verbatim des procès impliquant Français et Autochtones aux xviie et xviiie siècles[16]. Il y a une valeur heuristique à comparer la parole d’en bas à celle d’en haut. Car ce que disent les justiciables, ces gens d’en bas, tant français qu’autochtones, s’oppose aux représentations des Autochtones (et de celles des relations franco-autochtones) conçues et véhiculées par les écrits d’hier et d’aujourd’hui. En effet, l’écho de leurs voix résonne au coeur des verbatim des interrogatoires, contre-interrogatoires, témoignages, dépositions et recollections qui émaillent les procès civils et criminels[17]. Au fil des verbatim, nous entendons les voix des êtres, analphabètes qui n’ont laissé d’autres traces de leur existence que ces paroles transcrites à la hâte par un greffier. Grâce à ces documents inestimables, nous les écoutons défendre leurs droits, se justifier, tenter d’éviter les sentences ou chercher à alléger leurs peines. Ce faisant, les effets de vérité qu’ils pensent donner à leurs arguments pointent vers la banalité des attitudes et des représentations communément admises et partagées, mais qui contrastent parfois violemment avec celles exprimées dans les écrits missionnaires, la littérature de voyage et la correspondance officielle.
Points aveugles de la recherche, tant littéraire qu’historique, ces microsites de connivence cognitive partagée passent souvent inaperçus, car ils appartiennent à la banalité, à ce qui alors va de soi pour les peuples d’autrefois[18]. On ne les trouve pas dans l’intimité des unions franco-autochtones, bénies ou non par l’Église, ou dans les emprunts français aux cultures autochtones, déjà amplement repérés et commentés par les auteurs coloniaux et par l’historiographie[19] ; on les découvre plutôt dans le partage de structures similaires du quotidien, telles que les révèle, enfouie dans les archives judiciaires, la parole des gens d’en bas[20].
Les paroles et actions des gens d’en bas
Ainsi des mots barbare ou barbarie qui émaillent les discours des élites religieuses et civiles pour faire mesurer l’écart de civilisation entre la grossièreté et l’ignorance autochtones opposées à la politesse et à la science françaises. Or jamais, dans les verbatim des procès, les justiciables et gens d’en bas ne prononcent ces mots de « barbares » ou « barbarie » : ni pour qualifier la différence civilisationnelle franco-autochtone ni même pour évoquer la violence autochtone[21]. Dans les verbatim, le terme Sauvage est toujours employé sur le même plan neutre et globalisant que le terme François, précisant avec constance de quelle nation sont les Autochtones concernés. On trouvera ainsi Sauvage de la Nation du Loup ou Sauvage de la Nation hiroquoise — des désignations précises qui reflètent un savoir essentiel aux Français pour leur survie et pour la bonne entente avec toutes les différentes nations autochtones qu’ils fréquentent. De fait, dans les archives judiciaires, les gens d’en bas en ont plutôt contre les écarts de tous et toutes à l’égard de la norme et du bon vivre ensemble, ne faisant pour ainsi dire jamais explicitement de distinction culturelle entre Français et Premières Nations.
C’est particulièrement vrai des Français et des Autochtones qui, obstinément, continuent le trafic de l’alcool. Ni la peur de l’enfer, agitée comme un épouvantail, ni la répression judiciaire (quelque 34 lois prohibant la traite d’alcool seront promulguées entre 1663 et 1760) n’empêchent les colons de continuer à en proposer aux Autochtones, ni ces derniers de vouloir s’en procurer[22]. L’appât du gain chez les Français et l’intempérance des Autochtones sont-ils vraiment les seuls motifs de ces comportements jugés « irresponsables » par les élites civiles et religieuses, désespérées d’enrayer ce persistant problème ? Ne pouvons-nous pas interroger différemment cette remarquable pérennité comportementale ? Pourquoi ne voir, en effet, que des revendeurs sans coeur dans les cabaretiers, cabaretières et autres trafiquants ? Pourquoi ne voir, dans les Autochtones, que des naïfs débauchés qui persistent à se laisser berner ?
Quand on quitte les écrits d’en haut pour entendre les voix d’en bas, c’est-à-dire quand on analyse en série les dépositions des procès pour trafic d’alcool, on se rend compte qu’il existe une confiance réelle et pérenne entre Français et Autochtones, gens d’en bas, une confiance basée sur une fréquentation coutumière, de facto. Détruisons en passant le mythe de la disparition des Premières Nations de la vallée laurentienne en rappelant que, pendant tout le Régime français, les Français sont littéralement noyés dans une mer d’Autochtones[23]. Ce sont les Autochtones qui dictent les termes de cette proximité qu’ils mènent à leur gré, en imposant aux Français d’apprendre leurs langues et codes de conduite. À Montréal, ils sont visibles en tout temps, en toute heure, dans et hors de la ville qu’ils ont l’habitude de fréquenter. Ils y vivent, y travaillent, troquant leurs biens ou payant en espèce sonnante et trébuchante pour de la nourriture et des boissons, passant de maison en maison ou demandant d’y passer la nuit — c’est-à-dire, comme ils disent, de « s’y retirer[24] ».
De fait, dans les procès, les Français interrogés montrent qu’ils connaissent très bien leurs vis-à-vis autochtones : ils leur parlent dans leur langue, les appellent par leur nom autochtone et surnom francophone, nomment les membres de leur famille, reconnaissent les signes distinctifs de leurs nations[25]. Les colons recourent aux Autochtones pour se soigner, s’occuper de leurs enfants, les emploient à différents travaux[26]. Souvent ils les hébergent et leur servent à manger ce qu’ils aiment[27]. Pensons à ces cabaretières qui, sans façon, leur cuisent du chien — et leur offrent à boire comme elles le feraient avec leurs clients français, sans hésiter à trinquer avec eux — et pas nécessairement, comme on le leur a beaucoup reproché, pour profiter de leur ébriété pour les dépouiller de leurs biens[28]. Pourquoi en serait-il autrement, puisqu’ils composent la plus forte clientèle des cabarets, après celle des soldats[29] ?
Ces Français ne se perçoivent aucunement comme les irresponsables dépeints par les autorités civiles et religieuses. Dans leur traitement indifférencié de leurs clients français et autochtones, ils savent bien que les excès et violences commis sous l’influence de l’alcool ne sont pas le seul fait des Autochtones. Les travaux d’André Lachance sur la Nouvelle-France et de Robert Muchembled sur la France de l’époque ont suffisamment brossé le tableau de cette violence habituelle parmi les hommes comme les femmes euro-descendant·e·s, pour qu’on comprenne mieux comment une cabaretière comme Marie Anne Vandezegue puisse répondre, quand elle est interrogée en 1689 sur la surconsommation d’alcool de ses clients autochtones, « quelle ne prend point garde a des choses dont elle na que faire[30] ! » Une telle indifférence apparente aux excès autochtones illustre bien là l’état d’acceptation de la violence, qu’elle soit d’origine autochtone ou française, par la majeure partie de la population d’en bas. Chose certaine, nul n’agit inconsidérément. La violence qui se déchaîne, quand l’ivresse devient incontrôlable, fait certes peur mais elle est connue, elle fait partie de l’ordre pérenne des choses contre lequel on ne peut rien.
Glissement cognitif
C’est l’évidence, hier comme de nos jours : ce n’est pas le propre des seuls Autochtones d’user de psychotropes jusqu’à perdre le contrôle ! C’est bien ce que confirment les arrêts et ordonnances du Régime français concernant l’abus des boissons enivrantes. En effet, tous visent, de façon aussi réitérée que vaine, autant les Français que les Autochtones. Un exemple entre tous témoigne de l’exaspération des autorités, ici en la personne de l’intendant La Barre qui, en 1694, déclare être « obligé depuis deux ans de rendre diverses ordonnances pour tâcher de réprimer l’excès dans lequel les Français et les Sauvages des environs de Montréal et de ladite ville, par les boissons immodérées qu’ils y ont fait en sorte qu’il paraissait que cette ville fut plutôt un enfer qu’un lieu policé et sous obéissance[31] ». Aux xviie et xviiie siècles, la chasse à l’ivrognerie des Français ne s’est jamais arrêtée : les archives judiciaires regorgent de crimes mis sur le compte de l’ivresse. Pensant atténuer leurs peines, certains accusés français et euro-descendants mettent en effet leurs délits sur le compte de l’alcool, que ce soient les violences verbales ou physiques, les rixes, les vols, les duels, voire les meurtres. Les voies de fait représentent 43,82 % des plaintes connues et constituent le principal et le plus récurrent délit de violence contre la personne ; le cabaret est le lieu privilégié de ce crime banal, voire banalisé — l’ivresse et le jeu constituant les principaux motifs de dispute[32].
De fait, quand on compare les cas rapportés selon les ethnies, les excès dus à l’ivrognerie sont bien plus nombreux (et de loin) chez les Français que chez les Autochtones[33] ! Voilà qui rééquilibre quelque peu le sombre tableau de l’ivrognerie et son cortège de désordres, un fléau que, très tôt, les autorités religieuses et civiles ne cessent de dénoncer tant en France qu’en Nouvelle-France[34]. Par quel glissement cognitif, en est-on arrivé à stigmatiser les seuls Autochtones ? En effet, à la suite des élites coloniales, l’historiographie a repris le topos en le concentrant sur les seuls Autochtones — depuis la remarque de Marie Guyart en 1644 qu’« il ne leur en faut qu’une fois pour les rendre comme fols et furieux[35] », jusqu’aux mots fameux du sulpicien François Vachon de Belmont : « [L]’ivresse des Sauvages était de différente espèce de celle des Européens[36] ». Depuis lors, l’accoutumance autochtone et la violence qui l’accompagne ont été examinées et expliquées de façon essentialiste par la biologie et la neurochimie, la spiritualité (quête de vision et résistance aux missions), la sociologie, la politique, voire l’intempérance propre à la nature des Autochtones[37]. Une telle mythologie oublie la confiance réciproque franco-autochtone pérenne que l’on découvre par exemple, en 1731, dans la déposition de Pierre Liégeois qui voulait donner effet de vérité à sa dénonciation de Marguerite Lemoine, dite Jolicoeur, accusée de trafic d’alcool. Le témoin révèle une intimité partagée, puissamment évocatrice, quand il répond à la question du procureur :
[A] quoy s’occupoit lad jolicoeur et ce quelle dit. A dit quelle estoit proche du feu en conversation avec la sauvagesse dont il nous a parlé ci-dessus, Et que ce jourdhuy lorsqu’ils ont esté constitués prisonniers, Elle donnoit à téter a son enfant. Et quil y avoit deux sauvages dans lad maison assis sur un lit[38].
Nulle défiance chez Marguerite Lemoine qui, allaitant son bébé, converse paisiblement au coin du feu avec son amie autochtone, tandis que deux Sauvages vont et viennent librement dans sa petite maison.
Entre normalité familière et anormalité exotique
Ainsi, l’exercice consistant à comparer les verbatim des procès aux textes coloniaux permet-il de confronter la parole d’en bas à celle d’en haut, et de découvrir des microsites d’intimité franco-autochtone qui, existant dans le quotidien des peuples d’autrefois, fabriquent, au jour le jour, une confiance et une compréhension mutuelles[39]. Certes, ces microsites se trouvent en des lieux inattendus et parfois très dérangeants pour l’historiographie des représentations des Autochtones, car ce que disent les justiciables, ces gens d’en bas, tant français qu’autochtones, s’oppose aux représentations stéréotypées, imaginées et véhiculées par les auteurs, ces gens d’en haut. De fait, leurs paroles évoquent ce qui est, pour eux, de l’ordre de la normalité familière, alors qu’elles paraissent relever de l’anormalité exotique pour les gens d’en haut, en particulier en ce qui concerne les tempéraments violents, intempérants et incontrôlés. Ainsi, le spectre de l’hétérohistoire continue-t-il de hanter le complexe discursif et imaginaire. Voire, on peut dire avec Browen McShea, que de telles représentations, opposant la pauvreté et l’incivilité du peuple franco-autochtone à la richesse et la civilité des élites françaises, transforment ce qui est commun, subi et connu par le plus grand nombre en quelque chose d’étrange, voire d’exotique aux yeux des auteurs coloniaux ; à l’inverse, ces représentations ont tendance à travestir ce que ne partage pas le plus grand nombre, mais qui appartient aux élites urbaines, en traits caractéristiques de la culture nationale française[40]…
Parties annexes
Note biographique
Professeure titulaire à l’Université de Montréal, Dominique Deslandres enseigne l’histoire comparée européenne et américaine moderne au département d’histoire. En plus d’une centaine d’articles et chapitres, elle a publié Croire et faire croire. Les missions françaises au xviie siècle (Fayard, 2003), qui a reçu de nombreux prix ; elle a également dirigé un bestseller avec J. A. Dickinson et O. Hubert, Les Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de discrétion 1657-2007 (Fides, 2007) ; et dirigé, avec R. Brodeur et T. Nadeau-Lacour, Lecture inédite de la modernité aux origines de la Nouvelle-France (Presses de l’Université Laval, 2010). Son article sur l’expansion de la souveraineté française au xviie siècle s’est mérité le prix d’excellence de l’Institut d’histoire de l’Amérique française (2013). En 2017, elle a été élue membre de la Société des Dix.
Notes
-
[1]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, éd. Dom Guy-Marie Oury, Solesmes, Abbaye Saint-Pierre, 1971.
-
[2]
Marie de l’Incarnation et ses consoeurs ursulines et hospitalières sont célébrées par le clergé de leur époque comme de la nôtre comme les premières missionnaires françaises outre-mer. Voir Dominique Deslandres, Croire et faire croire. La mission française au xviie siècle [1600-1650], Paris, Fayard, 2003, p. 356-389.
-
[3]
Lucien Febvre, Au coeur religieux du xvie siècle, Paris, EHESS, 1968, p. 445.
-
[4]
Voir Dominique Deslandres, « Le jésuite, l’intoléré et le sauvage : la fabrication par omission d’un mythe », dans Chantal Grell et Christian Michel (dir.), Primitivisme et mythes des origines dans la France des Lumières, 1680-1720, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 1989, p. 87-99.
-
[5]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 801 (1668) ; voir aussi p. 144 (1641), 151 et 165-169 (1642), 201 (1643), 259 (1645), 281 (1646), 501 (1653).
-
[6]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 828 (1668).
-
[7]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 863 (1669).
-
[8]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 872-873 et p. 941 (1671).
-
[9]
François-Xavier de Charlevoix, Histoire et description générale de la Nouvelle France, Paris, Rolin Fils, 1744, t. i, p. 363-372 et 597-600.
-
[10]
Voir Georges E. Sioui, Pour une autohistoire amérindienne. Essai sur les fondements d’une morale sociale, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1989, p. 6 et 51.
-
[11]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 113 (1640).
-
[12]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 113 (1640).
-
[13]
Voir Pierre Goubert, La vie quotidienne des paysans français au xviie siècle, Paris Hachette, 1991 et Benoît Garnot, La culture matérielle en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, Paris, Ophrys, coll. « Synthèse et Histoire », 1995, p. 13-14.
-
[14]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 113 (1640), 461 (1652), 564 (1655), 614 (1659) et 683-684 (1662). Le droit de pêche, qui leur est accordé le 26 octobre 1651 par M. de Lauson, va depuis le Cap Diamant jusqu’à Sillery (Archives des Ursulines, [VMUQ original 3/1.1.1.1.3 SA-04-06-01-03] et Archives de l’Archevêché de Québec, Église du Canada, vol. il, p. 236). Le droit avait été accordé moyennant une redevance annuelle d’une barrique d’anguilles fraîches et de cinq-cents anguilles à donner à la paroisse de Québec ; la pêche à l’anguille se faisait surtout en septembre et en octobre. Voir J.-Ed. Roy, « Notice sur l’anguille », Bulletin des Recherches Historiques, vol. xxxvi, 1930, p. 699-704 et 722-728.
-
[15]
Voir Denis Delâge, Le pays renversé. Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est, 1600-1664, Montréal, Boréal Express, 1985, p. 223.
-
[16]
Contenus dans les archives judiciaires de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ci-après BAnQ.
-
[17]
Chacun et chacune doit plaider sa cause car, par ordre du roi, il n’y a pas d’avocat en Nouvelle-France. Voir Marcel Trudel, La Nouvelle-France par les textes. Les cadres de vie, Montréal, Hurtubise, 2004, p. 141-142.
-
[18]
Microsites au sens où l’entend Ann L. Stoler, « Tense and Tender Ties : The Politics of Comparison in North American History and (Post) Colonial Studies », The Journal of American History, vol. 88, no 3, 2001, p. 831.
-
[19]
Voir Louise Côté, Louis Tardivel et Denis Vaugeois, L’Indien généreux. Ce que le monde doit aux Amériques, Montréal, Boréal, 1992 ; Denys Delâge, « L’influence des Amérindiens sur les Canadiens et les Français au temps de la Nouvelle-France », Lekton, vol. 2, no 2, 1992, p. 103-191 ; Réal Ouellet, Alain Beaulieu et Mylène Tremblay, « Identité québécoise, permanence et évolution », dans Laurier Turgeon, Jocelyn Letourneau et Kadiyatoulah Fall (dir.), Les espaces de l’identité, Québec, Presses de l’Université Laval, 1997, p. 63 ; Christophe Horguelin, « Le xviiie siècle des Canadiens : discours public et identité », dans Philippe Joutard et Thomas Wien (dir.), Mémoires de Nouvelle-France. De France en Nouvelle-France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 209-219 ; Louise Dechêne, Le peuple, l’État et la guerre au Canada sous le Régime français, Montréal, Boréal, 2008, p. 61-92.
-
[20]
Voir Roland Viau, « Populations autochtones et colonisation européenne, des origines à 1796 », dans Danny Fougères (dir.), Histoire de Montréal et de sa région, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Les régions du Québec », 2012, t. i, p. 203 ; Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve-xviiie siècles, t. i, Les structures du quotidien, Paris, Armand Colin, 1979, p. 81-290 ; Daniel Roche, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation, 17e -19e siècles, Paris, Fayard, 1997, p. 100 ; Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au xviie siècle, Paris/Montréal, Plon, 1974, p. 322 et « La croissance de Montréal au xviiie siècle », Revue d’histoire de l’Amérique française, 1973, vol. 27, no 2, p. 169 ; Saliha Belmessous, « Être Français en Nouvelle-France : identité française et identité coloniale aux 17e et 18e siècles », French Historical Studies, 2004, vol. 27, no 3, p. 518-519.
-
[21]
« BARBARIE », dans Antoine Furetière, Dictionnaire universel, La Haye et Rotterdam, Leers, 1690. « Barbarie, (Géog.) grande contrée d’Afrique », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson et coll., 1752, t. ii, p. 69 b. Dans les archives judiciaires, le seul exemple émane du Conseil souverain, donc de l’élite (BAnQ, TP1, S28, P530, Arrêt portant dispense d’âge de delle Marie Moyen, 1667).
-
[22]
Ni les excommunications de François de Laval ni même le tremblement de terre de 1663, présenté comme la punition divine du commerce des boissons, ne détournent les colons de servir à boire aux Autochtones. Voir Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 681 (1662) et p. 686-699 (1663) et Catherine Ferland, Bacchus en Canada. Boissons, buveurs et ivresses en Nouvelle-France, Québec, Septentrion, 2010, p. 311.
-
[23]
Voir Denys Delâge et Claude Hubert, « Disparition de nations amérindiennes dans les registres de baptêmes, mariages et sépultures : quelle validité ? », Les cahiers des dix, no 71, 2017, p. 1-133 ; Roland Viau, dans Danny Fougères (dir.), Histoire de Montréal et de sa région, ouvr. cité, p. 110.
-
[24]
Par exemple, à BAnQ, Interrogatoire d’un sauvage, 7 décembre (1689), TL2 11 573 ; Procès Badaillac dit Laplante (1701), TL4, S1, D463 ; Interrogatoire de Buet (1718), TL4, S1, D2246 ; Procès Deforge Verdon (1723), TL4, S1, D2960, etc. Catherine Dagneau confie dans son journal qu’elle continue « à Recevoir les sauvages chez elle parce qu’ils avoient coutume de sy retirer du temps de son mary » (citée dans Dhyana Robert, La contrebande à Montréal, 1729-1752, mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, 2016, p. 40).
-
[25]
Par exemple, BAnQ, Procès Badaillac dit Laplante (1701) TL4, S1, D463.
-
[26]
En 1701-1702 un procès, intenté par Marie Chambli, une Iroquoise, lève le voile sur une curieuse intimité médicale d’une Autochtone avec un malade, Pierre Rose, récemment décédé. Ce que conteste l’exécuteur testamentaire, c’est moins que Marie Chambli ait allaité pendant un mois et demi le malade, mais bien qu’elle réclame la compensation promise ! (Requête de Marie Chambli [1702], TL4, S1, D556).
-
[27]
Ragoût de veau (Procès Pierre Marcheteau [1716], TL4, S1, D1940) ; tourtes (Interrogatoire de Françoise Petit [1716], TL4, S1, D1947) ; ou… chien (Interrogatoires Vendezegue et Leroux 26 mars [1693], TL2 11 577).
-
[28]
Par exemple, à BAnQ, Interrogatoire Leroux (1693), TL2 11 577 ; Déposition de Saiochai Huron (1702), TL4, S1, D478 ; Interrogatoire Cardinal (1716), TL4, S1, D1893. Sur la manipulation par l’ivrognerie, voir Catherine Ferland, Bacchus en Canada, ouvr. cité, p. 242-248.
-
[29]
Voir Yves Briand, Auberges et cabarets de Montréal (1680-1759). Lieux de sociabilité, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1999, p. 97-103.
-
[30]
BAnQ, Interrogatoire Vendezegue (1693), TL2 11 577, ou encore Marguerite Chorel qui précise, en 1721, qu’« avec les Sauvages qui venoient souvent chez elle etant yvres croyant que cela ne regardoit point la justice, et qui si elle avoit sceu que cella regarde la Justice quelle en avoit porté la plainte à M. le Procureur du Roy ». Ce qu’elle n’a jamais fait : Déposition Chorel/Procès contre Mathurin Parent (1721), TL4, S1, D2639. Voir aussi Requête de René Fezeret (1680), TL2 11 581 ; Interrogatoire de Gabriel Cardinal (1680), TL2 11 583 ; Enquête et information (1682), cote ? Interrogatoire de Magdeleine Plouard (1683), TL2 11 584. On peut consulter également André Lachance, La justice criminelle du roi en Canada, 1712-1748, thèse de doctorat, Université d’Ottawa, 1974, p. 74-78 et 118 et Délinquants, juges et bourreaux en Nouvelle-France, Montréal Libre expression, 2011, p. 20-42 ; Robert Muchembled, Une histoire de la violence, Paris, Seuil, 2008.
-
[31]
Cité dans Pierre-George Roy, Ordonnances, Commissions etc. des gouverneurs et intendants de la Nouvelle-France, Beauceville, L’Éclaireur, 1924, p. 77.
-
[32]
Voir André Lachance, La justice criminelle, ouvr. cité, p. 74-78 et 118 et Délinquants, juges et bourreaux, ouvr. cité, p. 20-42.
-
[33]
Voir Roland Viau, « Populations autochtones et colonisation européenne, des origines à 1796 », dans Danny Fougères (dir.), Histoire de Montréal et de sa région, ouvr. cité, p. 167-180.
-
[34]
Voir les prescriptions contre l’ivrognerie de plus en plus nombreuses, depuis l’Édit du 15 aout 1536 aux règlements des cabarets du xviiie siècle. Sur ce point, on peut lire Luc Bihl-Willette, Des tavernes aux bistrots. Une histoire des cafés, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1997, p. 31-33.
-
[35]
Marie de l’Incarnation, Correspondance, ouvr. cité, p. 221 (1644) : « Les François leur ayant fait gouster de l’eau-de-vie ou du vin, il le trouve fort à leur goust, mais il ne leur en faut qu’une fois pour les rendre comme fols et furieux. La cause de cecy est qu’ils ne mangent que choses douces et jamais de salures. Cette boisson les tue » ; et p. 214 (1644).
-
[36]
François Vachon de Belmont, Histoire de l’eau-de-vie en Canada [avant 1732], s. l. s. n., 1840, p. 237.
-
[37]
Voir Catherine Ferland, Bacchus en Canada, ouvr. cité, p. 269-314.
-
[38]
BAnQ, Interrogatoire de Pierre Liégeois/Procès Jolicoeur (1731), TL4, S1, D3868.
-
[39]
Depuis le colloque dont est issu ce dossier de Tangence, j’ai poursuivi cette piste de recherche dans Dominique Deslandres, « L’intimité française avec la “sauvagerie” à Montréal aux 17e -18e siècles », Dix-Huitième Siècle, no 52, 2020, p. 101-118.
-
[40]
Bronwen McShea, Cultivating Empire Through Print. The Jesuit Strategy for New France and the Parisian Relations of 1632 to 1673, thèse de doctorat, Yale University, 2011, p. 81.