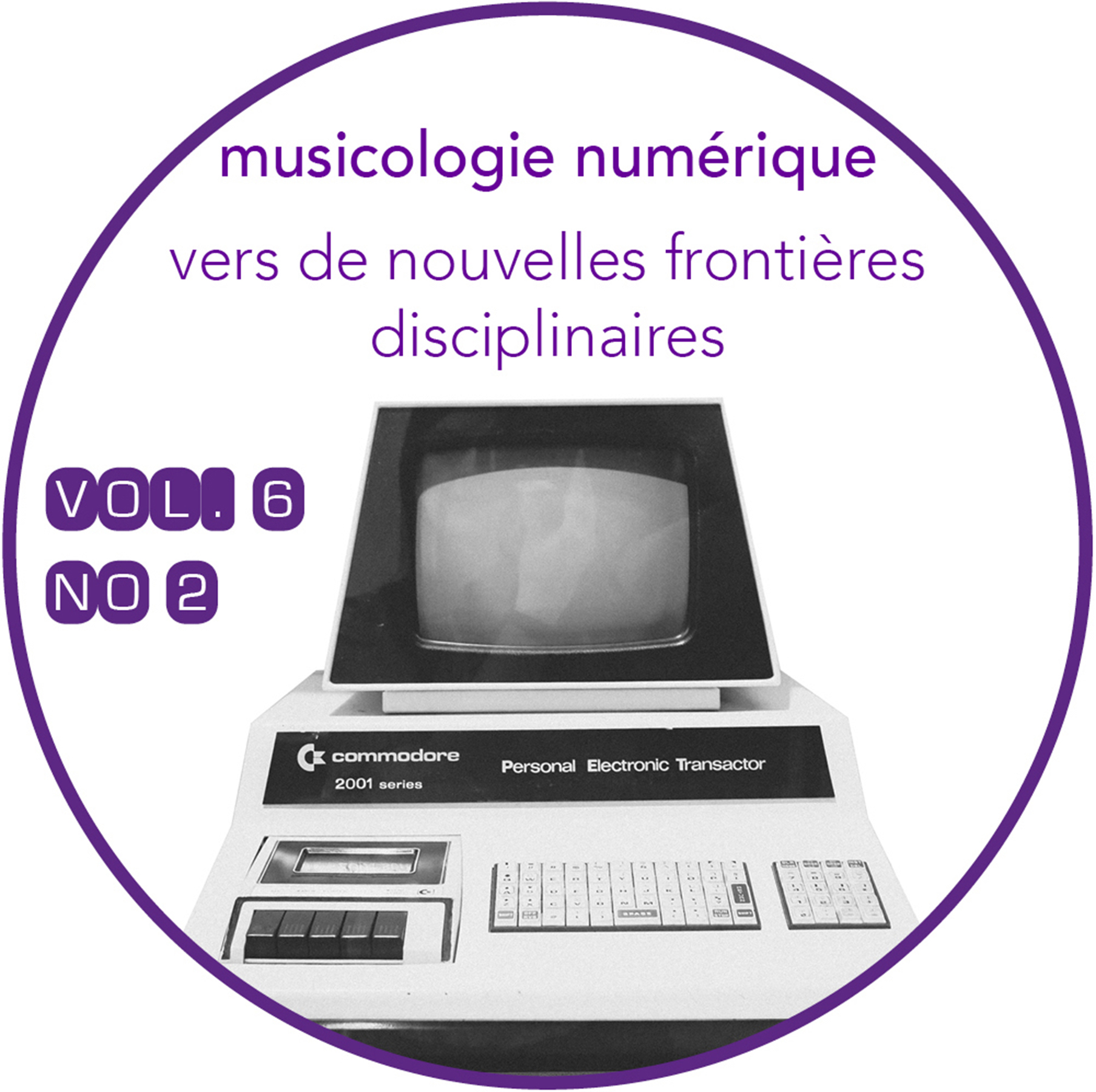Résumés
Mots-clés :
- France,
- Wolfgang Amadeus Mozart,
- propagande,
- Troisième Reich,
- Vienne
Keywords:
- France,
- Wolfgang Amadeus Mozart,
- propaganda,
- Third Reich,
- Vienna
Le cinquantenaire de la prise du pouvoir en Allemagne par les nazis en 1983 aura de toute évidence été une étape importante dans le processus de prise de conscience et de débat sur une période aussi trouble que culpabilisante pour les générations suivantes (Vergangenheitsbewältigung), le tout avec une forte augmentation du nombre de publications, pour se limiter à cet unique exutoire. Il y a une quarantaine d’années, les historiens de la musique avaient un retard par rapport à leurs collègues qui se penchaient sur la politique et la société ; le nombre d’études sur les conséquences de l’emprise du national- socialisme sur la vie musicale était donc encore limité. Le triste anniversaire aura donné lieu à un accroissement considérable de la bibliographie, en particulier sur la position prise par les compositeurs et les musiciens par rapport au régime dictatorial. Dans le cas de la France, la période trouble est le Régime de Vichy (1940-1944). Si l’on se base sur la publication en 2001 de La vie musicale sous Vichy, sous la direction de Myriam Chimènes, le 60e anniversaire du début de l’occupation par l’Allemagne et de la collaboration qui s’en est suivie marque un point tournant dans la littérature. Il s’agissait toutefois de l’aboutissement de travaux issus du groupe de recherche « La vie musicale en France pendant la Seconde Guerre mondiale », qu’a dirigé Chimènes entre 1995 et 1998. L’un des collaborateurs de l’ouvrage collectif, Yannick Simon, publiera à son tour Composer sous Vichy en 2009. Les deux auteurs dirigeront ensuite La musique à Paris sous l’Occupation en 2013, dont l’introduction (p. 13-24) fournit un excellent état de la recherche, et Karine Le Bail publiera en 2016 La musique au pas. Être musicien sous l’Occupation. C’est autour de cette année 2016 que les deux auteures du livre recensé ici, Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney, signent des publications relatives à la vie musicale pendant l’Occupation. Benoit-Otis, professeure agrégée à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, où elle enseigne depuis 2013, a établi sa crédibilité grâce à des travaux issus de son intérêt pour la France et l’Allemagne (voir sa bibliographie). Titulaire d’un doctorat de l’Université de Montréal et de la Freie Universität Berlin avec une thèse sur Ernest Chausson, dont la version publiée en 2012 lui a valu un prix Opus du Conseil québécois de la musique, elle a préparé une traduction annotée des Grundlagen der Musikgeschichte de Carl Dahlhaus pour ensuite traduire les écrits antisémites de Wagner sous la forme d’un groupe d’annexes totalisant 95 pages dans l’ouvrage de Jean-Jacques Nattiez sur cet aspect de la personnalité complexe du compositeur. Elle a codirigé avec Philippe Despoix une équipe de recherche interdisciplinaire pour le projet « Mémoire musicale et résistance dans les camps », qui a fait paraître en 2016 un numéro de la Revue musicale OICRM intitulé « Mémoire musicale et résistance. Autour du Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillion », qui compte parmi ses auteurs Cécile Quesney, à cette époque chercheure doctorale. Ce projet a aussi mené à la publication d’un ouvrage sur le sujet en 2018, que les deux auteures ont codirigé avec Philippe Despoix et Djemaa Maazouzi. Elles ont aussi à leur crédit plusieurs articles ou contributions à des ouvrages collectifs centrés sur l’utilisation de l’image de Mozart pendant les années d’occupation, qui forme le sujet du livre. Cécile Quesney, pour sa part, a obtenu son doctorat de l’Université de Montréal et de la Sorbonne avec une thèse sur le compositeur Marcel Delannoy (1898-1962), dont elle avait publié la correspondance avec Charles Koechlin. Attachée temporaire d’enseignement et de …