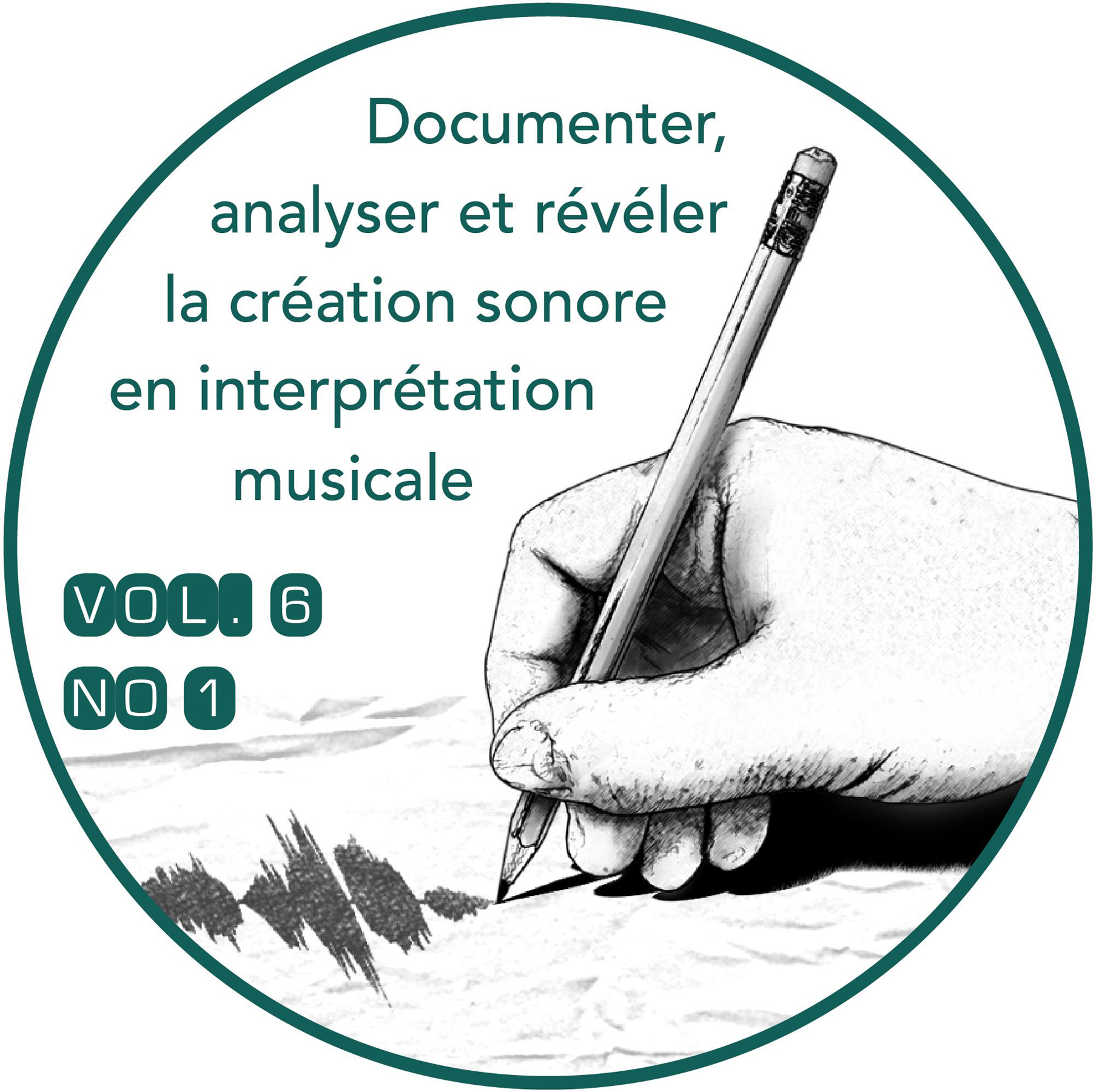Résumés
Mots-clés :
- analyse foucaldienne,
- discours,
- écoute musicale,
- Martin Kaltenecker,
- sciences humaines
Keywords:
- discourse,
- Foucauldian analysis,
- Martin Kaltenecker,
- music listening,
- social sciences
Le nouvel ouvrage de Martin Kaltenecker, L’oreille divisée. Les discours sur l’écoute musicale aux xviiie et xixe siècles, paru en 2010 aux Éditions MF, se situe, à l’image de son auteur, au croisement entre la France et l’Allemagne. Ses ouvrages précédents témoignaient déjà d’une curiosité intellectuelle envers l’histoire française et de sa spécialisation dans le domaine de la musique contemporaine allemande. Kaltenecker est musicologue et enseigne l’esthétique musicale et l’histoire de la musique en France à l’Université Paris-Diderot, où il est maître de conférences. Germanophone, il traduit régulièrement des ouvrages sociologiques ou musicologiques de langue allemande : il est notamment réputé comme traducteur de Theodor W. Adorno, dont il publie Les moments musicaux en 2003, et de Carl Dahlhaus, de qui il traduit l’ouvrage Die Idee der absoluten Musik (L’idée de la musique absolue) en 2006 – les deux ouvrages paraissent aux Éditions Contrechamps. Comme les publications précédentes de l’auteur, l’ouvrage L’oreille divisée. Les discours sur l’écoute musicale au xviiie et xixe siècles rend compte du goût de Kaltenecker pour l’histoire française et l’histoire allemande, et atteste de son parcours original. Boursier du Wissenschaftskolleg zu Berlin en 2006-2007, l’auteur a pu réaliser le travail préparatoire de son ouvrage au sein de cet institut pluridisciplinaire. Cette opportunité explique la très grande richesse des sources, à la fois francophones et germanophones, auxquelles il a pu avoir accès et qu’il choisit de mobiliser et d’analyser dans son ouvrage. Outre leurs origines différentes, les sources choisies sont de natures très diverses : extraits d’ouvrages philosophiques, littéraires, scientifiques, religieux, textes issus de manuels pédagogiques de pratique ou de théorie musicale. En s’appuyant sur un grand nombre de ressources provenant de tous les domaines du savoir, Kaltenecker retrace avec précision l’évolution des discours qui portent sur l’écoute musicale. En ce sens, il choisit d’opter pour une approche foucaldienne du terme de « discours ». Dans son introduction, Kaltenecker cite d’ailleurs Michel Foucault qui, dans un entretien de juin 1975 publié dans Le Monde le 19 septembre 2004, définit le discours comme « l’ensemble des énoncés qui peuvent entrer à l’intérieur d’une certaine systématicité et entraîner avec eux un certain nombre d’effets de pouvoir réguliers » (p. 13). Kaltenecker se situe dans une logique foucaldienne d’analyse du discours pour deux raisons. D’une part, il s’intéresse à une masse critique discursive à laquelle il s’agit de donner forme : comment les textes analysés se positionnent-ils vis-à-vis d’autres textes, en reprenant des notions et des catégories discursives similaires auxquelles il s’agit de donner un sens différent ? En un mot, comment ces textes se situent-ils au sein d’un ensemble discursif qui fait système ? L’auteur procédera à l’analyse des discours choisis en s’attachant à trois notions d’ordre esthétique et philosophique : l’imagination, l’ineffable et le sublime. Pensées séparément ou mêlées, ces trois notions revêtent des sens différents en fonction du contexte du discours étudié et encadrent la manière dont sont caractérisés les différents types d’écoute réflexive ou affective. D’autre part, Kaltenecker reprend le principe de discontinuité énoncé par Foucault dans sa leçon inaugurale au Collège de France de 1970 : si les discours forment un système cohérent, ils doivent également être traités comme des pratiques discontinues qui se croisent, se jouxtent, mais aussi s’ignorent et s’excluent. Considérés comme des évènements discursifs, les discours engendrent alors des effets réels sur les attitudes, les pratiques et les dispositifs. Kaltenecker nomme ce procédé une « opération discursive » : Le discours actif peut susciter des attitudes d’écoute spécifiques, mais aussi encourager la construction de certains lieux – ce sera l’objet du chapitre 4 (p. 179-218) …