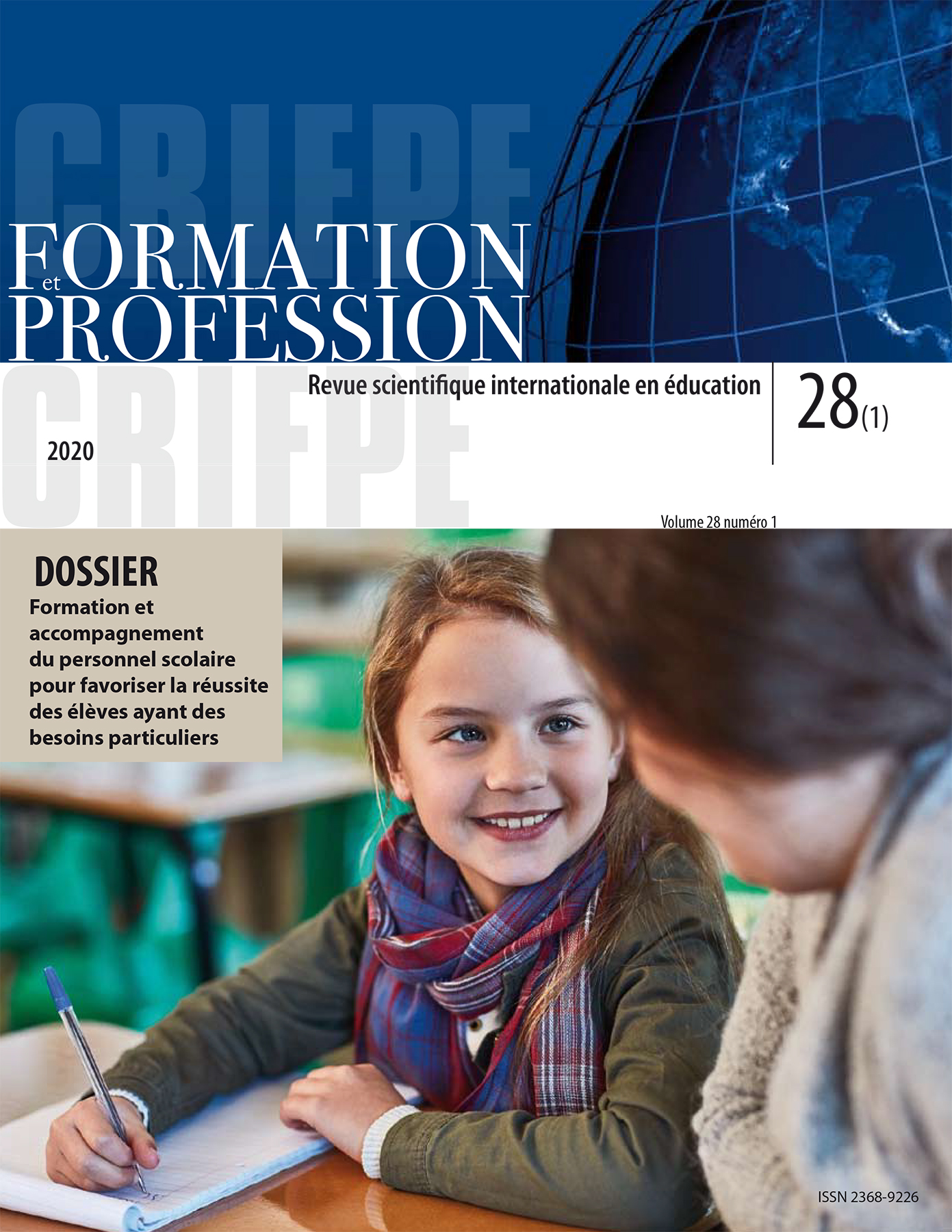Alors que le groupe de codéveloppement professionnel a d’abord été sollicité comme une approche de formation dans le domaine de la gestion avec comme pères fondateurs Adrien Payette et Claude Champagne, il suscite de plus en plus l’intérêt de formateurs du milieu éducatif dans le but d’amener les participants à améliorer leur pratique professionnelle. Dans le cadre de la formation pratique qui prépare à l’enseignement, cette modalité d’accompagnement est de plus en plus utilisée pour soutenir les activités des accompagnateurs de stagiaires et on le voit se décliner selon des formes variées. Depuis environ 20 ans, on voit se rapprocher nettement les acteurs du milieu scolaire et les acteurs du milieu universitaire dans le partage des responsabilités relatives à la formation initiale à l’enseignement. Ce rapprochement observé par Landry (2013) se retrouve sous des modalités diverses, notamment dû au fait de la place accrue accordée aux stages dans les programmes de formation initiale et la grande contribution des enseignants devenus des formateurs d’enseignants très (trop?) rapidement. Le rôle nouveau de formateur de stagiaires est né et il a fallu rapidement concevoir puis mettre en place des activités formelles de formation pour assurer la qualité du travail des enseignants associés, tout en valorisant le rôle de ces acteurs jusque-là bénévoles. Avec leur collectif portant le titre Le groupe de codéveloppement professionnel pour former à l’accompagnement des stagiaires. Conditions, enjeux et perspectives, les auteurs François Vandercleyen, Monique L’Hostie et Marie-Josée Dumoulin ont rassemblé des textes de recherches empiriques, mais aussi de projets de formation qui ont été réalisés récemment dans différents milieux au Québec. Cet ouvrage tente ainsi de répondre à plusieurs questions sur les avantages et les limites du codéveloppement professionnel, les défis qu’il pose sur les plans organisationnel ou pédagogique, les perceptions des acteurs impliqués et enfin les retombées de ce type d’approche dans les milieux scolaires et universitaires. L’ouvrage, qui compte sept chapitres, cerne tout d’abord les contours du codéveloppement en spécifiant avec précision les fondements et les principes de l’approche, détaillant par la même occasion les différentes étapes de la démarche (chapitre 1). Ce chapitre introduit et contextualise les différentes expérimentations dont il est question dans la suite de l’ouvrage. Les deux textes qui suivent sont orientés vers la formation des enseignants associés. Le premier, appuyé de schémas clairs et éclairants, fait état de la mise en oeuvre de groupes de codéveloppement professionnel accompagnés, à l’intérieur d’un dispositif de recherche-action-formation à l’intention d’enseignants associés, mené selon une approche collaborative (chapitre 2). Le second texte présente un dispositif de formation réalisé avec trois commissions scolaires et s’appuie sur le codéveloppement en réponse à une analyse de besoins approfondie, élaborée et constituée de traces recueillies auprès d’enseignants associés, de conseillers pédagogiques et de responsables universitaires (chapitre 3). Ces deux textes exposent les conditions de mise en oeuvre, les défis et les bénéfices perçus en lien avec l’approche, de même que les enjeux pour pérenniser ce type de projet, que ce soit pour les équipes-écoles impliquées, les enseignants associés ou encore les équipes de recherche à la base de ces initiatives. Le chapitre suivant aborde les défis reliés à la démarche, et plus particulièrement en ce qui a trait à la posture inhérente au rôle d’animateur (chapitre 4). On y voit que l’approche originale de codéveloppement peut faire l’objet d’adaptations en fonction de la particularité des contextes d’accompagnement et des enjeux spécifiques à chacun de ceux-ci. Entre autres, puisque le principe de mutualité voulant que chaque membre puisse soumettre une situation à l’échange et tire personnellement profit de la séance ne pouvait pas être respecté dans le cas exposé pour …
Parties annexes
Bibliographie
- Dumoulin, M-J., Guillemette, S., Garant, C., Nadon, I. et Danis, J. (2018). Vers une posture de coopération : regard sur la restructuration du sens de l’accompagnement professionnel auprès des enseignants. Dans S. Boucenna, É. Charlier, A. Perréard-Vité, et R. Wittorski (dir.). L’accompagnement et l’analyse des pratiques professionnelles : des vecteurs de professionnalisation (p.41-61). Toulouse : Éditions Octarès.
- Dumoulin, M-J. et Desjardins, J. (2019). Un modèle de codéveloppement professionnel en formation continue des enseignants associés au Québec pour déjouer l’opposition entre reconnaissance et mise en question du savoir d’expérience ? P. Guibert, X. Dejemeppe, J. Desjardins et O. Maulini (dir.). Questionner et valoriser le métier d’enseignant. Une double contrainte en formation (p.157-178). Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
- Landry, C. (2013). Le partenariat en éducation et en formation : des formes de collaboration à l’espace partenarial. Dans Landry, C. et C. Garant (dir.). Formation continue, recherche et partenariat. Pour construire la collaboration entre l’université et le milieu scolaire (p.31-62). Québec : Presses de l’Université du Québec.
- Payette, A. et C. Champagne. (2010) Le groupe de codéveloppement professionnel, 2e éd., Québec : Presses de l’Université du Québec.