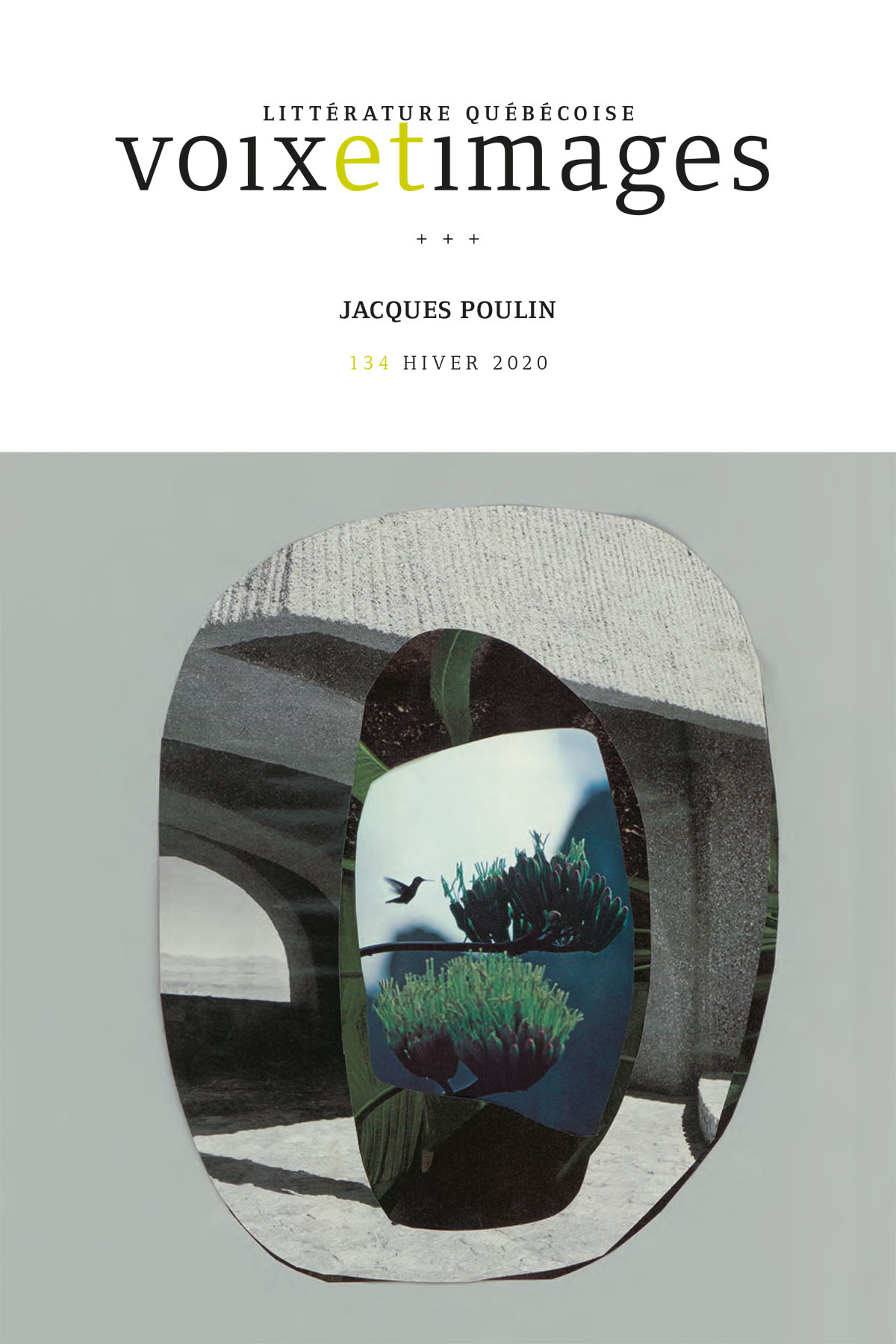Résumés
Résumé
Si certains ont perçu dans Atavismes (2011), recueil de Raymond Bock, un mouvement d’inquiétude, d’étiolement, de désespoir, cet article propose qu’il ne s’agit pas là de la finalité du livre : celui-ci affecterait plutôt le repli par entêtement vital, précisément pour échapper aux impasses. On étudie d’abord l’équivoque, qui est au coeur du recueil, à la lumière de manifestations de l’irrésolution chez les personnages, des brouillages qui marquent l’écriture et les voix de ces protagonistes, mais aussi de leurs élans de violence et de fuite. On avance ensuite, en s’appuyant sur la figure du coureur des bois — l’être de l’entre-deux, des risques et des possibles — que si Atavismes accélère, dans la fiction, le mouvement de la défaite, c’est moins pour déplorer un affaiblissement irrésistible que pour harnacher, de façon souterraine, les forces qui mènent à l’épuisement en espérant en tirer une détermination et une vigueur neuves.
Abstract
While some have seen in Raymond Bock’s short story collection Atavismes (2011) a movement of dread, loss of vitality, and despair, this article argues that such is not the book’s aim. The affectation of withdrawal, produced by a vital stubbornness, is actually designed to provide a way out of a dead end. We first analyze the ambiguity that is at the heart of the short stories, focusing on the indecisiveness of certain characters, the murkiness of the writing and the protagonists’ voices, and their impulses towards violence and flight. Basing ourselves on the figure of the coureur de bois— which embodies risk, possibility, and the in-between—we argue that while Atavismes accelerates the movement of defeat in fiction, this is done not to lament an irreversible process of deterioration, but rather to harness, at a subterranean level, the forces that lead to exhaustion in hopes of gaining from them a renewal of strength and determination.
Resumen
Si bien algunos percibieron en Atavismes (Atavismos) (2011), obra de Raymond Bock, un movimiento de inquietud, debilitamiento, desesperación, este artículo sugiere que no es ésta la finalidad de la obra: afectaría más bien el repliegue por terquedad vital, precisamente para escapar de los estancamientos. En primer lugar, se trata de analizar el equívoco, que ocupa el corazón del libro, a la luz de manifestaciones de la irresolución en los personajes, de las interferencias que caracterizan la escritura y las voces de estos protagonistas, pero también de sus arranques de violencia y de fuga. Luego el estudio establece, apoyándose en la figura del corredor de los bosques –el ser del intervalo, de los riesgos y los posibles– que si bien Atavismes acelera, en la ficción, el movimiento de la derrota, es menos para lamentar un debilitamiento irresistible que para aprovechar, de forma oculta, las fuerzas que llevan al agotamiento, a la espera de sacar de ello una determinación y un vigor nuevos.
Corps de l’article
À cause de son titre, à cause de la symbolique malchanceuse qui est associée au nombre de ses treize récits, à cause des questions troublantes que ceux-ci soulèvent, on a pu considérer Atavismes[2] comme un livre « sombre », « tragique[3] », « pessimiste, angoissé[4] », pénétré d’une « nature inquiète[5] », restant « coincé un peu de travers dans la gorge », un livre qui « s’accroch[erait] à une filiation qui s’effiloche de génération en génération[6] ». Y voyant le reflet de préoccupations bien québécoises — comme nous y invite sans doute la désignation générique histoires[7], qui évoque simultanément les récits individuels et collectifs, les petites comme la grande histoire[8] —, on a pu y recueillir le témoignage « d’une collectivité en perte de repères, aux mythes épuisés, qui éprouve une nostalgie ou une angoisse existentielle[9] » ; on y a décelé « une inquiétude bien fondée sur le destin du Québec, rarement aussi exacerbée dans nos lettres[10] », on y a discerné des personnages « très inquiets de la survie de leurs traces, pour ne pas dire de leur race », aux prises avec « l’horreur et le tourment de la filiation[11] » ; on y a entendu « la litanie […] de la défaite-génome inscrite au coeur même de l’homme et du peuple québécois[12] ».
Si les histoires de Bock donnent bien à lire de tels mouvements d’épuisement ou de crainte, dont je relèverai moi aussi certains traits, il me semble que l’obsession du dépérissement ne soit pas l’enjeu central d’Atavismes[13], qui interroge surtout la capacité de l’écriture à prendre en charge la rencontre entre le soi et ce qui le dépasse — forces historiques et collectives, remous intérieurs comme puissances naturelles. Pour le démontrer, je m’intéresserai à l’irrésolution des personnages, à leur tendance à compromettre leurs propres démarches, puis j’examinerai la façon dont Bock inscrit ces hésitations dans son texte par divers procédés. J’étudierai ensuite la manière dont les personnages du recueil se font, alternativement ou simultanément, victimes et monstres, avant de considérer leur propension à la fuite et leur désir de se fondre dans un monde qui les déborde de toutes parts. Enfin, je relierai cette disposition à l’action même de l’écriture : lorsque l’on paraît succomber, dans Atavismes, à ce qui nous dépasse et nous écrase, c’est pour mieux détourner les mouvements qui nous accablent — et y puiser l’énergie qui permettra de continuer à avancer.
À REVERS
Dans un article de 2015, Bock expliquait avoir tenté, en écrivant Atavismes, de « mettre à mal [s]es propres vues sur l’histoire », vues dont il commençait « à comprendre les faiblesses, les erreurs et les emportements[14] ». S’il avait choisi de faire « d’un patriote un tortionnaire, d’explorateurs des froussards, de colonisateurs des condamnés, de révolutionnaires armés des maladroits qui détruisent ce qu’ils voulaient sauver », c’était ainsi « pour [se] prendre [lui]-même à revers[15] », pour contrecarrer ses propres intuitions. Cette volonté paradoxale trouve écho dans l’une des tendances marquées de ses personnages : leur curieuse aptitude à l’autocontradiction qui, à la différence de celle de l’écrivain, se manifeste souvent sans qu’ils le réalisent.
Dans « Dauphin », ce trait se profile à l’occasion d’une méditation vaguement philosophique du narrateur, revenu à Montréal après une rupture qui découle de son infidélité envers la copine qu’il avait accompagnée dans l’Ouest. Le personnage dit croire que l’être humain est « responsable des grandes étapes de [sa] vie » et se demande s’il doit se qualifier « d’antidéterministe apathique » ou d’« existentialiste passif » (A, 48). Une chose lui paraît sûre, l’existence d’une certaine liberté de choix qui se manifesterait lors d’instants-clés :
Dans ces moments-là, on a la possibilité d’influencer ce qui nous attend. On rencontre quelqu’un, on hésite un peu, mais on s’engage sur la foi d’une simple émotion, ou pire, d’un orgasme, au point de changer de maison, de famille. On se fait labourer l’esprit toute notre enfance, et un jour, après un cours d’orientation, on s’enlise volontiers dans une carrière. […] [U]n choix est un embarras. Ce n’est pas un état perpétuel. On n’y survivrait pas. Ça peut arriver, disons, une fois tous les cinq ans. Oui, comme aux élections : un grand événement survient toutes voiles dehors, on sort les trompettes, fier de participer à quelque chose d’important, on se commet. Puis un nouvel engrenage s’enclenche qu’on ne contrôlera pas. Figurant dans sa propre histoire.
A, 48-49
L’inconséquente insistance du personnage sur les déterminants qui dépassent l’être humain évoque bien davantage la faiblesse du libre arbitre que la maîtrise, même partielle, de sa destinée. Ce personnage, qui cherchait à (se) convaincre de l’inexactitude de la croyance au destin et lui opposait l’existence d’une certaine liberté, en vient surtout à faire ressortir tout ce qui la contrarie, tout ce qui met la volonté en échec — et il le fait, ironiquement, malgré lui.
Ailleurs, le protagoniste — dont on peut supposer qu’il est écrivain, si l’on considère la présence constante des livres et de l’écriture dans son histoire (A, 39-40, 46, 51-53, 55) de même qu’une phrase discrète du « Pont[16] » — se pose une question importante pour tout littéraire : il se demande si les livres sont « une libre interprétation de notre réalité ou une transcription parfaite de notre fiction » (A, 51). Si les deux possibilités qu’il évoque suggèrent un décalage entre la vie et les livres, il bat lui-même cette idée en brèche en ne cessant de se comparer à des personnages de livres, de rapprocher sa vie des leurs (A, 46, 52-53, 55), allant jusqu’à s’estimer « bien meilleur » que l’un d’entre eux, ce qui fait de l’ouvrage qui l’occupe « une excellente lecture » (A, 40).
On retrouve dans « Le ver » un penchant similaire pour l’autocontradiction. Le protagoniste tente de s’approprier la maison familiale dont il a hérité à la suite du décès accidentel de ses parents et après sa rupture avec une femme nommée Alice. Il s’obstine, tout au long de l’histoire, à revendiquer son caractère rationnel, son inclination pour la rigueur. Pourtant, le vernis craque, dès les premières lignes, alors qu’il évoque les « maudites bobépines » d’Alice, qui lui paraissent « se multipli[er] » (A, 83) dans sa demeure, comme prolifèrent d’ailleurs les références à cette ex au fil de sa narration (A, 83-87, 89-91, 95-97, 100). Se surprenant à avoir passé « sans [qu’il s’]en aperçoive » une journée entière à découper des lombrics à la truelle, le personnage cherche en lui-même une « explication » (A, 89-92) à ce moment d’égarement, mais les souvenirs qui lui viennent spontanément, « si troublants [soient]-ils, n’éclair[ent] pas [s]a situation » (A, 91). Et tandis que la maison qu’il souhaitait s’approprier lui résiste, envahie par la nature, il revient à l’un de ses objectifs initiaux, « [r]eprendre le contrôle de [s]a cour » (A, 83 et 94), dans laquelle il décide de déplacer son mobilier, clamant que « [l]a sensibilité de l’homme sera toujours supérieure aux agencements fortuits de la nature » (A, 95-100). Convaincu d’exercer son goût, de démontrer sa prédominance, il sera presque avalé par cette nature qu’il cherchait à asservir, devenant lui-même un étrange ver et se livrant, contre toute raison, toute mesure, à « l’irrépressible désir de […] creuser [la terre], de l’embrasser, de [s]’y enfouir » (A, 103).
Si les exemples de « Dauphin » ou du « Ver » témoignent de façon éloquente de la tendance des personnages de Bock à contrecarrer leurs propres entreprises, ce caractère se retrouve tout au long du recueil, sous une forme plus modeste, à travers une sorte d’irrésolution chronique. Ainsi, alors que Marc, le narrateur de « Chambre 130 », semble presque partager la léthargie du père inconscient auquel il s’adresse, avouant qu’il n’a « plus de projet », qu’il ne se « sen[t] bon qu’à brasser [leur] vieux fond vaseux » (A, 191), le professeur du « Pont », qui envisage longuement la possibilité de son suicide appuyé sur un garde-fou, finit par « recul[er] » pour « reprend[re] sa marche » (A, 147). Quant à lui, le narrateur d’« Une histoire canadienne » affirme d’entrée de jeu avoir envie « de remettre [s]a démission au département, de changer de nom », mais se montre aussitôt hésitant, admettant que « quelques mots [de la part de son directeur le] convaincr[aient] » (A, 107) de ne pas le faire. Peu après, évoquant certains résultats de ses recherches, qui démontrent le recours à la torture au Pied-du-Courant, il confie ne pas savoir s’il est « fier ou non de cette découverte » (A, 111). Et s’il doute de ses motivations, soutenant qu’il regrette que « l’objectivité » (A, 111) ne guide pas assez les travaux des historiens, il révèle en fin de récit qu’il ne cherche lui-même qu’un moyen de « rendre justice à la mémoire de [s]on ancêtre » (A, 120). Enfin, la narration d’« Effacer le tableau » présente Dieudonné, l’un des révolutionnaires, comme un être versatile, qui agit « moins pour défendre un pays que pour se venger du destin, ou du hasard » — ce n’est « pas encore décidé » — qui lui aurait coûté son fils et sa « blonde » (A, 161-162). Même ceux de ses complices qui devraient être certains de l’importance de leur cause, puisque « [r]ien d’autre que les arts n’aurait pu les pousser à prendre les armes » (A, 158), montrent une indifférence inattendue devant les oeuvres qu’ils venaient préserver, « toiles, sculptures, poteries, installations » étant sans remords « lacér[ées] » (A, 168) durant leur combat.
Tout se passe comme si l’aptitude de ces personnages à se contredire, à tergiverser, à se prendre à revers, trait de l’« homme ambivalent[17] », constituait l’un des moteurs du recueil. Sous cet angle, celui-ci investirait l’écart entre les aspirations des protagonistes, leur potentiel, et leur réalité effective ; entre leur apparente faiblesse et les puissances, intérieures et extérieures, qui les animent et les déconcertent. Ce décalage, s’il peut être lu comme une source de déception — expliquant le ton mélancolique attribué à Atavismes, puisque rien n’y est jamais tout à fait conforme aux attentes, assuré, stable —, laisse aussi poindre l’une des forces des fictions de Bock : alors même qu’elles montrent la fragilité des certitudes et évoquent de néfastes éventualités, ce sont les possibilités favorables dissimulées qu’elles désignent, en creux, les issues qui restent à découvrir.
FAIRE DES HISTOIRES
Les ennuis que les personnages de Bock accumulent, les hésitations qui les travaillent — dont on entrevoit la fécondité —, marquent aussi le livre sur le plan de l’écriture, tandis qu’ils se déjouent eux-mêmes et s’empêtrent, font des histoires. Il faut dire que, déjà composé comme un recueil, c’est-à-dire forçant le lecteur à négocier les tensions sémantiques entre le tout et ses parties[18], et tirant profit de son ambiguïté générique, Atavismes repose aussi sur l’alliage entre une forme d’oralité — dont témoigne, comme le relève Pierre-Paul Ferland dans sa thèse, le recours à un vocabulaire populaire et vernaculaire, à des élisions syntaxiques, à des anglicismes non soulignés par l’italique — et un registre plus « littéraire » s’appuyant sur des temps de verbes rares et un lexique soutenu[19]. Bock affiche d’autre part une prédilection pour le zeugme, rapprochant des termes sémantiquement contrastants, brouillant les classifications et aménageant des correspondances inusitées[20] : « En raison de l’alcool, de la pénombre et des adjectifs, l’attention des camarades rasait le plancher. » (A, 159)[21] Usant de divers procédés pour générer de la discordance — comme lorsque le narrateur du « Ver » enchaîne ces phrases sans lien logique évident : « Comment pouvais-je perdre dix heures à hacher menu des vers de terre ? Alice, dans le fond, m’avait toujours subtilement ignoré. » (A, 90) —, Bock ponctue souvent sa narration d’éléments qui lui sont hétérogènes. Ainsi, « Une histoire canadienne » alterne entre lettres — celle d’un doctorant en histoire à son directeur et celles de son ancêtre, le docteur Pothier, sur le point d’être exécuté, à sa femme — et narration anachronique. De même, la narration de « Peur pastel » est entrecoupée de courtes descriptions des clichés trouvés par le narrateur dans une boîte ayant appartenu à une vieille dame décédée. Enfin, dans « Le voyageur immobile », ce sont des contes inuits et vikings, reproduits à même le texte, qui guident le narrateur dans sa quête. Il arrive aussi que Bock mêle discrètement les trames de ses histoires[22] : le voyageur immobile surgit, par exemple, dans « Eldorado » et « L’appel » (A, 80 et 181), le docteur Pothier est mentionné dans « Effacer le tableau » (A, 160), et il est question, dans « Le pont », d’un « archiviste », d’un « écrivain » et d’un « simpliste volontaire, casanier, rapailleur de cochonneries », ce qui rappelle les narrateurs du « Voyageur immobile », de « Dauphin » et de « Peur pastel » (A, 140).
Certaines des voix du recueil incarnent particulièrement l’équivoque qui se trouve au coeur de l’écriture d’Atavismes, en ce qu’elles proviennent de personnages qui s’emmêlent dans leur propre discours et se heurtent à leurs limites langagières. C’est le cas dans « Raton », dont le titre découle du surnom qu’attribue un couple démuni à son nourrisson. Dans cette histoire, le narrateur, pour qui les livres rappellent des parents peu aimés, un « fifi » et une « moumoune » (A, 130), multiplie les clichés et affiche une confiance excessive en ses moyens verbaux, par exemple lorsqu’il massacre des expressions : « avant de faire le petit on baisait sans arrêt, des vrais petits pains chauds » (A, 126)[23]. Voulant dépeindre la pauvreté dans laquelle vivait son père, ce narrateur passe par une comparaison : « Ils étaient tellement pauvres dans son coin que personne avait de frigo, juste des espèces de caissons gros comme des armoires à glace qu’un livreur venait remplir par la ruelle. » (A, 129) Or celle-ci est superflue, maladroite, puisque ce sont précisément des armoires à glace que le narrateur cherche à décrire. S’il tente, dans cette histoire, de raconter son expérience intime de la paternité, sa voix peine à se distinguer de celles des rares autres acteurs de son écosystème clos. Pénétrée de discours rapporté, souvent indirect, elle se constitue comme un tissu d’idées reçues, serti de formules qui en exposent la vulnérabilité : « Nancy prétend », « Nancy dit », « Nancy insiste », « mon père me disait », « ils l’ont dit à la télé », « [i]ls le disent à la télé » (A, 124, 126-128, 130). Ce phénomène est manifeste lorsqu’il évoque le cruel quiproquo qui entoure la naissance de son fils :
Ç’a pas été si difficile non plus, la grossesse, on a même pas eu à attendre neuf mois, il était pressé de sortir, et très énervé une fois sorti. L’infirmière était bizarre, elle nous a dit Je pense que votre petit a le saf [syndrome de l’alcoolisme foetal], mais moi tout de suite je lui ai répondu Hein, ben non, on a pas un petit saf, on a un petit crisse ! et Nancy m’a trouvé pas mal drôle.
A, 128
Dans « Carcajou », premier récit du recueil, un groupe de pseudo-felquistes anachroniques et ratés — dont un zeugme souligne bien l’état initial stagnant : « [c]omme d’habitude, on avait bu et rien à se dire sauf des jokes de cul » (A, 12) — kidnappent, tabassent et violent un pauvre bougre qu’ils croient être un ancien ministre libéral. Dès le départ, le narrateur, pour qui « ça doit passer par les mots », explique que son rôle est de raconter leur histoire, ajoutant que si cette variante « est la bonne », c’est moins parce qu’il la sent achevée que parce qu’il n’a « plus le temps » de la « réécrire sans cesse, à la recherche de détails plus précis, de sens plus profond » (A, 11-12). Sa quête laborieuse du mot juste est particulièrement perceptible lorsque la violence se déchaîne, à la fin de l’histoire, tandis que sa voix se confond avec celle de son compagnon :
Jason s’est défoulé sur les mesures de guerre, sur le maudit Trudeau du crisse, puis sur Mirabel, parce que Turbide avait pas vu les champs expropriés durant son somme et qu’il fallait bien lui rappeler cette grande oeuvre des siens, toute cette belle gang de crosseurs qui se votent des lois à leur goût sur le dos des pauvres petits dupes du Québec dont on rogne le territoire traité après traité depuis Mathusalem, et si aujourd’hui c’est plus le territoire c’est les compétences provinciales qu’on envahit puis l’esprit des enfants avec des drapeaux mur à mur payés sur notre bras des torchons dont l’emblème lui-même a été volé à la Société Saint-Jean-Baptiste et l’hymne national c’est pareil pauvre Calixa pauvre Basile s’ils avaient su je vous jure les tripes du pays en sont témoins depuis que la guenille est hissée à Ottawa c’est plus de l’eau c’est du sang qui coule de tous les érables qu’on entaille chaque année c’est pour ça la couleur qu’ils ont choisie les tabarnacs c’est quoi ta couleur préférée toé je m’en vas t’en faire moé des concessions en veux-tu des compromis dans l’honneur et l’enthousiasme mon câlisse ?
A, 20-21
Au fil de la progression de ce paragraphe se constitue un alliage de plus en plus confus, à travers une forme de discours hybride rendu plus ambigu par la raréfaction de la ponctuation. Les voix semblent tourner à vide, emportées dans un mouvement qui culmine dans la troublante scène du viol qui mènera les personnages au silence, « sonnés, les trois assis dans le char » (A, 22). En outre, le registre employé par le patriote d’« Une histoire canadienne », qui contraste avec ce qu’on pouvait lire dans « Raton » ou « Carcajou », ne peut, malgré sa noblesse et sa solennité, que mettre en évidence la bassesse de ses gestes — il tue de ses mains le cocher qui l’a dénoncé sous la torture — et souligner son incapacité à se comprendre et à se raconter lui-même : « Je peine à croire ce que je lui ai fait subir par cette revanche cruelle […]. Je me garderai de t’en faire souffrir les détails. » (A, 119) Et pour mieux voir comment l’ambiguïté centrale à Atavismes — qui passe par des décalages dans l’écriture, par la tendance de ses protagonistes à se déjouer eux-mêmes — devient productive, il faut se pencher sur les accès d’agressivité des personnages, irruptions subites de force à travers l’indolence, qui mettent en lumière leur perturbante complexité.
VICTIMES ET MONSTRES
Il n’est en effet pas rare que des personnages d’Atavismes soient animés par de vifs élans de brutalité, particulièrement lorsqu’ils tentent, d’ordinaire maladroitement, de réparer des injustices dont ils se pensent victimes. Ainsi, dans « Une histoire canadienne », le docteur Pothier, enragé que l’insurrection ait été mise en échec, ne peut s’empêcher d’exécuter son dénonciateur, Charles, « ce vulgaire chauffeur de fiacre » (A, 118). Le geste confère pourtant à l’ancêtre un statut moral trouble : lui qui sera sous peu supplicié ternit le sacrifice qu’il consent au « bien de [ses] compatriotes » (A, 118), devenant le bourreau de l’un d’entre eux. Pire encore, la honte se mêle, pour le docteur, au plaisir, alors qu’il se surprend à « savourer […] vilement » sa « revanche cruelle » (A, 119). Dans « Carcajou », le brouillage est d’autant plus saisissant qu’il est loin d’être évident que les trois complices s’en prennent à l’adversaire qu’ils croient viser. L’un d’eux remarque même, observant leur prisonnier, que « ça [lui] dit rien, cette face-là », mais ils concluent, carte d’identité à l’appui, que son nom, « Jean-Paul Turbide », « sonne bien en crisse, pour un ministre libéral » (A, 15). Presque lucides, ils observent que « [c]’est plate pareil pour un gars aussi important de finir saoul mort de même dans Centre-Sud » (A, 15). Pour sa part, Dieudonné, d’« Effacer le tableau », est animé par un désir de représailles sans objet clair, motivé par le deuil et l’abandon. Une chose est sûre : il veut « abattre quelqu’un, n’importe qui, lui tirer dans le dos, dans la face, dans les gosses » (A, 162). Et il devient difficile de discerner l’opprimé de l’oppresseur durant l’opération, lorsque Dieudonné saisit l’occasion de « corrig[er] [un otage qui résistait] de cinq balles au thorax » (A, 163) ou lorsque son complice, le Frisé, fait « explos[er] comme un geyser sur un Riopelle » (A, 169) la tête d’un contre-révolutionnaire.
Chez Bock, l’interchangeabilité des statuts de victime ou de bourreau va souvent de pair avec l’éruption d’une sorte de rage animale. Il n’est ainsi pas anodin que Jason se fasse « carcajou sur une carcasse » (A, 22), alors qu’il viole Turbide, surtout si l’on note que ce substantif donne son titre à ce premier texte du recueil. Dans « Peur pastel », le narrateur se représente une série d’« horreurs » qui pourraient lui arracher son fils ; il imagine entre autres un chien en lequel aurait « remont[é] d’âges lointains une furie de loup », et qui « s’élancer[ait] sans raison sur la poussette » (A, 65) où se trouve son enfant pour le défigurer. La colère de la bête contamine aussitôt le protagoniste, qui confie qu’il ne pourrait qu’ignorer les protestations du maître au moment où il le « tuer[ait] de [s]es mains » (A, 65). Dans « Le ver », le souvenir qui trouble le narrateur, lorsqu’il s’interroge sur sa journée passée à découper des lombrics, provient d’une scène de son enfance : il aurait torturé un « tamia à la patte arrière complètement arrachée », d’abord « [a]vec une branche, puis avec une grosse roche [qu’il] lui [aurait] lancée dessus à plusieurs reprises pour l’achever » (A, 91). Chez lui, la résurgence de l’animalité n’est pas seulement associée à une obscure vengeance contre les vers qui jouissent sournoisement de sa terre : elle finit par faire miroiter son incompréhension de lui-même — et, donc, une certaine vulnérabilité —, indice du brouillage, opéré dans Atavismes, de la distinction entre bourreaux et victimes. Marc, dans « Chambre 130 », décrit ainsi son angoisse comme « [u]n petit rat [qui] [lui] ronge les côtes à l’intérieur » (A, 195), mais il la relie paradoxalement à la culpabilité qu’il ressent d’avoir abandonné son père malade. Pour sa part, le voyageur immobile confie avoir « ramp[é] […] hors de la pièce comme un tamia blessé » (A, 214), terrifié par le pouvoir de l’oeil de cuivre ; il explique avoir découvert que l’objet ne lui permettait pas de changer l’histoire en tuant un homme ou un animal, ajoutant, soudain inquiétant : « j’ai essayé » (A, 215). Le bébé surnommé « Raton », atteint du syndrome de l’alcoolisme foetal, évoque plutôt la fragilité — lui que son père serait prêt à défendre en « défon[çant] la tête » (A, 128-129) d’un éventuel intrus —, tout comme l’un des camarades du coureur des bois de « L’autre monde », qui se trouve à « gein[dre] aigu comme un tamia affolé en reculant dans les roches », pourchassé par un sorcier sanguinaire accompagné de « prédateur[s] » aux figures animales : « loups », « renard », « loutre » qui « grond[e] comme un ours », mais aussi « chouettes » et « dindes » (A, 32-33). Charles, enfin, sur le point de trahir le docteur Pothier, ressent dans sa poitrine « un noeud grand comme un poing, comme le tamia qui a disparu dans le buisson juste avant qu’il secoue la bride pour sortir du boisé » (A, 117) — et il sera assassiné « comme on liquide un animal blessé » (A, 119).
Au cours de son entretien avec Mathieu Bélisle, Bock emmêle les identités et les rôles lorsqu’il note que « l’histoire du Québec est à la fois celle de vainqueurs et de vaincus » et que sa « position flottante […] donne accès à une conscience historique polymorphe[24] ». Il précise d’ailleurs qu’il n’appartient pas à la littérature de trancher : elle « ne permettra jamais d’élucider les énigmes », mais « nous forcera [au contraire] à nous poser sans cesse de nouvelles questions[25] ». C’est ce que l’on ressent devant ses personnages, qui révèlent constamment leur propre fragilité — celle de leurs raisonnements, de leur voix, de leur identité — et qui se surprennent à devenir, au gré des circonstances, bourreaux et victimes, carcajous, ratons et tamias. Cette exploration de l’équivoque à travers l’écriture, cette approche interrogative adoptée par Bock, semble motivée par un élan vital ; elle lui permet, comme le formulent Deleuze et Guattari, sans avoir à « faire le partage exact entre les oppresseurs et les opprimés », de les entraîner vers leurs avenirs possibles, dans l’espoir « que cet entraînement dégag[e] aussi des lignes de fuite ou de parade, même modestes, même tremblantes[26] ».
FUIR ET SE FONDRE
L’évasion est l’un des recours privilégiés des personnages de Bock en cas de coup dur. Ainsi, le coureur des bois de « L’autre monde », en mauvaise posture, sait bien que « [l]a fuite est préférable à la résistance quand la première seconde est disparue à l’avantage de l’ennemi » (A, 33), tandis que le récit de l’opération armée qui est au coeur d’« Effacer le tableau », vue comme le « sursaut de conscience du mourant » par l’un des protagonistes, s’ouvre et se termine par une « échappée », une « fuite chaotique », la recherche d’« un conduit, [d’]un sas, [d’]une crevasse, [de] n’importe quelle issue » (A, 151, 157, 173). De même, après son infidélité, le narrateur de « Dauphin » — à qui Jack London « en a appris pas mal sur la fuite et les biscuits secs » — sent qu’il lui « [faut] partir » (A, 53-54) ; les colons de « L’appel » tentent de « fuir le malheur » (A, 179) en s’éloignant de chez eux ; et le narrateur de « Peur pastel » s’imagine s’éclipser après « la catastrophe, le grand chaos » (A, 68). Enfin, les pseudo-felquistes de « Carcajou » mènent (et malmènent) Turbide dans la clairière où ils comptent eux aussi « fuir le jour du grand chaos » (A, 19), puis vont, leur crime commis, se perdre sur la route, vers le nord (A, 22).
Il arrive régulièrement que l’esquive, rendue nécessaire par les échecs et lacunes des personnages, les mène à la rencontre d’un monde naturel où ils espèrent trouver asile et réconfort. Le coureur des bois de « L’autre monde » doit ainsi trouver un moyen de se tapir dans son environnement, alors que des ennemis achèvent brutalement ses compagnons : « Pour l’instant, je dois rester immobile, m’intégrer au décor comme un lièvre, je dois devenir un rocher, ne pas respirer plus fort que ne le ferait le vent […]. » (A, 35) L’aventurier est d’ailleurs admiratif du lien particulier qui lui semble unir l’identité des Amérindiens à la nature, évoquant la capacité des Iroquois à « se transformer en arbre quand vient le moment de disparaître » (A, 31). Pour lui, la conception de soi des Outaouais, ses camarades d’infortune, paraît si fuyante, si mobile, qu’il les imagine devenir, s’ils étaient capturés, les « petits frères [de leurs ravisseurs] pour compenser la mort d’un cousin », changeant ainsi « de nom, de passé et d’âme tout simplement » (A, 27).
Voyant agoniser son père, le narrateur de « Chambre 130 » se remémore des épisodes de sa jeunesse, des moments passés dans un chalet où il pensait se rendre avec sa famille « pour fuir l’ordre, l’alignement des rues, l’horaire de [s]on école, l’obligation d’être toujours quelqu’un » (A, 196) et où il pouvait s’« évanouir, devenir la rivière, la forêt, la montagne, chasser, planer comme un urubu, pousser comme un arbre, dormir comme un loir » (A, 196). Le narrateur du « Ver » aborde lui aussi, avant d’évoquer le tamia blessé, son enfance au chalet, où il « rêvai[t] d’aller, en [s]e faufilant entre les racines, [s]’étendre dans le caveau formé par la remise écroulée, pour [s]’endormir dans l’humus » (A, 90). Dans « Le pont », François, qui expérimente — sans doute le plus intensément — le désir de perte de soi, fait également de la résidence de campagne familiale un « parfait lieu d’évasion pour le garçon qu’il était », y revoyant aussi son père « surgi[r] du boisé une grosse O’Keefe à la main », avec « toute sa tristesse, son besoin d’une échappatoire » (A, 142). Pour le professeur, la mort constitue l’ultime fuite, une façon d’enfin « efface[r] les douleurs » (A, 145) ; en « enjamb[ant] le garde-fou », il voudrait se réconcilier avec le monde et « redevenir lui-même » (A, 145-146) :
Son corps une fois décomposé après des années, il retournerait aider les marées gigantesques de la baie d’Ungava, les déluges interminables des moussons d’Asie, les cyclones au large du Japon et les ruisseaux chantant dans les sous-bois des Cantons-de-l’Est. […] Pendant qu’une partie de lui dormirait quelques centenaires dans l’inlandsis du Groenland et qu’une autre se reposerait dans une fosse abyssale de l’océan Indien, il irriguerait les récoltes dans les grandes prairies américaines, tomberait en violents orages dans le Grand Désert de Victoria pour faire éclore, lors d’une journée luxuriante, des millions de graines à demi desséchées, soufflées inlassablement par le vent, confondues avec le sable
A, 145-147
Or en continuant à s’imaginer mêlé à l’eau, François finit par sentir combien celle-ci est étrangère aux soucis qui sont les siens, indifférente à sa recherche de signification et, plus généralement, à toute préoccupation humaine. Ainsi, il se voit par exemple « [t]omb[er] en retard dans la bouche ouverte d’un plaisancier à la dérive […], mort au bout de ses rations » ; il se figure source de conflits dans les « déserts africains » ou empli de « déjections », « croupi[ssant] dans [d]es marais intoxiqués », « pendouill[ant], dans une salive épaisse et fétide, aux lèvres d’un vieillard parqué dans le corridor d’un mouroir » (A, 147). Puis, il « recule, détachant sa main du garde-fou » (A, 147). Lorsque l’on s’y arrête, d’ailleurs, les échappatoires envisagées par les personnages de Bock paraissent souvent hors d’atteinte pour eux, leurs grandes fuites imaginaires dans les faits hasardeuses : les felquistes en herbe de « Carcajou » ne pourront ni faire advenir leur Laurentie ni échapper à la stérilité de leur geste ; le coureur des bois de « L’autre monde » n’arrivera pas à se dissoudre tout à fait dans une nature impersonnelle, projetant plutôt sa sensibilité dans les arbres qu’il voit « souffrir en silence » (A, 35), percés de projectiles ; le narrateur du « Ver » ne sera pas libre de s’abandonner pleinement à la terre, sa métamorphose restant incomplète puisqu’il se dira heureux de sentir « contre [s]on ventre » un très humain « titre de propriété » (A, 103) ; les révolutionnaires d’« Effacer le tableau » seront sans doute capturés ou tués, et leur « ultime offensive » (A, 152) échouera ; Baptiste et sa femme sont rattrapés par le malheur dans leur tentative de colonisation ; rien n’indique que le narrateur de « Chambre 130 » pourra retrouver l’innocence de l’enfance et sa capacité perdue de se fondre dans la nature.
C’est que la paradoxale envie de fuir des personnages — qui combine souvent, d’une part, un attrait pour la disparition de soi, la fusion avec le monde, et, de l’autre, un désir d’ubiquité[27], c’est-à-dire d’expansion totale, de toute puissance du soi[28] — ne peut être ressentie et formulée que par des êtres finis, vulnérables. Elle ne peut nécessairement exister que comme source de tension, voire d’énergie, comme mouvement, plutôt que comme état final réconcilié. En d’autres termes, même la volonté de perte de soi, de dissolution complète dans la nature, ne peut être exprimée que par un soi, par une conscience humaine limitée, fragile, qui, commençant à sentir la porosité de son identité, est appelée à la sonder, tout comme elle interroge sa place au sein d’un monde vertigineux. D’ailleurs, François, dans un moment de lucidité, repense à sa lecture d’une fiction de Borges, qui le replonge dans d’inconfortables questionnements : « Le corps et l’esprit ne sont pas faits pour l’ubiquité, pour l’infini, pour le temps. Mais pour quoi sont-ils faits, dans ce cas ? » (A, 142)
Le narrateur de « Peur pastel » éprouve bien cette étroite relation qui existe, dans Atavismes, entre la méditation sur le soi — sur sa précarité, entre autres — et la perception sensible d’un monde démesuré, notant que « [l]es plus sublimes paysages [lui] font ressentir [s]a putrescence imminente » (A, 67). Et ce rapport se manifeste ailleurs dans le livre, lorsque François, le professeur suicidaire, brûle d’enjoindre à ses élèves apathiques et oublieux de leur passé de se connecter au monde et à son histoire — laquelle peut apparaître du paysage bordant une rivière, des vagues qui s’y agitent — en allant « toucher à un arbre, sent[ir] […] l’écorce sous la paume, ramass[er] une poignée de gravier près de ses racines » pour en prendre « une bouchée » (A, 138-139, 144). De même, le voyageur immobile, qui avait entretenu une relation plutôt abstraite à l’histoire, en vient, parce qu’il emploie la magie de l’oeil de cuivre, à « [s]e désintéresser de [s]es archives » qui perdent « tout relief en regard de ce [qu’il] [vit] », l’« immédiat, [l]e prégnant, [l]e banalement sensitif […] de [s]es voyages » (A, 217 et 221) — et il affirme à la fin du recueil :
Je ne vois certes aucun inconvénient à ce que le monde se transforme. Rien n’est jamais pareil d’une seconde à l’autre. Même le rocher le plus stable, le mieux conservé, à l’abri des intempéries sous une paroi, que rien n’a déplacé depuis la dernière glaciation, porte en lui les empreintes du temps qui passe. D’infimes marques d’usure érodent son contour, ses cristaux changent de visage au gel, au dégel, se crispent et se détendent. Cette pierre fendra et ses moitiés à leur tour.
A, 230
Si le narrateur parvient, du moins partiellement, à accepter l’idée que le monde ne cesse d’évoluer, qu’il est instable et insaisissable, il n’entretient pas — contrairement à François, lorsqu’il pense se jeter dans l’eau de la rivière — l’espoir de se réconcilier ni avec lui-même ni avec la matière anonyme en s’y désagrégeant. Au contraire, se rappelant que les transformations du monde n’existent que pour l’être conscient qui les perçoit, qui les apprécie ou les regrette — qui les éprouve et leur donne sens —, il décide d’aller « marcher tous les jours » sur sa terre familiale afin de tenter d’« entrer dans le mystère du corps, dans sa mémoire » (A, 230). Loin de le pousser à se refermer sur lui-même, cette rencontre du soi et de ce qui le dépasse, contact fondé sur la sensibilité et la lenteur, est solidaire d’une interrogation sur le fondement de la collectivité :
Je veux croire que le corps, avec un peu d’attention, déchiffre quelque chose de ce qui fait voler un essaim de chauves-souris exactement comme nage un banc de poissons — par vagues successives, en spirales sombres, dirigées par le schéma d’un tout qui vaut plus que la somme de ses parties, même infinies.
A, 230
Le voyageur immobile expérimente ainsi, alors que se termine la dernière histoire d’Atavismes — après que bien « [d]es choses telles qu’elles auraient pu être » (A, 139), bien des « “ostis de ‘possibles’ à marde” » (A, 85), selon l’expression d’Alice dans « Le ver », ont été explorés —, la puissance du doute, le potentiel de l’équivoque. Et il n’est pas anodin qu’il les ressente alors qu’il progresse, à pied, à travers « [l]e champ et [l]e bois » (A, 230).
BÛCHER SON PROPRE CHEMIN
Bock formule en entretien des observations qui permettent de mieux cerner les rapports qui se nouent, dans Atavismes, entre le soi et la collectivité, qui impliquent aussi le corps, la mémoire et la nature immense. Il évoque un texte de l’écrivain suédois Stig Dagerman, « Le destin de l’homme se joue partout et tout le temps », qui avance que « [p]arler de l’humanité, c’est parler de soi-même[29] », la petite et la grande échelle étant fondues l’une dans l’autre, et Bock explique, employant une image-clé, que s’il a écrit Atavismes « par accident », c’est en allant à la rencontre du « péril de l’écriture », ce qui revient selon lui à « s’aventurer dans le bois sans savoir si on trouvera un sentier adéquat, avec au fond de soi la force, peut-être encore ignorée, de bûcher son propre chemin si le branchage est trop dense[30] ».
On ne doute plus, alors, que l’incertitude de l’écriture est étroitement associée, chez Bock, au parcours du coureur des bois, dont la figure traverse Atavismes de part en part[31]. Ce personnage semble parfois bénéficier de pouvoirs inexplicables, découlant d’alliances occultes, comme dans « Carcajou », lorsque jaillissent « des farfadets, des zombies, des coureurs des bois, des sauvages » (A, 19) des ombres des ravisseurs, ou alors dans « L’appel », où l’on évoque ses mystérieuses disparitions et ses retours, « les sacoches remplies de contes effrayants, de formules magiques et de médecine algonquine » (A, 182). Il surgit avec une surprenante vigueur, dans « Le ver », lorsque le narrateur, qui peine à se tirer de sa demeure sauvage, ressent l’« euphorie du coureur des bois qui découvre aux confins de la forêt le dernier poste de la compagnie, alors qu’il s’était résigné à se laisser mourir à la prochaine clairière » ; il devient alors si confiant qu’il lui semble qu’il est désormais « trop tard pour [l]’arrêter » (A, 101-102). Pour sa part, luttant contre les embûches émotives et géographiques, le narrateur de « Dauphin » décrit ainsi son entêtement vital :
Il fallait partir. J’érigeai un cairn dans la lande, monticule marquant le passage de l’homme égaré : voilà, j’ai marché vers le vide. Il fallait que je me fonde dans le muskeg. […] Quitter l’hiver pour l’hiver n’a rien de raisonnable. Mais le trappeur qui s’est foulé une cheville dans un terrier camouflé par un tas de branches n’a plus besoin de la raison. Il ouvre toutes grandes les narines, il bande les muscles et avance, sans autre objectif qu’être encore là demain, là pour lui-même.
A, 54-55
Le coureur des bois de « L’autre monde » sent bien, lui aussi, que sa situation est sans espoir, mais même s’il se sait vaincu d’avance, il insiste : il « ne regrette rien », pas plus que Gagnon, son compagnon d’aventure (A, 28, 29, 32, 35). Demeurant tourné vers ses minces chances de survie, il ne se préoccupe que du mouvement éventuel, absorbé par les incertaines issues :
[S]i je ne suis pas moi-même achevé […], je me lèverai, je marcherai, je n’ai pas besoin de mon bras cassé pour avancer. Si j’ai de la chance, je rejoindrai en quelques jours le fort Frontenac, qui se dressera encore, ils ne l’auront pas brûlé, la garnison m’accueillera avec du sel, du lard et assez d’eau-de-vie pour remplacer le sang dans mon bras.
A, 26
Le personnage, qui ne sait pas comment interpréter les rayons de soleil découpés dans la pénombre et projetés sur lui, des « doigts de Dieu », accepte qu’il s’agisse « peut-être [d’]une grâce, peut-être [d’]une condamnation » (A, 25) ; et cet adverbe, « peut-être », qui indique l’irrésolution autant que les possibilités, fait retour à la toute dernière phrase, marquée par une invincible détermination : « Peut-être aurai-je aussi un restant de courage quand ils auront fini leur pillage et leurs sacrifices, et je rentrerai au fort Frontenac pour m’enrouler dans une peau de bison et dormir jusqu’au printemps. » (A, 35) Si le professeur du « Pont » envisageait l’éventualité que les « infinis détails [des] souvenirs » soient, chez chacun, présents à tout instant, « en puissance » (A, 140), il semble qu’à travers le « peut-être » du coureur des bois, les personnages de Bock découvrent en eux, en puissance, au contact des épreuves, des forces inattendues, ce qui ne les empêche pas, bien souvent, de « fomenter leur propre défaite », selon la formule d’Aquin, mais qui les révèle aussi, curieusement, « capables de tout[32] ». Ainsi, même le père de « Raton », qui semblait cloîtré dans son univers étroit, enfermé dans son appartement, ne récuse pas la possibilité d’une sortie, bien qu’il la remette au lendemain, lorsque « peut-être […] il fera plus chaud » (A, 123) ; le prêtre d’« Eldorado », condamné, sait qu’il doit se déplacer pour ne pas mourir gelé, engageant ainsi une « perpétuelle procession » entre les malades et les mourants ; il confie néanmoins, alors que son récit s’achève, attendre soit un « dernier malheur » qui les achèvera, soit un « miracle », qu’il n’écarte donc pas tout à fait (A, 78-80) ; enfin, quand tout semble perdu, Rose-Aimée de « L’appel » trouve inexplicablement — alors qu’elle avait été engourdie par la « torpeur » et la « prostration » — la force de « s’enfon[cer] dans l’hiver » (A, 185-188).
Le coureur des bois, l’être qui, chez Bock, va à la rencontre de l’« autre monde », celui du risque et des possibilités, de ce qui nous dépasse et nous échappe, n’a pas le luxe du désespoir, des regrets, pas plus que celui qui se hasarde à écrire, découvrant que les mots lui résistent, faisant « autre chose » (A, 229) que ce qu’il croit leur demander. Ce dernier, se sachant faible et doutant de sa réussite, se lance néanmoins, se mesurant à ce qui se dresse contre lui, ne pouvant qu’ainsi espérer découvrir l’étendue de sa propre force, ou plutôt expérimenter la « capture de forces » par laquelle l’art « transforme nos pouvoirs d’affecter et d’être affecté » en nous faisant « […] sentir, […] penser et […] rire des complexes de forces qui composent notre vie[33] ». Ce serait, autrement dit, en « gagn[ant] en conscience » qu’il arriverait, selon une formule de Bock, à « augment[er] [sa] capacité d’action[34] », donnant peut-être à voir de quelle façon l’art peut « change[r] les choses quand [il est] réussi » (A, 11). Sous cet angle, lorsque l’on se montre abattu, défait, dans Atavismes, lorsque l’on y fait le mort, c’est — « [u]n peu comme l’animal [qui] ne peut qu’épouser le mouvement qui le frappe, le pousser encore plus loin, pour mieux revenir sur vous, contre vous, et trouver une issue[35] » — pour révéler et harnacher les puissances contraires, face auxquelles la résistance directe est impossible, et les faire siennes. Voilà, peut-être, le moyen de combattre la crainte et l’épuisement, de déjouer les « absolu[s] qui [nous] écras[ent] », et de trouver la force de s’élancer « tête baissée vers un espace qui pren[d] vie à chaque foulée » (A, 43).
Parties annexes
Note biographique
XAVIER PHANEUF-JOLICOEUR entame sa deuxième année au doctorat au Département de langue et littérature françaises de l’Université McGill (DLLF) sous la supervision d’Isabelle Daunais. Sa thèse, financée par une bourse d’études supérieures du Canada Vanier, examine un motif, faire le mort, dans des récits d’après-guerre de Beckett, Céline, Duras et Simon. En 2014, après avoir terminé ses études en droit à McGill, il a entrepris une maîtrise en écriture littéraire, sous la supervision d’Alain Farah, dont le volet critique portait sur Atavismes. Il a notamment publié un article dans la revue Chameaux de l’Université Laval (2018), coorganisé un colloque intitulé Pour une poétique du rap (2017) et présenté des communications lors de colloques étudiants (2017). Il a depuis peu lancé un balado de théorie littéraire, intitulé Points critiques, au DLLF.
Notes
-
[1]
L’auteur souhaite remercier Alain Farah, Isabelle Daunais, Michel Biron et Guillaume Ménard pour leur(s) généreuse(s) relecture(s) et leurs précieux commentaires.
-
[2]
Raymond Bock, Atavismes. Histoires, Montréal, Le Quartanier, coll. « Polygraphe », 2011, 230 p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle A suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[3]
Christian Desmeules, « Littérature québécoise. L’art ancien de la défaite », Le Devoir, 16 avril 2011, en ligne : http://www.ledevoir.com/culture/livres/321225/litterature-quebecoise-l-art-ancien-de-la-defaite (page consultée le 20 janvier 2020).
-
[4]
Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit. Américanité et mythes fondateurs dans les fictions québécoises contemporaines, thèse de doctorat, Québec, Université Laval, 2015, f. 315.
-
[5]
Esther Laforce, « Atavismes, par Raymond Bock : les fragilités de l’identité québécoise », BAnQ. Annotations, 23 mai 2013, en ligne : http://blogues.banq.qc.ca/annotations/2013/05/23/atavismes-par-raymond-bock-les-fragilites-de-lidentite-quebecoise/ (page consultée le 20 janvier 2020).
-
[6]
Chantal Guy, « Atavismes : recueil d’histoires », La Presse, 20 mai 2011, en ligne : http://www.lapresse.ca/arts/livres/critiques-de-livres/201105/20/01-4401350-atavismes-recueil-dhistoires.php (page consultée le 20 janvier 2020).
-
[7]
Tout au long du présent texte, la référence à cette désignation générique sera indiquée par le recours à l’italique.
-
[8]
Ce qui a souvent été commenté ; voir, par exemple, Christian Desmeules, « Littérature québécoise. L’art ancien de la défaite » ; Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit, f. 186 ; Pierre-Luc Landry et Marie-Hélène Voyer, « Paratexte et mentions éditoriales : brouillages et hapax au coeur de la “Renaissance québécoise” », Études françaises, vol. LII, no 2, 2016, p. 52 ; Thomas O. St-Pierre, « Quatre truismes sur l’oeuvre de Maxime Raymond Bock », L’Inconvénient. Littérature, arts et société, no 73, été 2018, p. 51-52 ; voir aussi ce qu’en dit l’écrivain lui-même : Raymond Bock, « Le vieux et le neuf », Québec français, no 175, 2015, p. 95.
-
[9]
Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit, f. 315.
-
[10]
Michel Lord, « Raymond Bock, France Boisvert, Marie-Ève Sévigny », Lettres québécoises. La revue de l’actualité littéraire, no 147, automne 2012, p. 38.
-
[11]
Francis Langevin, « La régionalité dans les fictions québécoises d’aujourd’hui. L’exemple de Sur la 132 de Gabriel Anctil », temps zéro, no 6, avril 2013, ¶ 30, en ligne : http://tempszero.contemporain.info/document936 (page consultée le 20 janvier 2020).
-
[12]
Christian Desmeules, « Littérature québécoise. L’art ancien de la défaite ».
-
[13]
Ce que d’autres suggèrent aussi ; voir, par exemple : William S. Messier, « Les sentiers battus : quelques notes sur le coureur des bois », Liberté, vol. LIII, no 3, avril 2012, p. 36-37 ; Alain Farah, « D’un Bock l’autre. Des périls de la tentation atavique », Liberté, vol. LIV, no 2, hiver 2013, p. 6 ; Sophie Létourneau, « Les nouveaux héros », Spirale, no 240, printemps 2012, p. 81.
-
[14]
Raymond Bock, « Le vieux et le neuf », p. 95.
-
[15]
Ibid.
-
[16]
L’un des « vieux amis » de François est en effet décrit ainsi : « l’écrivain de la gang qui n’a jamais rien écrit et dont on ne sait rien depuis qu’il a suivi sa blonde dans l’Ouest » (A, 140).
-
[17]
Bock utilise l’expression dans Mathieu Bélisle, « Entretien de Mathieu Bélisle avec Raymond Bock », L’Inconvénient. Littérature, arts et société, 28 mars 2014, en ligne : https://linconvenient.wordpress.com/2014/03/28/entretien-de-mathieu-belisle-avec-raymond-bock/ (page consultée le 20 janvier 2020).
-
[18]
Voir à ce sujet René Audet, « To Relate, to Read, to Separate. A Poetics of the Collection and A Poetics of Diffraction », Interférences littéraires/Literaire interferenties, no 12, février 2014, p. 38-40 et p. 45.
-
[19]
Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit, f. 185-186 et f. 388.
-
[20]
Voir à ce sujet Jean Mazaleyrat et Georges Molinié, Vocabulaire de la stylistique, 1re édition, Paris, Presses universitaires de France, 1989, p. 381 : « il est sorti avec hâte et avec son chapeau » ; voir aussi l’article que consacre à cette figure de style la Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française, « Zeugme », en ligne : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3220 (page consultée le 20 janvier 2020) ; Ferland remarque aussi l’usage du zeugme et le relie au registre « littéraire » (Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit, f. 185-186 et f. 388).
-
[21]
Voir aussi : « […] en dix minutes on montait sur la 15 vers les hauteurs, la réparation, la liberté » (A, 15) ; « Les Tsonnontouans nous font la peau et les poches […] » (A, 34) ; « […] je nous sais condamnés par les vapeurs d’asphalte, l’ubiquité du grand guignol et la victoire des chiffres sur les lettres » (A, 67) ; « Ils étaient tout ouïe et dodelinaient, certains en raison des rimes, pauvres en majorité, d’autres en raison des cahots de la route. » (A, 161) ; « La révolte lui avait donné sa chance et son arme bien plus facilement que l’armée canadienne ne l’eût fait […]. » (A, 162) Ferland relève pour sa part les zeugmes suivants : « […] attrapant des lièvres et des poissons les jours de chance, la crève et la diarrhée le reste du calendrier » (A, 78) ; « Quand je m’y glissai, mes élancements se calmèrent, mes transports aussi. » (A, 96) ; « Si l’homme repasse comme il l’a promis, ils pourront revenir à la maison et peut-être à la normale. » (A, 109) Voir Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit, f. 185-186 et f. 388.
-
[22]
Comme l’observe aussi Ferland ; voir Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit, f. 300.
-
[23]
Voir aussi, dans la même veine : « Nancy prétend que je peux pas dire [que le bébé] se met les pieds dans la bouche parce que c’est une expression anglaise. » (A, 124)
-
[24]
Mathieu Bélisle, « Entretien de Mathieu Bélisle avec Raymond Bock ».
-
[25]
Ibid.
-
[26]
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1975, p. 107. Voir, pour une étude plus approfondie de ces concepts deleuziens, mon mémoire de maîtrise, dont le présent article reprend et prolonge la réflexion sur Atavismes : Xavier Phaneuf-Jolicoeur, Entre la victoire et la mort — Bûcher son propre chemin. Lecture d’Atavismes de Raymond Bock à l’aide des perspectives littéraires de Gilles Deleuze, suivi du texte de création Sept paroles, mémoire de maîtrise, Montréal, Université McGill, 2016, 148 f., en ligne : http://digitool.library.mcgill.ca/R?func=dbin-jump-full&object_id=145412 (page consultée le 20 janvier 2020).
-
[27]
Voir Pierre Nepveu, « Périphéries : la littérature québécoise hors d’elle-même », Marie-Hélène Constant, Martine-Emmanuelle Lapointe et Rachel Nadon (dir.), Esquives d’une mort annoncée. Lectures et récits de la littérature québécoise contemporaine, Québec, Codicille éditeur, coll. « Prégnance », 2017, p. 24.
-
[28]
Voir, à ce propos, quoique nos conclusions diffèrent quelque peu, Mathieu Bélisle, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, Montréal, Leméac, coll. « Nomades », 2018, p. 245-250.
-
[29]
Mathieu Bélisle, « Entretien de Mathieu Bélisle avec Raymond Bock ».
-
[30]
Ibid.
-
[31]
Je ne suis pas le seul à le remarquer : voir William S. Messier, « Les sentiers battus : quelques notes sur le coureur des bois », p. 27-37 ; Pierre-Paul Ferland, Une nation à l’étroit, f. 184 et f. 305-318.
-
[32]
Hubert Aquin, « L’art de la défaite : considérations stylistiques », Liberté, vol. VII, nos 1-2, janvier-avril 1965, p. 33.
-
[33]
Anne Sauvagnargues, Deleuze et l’art, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Lignes d’art », 2005, p. 58 ; voir aussi p. 106-108.
-
[34]
Mathieu Bélisle, « Entretien de Mathieu Bélisle avec Raymond Bock ».
-
[35]
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, p. 107.