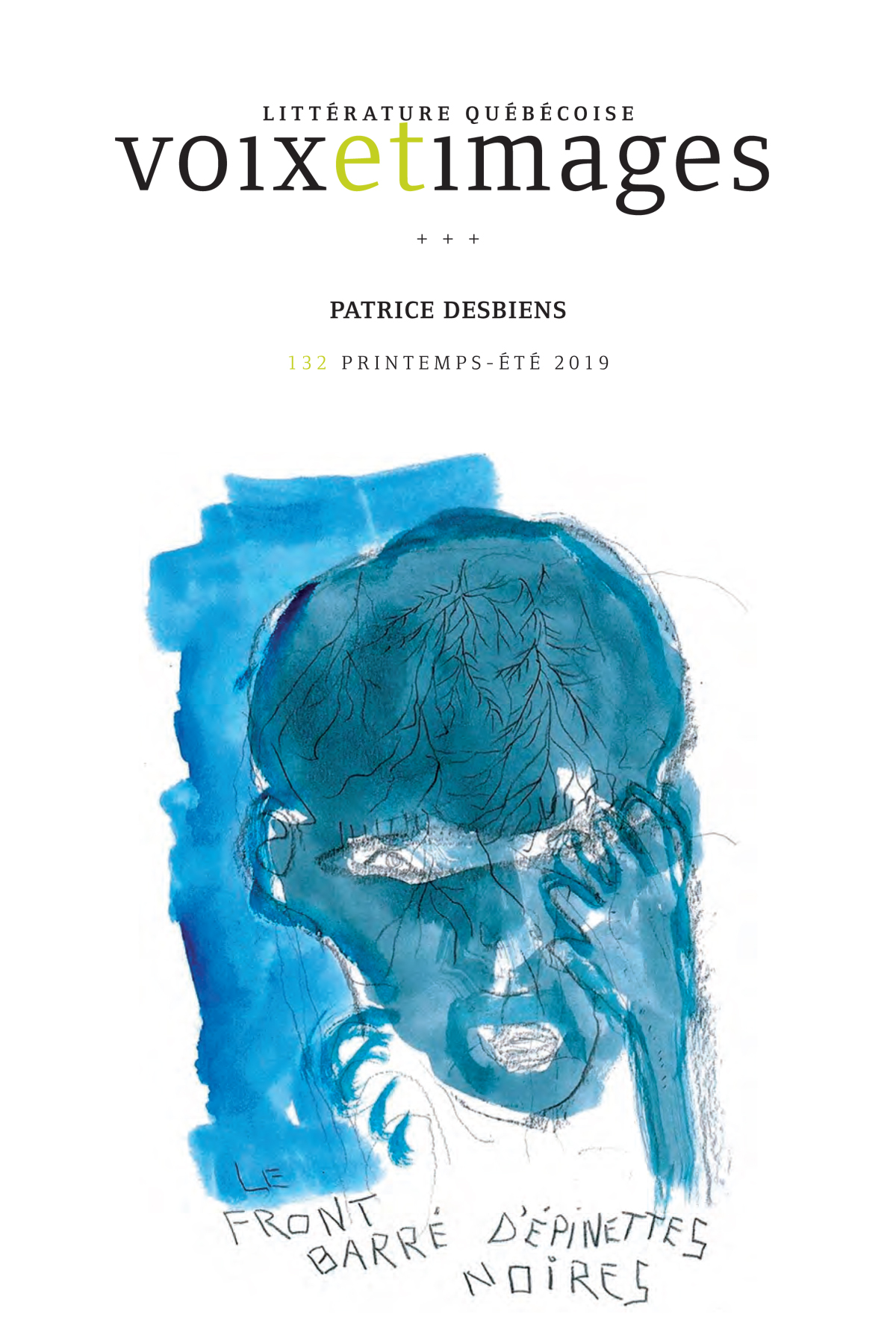Résumés
Résumé
Le décalage, qui est une donnée de base de l’oeuvre de Patrice Desbiens, est ici envisagé à la fois comme une donnée géographique, existentielle, syntaxique et sonore. À partir d’analogies musicales et de la poétique performative dégagée par Pierre Alferi dans Chercher une phrase, c’est en particulier l’approche du débit verbal qui est fouillée, notamment sous les angles de l’enjambement et de la syncope rythmique. Ces procédés permettent de relier des patterns d’écriture à une dialectique du lieu et du non-lieu qui traverse une majorité de recueils de l’auteur, où le phrasé minimaliste et la découpe en vers souvent très brefs peuvent être lus en convergence avec un équivoque renversement de la faiblesse identitaire.
Abstract
Displacement, a basic element in the work of Patrice Desbiens, is seen here in terms of geography, existential position, syntax, and sound. Starting from musical analogies and the performative poetics described by Pierre Alferi in Chercher une phrase, verbal delivery is given particular attention, especially in terms of enjambment and rhythmic syncopation. These processes enable us to make connections between writing patterns and a dialectics of place and non-place that is found in most of Desbiens’s works, in which minimalist phrasing, and lines that are often very short, may be read as converging on an ambiguous reversal of the weakness of identity.
Resumen
El desfase, que es un dato básico de la obra de Patrice Desbiens, se considera a la vez como un dato geográfico, existencial, sintáctico y sonoro. A partir de analogías musicales y de la poética realizativa resaltada por Pierre Alferi, en Chercher une phrase (Buscar una frase), se busca sobre todo el enfoque de la cadena verbal, en particular en los ángulos del encabalgamiento y la síncopa rítmica. Estos procedimientos permiten enlazar patrones de escritura con una dialéctica del lugar y del sobreseimiento que atraviesa la mayor parte de las recopilaciones del autor, en las cuales el fraseo minimalista y el recorte en versos, con frecuencia muy breves, pueden leerse en convergencia con un equívoco asombroso de la debilidad identitaria.
Corps de l’article
N’écrit que celui ou celle à qui la voix fait défaut[1].
Que ce soit dans sa pratique du vers bref ou dans la prose elliptique de L’homme invisible/The Invisible Man[2], Patrice Desbiens privilégie abondamment le décalage, non seulement comme procédé formel mais comme une donnée existentielle de base, infléchissant la structure profonde de l’expression. Synonyme d’un écart spatiotemporel entre des êtres, mais aussi, plus largement, d’une différence entre réalités, la notion de décalage s’avère très porteuse lorsqu’on l’utilise pour examiner une pratique artistique ancrée dans le refus ou la négation, où l’auteur procède à partir d’écarts inauguraux qui, en s’opposant aux attentes, multiplieront les contretemps. Si le titre du recueil Décalage[3] incarne cela jusque dans l’autoréflexivité — non seulement le livre fait-il ce que le titre dit, mais le terme décalage se trouve à être décalé, en couverture, en étant ramené à sa notation phonétique entre crochets : [dekalaʒ] —, le parcours entier de l’écrivain semble innervé par la non-coïncidence. De Timmins à Québec, de Sudbury à Montréal, le décalage géographique conduit souvent à un regard rétrospectif, plus ou moins distant, tandis que le présent lui-même est marqué par une inadéquation profonde, par un manque de présence à partir duquel le poème construira sa proximité paradoxale avec nous. « Chez lui, la douloureuse instabilité identitaire devient un drapeau de ralliement, une forme d’identité que le poète explore de recueil en recueil », écrit Elizabeth Lasserre[4], comme si le déséquilibre pouvait donner lieu à des assises partielles, dont la seule supposition suffirait à stabiliser un édifice personnel entrouvert sur le collectif. Ce « grand écart », François Paré le lit très finement, attentif aux superpositions qui donnent sa densité au texte :
Mais cet écart entre la voix et le texte se superpose toujours à la distance multiple qui, toujours chez Desbiens, fracture le sujet dans sa quête du sens. Plus tard, le même décalage révèle les rapports oppressifs entre les langues et surtout il nomme sous toutes ses formes la mise à l’écart de la mère, figure déficitaire de la signification à l’origine même de l’errance[5].
Toujours un peu ailleurs, Desbiens n’en colonise pas moins cet écart maintenu, territorialisant de biais l’exil et offrant à son peuple hypothétique un droit particulier sur le non-lieu. Si le raccord est forcément défectueux, c’est qu’il en est déjà ainsi du rapport au lieu actuel, comme en témoigne cette virée en ville où « Sudbury passe dans les vitres de la voiture comme/un film brisé[6] ». Le dehors immédiat est non seulement distant, mais abîmé, marqué par un défaut qui appelle d’urgence une parole, afin, paradoxalement, d’arriver ici, peut-être :
S, 130On part de nulle part.
On part de nulle part.
Ce besoin fatalement nécessaire d’arriver quelque
part.
Sudbury silence.
Sudbury silence.
Sudbury distance.
Ces rapports au territoire et à l’identité franco-ontarienne ayant été scrutés maintes fois, je tâcherai de m’en tenir surtout à l’aspect stylistique, en observant la phrase de Desbiens, la manière dont son expérience du décalage vient informer sa manipulation de la syntaxe, en conjonction avec le vers. Lieu privilégié où le lecteur prend contact avec cet être en décalage présidant les recueils, le déploiement de la phrase sera étudié à la lumière de la poétique de Pierre Alferi, qui, dans son microtraité Chercher une phrase, s’aventure à réfléchir à coups d’assertions intuitives sur la particularité du langage littéraire. J’étendrai notamment l’usage que fait Alferi de métaphores musicales, afin de porter le regard au-delà de la phrase grammaticale et de mieux viser l’organicité des processus littéraires[7]. Je capitaliserai en particulier sur la fréquence chez Desbiens du procédé syntaxique de l’enjambement, un trope dont je lierai la structure à celles de la syncope et de la « note bleue » caractéristique du blues et du jazz — univers musicaux auxquels le poète s’est maintes fois référé.
C’EST PARTI EN COUILLE
La définition du mot décalage recouvre en premier lieu l’idée d’un déplacement dans l’espace ou le temps, avec les conséquences qui l’accompagnent (d’où l’expression « décalage horaire »), signification qui s’étend jusqu’au déplacement, à l’écran d’ordinateur, d’un bloc de texte. Il y a en second lieu l’idée plus subjective d’une discordance, d’un écart entre des choses, des personnes ou des situations. S’il peut y avoir un décalage entre vous et moi, entre les pronostics et la réalité, on dira aussi de quelqu’un ou d’un style qu’il est décalé, ce qui comporte une connotation fort variable. Pointant un certain excès, une marginalité, un déphasage, l’adjectif « décalé » — proche en cela de l’anglais freak — désignera une réalité tantôt méprisable, tantôt rafraîchissante de par son caractère inusité. On comprend donc son usage fréquent dans le contexte de la contre-culture, et il fait désormais partie des facilités adjectivales du journalisme culturel, permettant — au même titre que des vocables comme « surréaliste », « déroutant » ou « expérimental » — d’étiqueter un objet artistique difficile à situer.
En lisant Patrice Desbiens, on comprend vite que quelque chose ne va pas. L’espace-temps, le texte lui-même sont porteurs d’une inadéquation, d’un impair, d’une différence qu’il conviendra d’explorer. « It began as a mistake », écrit Charles Bukowski dans l’incipit de son premier roman, Post Office[8]. Telle une erreur, un faux-pas, à même le brouillon qui nous sert d’identité, la poésie débute et chemine « à l’imparfait », comme le disait autrefois Gilles Marcotte de romans québécois imprégnés par un sentiment d’incomplétude. « L’imparfait, qui domine dans ces quelques lignes, n’implique pas un temps accompli, fermé, mais une durée qui se construit et ne cesse pas de se construire, dans le cheminement des consciences ou, plus justement, dans le cours du texte[9] », ce qui, dans le contexte qui nous occupe, peut tout aussi bien s’exprimer au présent de l’indicatif, dans des poèmes où la durée se brise « en direct », où le cheminement de la conscience ne va pas sans un fardeau de reconstruction dont la strophe porte les marques.
Au fil des textes, un point focal commun se dégage, qui va de pair avec un ton, une sorte de « note bleue » (j’y reviendrai) porteuse d’une nostalgie motrice. Là où Samuel Beckett théâtralise le vide dans sa diction, où Marguerite Duras fait danser verbalement l’impossibilité inhérente au désir, Desbiens manie l’absence et la déception pour en faire une musique langagière, laquelle, à défaut de consoler, tend à restituer son potentiel signifiant à une réalité usée, lourde d’histoires, de défaites et de présupposés.
Pour ramener cela à une équation simple, disons que le thème obsédant du ratage existentiel est, de manière récurrente, prolongé dans la réussite du poème. Cette notion de prolongation, je la fais dériver du concept musical de syncope rythmique, lequel désigne un temps faible qui se prolonge sur un temps fort. Outre la métaphore aisée à établir avec le temps faible entendu comme une disposition affective ou une condition négative habitant le sujet, il s’avère que les vers de Desbiens manifestent aussi une certaine syncope rythmique, si bien que le décalage faible-fort y figure autant dans le contenu que dans la forme. À la syncope existentielle poussant la faiblesse vécue vers une force évocatoire vient ainsi répondre une organisation syntaxique. La phrase, parsemée par les coupures qu’exhibe le vers bref, apparaît alors comme une entreprise de réunion dans la dislocation, une unification au second degré, ce que nous examinerons plus loin.
L’association proposée est donc la suivante : à l’image de la syncope rythmique (temps faible prolongé sur un temps fort), l’expression desbiensienne du ratage existentiel prolonge l’échec dans la réussite du poème, ce qui se miroite dans le décalage constant entre la coupure du vers et la réunion syntaxique opérée par l’enjambement.
PERMANENCE DU REJET
« Phrase par phrase / l’amour se défait » (S, 138-139), est-il dit dans un poème emblématique, où s’affirme un décalage « conjoint » de l’union amoureuse et du langage. S’il fallait s’en tenir à cela, nul doute qu’il vaudrait mieux se taire à tout prix, éviter le déchirement qu’instaure la coupure du signifiant. Or, pour l’être humain, il est rapidement trop tard pour se taire, celui-ci étant d’emblée parlé, exprimé par autrui[10]. Inclus dans une structure basée sur le découpage et qui s’amorce dès qu’on lui appose un nom civil, l’individu est notamment construit pour constater la perte, évaluer l’écart entre le mot et la chose, ce qui fait du discours amoureux un outil tranchant, modulant la division. Quant au discours poétique, il incarnerait la possibilité d’une réparation, possible, un pari périlleux où il s’agirait d’investir ses pertes afin de susciter un gain, quand « [n]os lèvres comme des lièvres / s’élèvent au-dessus de / la misère des mots[11] ».
Pour l’écrivain en particulier, ce pari s’exerce dans la phrase. C’est une de ses spécialités que d’effectuer une telle relance, de reprendre l’être comme sien, de le rattacher à travers ce qui précisément s’en détourne — le signe abstrait —, alors que phrase et événement n’apparaissent plus destinés à coïncider. Comme l’écrit Pierre Alferi, « [p]roduire une phrase et produire son origine se confondent alors dans le fait de dire. Ce geste unique est une instauration. Les phrases de la littérature ne sont pas descriptives, elles sont instauratrices » (CH, 13), si bien qu’un pli se conçoit entre langage et monde.
Chercher une phrase est non seulement le titre d’une plaquette d’Alferi, c’est aussi une poétique, une définition condensée de la littérature, et ces trois mots décrivent assez largement la poésie de Patrice Desbiens, dans laquelle la phrase se révèle comme performance, quête et réparation. Un des tropes incontournables de cette oeuvre est l’enjambement, procédé qui, exploitant un rapport discordant entre le vers et la phrase, met à l’avant-plan cette recherche interne de la proposition, un mouvement de la parole en train de se trouver.
Que ce soit par le rejet ou le contre-rejet, selon que la phrase amorcée dans un vers déborde dans le suivant, ou qu’une phrase s’amorce au milieu d’un vers pour se poursuivre plus loin, l’enjambement exploite un effet de surprise auprès d’un lecteur anticipant la concordance ou le décalage entre l’avancée de la phrase et la coupure du vers, une dimension que Desbiens — à l’exemple de nombreux poètes des années 1970-1980[12] — privilégie d’une façon pour le moins ostentatoire.
En effet, nul besoin de fouiller très loin pour relever des enjambements par dizaines dans des poèmes souvent bâtis en entier autour de cette figure :
S, 191Un poète licencié sous
la LCBO lit à
Cornwall le 23 mars
1980,
dimanche des paumés.
Puisque le vers est parfois restreint à un seul vocable, il en résulte un effet de verticalité et souvent, d’accélération, le texte prenant l’allure d’un précipité, d’un croquis sur le vif, comme si la réalité était trop rapide pour la conscience, et que seule une notation galopante pouvait permettre d’en retenir les essences. On remarque d’autre part que le cas du rejet syntaxique domine clairement celui — extrêmement rare — du contre-rejet[14], dans les poèmes de l’auteur, ce qui accentue l’effet de fuite en avant. La variation intervient plutôt dans le fait d’omettre l’enjambement, ce qui devient l’exception plutôt que la norme, stratégie qui a pour effet de déplacer le lieu de l’inattendu, en donnant à la surprise sa pleine mobilité. Une autre extension consiste ensuite à déporter l’enjambement du plan du vers à celui de la strophe, comme dans la finale de ce poème :
Je rêve au poème
qui rêve à moi
Loin d’être un tic littéraire, cette manie de l’enjambement me semble être une facilité volontaire et presque revendiquée, un accord de base à partir duquel le sens peut surgir. Ce sur quoi on ne saurait d’ailleurs trop insister, c’est l’ironie qui accompagne cette pratique. À force d’être reproduite, la figure rhétorique se dote d’un aspect kitsch, ce qui appelle à un retournement. Si les poèmes tendent à présenter une contemporanéité gangrenée par le banal, où l’individu est exposé à devenir une donnée parmi d’autres, la production télégraphique de l’enjambement, dont la monotonie heuristique est digne d’un blues traditionnel, devient un parfait véhicule pour exprimer cette lassitude dont on veut s’extirper :
Résolument moderne
et
terne
il texte
son sexe
dans
Unité par et dans la rupture, l’enjambement permet par ailleurs de montrer une totalité en acte, guettée en permanence par le spectre du discontinu et nécessitant un travail de cascadeur pour demeurer sur une voie stable. Si le retour à la ligne, dans sa récursivité, incarne ce retour à la langue où la littérature se fait originaire[17], la répétition des enjambements tend à réparer le défaut, la rupture rusée que ceux-ci incarnent, selon un geste parent de l’Aufhebung hégélienne et de sa synthèse des contraires[18]. Cette enjambée, que le présent du texte effectue en suturant le jadis, on pourrait la comparer à un coup de crochet, en couture. Si, selon Alferi, « [l]a littérature réduit ses origines aux formes rétrospectives d’une instauration » (CH, 19), l’enjambement peut être entrevu comme une inscription dynamique de cet entrecroisement, surtout dans un type de poème qui tend à s’établir à coups de contrastes. Ainsi, le rejet constant du propos vers la ligne suivante s’accompagne d’une inscription mémorielle trouble, passant par le refus de l’événementiel, le sens étant à peine davantage affirmé qu’il est remis à plus tard, poussé vers l’avant.
Encore une fois, il ne faudrait pas sous-estimer l’ironie d’une telle démarche, où la dépréciation apparente du sérieux n’est que la face visible d’une récupération de la valeur. « Déchu de rien[19] », Desbiens mérite d’être lu comme un artiste du retournement, maniant la double négation comme on coud en surjet, c’est-à-dire en faisant se chevaucher deux surfaces. Routinier, sériel, il aligne les vers comme un patient miniaturiste, décrivant très fréquemment un temps moche, alors même que le livre déploie un présent enrichi, vitaminé par le recul qu’offre l’acte d’écriture.
Si on revient au recueil Décalage, il est à remarquer que le poème éponyme qui l’amorce exprime justement cette suture, l’oblitération d’une distance — géographique, métaphysique — à la fois désignée et rétrécie par l’écriture :
D, 10Des petites étoiles de poil
s’élèvent
s’envolent et
s’éparpillent
de Limoilou
à Lowell à
Longlac.
Il n’y a pas
de décalage.
Le sens du titre est également lié au fait que ce recueil collige des textes publiés en revue, dont plusieurs portent un regard rétrospectif sur des événements passés, comme la Rencontre internationale Jack-Kerouac de 1987 ou des épisodes de jeunesse à Timmins. Présupposant un décalage, l’écriture n’en est pas moins — grâce à sa ressource fictionnelle et élocutoire — une négation de celui-ci. Pour parler comme Alferi, il s’agit d’une « rétrospection instauratrice[20] », ce qui, semble-t-il, ne saurait advenir qu’en passant par un vacuum et par l’habitation d’un trou. Car :
D, 49[i]l n’y a pas
de décalage
entre
Timmins et
Trouville
tandis que, tout comme dans les dessins d’avions qu’effectuait autrefois le père, l’unité de perspective vient racheter l’écart:
D, 54Il n’y avait pas de décalage car le pilote
de tous ces avions était
Mickey Mouse
ENTRE BOUSTROPHÉDON ET OUROBOROS : LE PHRASÉ
L’unité du décalage, c’est le travail même de la phrase, dont les membres distincts (sujet, verbe, complément) sont entrecroisés pour viser l’être, l’adéquation présupposée par la copule. Une opération que la littérature mène jusqu’à ses limites, grâce à l’indétermination privilégiée qui caractérise son mécanisme. Si établir une syntaxe, c’est donner un ordre (le grec suntaksis signifie « ordre », le latin copula, « union »), il faut être soit magicien soit poète pour croire que cet ordonnancement se confond avec la vie même, l’écartèlement des mots n’offrant au mieux qu’une asymptote plus ou moins rigoureuse pour combler la perte d’objet qui est notre véritable idiome maternel.
Il s’ensuit que la tâche du poète est inachevable et qu’elle appelle la répétition, comme dans cette pratique assidue de la miniature exercée par Desbiens, dont les phrases tout en sinuosités rappellent le mouvement archaïque du boustrophédon, fantasme d’une continuité parfaite de gauche à droite et de droite à gauche des lignes, alors même que le sérieux d’une telle entreprise de réconciliation entre le verbe et la terre est on ne peut plus raillé, quand :
D, 10[l]e poète se pogne le poème
et le poème pogne
la chienne et
la chienne explose
comme un
feu d’artifice
à une
fête nationale
On sent bien qu’il voudrait, à travers cette sinuosité, parvenir à se mordre la queue tel l’Ouroboros, sillonner quelque chose comme le réel dans de continuelles enjambées, des chevauchements connexes, mais il a trop appris à se méfier de ses rêves pour leur accorder tout le terrain. Quand le prosaïque a réclamé ses droits, reste le travail, le métier, l’exercice singulier de la phrase littéraire et de sa syntaxe seconde, surajoutée. Pour Alferi,
[l]a construction grammaticale de la phrase est évidemment rythmique — elle segmente en hiérarchisant. Mais il existe aussi des relations précises d’un terme à un autre par-delà les limites des membres de la phrase et sans égard pour leur organisation grammaticale : écho, nuance, opposition, trope, relation de tel terme à tel autre dont l’absence se fait sentir ou à sa propre absence qui se fait sentir ailleurs, etc.
CH, 24
En d’autres termes, il y a par essence un décalage dans la phrase, une fracture où se joue une grande partie de la littérature et où s’ouvrent par ailleurs des espaces de liaison. Par-delà la syntaxe du vers redoublée par l’enjambement, c’est tout un réseau de contacts qui frétille, à la rencontre du contrôle de l’artiste et des milieux où il baigne plus ou moins à son insu, tout cela tissant la matière de son humanité. « Souvent indépendantes de la construction, ces relations de sens forment néanmoins des structures rythmiques — elles font osciller le fil de la phrase, définissent l’ampleur de ses vibrations. Elles sont donc syntaxiques sans être de nature grammaticale. » (CH, 24-25)
Lui-même percussionniste à un moment de sa vie, Desbiens semble extrêmement attentif à la profondeur de champ des effets rythmiques, lesquels ne se limitent pas à aligner des sons, mais se prolongent dans les gammes de contrastes, d’interruptions, d’échos et de reprises qui peuvent habiter le poème à l’apparence la plus simple. Spécialiste en disparition, l’auteur de L’homme invisible/The Invisible Man excelle à orchestrer les absences, à faire vibrer ensemble les précarités, comme si, malgré la finitude qu’on croit connaître, tout n’était pas joué. Dans le décalage et par lui, un relent de sacré s’exprime comme le jus d’un citron, zeste dérisoire, antipoème et poème tout de même :
D, 40On n’est pas des poètes.
On n’est pas des poèmes.
On n’a aucune idée du poème.
On attend
la messe de minuit
à midi
sous la pluie.
DÉSÂMÉ (MUCHO)
Quelques années avant Décalage a paru Désâmé[21], avec un titre privatif qui chapeaute bien l’entreprise « épuisée » du poète, son âme en creux distillée à la manière d’un moine agnostique, se contentant de mettre le destin à l’épreuve en lui renvoyant son miroir tordu :
Camouflés par la dérision, les éléments d’une théologie négative sont tout de même perceptibles dans ce poème : abandon des sens (fermer les yeux), humilité et renoncement (être nu et sans âme), retournement du temporel vers son contraire (la stepette), nous assistons à un atelier de mystique en mode mineur, dans une posture que n’auraient certes pas reniée Allen Ginsberg ou Frank O’Hara[23]. Le terme « stepette », qu’on peut définir comme un petit mouvement rythmé, peut ainsi être attribué autant à un geste de l’esprit qu’au langage qui le manifeste, l’apparition du mot coïncidant avec l’amorce d’un enjambement entre les troisième et quatrième vers. Décalés, partis en couille, poète et poème se refont une âme dans un pas de côté, une réflexivité asymétrique et une prière hirsute dont les « mille-pattes », par leur incarnation humble du multiple, représentent bien le profil et la démarche, ceux d’un être au destin de mini-dieu :
La poésie et la prière
me poussent et me perpétuent
comme des mille-pattes
[…]
jusqu’au toit où
dieu
le tireur d’élite
me pointe du doigt
et
je saute[24].
Si la syncope rythmique, en musique[25], consiste à déporter un temps faible sur un temps fort — procédé qui, tout comme le contretemps, implique un chevauchement au sein d’une mesure ou encore entre deux mesures —, j’oserais attribuer cette expression à un aspect récurrent de la poésie de Desbiens. Non seulement l’enjambement déporte le sens d’un vers à l’autre dans la « mesure » que constitue la strophe, mais chez lui, cela se superpose à un renversement du douloureux ou du dérisoire. Un temps faible du vécu, par son inclusion dans une rythmique où le sens tend à fuir vers l’avant pour culminer dans un effet de surprise narrative, tend alors à se prolonger dans le temps fort du poème, à se fondre dans son énergie propre. Bien entendu, la notion de temps se trouve ici fortement subjectivisée, ne désignant plus seulement une période calculable mais un moment teinté par l’affectivité et les accidents du réel. Dans des passages comme le suivant, on observe aisément la manière dont la transition entre les vers et la tonalité ambiguë s’appuient l’une l’autre en créant un décalage dialectique essentiel à apprécier pour bien saisir le fonctionnement de cette poésie :
Je me plante des crayons
dans les yeux et on
trouve ça drôle.
La terre porte une couronne
de fil barbelé et
le poète parle dans le vide
et si je bois
comme un trou
c’est parce que
je suis un trou
un trou de mémoire
où tout entre et
rien ne sort[26].
Jouant avec l’attente du lecteur et modulant le sentiment de défaite — en « se grattant le bobo », comme dit l’expression populaire —, Desbiens s’appuie sur du négatif pour susciter son envers, le haut et le bas devenant indissociables grâce à l’accumulation forcenée d’un même mouvement du discours.
Ancrée dans une pratique du vers et de la phrase, la syncope, ici, est aussi existentielle que langagière et musicale, constituant un mouvement clé de l’oeuvre. Outre la cohérence rythmique qu’il procure, le déportement syntaxique tend d’autre part à conférer une note méliorative au propos quand celui-ci se fait davantage pessimiste, comme dans cette strophe où — alors qu’on perd de l’argent et que la bière perd sa fraîcheur — une certaine euphorie s’installe en filigrane, entre les lignes :
S, 86l’argent s’envole
de mes poches.
les piastres sortent
une par une
faisant un bruit d’oiseaux
et elles sont toutes
aspirées par et
brûlées par
un soleil chaud ;
bière chaude d’un après-midi
chancelant.
De manière complémentaire — il y aurait d’ailleurs matière à un autre article pour bien développer la question —, on pourrait effectuer des rapprochements avec le blues, un genre musical dont les tensions caractéristiques impliquent un décalage formel. Travaillant sur une relative dissonance, les « notes bleues » impliquent d’une part une ambiguïté entre les modes mineur et majeur, ce qui les rend porteuses d’incertitude modale. D’autre part, ces notes se bâtissent à partir d’un glissement, quand on abaisse d’environ un demi-ton une note standard afin d’évoquer un sentiment de nostalgie ou de tristesse[27]. Si cette dernière caractéristique est plus malaisée à transposer en termes langagiers, je retiens toutefois l’effet d’indécision. Dans la poésie de Desbiens, où l’entrecroisement problématique est en quelque sorte la règle, on retrouve une ambiguïté omniprésente entre le comique et le triste, tout comme entre les « modes » mineur et majeur[28] de l’écriture, ce qui, comme on l’a vu, devient indissociable de la surprise narrative aussi bien que syntaxique[29]. Le poème, remède et poison — pharmakon ou vaccin —, travaille ici presque malgré lui à soigner, même si c’est en rouspétant toujours un peu :
S, 78un blues tout croche,
60 cennes dans mes
poches
S, 68j’aime mieux continuer
d’écrire, sauvage,
sécure et soyeux dans
le lit chaud de mes mots.
en cas d’urgence
mon numéro de téléphone est
inscrit sur ma
langue.
Il ne faut toutefois pas oublier que, comme le suggère Alferi, la musicalité de la phrase ne s’exerce que partiellement sur le plan de la sonorité et de l’audible[30], puisqu’il en va de sa motricité générale, incluant les suspens et les décalages syntaxico-sémantiques qui trouvent lieu en elle. Agent du décalage et de son renversement programmé — à travers l’intervention du lecteur —, inspiré par la musique en tant qu’altérité de sa propre pratique, le contre-poète qu’est Patrice Desbiens nous permet d’observer la genèse et les strates de cette phrase musicale propre au texte littéraire. Déportant tel un judoka le poids de l’adversité, il met en branle une syncope langagière où, dans la dynamique heurtée des vers, s’exprime un modus operandi tranquillement acharné, celui d’une phrase oblique dont les enjambements sont les dents, et avec laquelle il scie ironiquement son espace à même l’éventualité du non-sens.
Parties annexes
Note biographique
THIERRY BISSONNETTE est professeur agrégé à l’Université Laurentienne (Sudbury), où il enseigne la littérature et la création littéraire. Ses travaux ont essentiellement porté sur la poésie contemporaine, et plus récemment, sur l’imaginaire minier et les représentations de l’invisible. Sous l’altéronyme Thierry Dimanche, il est l’auteur de nombreux livres, dont les plus récents sont Le milieu de partout (Prix-Champlain 2015) et Problème trente.
Notes
-
[1]
Pierre Alferi, Chercher une phrase, Paris, Christian Bourgois, coll. « Titres », 2007 [1991], p. 73. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle CH suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[2]
Patrice Desbiens, L’homme invisible/The Invisible Man [1981] suivi de Les cascadeurs de l’amour [1987], préface de Johanne Melançon, Sudbury, Prise de parole, coll. « BCF. Bibliothèque canadienne-française », 2008 [1997], 204 p.
-
[3]
Patrice Desbiens, [dekalaʒ]/Décalage, Sudbury, Prise de parole, 2008, [65] p. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle D suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte. Le recueil imprimé étant privé de pagination, j’emprunte ici celle de l’édition électronique.
-
[4]
Elizabeth Lasserre, « Patrice Desbiens : “Je suis le franco-ontarien” », Nuit blanche, no 62, hiver 1995-1996, p. 67.
-
[5]
François Paré, « Les traîneries de la mémoire », Liaison, no 143, printemps 2009, p. 62.
-
[6]
Patrice Desbiens, Sudbury (poèmes 1979-1985), 3e édition, Sudbury, Prise de parole, coll. « BCF. Bibliothèque canadienne-française », 2013 [2000], p. 133. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle S suivi du folio, et placées entre parenthèses dans le texte.
-
[7]
Dénué de références externes, cet ouvrage elliptique — dont la manière n’est pas sans rappeler le Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein — déploie une sorte de miroir performatif, en insistant sur une conception de la phrase comme recherche autodifférenciatrice. Décalage qui se répète et module ses occurrences passées, l’énonciation littéraire est alors pensée comme fabrique du langage et comme excroissance génératrice.
-
[8]
Charles Bukowski, Post Office, Santa Barbara, Black Sparrow Press, 1980 [1971], p. 9. Je traduis : « Ça a commencé par erreur. »
-
[9]
Gilles Marcotte, Le roman à l’imparfait. Essais sur le roman québécois d’aujourd’hui, Montréal, La Presse, coll. « Échanges », 1976, p. 13.
-
[10]
Ici, on pourrait à profit invoquer le concept heideggérien d’être-jeté, pour souligner la situation interprétative où nous dépose le langage.
-
[11]
Patrice Desbiens, Hennissements, Sudbury, Prise de parole, 2002, p. 56.
-
[12]
La poésie de Michel Beaulieu, par exemple, fait de l’enjambement un de ses procédés centraux, en écho notamment à la poésie beat. Vecteur d’irrégularité, ouvrant à de multiples interprétations, l’enjambement s’avère un outil privilégié pour une expression de l’américanité.
-
[13]
C’est moi qui souligne les passages impliquant des enjambements.
-
[14]
Rare occurrence de contre-rejet, où une proposition subordonnée s’amorce au cours d’un vers : « une mouche qui se jette / dans un verre de vin / blanc parce / qu’elle n’en peut plus / de le sentir sans / jamais le voir, sans / jamais le boire » (S, 70 ; je souligne). Encore ne s’agit-il pas d’un contre-rejet au sens fort, où c’est une proposition principale qui commencerait.
-
[15]
Patrice Desbiens, Sous un ciel couleur cayenne, Sudbury, Prise de parole, coll. « poésie », 2017, p. 26. Je souligne.
-
[16]
Ibid., p. 11.
-
[17]
Voir à ce sujet Daniel Bougnoux, Vices et vertus des cercles. L’autoréférence en poétique et pragmatique, Paris, La Découverte, coll. « Armillaire », 1989, 266 p.
-
[18]
« Aufheben », verbe qu’on peut traduire approximativement par « nier, tout en affirmant », ou « surmonter tout en exposant ». L’Aufhebung, ou sursomption, désigne ainsi une synthèse des contraires dans un énoncé — sorte d’enjambement logique.
-
[19]
Déchu de rien : titre de la plaquette autoéditée de 2006. Déçu, mais dépositaire d’une déception masquée et sans objet, déchu tout court, le sujet (absent) de cette formule est du même coup jovial et doublement négatif.
-
[20]
« Dans l’émission d’une voix, l’instauration est une rétrospection. La tresse qui constitue la voix est sans modèle. La voix ne précède donc le texte sous aucune forme, elle ne se donne nulle part avant qu’un ensemble ne soit formé. » (CH, 71)
-
[21]
Patrice Desbiens, Désâmé, Sudbury, Prise de parole, 2005, 60 p.
-
[22]
Ibid., p. 60.
-
[23]
On pourrait également penser ici à un autre obsessif du décalage syntaxique, soit l’écrivain Michel Beaulieu, chez qui la répétition de l’enjambement fait écho à une manière d’appréhender l’espace-temps.
-
[24]
Patrice Desbiens, Désâmé, p. 20.
-
[25]
Je remercie le compositeur et professeur de musique Robert Lemay pour ses précieuses remarques au sujet des quelques notions musicales évoquées dans cet article.
-
[26]
Patrice Desbiens, Poèmes anglais, suivi de Le pays de personne, suivi de La fissure de la fiction, Prise de parole, coll. « BCF. Bibliothèque canadienne-française », 2010, p. 42.
-
[27]
« Si le blues a prospéré, c’est certainement dû à cette incertitude modale, ni tout à fait juste, ni tout à fait fausse. La plus “honteusement” impropre à la consommation de nos oreilles est bel et bien la tierce, puisque celle-ci est notre premier indice de notre mode mineur. Ensuite, la mélodie du blues, qui privilégie la tierce et la septième bémolisées, se plaque sur des accords majeurs (sauf blues mineur). De là naissent une coloration particulière, une dissonance apte à faire naître la sonorité du blues […]. De cette ambiguïté découlent alors des chansons étonnantes, comme ce Saint James Infirmary, morceau qui est en mineur, mais qu’un bluesman peut accompagner avec des accords majeurs. » Patrick Martial, « Le blues, son histoire s’écrit en bleu », en ligne : https://www.pianoweb.fr/blues-et-histoire-de-blue-notes.php (page consultée le 25 février 2019).
-
[28]
Les termes mode mineur et mode majeur sont alors entendus au sens de prestige plus ou moins grand d’un style ou d’un genre, soit bas, soit élevé. Bien que cette connotation existe aussi en musique, elle est loin d’être absolue.
-
[29]
« C’est là le secret de l’ambiguïté du blues : est-ce du mineur ? Est-ce du majeur ? On ne sait plus trop et c’est tant mieux ! » Thierry Carpentier, Les accords de guitare, Bruxelles, Ixelles Éditions, 2011, section 11, [s. p.].
-
[30]
« Toute phrase est musicale. L’imitation de la musique sonore reste pourtant secondaire » (CH, 24) ; « Tout ce qui est balancement, vitesse, syncope relève de la syntaxe. Ainsi entendue, la syntaxe est bien plus que le squelette de la phrase, c’est son système circulatoire : ce qu’il y a de rythmique dans le sens. » (CH, 25)