Résumés
Résumé
En matière de protection des convictions religieuses, la Cour suprême du Canada a adopté, dans l’affaire Syndicat Northcrest c. Amselem (2004), une conception éminemment subjective et individualiste de la religion. Le juge a l’obligation de s’abstenir de toute appréciation sur la validité des croyances religieuses et en particulier sur les valeurs qu’elles véhiculent. La jurisprudence libérale en la matière était de nature à nourrir des inquiétudes quant à l’intensité de la protection accordée par les chartes québécoise et canadienne aux autres droits fondamentaux, notamment l’égalité et la non-discrimination. Près de quinze ans après, ces craintes se sont largement atténuées. Dans la présente contribution, l’auteur se propose de retracer succinctement les enseignements majeurs dégagés de cette décision et de les mettre en perspective avec la jurisprudence subséquente et le droit comparé en la matière.
Abstract
In the Amselem case (2004), the Supreme Court of Canada clearly adopts a broad and subjective conception of religion. The judge must refrain from assessing the validity of religious beliefs, and in particular the values they convey. The liberal jurisprudence on the protection of religious beliefs was likely to raise concerns about the intensity of the protection granted by Quebec and Canadian charters to other fundamental rights, notably equality and non-discrimination. Nearly fifteen years later, these apprehensions are largely attenuated. In this contribution, the author attempts to revisit the lessons learned from the Amselem decision and put them into perspective with subsequent case law and comparative law in this area.
Parties annexes
Bibliographie
- Al-Dabbagh H. (2016), « Terre et ciel dans le droit québécois du mariage. Commentaire sur le jugement Droit de la famille — 16244 », Revue du Barreau, 75, p. 65-93.
- Al-Dabbagh H. (2017), « La réception de la kafala dans l’ordre juridique québécois. Vers un renversement du paradigme conflictuel ? », Revue générale de droit, 47/1, p. 165-226.
- Al-Dabbagh H. (2019), « Mariage et effets du mariage » dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Droit international privé, fasc. 14, Montréal, LexisNexis Canada, par. 8 et 9.
- Atlan, G. (2002), Les juifs et le divorce. Droit, histoire et sociologie du divorce religieux, Berne, Peter Lang, p. 68.
- Aubert, J.-L. (200611), Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Paris, Sirey, p. 10.
- Bergel, J.-L. (20125), Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, p. 28.
- Bosset, P. et EID, P. (2007), « Droit et religion. De l’accommodement raisonnable à un dialogue internormatif ? », Revue juridique Thémis, 41, p. 512-535.
- Boyer, A. (1993), Le droit des religions en France, Paris, PUF.
- Boyer, A. (2005), « Comment l’État laïque connait-il les religions ? », Archives de sciences sociales des religions, 50, p. 37-49.
- Brunelle, C. (2008), « Les limites aux droits et libertés », dans J. Tremblay, dir., Droit public et administratif, vol. 7, Cowansville, Yvon Blais, 2008, p. 75 et suiv.
- Carbonnier, J. (1969), note sous CA de Nîmes, 10 juin 1967, D. 1969, p. 366.
- Cornu, G. (200713), Droit Civil — Introduction au droit, Paris, Montchrestien, p. 23.
- Dahan, D. (2016), Agounot « les femmes entravées ». Problèmes et solutions du droit matrimonial hébraïque, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, p. 97-98.
- Delsol X., A. Garay et E. Tawil (2005), Droit des cultes. Personnes, activités, biens et structures, Paris, Juris Associations.
- Deumier, P. (2011), Introduction générale au droit, Paris, L.G.D.J., p. 47.
- Duvert, C. (1996), « Droit et religion(s). Genèse et devenir d’un rapport méconnu », Revue de la recherche juridique — droit prospectif, 3, p. 737-740.
- Fenouillet, D. (2006), « Règlement de copropriété et liberté religieuse, ou la difficile cohabitation des consciences », Les Petites affiches, 133, p. 9.
- Forey, E. (2007), État et institutions religieuses. Contribution à l’étude des relations entre ordres juridiques, Presses universitaires de Strasbourg.
- Gaudemet, J. (2009), « Liberté religieuse et laïcité en droit français » dans Mélanges Petros J. Pararas, Ant. N. Sakkoulas et Bruylant, Athènes, p. 237-348.
- Gaudreault-Desbiens, J.-F., dir., (2009), Le droit, la religion et le « raisonnable ». Le fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique, Montréal, Les Éditions Thémis.
- Jobin, P.-G. (2007), « L’application de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne aux contrats », R.T.D.civ., p. 33-45.
- Koussens, D., M.-P. Robert, C. Gélinas, et S. Bernatchez (2016), dir., La religion hors la loi. L’État libéral à l’épreuve des religions minoritaires, Bruxelles, Bruylant, p. 133.
- Lampron, L.-P. (2010), « Pour que la tempête ne s’étende jamais hors du verre d’eau. Réflexions sur la protection des convictions religieuses au Canada », McGill Law Journal, 55, p. 743-766.
- Lampron, L.-P. (2012), « Hiérarchie des droits fondamentaux et protection des convictions religieuses en droit constitutionnel québécois et canadien », Revue québécoise de droit constitutionnel, 4, p. 43-60.
- Landheer-Cieslak, C. (2007), La religion devant les juges français et québécois de droit civil, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 255.
- Landheer-Cieslak, C. (2012), « Appliquer « en harmonie » le droit civil québécois et la liberté fondamentale de religion. Quelques réflexions juridiques et éthiques pour une relecture de Syndicat Northcrest c. Amselem », Revue québécoise de droit constitutionnel, 4, p. 87-127.
- Langevin, L. etal. (2008) « L’affaire Bruker c. Marcovitz Variations sur un thème », Les Cahiers de droit, 49, p. 655-708.
- Messner F. (2011), dir., Dictionnaire du droit des Religions, Paris, CNRS Éditions.
- Messner F., P.-H. Prélot et J.-M. Woehrling (2013), dirs., Traité de droit français des religions, 2e éd., Paris, LexisNexis.
- Moore, B. (2009a), « Convention de rupture et religion. À la frontière du droit et de la foi », Revue de la recherche juridique – droit prospectif, 1, 2009, p. 43-55.
- Moore, B. (2009b), « Sur la contractualisation de la croyance », dans J.-F. Gaudreault-DesBiens, dir., Le droit, la religion et le « raisonnable ». Le fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique, Montréal, Éditions Thémis, p. 493-530.
- Mestre, J. (2003), « Les pratiques dictées par les convictions religieuses », R.T.D.civ., p. 290.
- Reid, H. (20155), Dictionnaire de droit québécois et canadien. Avec table des abréviations et lexique anglais-français, Montréal, Wilson & Lafleur, p. 543.
- Robert, M.-P. et S. Bernatchez (2010), « La criminalisation de la polygamie soumise à l’épreuve de la Charte », Revue générale de droit, 40, p. 541-556.
- Saris, A. (2005), La compénétration des ordres normatifs. Étude des rapports entre les ordres normatifs religieux et étatiques en France et au Québec, Thèse, Faculté de droit, Université McGill.
- Saris, A. (2010), « L’État et la religion sur la scène internationale », dans S. Lefebvre et R. R. Crépeau, dir., Les religions sur la scène mondiale, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 54.
- Tawil, E. (2016), Justice et religion. La laïcité à l’épreuve des faits, Paris, PUF.
- Tremblay, L. (2009), « Religion, tolérance et laïcité. Le tournant multiculturel de la Cour suprême » dans J.-F. Gaudreault-Desbiens (dir.), Le droit, la religion et le « raisonnable ». Le fait religieux entre monisme étatique et pluralisme juridique, Montréal, Éditions Thémis, p. 213-218.
- Tremblay, L. (2010), « The Bouchard-Taylor Report on Cultural and Religious Accommodation. Multiculturalism by any other Name ? », Review of Constitutional Studies, 15/1.
- Tribe, L. H. (1978), American Constitutional Law, Mineola, The Foundation Press Inc., p. 1181.
- Woehrling, J. (2011), « Quand la Cour suprême s’applique à restreindre la portée de la liberté de religion. L’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony (2009) », Revue Juridique Thémis , 45, p . 7-49.

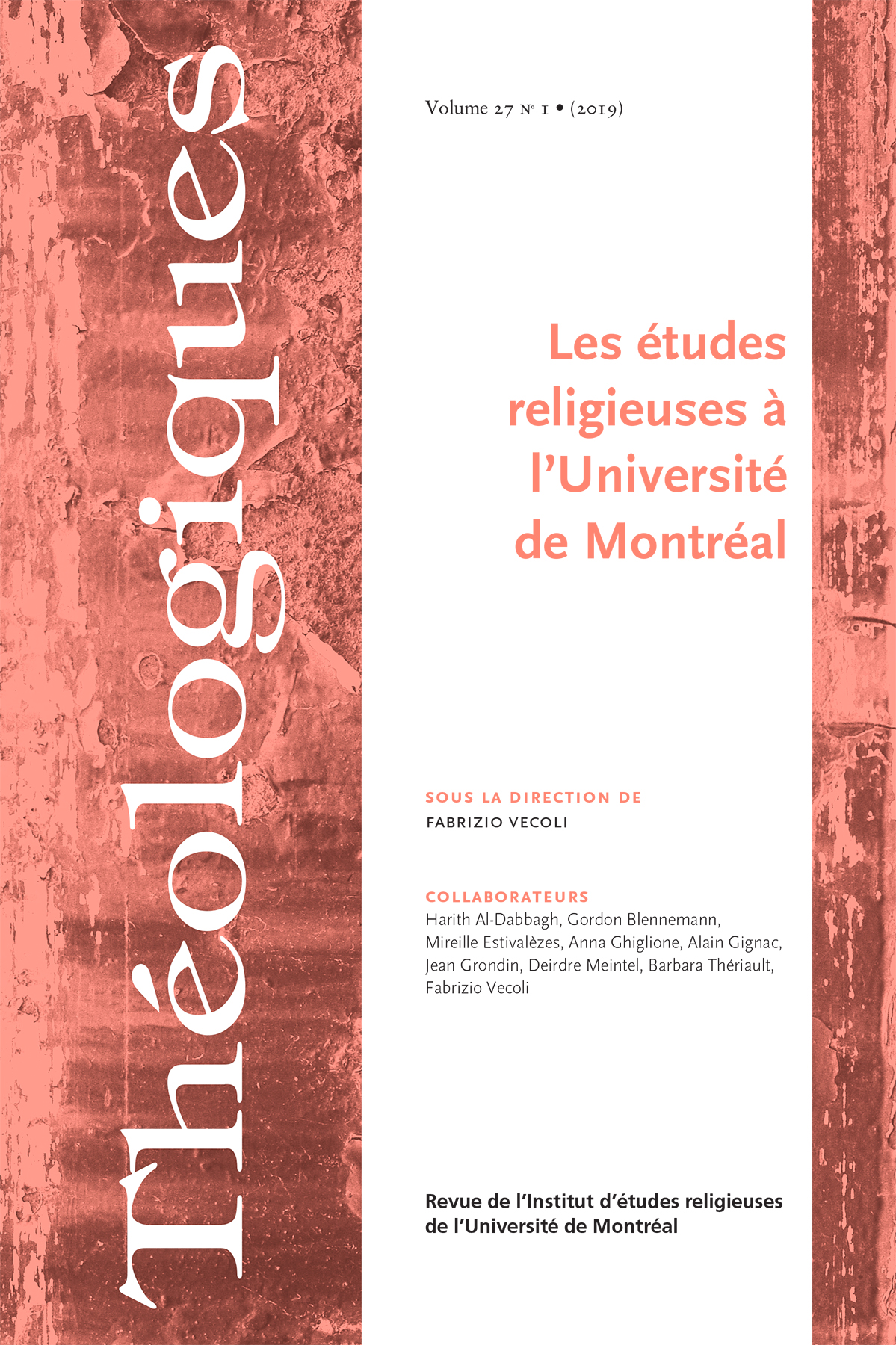
 10.7202/1040499ar
10.7202/1040499ar