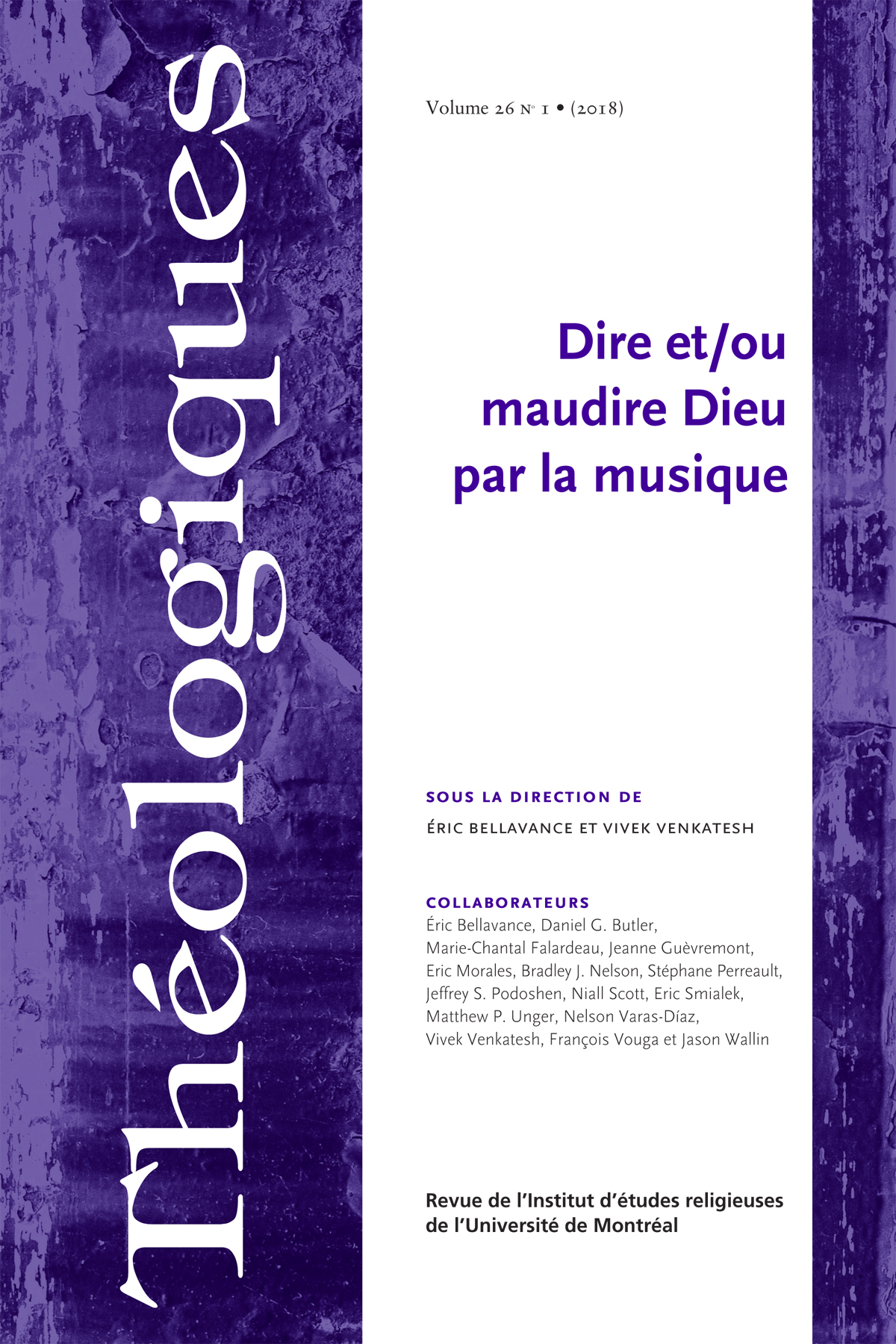Résumés
Résumé
La multiplication des « Requiems » dans la modernité occidentale constitue un phénomène paradoxal dans notre monde apparemment dominé par l’athéisme et l’agnosticisme. L’auteur a choisi trois oeuvres — Un Requiem allemand de Brahms (1861-1869), le Requiem de Frank Martin (1971-1973) et les Requiem Canticles d’Igor Stravinsky (1965-1966). Il se propose de situer chacune dans son contexte intellectuel puis d’en décrire l’architecture afin d’en donner une interprétation théologique. Pour fonder celle-ci, l’argumentation analyse chacun des « Requiems » et met en évidence la réflexion théologique, explicitement présente dans les écrits de Stravinsky et dans la correspondance de Frank Martin, qui a accompagné leur travail de composition. La pensée propre à chaque musicien et la conscience d’une responsabilité d’ordre spirituel et intellectuel déterminent les solutions esthétiques adoptées. Elles permettent de comprendre la transformation que chacun opère du genre musical du requiem pour transmettre une espérance universelle à une humanité sécularisée.
Abstract
The multiplication of “Requiems” in Western modernity appears as a paradoxical phenomenon in a world that is apparently ruled by atheism and agnosticism. The author has chosen three works – A German Requiem by Brahms (1861-1869), the Requiem by Franck Martin (1971-1973), and the Requiem Canticles by Igor Stravinsky (1965-1966). He replaces each of them in their intellectual context and describes their architecture in order to bring out a theological interpretation. Particularly, he analyses each Requiem and highlights the theological reflections that are explicitly part of Stravinsky’s writings and of Franck Martin’s letters, reflections that supported their compositions. The esthetical solutions they adopted were determined by their own way of thinking, as well as a sense of responsibility of spiritual and intellectual order. These allow us to understand how each of the composers have transformed the requiem musical genre to share a universal hope to a secularized humanity.
Corps de l’article
1. La question théologique
Peut-être pourrait-on s’interroger sur le faisceau de paradoxes qu’implique le curieux phénomène de la multiplication des « Requiems » dans la modernité occidentale. On comprend que la mort se présente comme une question universelle, comme la question existentielle majeure. Malgré quelques tentatives de suggérer le contraire, on comprend aussi que la réponse, si tant est que l’on puisse en donner une, ne viendra pas des progrès de la technique. D’ailleurs, le succès des arts médicaux à repousser les limites se révèle ambivalent : devenir plus vieux, oui, mais dans quel état et pour quelle vie ? On comprend donc le recours aux ressources classiques de l’histoire de l’art, de la musique et de la littérature en particulier, pour se confronter aux énigmes de la finitude, du sens de la vie et de la destination de sa fin.
Mais avec quels textes de référence entrer en dialogue pour donner sens et éclairer le présent de manière crédible ? Où trouver appui pour une quête critique de signification permettant de fonder les convictions ? Dans une culture et dans des mondes intellectuels dominés par l’agnosticisme et par la sécularisation, il est étonnant que, loin de perdre en attrait, la liturgie catholique de requiem, et en particulier son élément traditionnellement central, le poème médiéval du Dies Irae, résiste fort bien au scepticisme religieux et aux effondrements de la chrétienté. L’étonnement vient de ce que les images du Dieu de colère dont on implore miséricorde, qui en forment la charpente, et la rhétorique de la peur du jugement et de la condamnation qui en découle, heurtent de plein fouet l’esprit éclairé des lumières et de la modernité. Or, on doit constater que ce texte-là précisément apparaît comme un carrefour central de la réflexion de l’Occident moderne devant la mort, indépendamment de toute appartenance confessionnelle et de toutes croyances. Massivement sorti de son cadre ecclésial depuis Gossec, Berlioz, Verdi ou Dvorak, ouvertement laïcisé — qu’on pense par exemple au Requiem de Ligeti —, il permet de formuler individuellement et publiquement la double vocation existentielle de l’accomplissement de la vie et du deuil, c’est-à-dire, de part et d’autre, de la prise de congé imposée par la séparation de la mort, et de la présenter devant la question ultime d’une Transcendance qui juge, pardonne et libère.
Dies Irae : le texte de la séquence
Dies Irae, strophes 1-6 : le jour de colère[1]

Dies Irae, strophes 7-17 : la prière de l’individu devant son Juge

Dies Irae, dernière strophe : la prière pour les défunts
Jour de larme,
jour où les coupables se réveilleront
pour entendre leur jugement,
alors, ô Dieu, pardonne-leur et leur donne le repos.
Jésus, accorde-leur le repos.
2. Quel Dieu invoquer devant la mort ?
On peut évidemment s’interroger sur les raisons de l’attirance que ce poème exerce jusqu’à aujourd’hui dans l’histoire de la musique. Se presse la question théologique, qui n’a échappé ni à Brahms, ni à Frank Martin, ni à Stravinsky, qui lui ont chacun apporté, dans leur requiem, la réflexion d’une réponse originale : à quel Dieu et à quelle Transcendance entend-on se remettre devant la mort ?
Visiblement, l’Être suprême de Jean-Jacques Rousseau, dont l’existence fut ensuite décrétée le 7 mai 1794 par la Convention, n’y suffit pas. La généralité d’un consensus de la raison, jugé indispensable à la fondation politique d’un contrat social respectueux des droits de l’homme, s’avère sans doute inapte à recueillir les confessions personnelles, face à la mort, d’une recherche de sens et de pardon devant la manifestation ultime de l’imperfection et de la finitude. Inversement, on aurait pu s’attendre à ce que les sept sentences tirées du Livre de la prière commune anglican (1552), qui servirent de base à Morley, Gibbons ou Purcell, offrent à l’imaginaire de l’Occident moderne une alternative existentielle aux scènes apocalyptiques du Dies Irae et du Libera me. Mais précisément, elles s’adressent avec confiance à un Dieu de résurrection et de vie et elles formulent une prière croyante qui, explicitement, engage la conviction et l’espérance de ceux qui les prononcent et les chantent : l’usage de l’ordre pour la sépulture des morts dont elles sont tirées est destiné à un office « qui ne doit point se dire pour ceux qui meurent sans avoir été baptisés, ni pour les excommuniés, ni pour ceux qui se sont détruits de leurs propres mains[2] ». C’est dire aussi qu’elles présupposent l’adhésion de leurs destinataires à une communion de foi et qu’elles ne peuvent satisfaire des artistes soucieux d’adresser leur réflexion à l’auditoire universel.
L’avantage de la débauche d’images mises à disposition par la liturgie de requiem réside au contraire dans sa potentielle universalité. Ayant, comme centre dramatique, le Dies Irae qu’y a probablement introduit Thomas de Celano (vers 1190 – vers 1260), en adaptant un poème plus ancien à son nouveau contexte, elles se proposent à la libre fantaisie des compositeurs. Car elles tendent, pour le scepticisme tant agnostique que croyant, à relever de la fiction. Elles construisent en effet un scénario de désolation, de terreur et de désespoir qui correspondait certes, bien que sans doute partiellement, à une certaine perception de la réalité à l’époque des Croisades, mais elles véhiculent une image de Dieu qui a mal résisté à la pensée critique moderne et contemporaine. Relevant donc d’une fiction symbolique et littéraire, elles se déploient comme une représentation théâtrale dans laquelle il devient d’autant plus facile de réfléchir ses angoisses et ses questions qu’on peut les y projeter librement. Il n’est donc qu’apparemment paradoxal, je pense, qu’elles prennent souvent, depuis le romantisme déjà, des dimensions à proprement parler spectaculaires, alors qu’aussi bien des musiciens concevant leur composition pour l’usage de la liturgie (Fauré, Duruflé, Desenclos) que le concile Vatican II ont fait disparaître le Dies Irae de la messe des défunts.
La responsabilité qu’ont prise Brahms, Stravinsky et Martin, chacun sur la base de ses convictions et d’une réflexion théologique qui leur est propre, a consisté à réinvestir le genre et la forme du requiem de manière à trouver un langage universel crédible qui soit susceptible de dire un Dieu d’espérance devant la mort. Ils ne sont évidemment pas les seuls. Ils présentent cependant l’intérêt de produire trois propositions très différentes, originales et argumentées.
3. Trois tentatives de transmettre l’espérance à l’universalité de l’humanité
De trois manières différentes et dans des contextes culturels divers, Brahms, Stravinsky et Martin prennent l’initiative de recréer le genre musical du requiem pour formuler, chacun à leur manière, une espérance pour l’humanité qui, tout à la fois, s’enracine dans une tradition confessionnelle et entend la reformuler pour un auditoire universel.
Dans une oeuvre de relative jeunesse, Johannes Brahms prend la liberté de composer un « Requiem allemand » ; Brahms entend par-là un requiem luthérien, auquel il donne la forme libre et originale d’une grande cantate de certitude confiante. Il prend congé de la liturgie des morts et, à partir d’une familiarité évidente avec l’Ancien et le Nouveau Testament, constitue un florilège de textes bibliques qui lui permettent de recadrer la parole de l’Église sur la mort et sur la vie. Les Requiem Canticles d’Igor Stravinsky se présentent comme l’aboutissement d’une réflexion de critique théologique de la religion. Celle-ci trouve son point de départ dans l’événement d’une conversion personnelle et esthétique dont il rend compte lui-même. Elle ré-enracine sa poétique musicale dans une confluence de la tradition catholique et de l’orthodoxie russe, et elle la rapproche, sur le fond, de l’austérité de la théologie dialectique réformée de Karl Barth. Quant au Requiem de Frank Martin, il adopte lui aussi une voie paradoxale en suivant fidèlement la liturgie catholique, mais en en modifiant radicalement le propos par la mise en intrigue de la musique. Sur le texte d’une prière pour les morts, il édifie une réflexion existentielle, à la lumière de l’espérance de Pâques, sur la situation de l’individu confronté au compagnonnage et à l’échéance de la mort.
Je me propose de situer les trois oeuvres dans leur contexte intellectuel puis d’en décrire l’architecture et le propos afin d’en proposer une interprétation théologique et de mettre en valeur le travail de théologiens des trois compositeurs.
4. Johannes Brahms (1833-1897), un Requiem allemand (1861-1869)
4.1 Le recadrage théologique du genre par la forme
Comme l’indique déjà le titre programmatique donné à son oratorio, qui quitte toute forme liturgique, Brahms adopte à bien des égards une solution radicale. Il entend certes composer une oeuvre qui remplit la fonction d’un requiem, celle d’une méditation devant la mort et d’une consolation dans le deuil. Il conserve d’ailleurs le terme de requiem. Mais il n’écrit pas à proprement parler un requiem, une prière d’intercession pour les défunts — et pour les vivants quand ils seront morts, comme le faisaient Michael Haydn ou Mozart. Il entreprend tout autre chose. Car il ne s’intéresse pas au sort des trépassés, mais à la vie spirituelle des vivants, ici et maintenant. Il propose à l’auditoire universel de ses auditeurs, pour leur édification dans le temps présent, une prédication de l’espérance évangélique et une confession de la confiance croyante devant la mort.
Rendant compte du changement de perspective, Brahms ajoute l’adjectif « allemand » à la désignation de son oeuvre par le terme conventionnel de requiem. La précision n’est pas d’ordre national, mais à la fois confessionnel, théologique et littéraire. « Allemand » ne signifie en effet rien d’autre, dans son esprit, que « protestant » ou « luthérien ». Brahms invente dans le « Requiem allemand » une alternative non catholique, au sens institutionnel du terme, au genre du requiem.
Pour ce faire, Brahms renonce à la base littéraire traditionnelle de l’ordinaire liturgique de la messe pour les défunts de l’Église romaine. Il prend au contraire la peine de composer, sous la forme d’une mosaïque de versets bibliques isolés, un livret original qui construit avec force son propre scénario dramatique. Il puise sa matière littéraire dans les évangiles (les béatitudes selon l’évangile de Matthieu et les discours d’adieu de l’évangile de Jean), dans les épîtres (première épître de Paul aux Corinthiens, épître de Jacques et première épître de Pierre), dans l’Apocalypse de Jean et dans l’Ancien Testament (Psaumes, le livre du prophète Esaïe et le Siracide[3]). Les éléments cités demeurent reconnaissables. Chacun comprend que Brahms recourt au texte biblique comme référence classique de l’Occident. Les fragments ainsi découpés et rassemblés sont cependant intégrés dans la cohérence d’une nouvelle architecture. Fondé sur la reconnaissance culturelle de leur autorité et sur leur évidence propre, le Requiem allemand construit une argumentation poétique et musicale qui invite à un parcours de réflexion confiante sur le sens de la vie et de la réconciliation avec la finitude de l’existence humaine (voir tableau 1).
Tableau 1
Brahms, Un requiem allemand – architecture
4.2 La genèse d’une architecture
Le Requiem allemand apparaît comme l’un des premiers grands chefs d’oeuvre de Brahms.
Sa conception a occupé le compositeur pendant plusieurs années et sa composition s’est effectuée en plusieurs étapes.
Les premiers projets datent de 1861. Brahms a 28 ans. Les trois premières parties ont été créées à Vienne en 1867 :
-
Bienheureux ceux qui sont dans la peine, car ils seront consolés.
-
Toute chair est comme l’herbe, mais la parole du Seigneur dure éternellement, et joie et allégresse saisiront les rachetés.
-
Apprends-moi, Seigneur, que la vie à une fin et un but. J’espère en toi : les âmes des justes sont dans la main de Dieu.
Une seconde version a été créée à Brême en 1868. Elle comprend les quatre premières et les deux dernières parties actuelles :
-
Comme sont aimables tes demeures, Dieu tout puissant !
-
Nous n’avons pas ici de cité permanente, mais tous nous serons transformés.
-
Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur, qu’ils se reposent !
Quant à la version définitive, jouée pour la première fois à Leipzig en 1869, elle complète l’oeuvre d’une déclaration d’intentions qui ajoute un soprano solo au choeur, à l’orchestre et au baryton solo (parties 3 et 6) et qui établit désormais l’affirmation de confiance de la quatrième partie comme centre architectural et comme clé de voûte de l’ensemble :
Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je veux vous consoler.
4.3 Le Texte








4.4 Dire la confiance et l’espérance devant la mort
La structure théologique qui résulte de la composition littéraire et musicale du Requiem allemand s’impose avec une clarté singulière :
I.
Le cadre littéraire et théologique est posé dans les deux béatitudes proclamées — et chaque fois répétées — en ouverture et en conclusion de l’oratorio (parties 1 et 7). Le langage (« bienheureux ») est celui de l’annonce d’une bonne nouvelle destinée à l’universalité de l’humanité : l’Évangile et le visionnaire de l’Apocalypse, par la voix de l’orchestre et du choeur, témoignent d’un accomplissement ultime qui tout à la fois constitue l’horizon de la vie humaine et lui donne sens : les peines et les larmes ne sont pas vaines, mais elles porteront leur fruit. Le repos ne fait pas l’objet d’une demande, mais d’une certitude : il est promis par une transcendance de l’Esprit. Le thème central de ce requiem n’est donc pas celui du salut éternel, mais de la proclamation du bonheur comme vérité ultime et comme destination véritable de l’existence humaine. Brahms présente et conclut son oeuvre comme la proclamation du bonheur promis à l’humanité.
II.
La Transcendance, évoquée indirectement dans les béatitudes, devient l’interlocuteur direct de la confession centrale, clé de voûte sur l’engagement existentiel de laquelle repose l’ensemble de l’argumentation (partie 4) :
Comme sont aimables tes demeures, Dieu Tout-puissant ! (Ps 84,2)
Mon âme désire ardemment et soupire après les parvis du Seigneur ;
mon corps et mon âme trouvent leur joie dans le Dieu vivant (Ps 84,3).
Au langage de la promesse répond celui de la reconnaissance. Mais qui parle donc ? Qui est le « je » auquel appartiennent le corps et l’âme qui partagent leur joie ? Le choeur et l’orchestre, de nouveau, se font porte-parole du poète et du compositeur qui, en prêtant les voix et les instruments aux vers du Psaume, font retentir sa parole. Face à l’auditoire universel, le « je » rend ainsi compte d’une conviction qui n’engage l’auditeur que dans la stricte mesure où il en fait le témoin d’une joie qu’il invite à partager. La prédication se poursuit dans la béatitude qu’elle enchaîne :
Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison,
ils te louent sans cesse (Ps 84,5)
III.
La couronne qui entoure cette confession centrale (parties 2-3 et 5-6) s’en tient aussi bien à cette théologie évangélique qu’à cette éthique universaliste de la communication. Brahms conserve son rôle d’un prédicateur non religieux d’une bonne nouvelle, tirée des Écritures, d’espérance, de confiance et de joie. Évidemment, il est inutile de chercher dans le Requiem allemand quelque équivalent que ce soit au Dies Irae. Le rapprochement que l’on tente parfois, en désespoir de cause, avec la mise en scène, dialoguée entre le choeur et le baryton, de l’annonce de la transformation finale (partie 6), est un pur contresens. L’essentiel de cet épisode apocalyptique reprend à son compte l’annonce, par l’apôtre, d’un achèvement de la création du monde dans la re-création universelle des vivants et des morts. La longue explication qui, tant dans l’architecture du Requiem allemand que dans la première épître aux Corinthiens, donne corps à l’espérance croyante, est à ma connaissance un des seuls passages des lettres de Paul à avoir été mis en musique[4]. Elle concrétise la double promesse qui précède (partie 5), celle du Jésus des discours d’adieu de l’évangile de Jean, qui annonce par la voix du soprano la fin des temps de tristesse et la joie des retrouvailles, et celle du choeur qui l’interprète comme la perspective d’une consolation.
À ce second versant de la couronne (parties 5 et 6), Brahms confère donc le caractère d’une prédication donnant la parole au Jésus de l’Évangile et à l’apôtre de la réconciliation universelle. Le premier versant présente un caractère plus réflexif : le choeur prend tout d’abord acte, comme constat d’un état de fait, de la finitude humaine, puis il en instruit la question en appelant ses auditeurs (« vous ») à la patience et en y opposant l’éternité d’une Transcendance qui promet la joie. On remarquera l’enchaînement particulièrement imaginatif créé par Brahms, qui donne la seconde citation comme contenu à la première (partie 2, C) :
Mais la parole du Seigneur demeure pour l’éternité (1Pi 1,25) :
les rachetés du Seigneur vont revenir et viendront vers Sion avec joie ;
une joie éternelle sera au-dessus de leur tête,
joie et allégresse les saisiront,
et douleur et soupirs devront disparaître (Es 35,10).
Puis, en alternance, le ténor et le choeur font suivre sous la forme d’une prière une méditation cherchant le sens de la finitude de l’existence dans la découverte du sens de l’histoire personnelle. La Transcendance y joue un double rôle. Celui, dans un premier temps, d’un vis-à-vis du dialogue avec lui-même du sujet individualisé par le ténor et universalisé par le choeur. Puis celui, ensuite, d’une Providence dans la main de laquelle il peut s’en remettre avec joie.
Au paradoxe du succès des requiem dans la modernité sécularisée, Brahms oppose à bien des égards, en somme, un contre-paradoxe : à la rhétorique de la crainte, il oppose une prédication de l’espérance et un appel à la joie. Son Dieu n’est pas celui de la colère et du Jugement, auprès duquel le pécheur vient quémander miséricorde. Il est la Transcendance face à laquelle le sujet entre en débat sur sa propre finitude. Il est le Créateur, celui qu’il présente, selon sa propre conviction, comme la Providence qui destine l’universalité de l’humanité à l’accomplissement de la joie, qui tient les justes dans sa main, et au nom de laquelle, par la voix du soprano, du ténor et du choeur, les promesses du Jésus ressuscité de l’Évangile et des apôtres appellent les vivants à la confiance. Le Requiem allemand n’est pas une prière pour les défunts, mais une joyeuse invitation adressée, sur la foi de l’Écriture, à l’auditoire universel de l’humanité tout entière.
5. Frank Martin (1890-1974), Requiem (1971-1973)
5.1 Le Requiem comme réponse à une vocation : la réconciliation avec la mort
Brahms remplaçait le texte liturgique par un livret de sa propre composition, ajoutant le commentaire d’un adjectif au titre de Requiem. Frank Martin adopte, lui aussi, une solution radicale, en suivant scrupuleusement le texte, certes, mais dans une perspective et selon une lecture qui le reconfigurent. Le rôle prééminent que jouent individuellement le ténor solo, le soprano puis les quatre solistes dès l’entrée et dans l’ensemble de l’introitus (« Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que la lumière éternelle brille sur eux ! »), devant un choeur réduit à une toile de fond, n’est pas seulement inhabituel. Il annonce de façon programmatique la singularité de l’approche. La cohérence d’une logique très précise domine l’architecture de l’oeuvre, qui fait ressortir les dimensions personnelles et intimes du parcours, confère une intensité particulière à l’attente ardente du repos et de la paix dans l’Agnus dei réservé à l’alto solo et à l’orgue, et conduit à la lumière éclatante de certitude du Lux aeterna :

« Aucun autre Requiem du répertoire ne se termine avec cette foi inébranlable et affirmative » (Perroux 2001, 123).
Le thème central du Requiem allemand de Brahms était, en plein romantisme, celui de la promesse d’un accomplissement dans la joie et de l’espérance face à la mort. Celui qui domine un siècle plus tard le Requiem de Frank Martin est, sur la base d’une semblable confiance, tout aussi personnelle, le thème de la réconciliation avec la mort. Présent dans l’ensemble de son oeuvre, sous des aspects divers, il s’impose avec une concentration particulière dans les compositions de ses dernières années :
-
1969-1971 : Poèmes de la Mort (François Villon) pour ténor, baryton, basse et 3 guitares électriques ;
-
1971-1972 : Requiem ;
-
1973 : Polyptique, Six images de la Passion du Christ pour violon et 2 orchestres à cordes ;
-
1974 : Et la vie l’emporta (Maurice Zundel, Martin Luther, Pseudo Fra Angelico), cantate de chambre pour alto, baryton et ensemble vocal et instrumental.
C’est d’ailleurs dans l’esprit de cette familiarité imposée et acceptée avec la mort, mais aussi et tout autant de la nécessité intérieure d’en rendre compte, qu’il explique la genèse et le sens du Requiem :
Depuis de longues années je savais que je devais un jour écrire un Requiem. C’était une sorte de conviction intime, mais rien ne me disait quand ni comment ce vague pressentiment prendrait forme pour se réaliser. Il y a quatre ou cinq ans que mon ami J-Claude Piguet y avait attaché de plus près ma pensée, me mettant en quelque sorte sur la conscience d’avoir à l’écrire. Mais là encore de graves résistances intérieures se manifestaient : je ne me sentais pas mûr pour une tâche pareille. Mais l’idée travaillait en moi et j’imaginais diverses formes possibles, des formes parfois aberrantes et quelque peu apparentées à cet essai scabreux dont j’eus un jour la partition sous les yeux : un Requiem avec orchestre de jazz. Et puis, un jour, je m’y suis mis, non pas que je me sentisse mûr pour cela. Est-on jamais mûr pour une tâche pareille ? Mais en janvier 1971 je fis un voyage en Méditerranée où j’eus l’occasion de contempler, dans la solitude, à Venise l’église de Saint-Marc, à Palerme la basilique de Monreale et près de Naples les temples de Paestum. Ces trois monuments, qui expriment le sentiment de l’adoration de façon si accomplie, éveillèrent en moi le désir d’édifier à mon tour, selon mes pauvres moyens, un temple dédié à l’adoration[5].
Ce que j’ai tenté d’exprimer ici c’est la claire volonté d’accepter la mort, de faire la paix avec elle, de la voir pleinement dans tout ce qu’elle comporte d’angoisse, physique et morale, en nous mettant face à face avec ce qu’a été notre vie, si peu digne de ce qu’elle aurait pu être, si pleine de faiblesses et de défaillances ; mais aussi de la considérer avec la pleine confiance du pardon, attendant d’elle le véritable repos, le repos éternel. Ce que j’ai tenté de signifier ici, ce n’est pas l’image de la description de ce repos, mais l’ardente prière de l’obtenir par grâce. Ce texte liturgique qui dans sa richesse évoque tour à tour l’attente du repos, la supplication, l’adoration pure ou les angoisses du jugement dernier, je m’y suis identifié pleinement malgré tout ce qui peut, intellectuellement parlant, nous le rendre étranger. Ces images issues du Moyen-Âge parlaient directement à ma pensée la plus profonde. Cette pensée, aucun langage ne peut l’exprimer clairement, mais c’est elle, cette pensée de la mort, que j’ai tenté de mettre dans ma musique. Puisse-t-elle apporter à quelques-uns, ce sentiment de confiance et de paix qui m’a animé au cours de ce travail[6].
Comme chez Brahms, mais sans abandonner le texte liturgique traditionnel de la messe pour les défunts et ses images médiévales, Frank Martin, par la relecture qu’en opère la composition musicale, en recadre le genre. De l’Intercession de l’Église pour les trépassés, il tire une méditation universellement humaine invitant les vivants à réintégrer la mort et leur propre finitude comme une dimension positive de leur histoire personnelle :
Je crois que, dans notre époque, qui considère la mort comme une ennemie qu’il faut combattre par tous les moyens et qu’on voudrait au fond supprimer (si possible !) cela a été pour beaucoup une sorte de révélation de trouver quelqu’un qui l’admet, qui la considère comme le grand repos, comme un fait positif ; quelqu’un aussi qui peut exprimer dans la musique cette sorte de paix avec la mort[7].
5.2 Le recadrage du texte liturgique par sa recomposition musicale
Sa correspondance le montre : songeant à écrire un requiem, Frank Martin ne semble pas l’avoir imaginé autrement que sur la base de l’ordinaire latin. Mais on comprend aussi que, dans son esprit, en suivre scrupuleusement le texte signifiait nécessairement entrer dans un travail d’interprétation intersubjectif prenant la forme d’un dialogue entre les images et le sens que leur donnait sa lecture.
La rencontre comportait ses propres difficultés, clairement envisagées :
[…] le Requiem ? Il faudrait un bouquin aussi gros que celui d’Ansermet, pour répondre à cette question-là.
J’y pense et j’y repense. Comme je vous l’avais dit, c’est un vieux rêve de toute ma vie d’écrire un Requiem sur mes vieux jours. Et puis, en m’approchant, je bute sur deux obstacles d’inégale grosseur. Le premier, c’est que c’est du latin. Or, vous savez que j’écris ma musique vocale aussi près que possible de la langue parlée, et si je connais bien le rythme théorique de cette langue, je ne l’ai pas entendu parlé. Cela me gêne parce que je ne trouve pas les finesses expressives d’une langue courante. Je serais obligé de les inventer, ce qui est tout autre chose.
L’autre obstacle est plus grave. J’aime m’approcher des sentiments, ou des pensées fondamentales, des archétypes, comme dit Jung ; ou, comme le dit Koestler dans son bouquin intitulé : Euréka, j’aime que l’Éternité regarde un moment à la fenêtre du temps. Mais ces moments-là j’aime les approcher au travers de quelque chose d’humain. Dans un Requiem, dès le premier mot on est en plein archétype. C’est un saut à pieds joints dans l’autre monde, en pleine Éternité, en pleine lumière éternelle. Comment faire ?
Tout cela me tracasse, car j’ai l’impression que ce serait une lâcheté d’abandonner l’idée, « il grand rifiuto » qui avait mené je ne sais plus qui droit aux enfers[8].
La solution logiquement trouvée et adoptée par Frank Martin, qui va déterminer l’entière conception de l’oeuvre, réside dans une interprétation existentiale qui démythologise les représentations apocalyptiques. Celle-ci lui permet de détacher le déroulement du rituel de son environnement confessionnel, et de mettre en musique le parcours qu’il ordonne entre les archétypes religieux comme la possibilité offerte d’un long dialogue critique avec lui-même, libérateur et apaisant pour l’individu, placé face à sa propre histoire :
[…] Nous avons tous, tant que nous sommes, le sentiment profond que nous devons être jugés. Nous nous sentons responsables de nos actes, coupables ou non. Et nous mesurons que l’épreuve est purifiante, nous le sentons bien : elle nous apparaît comme une justice qui nous permet de réparer nos faiblesses. La vie trop facile que nous menons actuellement crée des névroses parce que les gens conservent bien, plus ou moins inconsciemment, le sentiment qu’ils seront jugés — sentiment inhérent à tout homme normal — mais ils n’assument pas leurs fautes, de sorte qu’ils en restent chargés et ne peuvent ainsi en être libérés.
Oui, le Dies irae exprime admirablement ce fait. À chaque instant, il revient à la miséricorde. Il y a des images d’une beauté incroyable comme, par exemple, « quaerens me sedisti lassus » — pour me chercher tu as souffert la fatigue —. Après tout le déchaînement initial qui dépeint le jugement universel, tout d’un coup une simple phrase « quid sum, miser, tunc dicturus ? » — que dirais-je alors, moi pécheur misérable ? — nous ramène sur nous-mêmes. J’avoue qu’en composant ce Dies irae, je l’ai vécu avec une intensité extraordinaire[9].
5.3 Le Dies Irae, face à face universel de l’individu avec lui-même
Cette clé de lecture explique la répartition des voix et, en particulier, la signification singulière de celles, individuelles, des solistes, dans l’ensemble de l’oeuvre et dans le Dies Irae en particulier. Ce sont elles qui incarnent la quête existentielle de repos et de paix qui constitue le centre de gravité de la prière.
Les strophes dans lesquelles interviennent le choeur et l’orchestre, représentations apocalyptiques du jour de la colère, de la désolation et du jugement, leur servent de récit-cadre (voir Tableau 2).
Tableau 2
Le récit est collectif, porté dramatiquement par le choeur et l’orchestre :

Puis, de la mise en scène des images de la colère et du jugement, placées comme le décor sur lequel l’âme humaine puisse projetter ses angoisses et sur le fond duquel elle puisse jouer ses questions et ses doutes, l’oeuvre revient à la dimension individuelle qui, depuis le début, en constitue la trame. Comme c’était dès le commencement, dans l’introitus, la prédominance est rendue aux solistes.
Frank Martin rend lui-même compte du passage : « Par ailleurs, écrit-il en cours de composition, je travaille ferme à la partie centrale du Dies Irae, où cela devient plus personnel, plus intime qu’au début[10] ».


Le choeur reprend alors la parole pour fermer le cadre, mais ce sont les quatre solistes qui, concluant par l’Amen final, réintroduisent la dimension individuelle et existentielle, qui a le dernier mot :


5.4 Dire la confiance devant la mort comme attente du repos et de la paix
Au fond, demande-t-on à Frank Martin, ce Requiem est un acte de foi ?
Exactement, répond-il. Je n’ai pas du tout conçu ce Requiem sous un angle purement esthétique. Bien entendu, un artiste ne peut exclure complètement l’esthétique, élément indispensable, car c’est entre l’éthique et l’esthétique que se produit l’oeuvre d’art : il faut qu’une éthique trouve une esthétique appropriée et inversement que l’esthétique s’adapte à une pensée éthique. Cependant le Requiem se veut d’abord un acte de foi dans la mesure où, sans être réellement croyant, je possède tout de même une véritable foi.
Buffat 1973, 2
Le contre-paradoxe que constitue ce Requiem s’exprime précisément dans la radicalité d’une relecture qui ne succombe pas à la tentation du « grand rifiuto » ni n’élude les défis posés par le langage médiéval de la rhétorique de la crainte, mais qui s’en saisit à bras le corps et, par la composition musicale, en retourne le propos. Ce que Brahms a réalisé en changeant de texte et en mettant en musique un autre texte — ce que Frank Martin fera ensuite, après avoir écrit le Requiem, dans son oeuvre ultime, la cantate au titre programmatique « Et la vie l’emporta » — Frank Martin l’a fait en recadrant le texte de la tradition. On comprend que, autant d’un point de vue éthique que d’un point de vue esthétique, ce Requiem est exactement un acte de foi dans la mesure où il transforme cet héritage traditionnel du christianisme occidental, se le réapproprie, dégagé de tout cadre institutionnel au nom de sa propre conviction, et il nous le rend comme parole libératrice, adressée à l’auditoire universel, de certitude, de confiance et de paix.
Le Dieu du jugement a fait place à celui de la grâce. L’angoisse et l’effroi devant la mort, l’inquiétude religieuse devant le sort incertain des trépassés ont fait place à une confiance et à une paix fondamentale qui, dans une certitude tranquille, ont trouvé la liberté d’une réconciliation avec la mort, devenue espérance de repos et de lumière.
6. Igor Stravinsky (1882-1971), Requiem Canticles (1965-1966)
6.1 La liturgie comme critique de la religion
Stravinsky adopte, lui aussi, une solution radicale, mais contraire aussi bien à celle de Brahms qu’à celle de Frank Martin. Dans la destination de son oeuvre, d’abord : comme sa Messe de 1948, Stravinsky conçoit son requiem de manière à ce qu’il puisse être utilisé pour l’usage liturgique. Il devait être chanté peu après sa création pour les funérailles du physicien Robert Oppenheimer, à sa demande, puis il le fut pour celles du compositeur lui-même. Dans ses dimensions ensuite : alors que, selon la partition, l’exécution de la Messe ne devait durer que 17 minutes, celle du Requiem se réduit, prélude, interlude et postlude instrumentaux compris, à moins d’un quart d’heure. Stravinsky en parla comme d’un requiem de poche. Puis, évidemment, dans son rapport au texte : Stravinsky compose lui-même sa liturgie en ne conservant que six fragments de l’ordinaire de la messe pour les défunts, qu’il organise formellement en deux blocs de trois, séparés par un interlude. Le tout, encadré par un prélude et un postlude, est agencé selon une parfaite symétrie :

Tableau 3
La recherche formelle est évidente. Elle découle de convictions esthétiques auxquelles Stravinsky a donné un fondement explicitement théologique ; la conversion stylistique qu’a opérée Stravinsky au début des années 1920, marquée par la recherche de tenue et par l’importance croissante, dans son activité créatrice, de compositions à caractère liturgique ou biblique[11], trouve son explication dans une critique théologique de la religion, parallèle à celle de Karl Barth et, plus tard, de Bonhoeffer[12].
À toute époque d’anarchie où l’homme, ayant perdu le sens et le goût de l’ontologie s’effraie de lui-même et de son destin, on voit toujours paraître une de ces gnoses qui servent de religion à ceux qui n’en ont plus […] Ainsi de la musique impudiquement considérée comme une jouissance purement sensuelle, on est passé, sans transition aux obscures fadaises de l’Art-religion, avec sa ferblanterie héroïque, avec son arsenal mystique et guerrier et son vocabulaire frotté de religion frelatée.
Stravinsky 2000, 102
6.2 Une éthique de la communication
Cette décision théologique, fondée sur des motifs de foi et de conscience, explique ou tout au moins va de pair avec l’esprit de distanciation formelle et d’ascèse qui domine l’oeuvre de Stravinsky, passée la période expressionniste des grands ballets. Ce souci, qui s’exprimait déjà dans la conception de la Symphonie de Psaumes, écrite à la gloire de Dieu sur la traduction de la Vulgate et qui se chantera toujours en latin, se retrouve dans la Messe, sobre enluminure du texte sacré[13], puis dans l’ensemble des oeuvres bibliques et liturgiques de la période sérielle et, finalement, dans les Requiem Canticles. L’ensemble du requiem se base sur deux séries et on comprend bien que la sobriété délibérée n’est pas un jeu, mais qu’elle résulte de la compréhension que le compositeur a de lui-même et de son travail. Ayant accepté la commande d’écrire un requiem, Stravinsky entend s’en tenir à la fonction de mettre en valeur, dans sa lettre, la pérennité du texte sacré. L’énoncé musical évite dès lors tout épanchement émotionnel qui interférerait avec la parole du texte lui-même. Il adopte la forme hiératique d’une déclamation syllabique destinée à ordonner la pensée dans le temps :
La musique est le seul domaine où l’homme réalise le présent. Par l’imperfection de sa nature, l’homme est voué à subir l’écoulement du temps — de ses catégories de passé et d’avenir — sans jamais pouvoir rendre réelle, donc stable, celle de présent.
Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d’instituer un ordre dans les choses, y compris et surtout un ordre entre l’homme et le temps. Pour être réalisé, il exige donc nécessairement et uniquement une construction. La construction faite, l’ordre atteint, tout est dit. Il serait vain d’y chercher ou d’en attendre autre chose. C’est précisément cette construction, cet ordre atteint qui produit en nous une émotion d’un caractère tout à fait spécial, qui n’a rien de commun avec nos sensations courantes et nos réactions dues à des impressions de la vie quotidienne. On ne saurait mieux préciser la sensation produite par la musique qu’en l’identifiant avec celle que provoque en nous la contemplation du jeu des formes architecturales.
Stravinsky 1962, 63-64
Les sources d’inspiration sont évidentes et, quels que soient les intermédiaires avec lesquels Stravinsky s’est trouvé en dialogue, la méditation de saint Augustin sur le temps dans le livre 11 des Confessions s’y retrouve immédiatement audible. Réaliser le présent ne signifie rien d’autre, pour l’un comme pour l’autre, qu’ordonner le temps humain à la présence de l’éternité — Stravinsky parlera d’ontologie et dira : de l’Être.
6.3 Le requiem de poche
Soucieux de contenir sa messe de requiem dans des dimensions compatibles avec un usage liturgique — le même réalisme ne règne pas sur l’instrumentation —, Stravinsky sélectionne dans le texte liturgique quelques éléments qui lui paraissent essentiels. On peut observer que les fragments retenus correspondent à une logique précise, et qu’ils coïncident presque parfaitement avec les passages que Frank Martin, dans l’interprétation existentiale et individualisante qu’il proposait du texte, avait laissés au second plan.
Il en résulte une architecture originale, totalement différente, certes, mais, dans son extrême concentration, cohérente et entièrement lisible : deux parties vocales de prière ecclésiale encadrent les quatre parties qui, tirées de la séquence du Dies Irae, évoquent la double perspective de l’échéance de la mort et du jugement :
EXAUDI : écoute ma prière, toute chair viendra à toi
DIES IRAE : jour de colère qui réduira le monde en cendres
TUBA MIRUM : la trompette rassemblera tous devant le Trône
REX TREMENDAE : Roi terrible de majesté, sauve-moi !
LACRYMOSA : lors de la résurrection en vue du Jugement, donne le repos !
LIBERA ME : délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle.
On remarquera tout d’abord que, malgré sa volonté de ne faire que mettre en valeur le texte sacré, Stravinsky en modifie fondamentalement la fonction. Pas plus que ceux de Brahms et de Frank Martin, son requiem ne se présente en effet comme une prière pour les défunts. Stravinsky écarte la requête qui sert de cadre et de thème principal au texte liturgique, et qui d’ailleurs lui donne son titre de requiem, « Requiem aeternam dona eis, Domine », « Seigneur, donne-leur le repos éternel », pour centrer l’attention de la prière sur « je », lui-même représenté par le choeur qui la prononce : « Écoute ma prière ! ».
L’introïtus se concentre sur un appel à l’exaucement adressé à Celui vers lequel se retrouvera, en fin de parcours, toute l’humanité, et se limite à cet appel. Le thème n’est, pas plus que pour Brahms ou pour Frank Martin, le salut des trépassés. Il devient, dans la réécriture de Stravinsky, l’invocation confiante que l’individu adresse, se retrouvant, à la fin de sa vie, face à l’échéance de sa mort, avec la communion des croyants, à celui qu’il ne nomme pas, mais qu’il confesse comme son dernier recours. Contrairement à ce qu’effectuait le recadrage opéré par l’individualisation des voix dans le requiem de Frank Martin, la prière qu’adresse le « je » n’est en effet pas une méditation personnelle d’une réconciliation avec la mort, mais la prière de la communauté ecclésiale qui l’entoure et dans laquelle il s’incorpore :

Cette double volonté de recadrer la messe pour les défunts en un appel du « je », priant à sa propre délivrance et, en même temps, d’affirmer le caractère communautaire et ecclésial de la prière, trouve sa confirmation, d’une part, dans le choix du Libera me comme dernier fragment retenu pour conclure la prière liturgique et, d’autre part, dans sa mise en scène. La superposition du chant des quatre solistes, venus du choeur, et de la déclamation du même texte par le reste du choeur, devenu l’assemblée, installe directement l’oeuvre, comme liturgie, sur les bancs d’église. Stravinsky, non sans humour, parle de « la prière paroissiale qui accompagne comme un murmure de fond le Libera me », et qui pourrait rappeler le bruit des aliénés de Marat / Sade[14]. Les Requiem Canticles concluent comme ils ont commencé : la demande qu’ils présentent ne concerne pas le salut des trépassés, mais celui des vivants, du « je » de l’Église rassemblée :

L’évocation de la désolation du jour de la colère, de la trompette annonçant le Jugement et des larmes de l’humanité implorant la miséricorde remplissent la fonction très précise de situer la prière face aux questions que pose l’échéance de la mort : la réalisation musicale des quatre fragments tirés du Dies Irae évite tout débordement et respecte la tenue formelle recherchée par Stravinsky :
La nécessité d’une contrainte, d’une tenue délibérément acceptée prend sa source dans les profondeurs de notre nature même et se rapporte non seulement aux choses d’art, mais à toutes les manifestations conscientes de l’activité humaine. C’est le besoin d’un ordre sans lequel rien ne se fait et avec la disparition duquel tout se désagrège. Or tout ordre réclame une contrainte. Mais on aurait tort d’y voir une entrave à la liberté. Au contraire, la tenue, la contrainte contribuent à son épanouissement et ne font qu’empêcher la liberté de devenir carrément licence. De même, en empruntant une forme toute faite et déjà consacrée, l’artiste créateur ne se trouve nullement restreint dans la manifestation de sa personnalité. Bien plus, celle-ci se dégage davantage et gagne encore plus de relief quand elle se meut dans un cadre conventionnel et déterminé.
Stravinsky 1962, 142-143
6.4 Dire la prière d’un croyant devant sa mort
Aux étudiants de l’université Harvard devant lesquels il prononce en 1939 les leçons de sa Poétique musicale, Stravinsky présente sa création comme le fruit de sa conscience et de sa foi. La musique lui apparaît comme un élément de communion avec le prochain — et avec l’Être. Les Requiem Canticles s’imposent, dans cette perspective, comme une ultime prise de parole dans laquelle s’incarnent les paradoxes théologiques et esthétiques d’une conviction :
-
Infiniment respectueux du texte liturgique qu’il met en musique, il le détourne de sa fonction pour se l’approprier et, à strictement parler, pour en faire sa chose : la prière d’intercession de l’Église pour le salut des trépassés devient la quête de délivrance d’un homme confronté à l’échéance de la mort et aux questions existentielles qu’elle pose.
-
Inversement, un créateur qui manifeste avec force et conviction son individualité entend se faire le porte-parole de la communion ecclésiale et le gardien de ses textes sacrés, du patrimoine spirituel de l’occident chrétien.
Peut-être paraîtra-t-il utile de citer ici quelques lignes de l’essai que Théodore Stravinsky a consacré à la spiritualité de son père. Les formulations sont plus directes que celles des déclarations publiques de Stravinsky lui-même. Stravinsky a cependant reconnu, dans une préface de la publication, s’y trouver intimement compris :
Par nature, Stravinsky est un être éminemment croyant. Toute implicite dans sa jeunesse, sa foi a trouvé, au temps de sa maturité, son explicitation toute naturelle dans le credo chrétien de Nicée-Constantinople, car Stravinsky est issu d’une famille orthodoxe […]
Un croyant est avant tout un homme pour qui une Vérité extérieure à lui existe, nécessaire, indépendante de son moi qu’il refuse de diviniser en le mettant à la place de cette Vérité : un homme qui refuse de considérer comme équivalents l’Être et le néant. Le monde « moderne » a apostasié […] Il nie ou ignore totalement la Vérité substantielle, l’Être ; Par conséquent, il ne sait plus, ne peut plus adorer ni prier […] Stravinsky, lui, croit fermement et n’a pas besoin de violenter sa nature profonde pour adorer et pour prier […]. Son attitude en matière d’art est nettement religieuse — métaphysique, ontologique (non sentimentale, ni intellectuelle) — bref, une attitude de croyant. En ce sens, Stravinsky est le plus antimoderne des compositeurs contemporains.
T. Stravinsky 1980, 44-46
7. Pour ne pas conclure : dire un Dieu de vie devant la mort
De tous les genres musicaux hérités de l’histoire de la chrétienté occidentale et de ses différentes traditions confessionnelles et liturgiques, le requiem paraît être celui qui s’est le mieux adapté à l’environnement culturel de sociétés sécularisées ou laïques. Le plus souvent sans grande adaptation de son livret, l’ordinaire catholique de la messe des morts, il est passé de la célébration religieuse à la salle de concert, se mettant au service des commémorations et des manifestes politiques les plus divers et prenant par la même occasion l’ampleur de dimensions nouvelles.
Le paradoxe n’est sans doute qu’apparent : l’humanité reste désarmée devant la mort — et devant ses morts, et la pensée agnostique moderne n’a guère trouvé de langage alternatif à l’imaginaire symbolique médiéval pour accompagner ses angoisses, ses espérances et ses doutes devant la mort. Dans cette situation, il m’a semblé intéressant de rendre compte de la manière dont trois compositeurs de traditions différentes — un luthérien, un réformé et un orthodoxe converti au catholicisme — avaient recadré le genre du requiem pour en faire une parole d’espérance croyante pour l’universalité de l’humanité : comment dire Dieu par la musique[15].
Le plus grand dénominateur commun des trois requiem de Brahms, de Stravinsky et de Frank Martin ne réside pas dans la réponse qu’ils donnent à la question, mais dans le défi qu’ils relèvent, chacun à sa manière : à quel Dieu et à quelle Transcendance s’en remettre devant la mort, et comment, face au deuil, dans le compagnonnage imposé et accepté avec la mort ou devant la présence de l’échéance proche de la mort, transmettre par leur art une parole d’espérance et de paix ? Les réponses que donnent leurs compositions sont d’ordre esthétique. Mais les différentes solutions esthétiques, littéraires et musicales qu’ils adoptent découlent d’une réflexion critique d’ordre théologique : quel sens y a-t-il à invoquer Dieu devant la mort, devant quelle Transcendance se placer et pour quoi faire ? Ce sont d’ailleurs les convictions délibérément et explicitement théologiques qui prennent forme dans leurs créations artistiques et qui s’expriment dans leurs prises de parole qui leur confèrent leur véracité. Les trois requiem de Brahms, de Frank Martin et de Stravinsky proposent trois contributions de théologiens laïcs qui recadrent la liturgie de la messe pour les morts en une prière ou en une prédication des vivants pour les vivants.
Parties annexes
Note biographique
François Vouga est professeur émérite de Nouveau Testament à la Kirchliche Hochschule Wuppertal / Bethel. Il prépare actuellement un commentaire sur la Première épître de Pierre et deux essais sur la poétique théologique de l’Évangile de Marc. Il a récemment publié, en collaboration avec Henri Hofer et André Jantet : (2016) Dieu sans religion. Les origines laïques du christianisme, Genève, Labor et Fides et (2018) « Apports du protestantisme à la musique – apports de la musique à la pensée protestante », Foi & Vie, 1, février, p. 14-26.
Notes
-
[1]
Traduction du programme de la création du Requiem de Frank Martin, Lausanne, le 4 mai 1973.
-
[2]
Texte tiré du Livre de la prière commune, l’ordre pour la sépulture des morts, traduction par l’Église d’Angleterre du Book of Common Prayer, Londres 1662 :
-
Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur ; celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais.
-
Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il demeurera le dernier sur la terre. Et lorsque après ma peau, ce corps aura été rongé, dans ma chair, je verrai Dieu ; je le verrai moi-même, et mes yeux le verront, et non pas un autre.
-
Nous n’avons rien apporté au monde ; et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a ôté ; que le Nom du Seigneur soit béni !
-
L’homme né de la femme est de courte durée, et il est rassasié de peines. Il s’épanouit comme une fleur, puis il se fane ; il s’enfuit comme une ombre qui ne s’arrête point.
-
Au milieu de la vie nous sommes dans la mort : auprès de qui chercherons-nous du secours, si ce n’est auprès de toi, ô Seigneur, qui es justement irrité à cause de nos péchés ? Néanmoins, ô Seigneur, Dieu très-saint, ô Seigneur très-puissant, ô saint et très-miséricordieux Sauveur, ne nous livre point aux amères douleurs de la mort éternelle.
-
Tu connais, Seigneur, les secrets de nos coeurs ; ne ferme point les oreilles de ta miséricorde à notre prière ; mais pardonne-nous, Seigneur très-saint, ô Dieu très-puissant, ô saint et miséricordieux Sauveur ; toi, très-juste Juge éternel, ne permets point qu’à notre dernière heure, si grandes que soient les angoisses de la mort, nous nous détachions de toi.
-
J’entendis une voix du ciel qui me disait : Écris : Bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, car ils se reposent de leurs travaux.
-
-
[3]
On remarquera au passage, typiques de l’héritage protestant :
-
La familiarité du compositeur avec sa Bible ;
-
Le principe herméneutique luthérien du sola scriptura comme scriptura sui interpres ;
-
La conception réformée d’un canon biblique comprenant le Nouveau et l’Ancien Testament comme un corpus unitaire.
-
-
[4]
Autre exception singulière : Igor Stravinsky (1961), A Sermon, a Narrative and a Prayer, première partie.
-
[5]
« À propos du “Requiem” par Frank Martin », programme de la création, Lausanne, le 4 mai 1973, repris dans Martin (1984, 158).
-
[6]
« A propos du Requiem », dans Martin (1984, 159-160).
-
[7]
Lettre à Jan-Frank Martin [fils de Frank Martin], 14.5.1973 (Société Frank Martin 1984, 137).
-
[8]
Lettre à Jean-Claude Piguet, 23. 1. 1968, publiée dans Felix, Piguet et Martin (2001, 17).
-
[9]
Zodiaque 103, La Pierre-qui-vire (1975, 12-13), cité dans : Société Frank Martin (1984, 137).
-
[10]
Lettre à Victor Desarzens, 22 avril 1971, publiée dans Sulzer (1988, 56).
-
[11]
Pater Noster (1926) ; Symphonie de Psaumes (1930) ; Credo (1932) ; Ave Maria (1934) ; Babel (1944) ; Messe (1948) ; Canticum sacrum ad honorem Marci Nominis (1956) ; Threni id es lamentationes Jeremiae prophetae (1958) ; A Sermon, a Narrative and a Prayer (1961) ; The Flood (1962) ; Abraham and Isaak (1963) ; Introïtus T. S. Eliot in memoriam (1965) ; Requiem Canticles (1965-1966).
-
[12]
Dans Chroniques de ma vie (Igor Stravinsky, 1962, p. 48-50), Stravinsky fait un récit haut en couleur du scandale causé en lui par la confusion wagnérienne entre art et religion.
-
[13]
« Ma Messe […] est liturgique et presque sans ornements. En mettant le Credo en musique, j’ai voulu seulement préserver le texte, d’une manière particulière. On compose une Marche pour aider les hommes à marcher ; ainsi, avec mon Credo, j’espère fournir une aide pour le texte. Le Credo est le mouvement le plus long. Il y a beaucoup à croire ». Déclaration citée dans Boucourechliev (1982, 293).
-
[14]
Allusion à Peter Weiss (1963), Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade, traduction française de Jean Baudrillard : (1965), La Persécution et l’Assassinat de Jean-Paul Marat représentés par le groupe théâtral de l’hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade.
-
[15]
Je n’ai pas repris l’analyse du War Requiem de Benjamin Britten, qui aurait certainement eu sa place, originale, ici, puisque je lui avais consacré un chapitre dans Vouga (1983).
Bibliographie
- Boucourechliev, A. (1982), Igor Stravinsky, Paris, Fayard.
- Buffat, D. (1973), « Frank Martin nous dit… Une interview exclusive sur la création de son “Requiem” », Revue Musicale de Suisse Romande, 26/3, p. 2 et 4.
- Felix, F., J.-C. Piguet et M. Martin (2001), dir., Correspondance Frank Martin - J.-Claude Piguet (1965-1974), Genève, Georg.
- Martin, M. (1984), dir., À propos de… Commentaires de Frank Martin sur ses oeuvres, Langages, Neuchâtel, La Baconnière.
- Perroux, A. (2001), Frank Martin ou L’insatiable quête, Genève, Éditions Papillon.
- Société Frank Martin (1984), Frank Martin 1890-1974. L’univers d’un compositeur. Catalogue de l’Exposition commémorant le dixième anniversaire de la mort de Frank Martin, Lausanne.
- Stravinsky, I. (1962) [1935], Chroniques de ma vie, Paris, Denoël et Gonthier (Bibliothèque Médiations).
- Stravinsky, I. (1952), Poétique musicale, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Le Bon Plaisir (Amour de la musique), p. 41-42 ; réédition critique : I. Strawinsky (2000), Poétique musicale sous forme de six leçons, Paris, Flammarion (Harmoniques).
- Stravinsky, T. (1980) [1948], Le message d’Igor Stravinsky, Lausanne, Éditions de l’Aire.
- Sulzer, P. (1988), dir., Frank Martin. Lettres à Victor Desarzens. Témoignages de collaboration et d’amitié entre le compositeur et son interprète, Lausanne, L’Âge d’homme.
- Vouga, F. (1983), Résonances théologiques de la musique, Bach - Beethoven - Stravinsky - Mozart - Verdi - Britten, Genève, Labor et Fides (L’Évangile dans la vie 9).
Liste des tableaux
Tableau 1
Brahms, Un requiem allemand – architecture
Tableau 2
Tableau 3