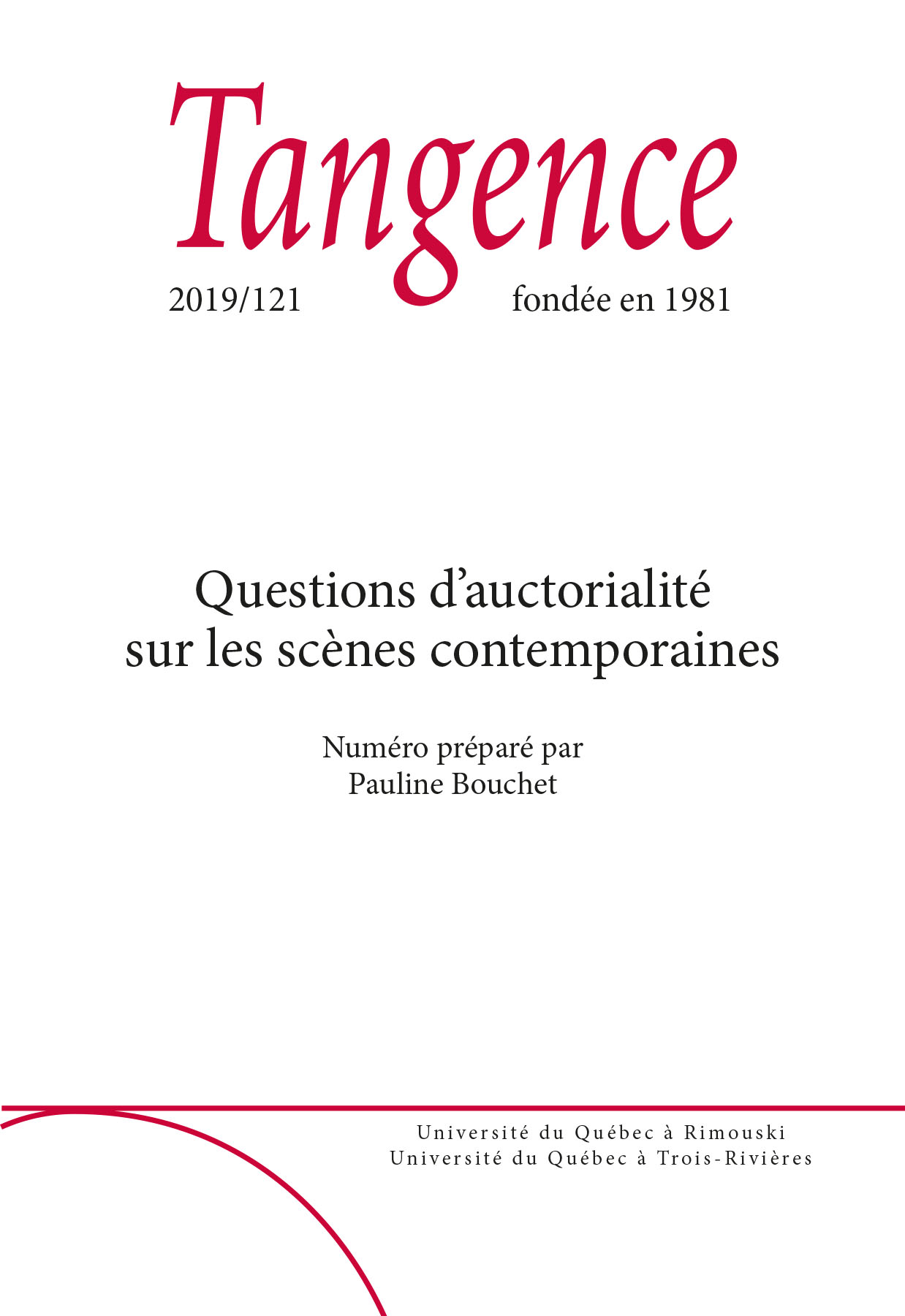Corps de l’article
Depuis l’annonce de la « mort de l’auteur » par Roland Barthes en 1968, employer le terme d’« auteur » et, avec lui, celui d’« autorité » sur l’oeuvre, est devenu sujet à polémiques. L’idée d’un auteur qui détiendrait la vérité sur son oeuvre est totalement évacuée.
Cette problématique est d’ailleurs plus forte lorsqu’il s’agit de spectacles vivants et en particulier de théâtre, car avec la disparition progressive, sur les scènes contemporaines, du textocentrisme et de l’idée d’un « art à deux temps[1] », que souligne Hans-Thies Lehmann[2], la notion d’auteur s’est déplacée de la production du texte théâtral à la production d’objets scéniques, des metteurs en scène se voyant, par là même, désignés comme « écrivains de plateau[3] », selon Bruno Tackels, si bien que « toutes les places du schéma qui organise le circuit de la parole de l’Auteur au Spectateur, en passant par le relais des acteurs et des personnages, sont à reconsidérer[4] ».
Tout d’abord, la situation de ceux qui se disent encore « auteurs dramatiques » est complexe et souvent précaire, et ce dossier en témoignera, notamment en France (comparativement à d’autres pays européens), comme l’explique très bien l’auteur Guillaume Poix dans le numéro de Théâtre/Public de l’hiver 2017 consacré aux écritures contemporaines européennes :
En Allemagne, vous constatez que si l’on ne publie presque plus de textes de théâtre, sinon dans des revues, on crée toutefois un nombre conséquent de ces textes contemporains écrits pour le théâtre par des dramaturges assumé(e)s. L’inverse, en somme, de notre condition.
En Angleterre, on publie et on joue. Bonne pioche […]
Vous pensez au paradoxe de votre pays. À la petite dizaine de maisons d’éditions spécialisées dans le théâtre que celui-ci compte.
Vous mettez en rapport le nombre de publications annuelles de textes dits de théâtre et le nombre de spectacles les mettant à l’honneur.
Vous trouvez la proportion accablante.
Vous vous demandez pourquoi on publie bien plus de textes que l’on en joue.
Pourquoi la scène est devenue le lieu de vie naturel du roman.
Pourquoi, hormis pour que survivent les auteur(e)s, objectif relativement louable tempérez-vous, on passe plus de commandes de textes inédits que l’on ne joue des textes déjà publiés ou écrits[5].
Mais cette situation ne repose pas seulement sur un contexte théâtral, une conjoncture éditoriale ou des données sociologiques, elle est aussi d’une certaine façon inhérente à la fonction d’auteur dramatique :
Le théâtre est non seulement le genre où la présence textuelle de l’auteur est la plus faible, puisque celui-ci ne peut s’y exprimer en son nom et ne prend la parole que derrière le masque de personnages fictifs, mais également celui où l’auteur rencontre le plus de difficultés pour garder le contrôle de son texte au cours de son histoire éditoriale[6].
L’auteur dramatique, par le fait même qu’il délègue une parole à des personnages et qu’il ne construit pas a priori de double de lui-même sous la figure d’un narrateur, a toujours dû s’inventer une place paradoxale entre présence et absence, comme l’explique l’auteur grec Dimitris Dimitriadis :
On est au coeur du sujet : écrire pour le théâtre présuppose une totale inexistence, une prédisposition génétique de celui qui écrit pour le théâtre à l’absence existentielle, consciente et éprouvée. Un auteur dramatique est une personne qui ne s’appartient pas, un personnage qui n’est constitué de personne, une non-personne, tout le contraire de la personnalité, un vide absolument disponible et prêt à être rempli par l’apparition de ces moi différents qui vont, d’une façon ou d’une autre, selon les époques, surgir de son vide même, car ils sont ses propres génitures. Le préalable, donc, pour écrire du théâtre, c’est un non-être préliminaire […] une absentia fundamentalis toute prête à devenir praesentia fundamentalis non pas de lui-même mais de ses personnages écrits[7].
C’est cette présence-absence qui fait de l’entité-auteur au théâtre une entité mouvante et polymorphe. Ainsi, annoncer la mort de l’auteur sur les scènes contemporaines n’aurait pas de sens, car il s’agit plutôt d’une reconfiguration perpétuelle. La figure de l’auteur se métamorphose, elle se multiplie, elle se renouvelle. L’auteur est, en effet, la figure centrale de certaines écritures contemporaines québécoises et européennes, comme dans le cas plus explicite de la pièce The Author[8] du dramaturge anglais Tim Crouch (auteur britannique évoqué par Séverine Ruset dans l’article « Les auteurs dramatiques anglais contemporains à l’épreuve des pratiques collaboratives »), dans laquelle l’auteur se désigne par son propre prénom « Tim », joue son propre rôle sur scène et se désigne comme un « monstre ». Cette pièce repousse les frontières de l’autofiction en interrogeant les limites et les pouvoirs du récit théâtral. Des acteurs de la compagnie de Tim Crouch sont disséminés dans le public (Crouch utilise leurs véritables prénoms pour les désigner dans le texte) et un personnage représente le public, « Chris » (lui aussi portant le prénom de l’acteur qui le joue). Lorsque la pièce débute, Tim Crouch raconte comment une jeune femme le conduit vers une baignoire pour qu’il s’y tranche les veines. Il donne explicitement son nom à cette femme qui ne le connaît pas : « Je suis Tim Crouch, je lui dis, l’auteur. Elle semble déconcertée. Elle n’a jamais entendu parler de moi[9] ! » Puis les acteurs parlent successivement d’une pièce de Tim Crouch dans laquelle ils ont joué et qui a choqué par sa violence extrême. Cette pièce parle d’une jeune fille violée par son père. Le personnage-actrice Esther raconte comment elle est allée chercher une femme ayant vécu la même chose pour s’en inspirer pour son rôle. L’acteur Vic souligne dès le début de la pièce, dans une réplique éminemment métathéâtrale, la question épineuse de la source de la parole et de l’adresse dans la pièce :
VIC. Tim m’a dit, avec un monologue, la chose la plus importante c’est de savoir à qui tu le dis. À qui tu le dis. Tu comprends ?
Tu ne peux pas te contenter de dire, oh, je me le dis à moi-même. Ou, je pense tout haut. Ou, je suis en train de parler à un « public » dans un « théâtre »[10] !
D’ailleurs, dans la pièce, l’auteur-metteur en scène tout puissant Tim fait subir des épreuves à ses acteurs (un voyage en Irak, la rencontre avec une femme victime d’inceste, Karen) pour leur faire comprendre à qui ils s’adressent, de quoi ils parlent et ce qui lui est passé dans sa tête à lui au cours de l’écriture.
À la fin de la pièce, Tim nous raconte la soirée qui suit la dernière représentation de la pièce dont les acteurs ont parlé. Après cette soirée, quand tout le monde est couché, Tim est tombé sur une vidéo pornographique mettant en scène un homme qui met son pénis dans la bouche d’un bébé et Tim raconte qu’il l’a regardée jusqu’au bout et s’est masturbé dessus. On comprend alors que c’est pour cela qu’il veut se tuer (Esther, l’actrice, a trouvé la vidéo ouverte sur son ordinateur, la femme de l’auteur l’a su). La pièce se clôt donc sur l’auteur qui s’excuse et meurt :
Personne n’a été blessé.
Enfin.
Je suis désolé.
Enfin.
Je continue.
L’écriture quitte l’écrivain.
Mort de l’auteur[11].
La pièce se termine donc sur la mort réelle de l’auteur, une mort choisie (un suicide) et nous laisse dans l’incertitude sur ce que nous venons d’entendre ou de voir. La figure de l’auteur dans cette pièce est complexe, abyssale, disséminée, reconfigurée en somme et c’est la notion d’autorité même qui est mise à mal avec une pièce qui brouille les frontières de la fiction et qui, tout en étant autofictionnelle et métathéâtrale, se construit grâce aux spectateurs.
C’est que le discours porté par les oeuvres sur les scènes contemporaines est vraiment polyphonique et laisse la place à un « dialogue hétéromorphe », pour reprendre la formule d’Hervé Guay dans « Le partage de l’auctorialité avec le spectateur dans le théâtre québécois contemporain au temps du numérique ». Les pratiques performatives, multidisciplinaires, participatives, collectives et autres intermédiatiques et interculturelles repoussent les limites de la définition de l’auteur dans un monde gagné par l’espace numérique du réseau social où l’autorité ne peut plus être pensée de manière descendante.
Ainsi, l’artiste scénique contemporain ne propose plus une posture d’autorité sur une oeuvre absolument originale, mais invente une autorité démultipliée, « hypermoderne », dans le sens employé par la sociologue Nicole Aubert quand elle parle de « l’individu hypermoderne » :
En s’étendant peu à peu à tous les domaines, avec des acceptions pas toujours similaires, le concept de postmodernité s’est peu à peu délité et ne permet plus vraiment de rendre compte des bouleversements les plus récents de la société contemporaine. En lui substituant celui d’hypermodernité, nous soulignons le fait que la société dans laquelle évoluent les individus contemporains a changé. L’accent est mis non pas sur la rupture avec les fondements de la modernité, mais sur l’exacerbation, sur la radicalisation de la modernité. […]
Ce à quoi l’on assiste aujourd’hui, selon Michel Maffesoli, c’est à un processus de glissement : glissement de l’individu (pourvu d’une identité stable et « exerçant sa fonction dans des ensembles contractuels »), à la personne, « aux identifications multiples » et jouant des rôles variés dans des « tribus affectuelles ». Ces identifications multiples, ce n’est pas seulement dans les tribus affectuelles que l’individu contemporain cherche à se les procurer. C’est aussi à travers les pratiques sur internet, consistant à jongler avec son identité et à se constituer un « sursoi » en s’autocréant des personnalités multiples, qu’on peut observer. […]
Dans un contexte où les possibilités et les limites du moi de chacun ne sont plus fournies par les rôles sociaux traditionnels et par l’appartenance sociale, l’individu est appelé à se produire lui-même et à s’interroger sur les nouvelles limites de son identité : jusqu’où est-il lui-même ? Cette forme d’expérimentation de soi, consistant à se mettre dans la peau d’un autre que lui, est ainsi une manière, pour l’individu contemporain, de porter sur lui-même un regard réflexif et d’apprendre à mieux se situer et à mieux s’expérimenter[12].
Il nous a donc semblé intéressant dans un tel contexte, plutôt que d’employer le concept d’auteur, d’analyser des questions d’auctorialité, terme dont la définition, notamment proposée par Alain Brunn — même s’il parle de littérature —, ouvre des perspectives :
Parler de l’auctorialité d’un auteur, c’est donc poser la question de son statut dans l’écriture : qu’est-ce qui justifie, finalement, que l’auteur soit tel ? Quelle position occupe-t-il par rapport au texte ? Utiliser la notion d’auctorialité consiste donc à envisager l’auteur comme une instance de régulation du texte, en dehors de toute prétention à déterminer le sens. Là où l’autorité tend en effet toujours à imposer une figure d’auteur capable de rendre compte d’un vrai sens du texte (et c’est évidemment cette utopie du vrai qui importe alors), parler de l’auctorialité d’un auteur permet de maintenir la présence de celui-ci au moment où la croyance en son utilité herméneutique disparaît[13].
Cette notion est encore extrêmement floue dans sa définition puisqu’il s’agit d’un néologisme en français qui n’est que la traduction d’un concept polysémique en anglais, « authorship », comme l’expliquent Estelle Doudet et Marie Bouhaïk-Girones :
En témoigne le sens assez confus d’authorship en anglais, qui désigne tour à tour tels individus singuliers ou subsume un groupe social. Le terme peut selon les cas peindre un caractère, résumer un ensemble de traits stylistiques ou évoquer le support dont le lecteur a besoin pour assurer son interprétation. Le néologisme français « auctorialité », d’un usage encore fragile, est accompagné des mêmes incertitudes. Pour des historiens ou des sociologues, il renvoie à la difficile constitution d’un statut ; pour des littéraires ou des linguistes, il est une condition de possibilité essentielle mais problématique des textes et de leurs lectures. C’est ce brouillage, ou si l’on veut cette souplesse notionnelle qui a retenu notre attention[14].
Il s’agira dans ce dossier de définir les différentes places de l’auteur sur les scènes contemporaines en s’interrogeant plus largement — dans des processus artistiques de plus en plus complexes où le partage de l’auctorialité est le fondement de la création d’objets scéniques collectifs et interdisciplinaires — sur ce que devient la « fonction-auteur » :
La fonction-auteur est liée au système juridique et institutionnel qui enserre, détermine, articule l’univers des discours ; elle ne s’exerce pas uniformément et de la même façon sur tous les discours, à toutes les époques et dans toutes les formes de civilisation ; elle n’est pas définie par l’attribution spontanée d’un discours à son producteur, mais par une série d’opérations spécifiques et complexes ; elle ne renvoie pas purement et simplement à un individu réel, elle peut donner lieu simultanément à plusieurs ego, à plusieurs positions-sujets que des classes différents différentes d’individus peuvent venir occuper[15].
Nous analyserons donc les différents modes de partage de l’auctorialité dans le cadre de productions collectives ou au contraire dans des spectacles portés par un metteur en scène dont l’autorité est manifeste. Nous interrogerons ce que chaque actant du processus théâtral (acteur, metteur en scène, auteur dramatique) définit comme son auctorialité.
Au-delà des manifestations d’une co-auctorialité, nous reviendrons aussi sur le statut social et juridique de l’auteur dramatique. Par ailleurs, nous exposerons la démarche d’artistes qui construisent leurs oeuvres en tablant sur l’intextextualité et la réappropriation qui met en jeu l’auctorialité et son partage. Le dossier s’intéressera au spectacle vivant dans son ensemble (théâtre, cirque, formes interdisciplinaires, voire indisciplinaires) et cela sur plusieurs territoires (Québec, États-Unis, France, Angleterre).
Le présent numéro s’ouvre sur des contributions qui dessinent les cadres de la définition historique et sociologique de l’auctorialité. La première contribution se concentre sur les questions générales d’auctorialité depuis le xviiie siècle jusqu’à aujourd’hui en France et en Europe. Dans les deux contributions suivantes, il s’agit de s’attarder sur le cas français en revenant, d’une part, sur le statut juridique et moral d’auteur dramatique avec l’article d’Antoine Doré, « Les conditions et les modes d’exercice du métier d’auteur dramatique en France » et, d’autre part, avec celui de Bérénice Hamidi-Kim, « Le metteur en scène et les autres ou la difficulté du partage de l’auctorialité dans le théâtre public français », sur la question épineuse de l’hégémonie politique de la figure du metteur en scène sur les scènes françaises contemporaines.
Dans leur étude « Auctorialités théâtrales : un chantier du GRIET XIX-XXI », Catherine Brun, Benoît Barut et Élisabeth Le Corre rendent compte d’un chantier qu’ils ont lancé au sein de leur équipe, le GRIET (Groupe de Recherche Interuniversitaire sur les Écritures Théâtrales)[16]. Ce groupe de recherche, créé à leur initiative en 2016 pour une durée de 3 ans, s’est donné pour objectif scientifique d’interroger la figure de l’auteur dans les écritures théâtrales du xixe au xxie siècle en associant des chercheurs en littérature française, littérature comparée et études théâtrales. C’est ce chantier qui nous est présenté ici, ce qui permet d’ouvrir le dossier avec un panorama qui s’étend de Victorien Sardou à Romeo Castellucci, en passant par Eugène Ionesco ou Ariane Mnouchkine. Cette contribution ne prétend pas apporter une définition de l’auctorialité, mais plutôt construire une réflexion autour de la variété des positionnements d’artistes marquants dans l’histoire du théâtre, ce qui rend compte d’une auctorialité polymorphe dans les arts de la scène.
Après avoir présenté les cadres historiques du métier d’auteur, l’étude portera d’abord sur la figure de l’auctorialité dite « en plongée », à savoir une auctorialité assumée et revendiquée, comme c’est le cas chez des artistes aussi différents qu’Eugène Ionesco (qui construisait un ethos très fort d’auteur dramatique en répétant dans les paratextes de ses pièces que le metteur en scène devait lui être soumis du point de vue du sens de ses oeuvres) et Jan Lauwers ou Romeo Castellucci (qui inventent une nouvelle forme d’auctorialité liée à leur pratique de l’écriture scénique). En effet, ces trois artistes seraient ce qu’on pourrait appeler des « hyper-auteurs » : Ionesco affirmant l’hyper-pouvoir de l’auteur de théâtre sur son oeuvre et Lauwers et Castellucci présentant des oeuvres hypertextuelles qui leur permettent de construire leur identité d’auteurs scéniques par-dessus, à côté, au-delà d’auteurs majeurs comme Shakespeare ou Eschyle qu’ils reconfigurent à leur guise.
Dans un second temps, l’étude aborde des cas d’« auctorialités partagées », dans le contexte de collectifs de création : le Théâtre du Soleil en premier lieu, qui fait figure d’exemple en la matière, et le collectif In Vitro, mené par la metteuse en scène Julie Deliquet, qui, après avoir mis en scène des textes de Jean-Luc Lagarce et Bertolt Brecht, a choisi l’écriture collective qui repose beaucoup sur la force d’improvisation du collectif de comédiens autour d’une « dramaturgie commune ». Mais, dans le cadre de ce que les auteurs appellent des « coopérations horizontales », force est de constater qu’il y a toujours une figure dominante qui émerge, que ce soit Ariane Mnouchkine (dont la posture autoritaire a pu notamment être dénoncée par un ancien comédien de sa troupe, Philippe Caubère, dans le cadre de spectacles solos-fleuves dans lesquels il compare Ariane Mnouchkine à Dieu, rien de moins) ou Julie Deliquet (qui assume son pouvoir de décision artistique finale sur les spectacles du collectif In Vitro et dont le talent singulier de mise en scène est souvent soulignée dans les articles de presse au-delà de l’écriture du collectif).
L’article « Les conditions et les modes d’exercice du métier d’auteur dramatique en France » présente avec précision, comme le titre l’indique, les conditions d’exercice du métier d’auteur dramatique en France. Antoine Doré commence par rappeler l’importance des droits moraux dans le cadre du droit d’auteur à la française, puis il revient sur la question épineuse de la rémunération spécifique que constituent les droits d’auteurs. Il s’agit là d’une rémunération très faible (et qui exclut les auteurs du statut d’intermittence du spectacle en France). À partir de ce constat, l’auteur montre à quel point les auteurs dramatiques en France sont condamnés à une polyvalence nécessaire à leur survie. Cette question, qui peut sembler d’ordre financier, permet aussi de comprendre le statut de plus en plus complexe d’auteur-metteur en scène. Elle implique aussi une vraie réflexion sur la solitude supposée de l’auteur dont la posture devient, dans les faits, de plus en plus difficile à tenir du point de vue financier. L’implication croissante des auteurs dans le processus de création théâtrale, leur proximité de plus en plus grande avec le plateau ne peuvent pas non plus être totalement séparées de ces contingences matérielles : l’auteur doit diversifier ses activités s’il veut en vivre. Antoine Doré propose ensuite une typologie des auteurs dramatiques selon leurs activités et leur rapport à une forme de liberté créatrice. Ainsi, il propose de diviser les auteurs en trois groupes : les « auteurs-metteurs en scène », « les auteurs de commandes » et « les auteurs de projets libres ». Il va de soi que ces catégories sont superposables. Elles permettent en tout cas de comprendre les différents statuts de l’auteur, d’où découle une forme ou une autre de rémunération mais aussi un rapport à l’auctorialité qui n’est pas le même.
L’article « Le metteur en scène et les autres, ou la difficulté du partage de l’auctorialité dans le théâtre public français » pointe du doigt un paradoxe persistant : si le théâtre est considéré comme un art collectif, la figure du metteur en scène en France reste hégémonique sur les plans social, institutionnel et politique. Bérénice Hamidi-Kim montre à quel point les metteurs en scène sont à la fois directeurs de compagnies, directeurs de scènes nationales et garants du sens des oeuvres produites alors même que de plus en plus d’oeuvres sont produites par des collectifs de création dont les définitions sont variées. Cet article, sans doute plus polémique que d’autres dans le présent numéro, pose de vraies questions sur l’installation du modèle hiérarchique en France qui, en plus d’avoir marginalisé les auteurs dramatiques, a créé un système de monopole où le metteur en scène est l’alpha et l’omega de toute production scénique. C’est aussi que, désormais, les metteurs en scène peuvent être considérés comme les auteurs des spectacles (ils touchent alors des droits) et cela leur procure une véritable autorité symbolique (celle qui est désormais refusée aux auteurs dramatiques). Dans son article, Bérénice Hamidi-Kim aborde la question très intéressante des collectifs de création. En effet, depuis une dizaine d’années, beaucoup de compagnies se définissent comme des collectifs de création. Pourtant, cette étiquette, devenue un label (car beaucoup de scènes nationales promeuvent cette figure du collectif comme nouvelle forme plus démocratique de production), cache souvent des réalités très diverses et, la plupart du temps, l’auctorialité ne peut être partagée jusqu’au bout dans la mesure où les institutions exigent généralement un seul signataire. Le cas particulier de la compagnie Louis Brouillard, dirigée par Joël Pommerat, montre qu’il est possible de créer une troupe permanente, modèle qui a été abandonné en France sauf à de rares cas comme la Comédie-Française, bien sûr, ou le TNP à Villeurbanne) et de distribuer collectivement les droits d’auteur aux acteurs qui participent à la création des spectacles dans une écriture de plateau basée sur des improvisations, même lorsque le texte est finalement édité sous le nom de Joël Pommerat. Mais ce modèle est totalement exceptionnel, et il y a encore en France une véritable mainmise du metteur en scène sur le spectacle vivant. Or, cette hégémonie du metteur en scène qui repousse à la marge l’auteur dramatique est bien franco-française, car l’article qui suit présente un tout autre paysage institutionnel en Angleterre, pays qui a encore jusqu’à récemment accordé une place symbolique forte aux auteurs.
L’article de Séverine Ruset « Les auteurs dramatiques anglais contemporains à l’épreuve des pratiques collaboratives », qui se concentre sur les écritures anglaises contemporaines, interroge un nouveau positionnement des auteurs dramatiques. En effet, le contexte anglais a longtemps été largement favorable au soutien des écritures contemporaines et il a résisté à la marginalisation de l’auteur observable dans d’autres pays européens comme la France. Ainsi, l’auteur dramatique en Angleterre est une véritable figure d’autorité qui détient un capital symbolique et une assise dans les institutions théâtrales. Or, Séverine Ruset étudie un glissement qui s’opère depuis quelques années en Angleterre et qui voit se développer des pratiques collaboratives qui poussent l’auteur à se réinventer et à se repositionner dans le processus de création. L’étude porte vraiment sur la redéfinition du statut de l’auteur dramatique en Angleterre en prenant appui sur des discours publics tenus par les auteurs eux-mêmes. Séverine Ruset commence donc par rappeler que l’auteur dramatique possède encore une force symbolique très forte en Angleterre, qu’il compte encore dans le paysage théâtral et qu’il n’y a pas perdu sa place comme dans le reste de l’Europe. Il est vrai qu’il existe en Angleterre des institutions prestigieuses comme le Royal Court Theatre, qui accompagne les écritures émergentes et les mettent en avant dans leur programmation. L’enjeu formulé par les metteurs en scène est souvent celui de faire entendre une « voix » auctoriale et son originalité. Ainsi, les auteurs sont connus par leurs noms chez le public anglais, au moins autant que les metteurs en scène, ce qui constitue une véritable exception européenne. Ils occupent une place dans le paysage médiatique et peuvent constituer un argument de vente pour un spectacle. Pourtant, même si les écritures contemporaines continuent d’être présentes dans les programmations des théâtres, un certain nombre d’auteurs ressentent depuis ces dix dernières années une forme de déclassement, notamment financier, car les dispositifs de soutien, s’ils se multiplient, ont tendance à encourager une première pièce et à laisser ensuite l’auteur dans une grande précarité.
Cependant, la redéfinition de l’auctorialité dans ce contexte anglais n’est pas seulement liée à des contingences économiques : elle trouve également son origine, selon Séverine Ruset, dans deux pratiques : l’accompagnement dramaturgique proposé dans les théâtres et le développement des écritures de plateau. Les théâtres anglais ont multiplié ces dernières années des dispositifs d’accompagnement et de développement dramaturgique proposés par des conseillers littéraires aux auteurs. Or, si cette pratique du conseil dramaturgique est bien connue au Québec dans le cadre du Centre des Auteurs Dramatiques, son application anglo-saxonne est bien différente. En effet, les auteurs s’érigent contre une forme d’interventionnisme des théâtres et la recherche d’efficacité mise en avant par le conseil dramaturgique, qui les privent de leur singularité auctoriale au profit d’une écriture à la demande, selon les goûts du jour. Bien sûr, la perte de singularité auctoriale est encore plus grande dans des compagnies qui mettent en avant une pratique collaborative et font ainsi totalement disparaître la figure de l’auteur de leur processus de création. Séverine Ruset prend l’exemple de Forced Entertainment qui ne fait plus apparaître Tim Etchells, l’écrivain de la compagnie, comme l’auteur des spectacles que celle-ci propose. Mais ce qui devient intéressant, c’est que certains auteurs, à rebours, construisent leur identité artistique sur une pratique collaborative de l’écriture assumée et revendiquée. C’est le cas de l’auteur-metteur en scène Alexander Zeldin qui met en avant des processus d’écriture collective (enquêtes documentaires, implications d’une troupe d’acteurs permanente avec laquelle il élabore ses textes). Cet exemple dépasse l’opposition entre « auctorialité en plongée » et « auctorialité partagée » autour d’une figure que Marion Cousin a décrite comme l’« auteur en scène », qui peut désigner des pratiques d’écriture comme celles de Jöel Pommerat ou Wajdi Mouawad :
Cette figure qui réunit écriture textuelle et écriture scénique dans un même geste, nous la nommons auteur en scène. Bien qu’elle n’ait, à notre connaissance, pas été forgée et utilisée auparavant, cette expression a pour atout principal sa simplicité et ses sonorités familières. En effet, elle fait écho, au metteur en scène, et donc au travail de la composition scénique, mais remplace la première partie du syntagme, celle qui faisait référence au verbe transitif mettre en scène, et donc à un élément premier, souvent textuel, faisant l’objet de la pratique. Elle lui substitue le terme d’auteur qui, en construction absolue, sans complément, évoque immédiatement l’auteur de mots, l’écrivain, mais qui reste cependant ouvert, plus que ce dernier, à d’autres pratiques artistiques, d’autres champs et matières, et peut, par là, englober la scène. Si cette expression représente aussi la contraction de celle d’auteur-metteur en scène, elle supprime cependant la séparation temporelle et notionnelle des deux fonctions qui était induite par la juxtaposition. Les deux gestes et les deux éléments — texte et scène — sont rassemblés en une seule expression, la préposition en les imbriquant de manière organique. En effet, contrairement à de qui limitait la pratique dans l’expression écrivain de plateau, cette dernière, « marquant en général la position à l’intérieur de limites spatiales, temporelles ou notionnelles » intègre l’auteur, son geste d’écriture et sa pratique dans l’espace et le temps, la pensée et la matière de la scène, quatre domaines que la préposition est apte à recouvrir. La séparation temporelle, spatiale et conceptuelle, à l’oeuvre dans les expressions précédemment citées, est conjurée par en. L’idée, formulée précédemment, que ces créateurs sont metteurs en scène quand ils écrivent, et écrivains quand ils mettent en scène, apparaît donc grâce à la préposition[17].
Par ailleurs, des auteurs reconnus comme Mark Ravenhill ou Tim Crouch affirment qu’il est important de décloisonner leur activité créatrice et qu’ils peuvent adopter tantôt la posture de l’auteur solitaire qui écrit à sa table, tantôt celle de l’auteur proche du plateau et d’une équipe de création.
L’article « Le partage de l’auctorialité avec le spectateur dans le théâtre québécois contemporain au temps du numérique » questionne pour sa part une forme de partage d’auctorialité très fréquente, qui n’a pas été analysée dans les autres contributions : celui qui consiste à partager l’auctorialité avec le spectateur. En effet, partant de son hypothèse selon laquelle de plus en plus de pratiques intermédiales et interculturelles voient le jour sur les scènes contemporaines et provoquent ce qu’il appelle un « dialogisme hétéromorphe » en substituant aux dialogues des personnages le dialogue, sur scène, de diverses pratiques artistiques, Hervé Guay analyse dans deux spectacles québécois récents (Le 6e salon international du théâtre contemporain en 2005 du Nouveau Théâtre Expérimental et Pôle Sud en 2016 d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, présenté à l’Espace Libre l’instauration particulière d’un rapport au public qui pousse ce dernier à prendre part au spectacle et à y exercer une forme d’autorité sur son sens.
Le premier spectacle, inspiré de la foire commerciale, propose plutôt un espace d’échanges où le spectateur déambule et construit ainsi sa représentation singulière. En amont, déjà, les acteurs assument une auctorialité partagée puisqu’ils sont à l’origine du texte du spectacle qui est d’ailleurs largement improvisé. Par ailleurs, ce spectacle, comme son nom l’indique, est bien une autocritique du théâtre contemporain. Il s’écarte ainsi d’une position surplombante par rapport au spectateur. Les artistes refusent ce faisant toute auctorialité « en plongée » et préfèrent instaurer une horizontalité et un espace collaboratif de production du sens de l’oeuvre.
Le second spectacle se définit comme une suite de « documentaires scéniques » mettant en scène des habitants du quartier ouvrier de l’Est montréalais. Ces derniers, par leur présence, contribuent à reconstituer leur espace quotidien, mais ils ne parlent pas. En effet, c’est la bande-son de leur interview par Anaïs Barbeau-Lavalette qui est à chaque fois diffusée lorsqu’ils évoluent silencieusement sur scène au milieu de leurs objets personnels. La documentariste est elle aussi présente sur scène, mais telle un personnage de soutien qui n’est là [en marge, dans l’obscurité] que pour regarder les personnages vivre sur scène. Ce spectacle intermédial [il y a du son et des projections vidéo sur un écran en fond de scène qui ne correspondent pas toujours à ce qui est dit, mais proposent plutôt un espace de résonance] met en scène ce qu’Hervé Guay appelle un « non-public » de l’Espace Libre, puisqu’il s’agit de personnes du quartier qui n’ont pas véritablement accès à la culture. Ainsi, outre qu’il met en valeur ces résidants et leur permet d’occuper l’espace scénique dont ils sont si souvent absents à Montréal, le spectacle instaure un dialogue entre des publics qui ne se côtoient pour ainsi dire jamais et tend à susciter un véritable échange citoyen. Là encore, c’est bien la production collective de sens qui prime sur la visée directive d’un auteur désigné. D’ailleurs, le spectacle est le fruit d’un travail à deux [celui d’Émile Proulx-Cloutier, metteur en scène et chanteur, et de sa compagne Anaïs Barbeau-Lavalette, romancière et documentariste] qui exclut toute forme individuelle d’auctorialité.
L’article « Auctorialité en partage : réappropriation de la pop culture chez Olivier Choinière et le Wooster Group » explore une autre forme de construction de l’auctorialité qui passe par la réappropriation et l’intertextualité. En effet, dans les oeuvres du Wooster Group et d’Olivier Choinière que Maude B. Lafrance étudie, il s’agit pour les artistes d’inventer une hyper-oeuvre écrite en résonance avec l’oeuvre d’autres artistes. Cette démarche rejoint ce que Catherine Brun, Benoît Barut et Élisabeth Le Corre [« Auctorialités théâtrales », dans ce numéro] disent de celle de Romeo Castellucci, écrivain scénique qui se réapproprie les oeuvres canoniques d’auteurs majeurs, ce qui lui permet de construire sa singularité en regard d’une grande histoire du théâtre dans laquelle il s’inscrit alors. Maude B. Lafrance montre bien ce contraste qui consiste, pour les auteurs des spectacles qu’elle étudie, à affirmer une non-originalité [ils reprennent des oeuvres existantes, les détournent] tout en construisant justement une singularité et une originalité grâce au regard qu’ils portent sur les oeuvres qu’ils se réapproprient et en inscrivant leur démarche dans un grand tout : intertextualité magistrale, hyper-oeuvre qu’est la somme des références médiatiques avec lesquelles ils jouent. La posture d’agenceur, d’assembleur, de monteur remplace celle de créateur, même si une forme n’est pas abandonnée. C’est d’ailleurs cette auctorialité hypertextuelle qui se développe sur les scènes contemporaines. Nombre de mash-up, de réécritures, de détournements médiatiques envahissent les théâtres et inventent une autre façon de voir l’auteur comme celui qui a un point de vue sur un environnement médiatique envahissant, un flux incessant de références auquel il doit faire face, qu’il doit trier, détruire et reconfigurer.
Enfin, parce que ce dossier se concentre sur des problématiques théâtrales, il nous a semblé essentiel d’ouvrir le questionnement sur l’auctorialité à d’autres arts de la scène et en particulier au cirque qui développe depuis plusieurs années une démarche de légitimation qui passe notamment par une définition de l’auctorialité dans des processus souvent collectifs où les interprètes sont les auteurs du spectacle. Ainsi, l’article « De l’artiste à l’auteur : processus de légitimation du cirque comme art de création en France », aborde la question de l’auteur dans le cadre du cirque. Marion Guyez y montre à quel point ce passage du terme d’« artiste » de cirque à celui d’« auteur » rentre dans un processus plus global de légitimation de cet art qui a longtemps été relégué au rang d’art mineur et qui a souvent été défini dans les termes des arts dominants, à savoir le théâtre, la danse ou encore le cinéma. Elle montre en effet comment le passage au post-dramatique, qui a profondément bouleversé la pensée des scènes contemporaines, a aussi eu des conséquences sur les spectacles de cirque et a conduit les artistes de cirque à s’interroger sur leur statut d’auteur. Par ailleurs, elle montre le lien intrinsèque qui existe entre cirque et texte — alors que l’on pourrait imaginer que cet art de performance physique et de la technique évacue les formes de l’écrit auxquelles est rattachée une vision traditionnelle de l’auctorialité) — puisqu’elle explique à quel point le texte et l’écrit sont omniprésents dans les processus de création circassienne, notamment sous la forme de cahiers dramaturgiques, carnets de notation et autres notes d’intention qui sont vraiment le lieu où se conçoit le spectacle, où s’invente sa structure, s’élabore son sens et où naît la notion d’auteur au sens de celui qui est le garant du spectacle produit. C’est donc là encore une auctorialité protéiforme que Marion Guyez explore et qui vient résonner avec les questionnements théâtraux du présent dossier et les réinterroger à la lumière d’un autre art de la scène, un art qui ne doit pas être soumis aux outils d’analyse du théâtre.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Henri Gouhier, Le théâtre et les arts à deux temps, Paris, Flammarion, 1992.
-
[2]
Hans-Thies Lehmann, Le théâtre post-dramatique, Paris, l’Arche, 2002.
-
[3]
Bruno Tackels, Les écritures de plateau, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2015.
-
[4]
Julie Sermon et Jean-Pierre Ryngaert, Théâtres du xxie siècle : commencements, Paris, Armand Colin, 2012, p. 52.
-
[5]
Guillaume Poix, « Mauvaise foi », Théâtre/Public, no 223 (Nouvelles écritures dramatiques européennes, dir. Christian Biet et coll.), janvier-mars 2017, p. 110.
-
[6]
Véronique Lochert, « L’anonymat de l’auteur au théâtre : création collective et stratégies éditoriales », Littératures Classiques [En ligne], 2 013/1, no 80, p. 106, mis en ligne le 21 juin 2013, consulté le 12 août 2018, URL : https://www.cairn.info/revue-litteratures-classiques1-2013-1-page-105.htm.
-
[7]
Dimitris Dimitriadis, Le théâtre en écrit, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2009, p. 19.
-
[8]
Tim Crouch, The Author, London, Oberon Modern Plays, 2011.
-
[9]
« I’m Tim Crouch, I tell her, the author. She looks blank. She hasn’t heard of me ! » (Tim Crouch, The Author, ouvr. cité, p. 23 ; je traduis).
-
[10]
« VIC. Tim said, with a monologue, the most important thing is to know who you’re speaking it to. To whom you’re speaking it. Do you understand ? You can’t just say, oh, I’m speaking it to myself. Or, I’m thinking out loud. Or, I’m just talking to “an audience” in “a theatre” ! » (Tim Crouch, The Author, ouvr. cité, p. 25 ; je traduis).
-
[11]
« Nobody was hurt. Anyway. I apologise. Anyway. I continue. The writing is leaving the writer. The death of the author » (Tim Crouch, The Author, ouvr. cité, p. 60 ; je traduis ; l’auteur souligne).
-
[12]
Nicole Aubert, « Un individu paradoxal », dans Nicole Aubert (dir.), L’individu hypermoderne, Toulouse, Édition Érès, 2 006 [En ligne], mis en ligne le 1er avril 2010, consulté le 5 février 2014, URL : http://www.cairn.info/l-individu-hypermoderne--9782749203126-page-11.htm, p.19-20.
-
[13]
Alain Brunn, L’auteur, Paris, GF-Flammarion, coll. « GF-Corpus », 2001, p. 211.
-
[14]
Marie Bouhaïk-Girones et Estelle Doudet, « L’auteur comme praxis. Un dialogue disciplinaire sur la fabrique du théâtre », Perspectives médiévales [En ligne], 35 | 2014, mis en ligne le 1er janvier 2014, consulté le 12 août 2018, URL : http://peme.revues.org/4142.
-
[15]
Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur », Bulletin de la société française de philosophie, 1969, p. 84-88, dans Dits et Écrits, Paris, Gallimard, 1994, t. i, cité dans Alain Brunn, L’auteur, Paris, GF Flammarion, 2001, p. 82.
-
[16]
On peut consulter le site à l’adresse suivante : http://www.thalim.cnrs.fr/ programmes-de-recherche/autres-programmes/article/groupe-de-recherche-interuniversitaire-sur-les-ecritures-theatrales-xixe-xxie.
-
[17]
Marion Cousin, L’auteur en scène : analyse d’un geste théâtral et dramaturgie du texte né de la scène, thèse de doctorat, Université Paris 3 — Sorbonne Nouvelle, 2012, p. 29-30 ; l’auteure souligne.