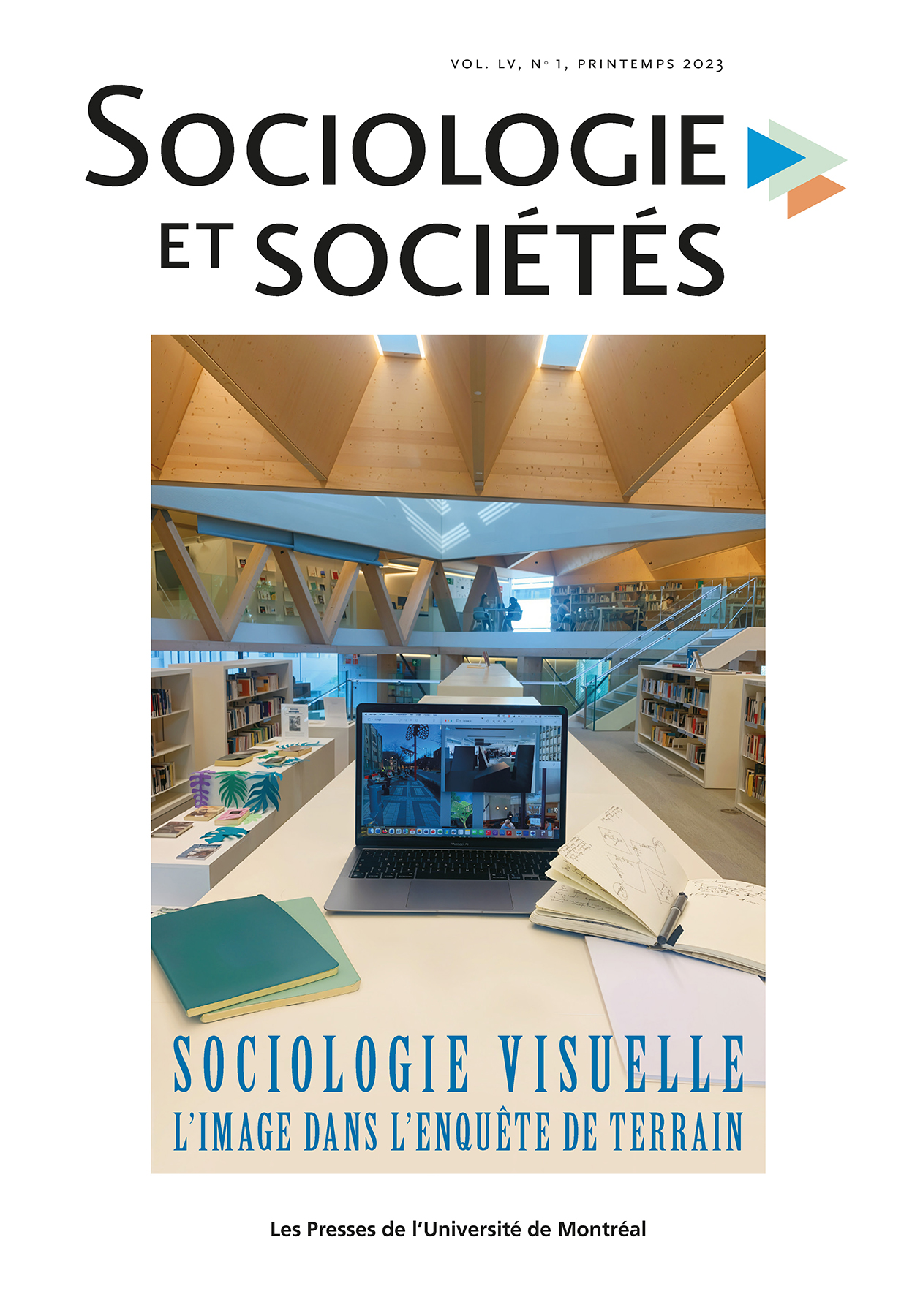Résumés
Résumé
C’est à John Collier que l’on doit d’avoir posé les bases de la méthode de l’entretien par photo-élicitation. L’article propose à la discussion la thèse d’une certaine persistance contemporaine d’un double impensé épistémologique présent dans l’argumentaire de John Collier. Il semble en effet que l’on ne se soit pas complètement affranchis aujourd’hui d’une illusion persistante de transparence de l’image photographique tout comme d’une épistémologie positiviste conjuguant dénégation de la relation d’enquête comme relation sociale et persistance d’un idéal d’observateur témoin invisible. Cet article se propose donc, à partir d’une revue de la littérature récente sur le sujet, de rendre compte de la persistance contemporaine de ce double impensé épistémologique concernant l’usage des images photographiques comme support d’entretien dans l’enquête de terrain pour ensuite proposer quelques pistes d’analyse réflexive de ce que faire parler à partir d’images montrées veut dire dans la démarche de recherche, à commencer par les effets induits par la construction sociale des documents photographiques commentés dans la production des données en entretien.
Mots-clés :
- photo-elicitation interview,
- images,
- sociologie,
- épistémologie
Abstract
It is to John Collier that we owe the foundation of the photo-elicitation interview method. This article offers a discussion of the thesis underlying a certain contemporary persistence of a double epistemological unthinking present in John Collier’s argument. Indeed, it seems that we have not yet completely freed ourselves from a persistent illusion of the transparency of the photographic image, nor from a positivist epistemology combining a denial of the investigative relation as a social relation and the persistence of the invisible observer-witness as an ideal. A review of the recent literature on the subject gives an account of the contemporary persistence of this double epistemological unthinkable concerning the use of photographic images as supports for interviews in fieldwork, and then proposes a few avenues of reflexive analysis of the impacts of speaking from shown images on the research process, starting with the effects induced by the social construction of the commented photographic documents in the production of data in the interview.
Keywords:
- Photo-elicitation interview,
- images,
- sociology,
- a epistemology
Resumen
El mérito de haber sentado las bases del método de entrevista por fotoelicitación se le atribuye a John Collier. El presente artículo propone debatir la tesis relativa a una cierta persistencia contemporánea de una dualidad epistemológica contradictoria presente en los argumentos de John Collier. En efecto, parece que, hasta el momento, no hemos sido capaces de liberarnos completamente de la persistente ilusión de transparencia de la imagen fotográfica ni de una epistemología positivista que conjuga negar la relación que surge de la investigación como relación social con reafirmar el ideal del observador-testigo invisible. A partir de una revisión del marco teórico reciente acerca del tema, el presente artículo tiene por objeto dar cuenta de la persistencia contemporánea de esta dualidad epistemológica contradictoria relacionada con el uso de fotografías como guías para las entrevistas en el trabajo de campo, para luego proponer una serie de líneas de análisis reflexivo sobre lo que significa hablar a partir de las imágenes mostradas en la investigación, comenzando por los efectos inducidos por la construcción social de los documentos fotográficos comentados en la producción de los datos de la entrevista.
Palabras clave:
- entrevista por fotoelicitación,
- imágenes,
- sociología,
- epistemología
Corps de l’article
Désignée comme « feedback interview » (Caldarola, 1985), « Talking pictures interview », « photo interview » (Bunster, 1978), ou le plus souvent désormais « photo-elicitation interview » (Collier, 1967), la photographie comme support d’entretien consiste à introduire une ou plusieurs photographies (prises ou non par le chercheur) au cours d’un entretien de recherche afin de les faire commenter par la personne interviewée (Harper, 2002, p. 13). France Winddance Twine rappelle à quel point les sources photographiques désormais utilisées dans le cadre des entretiens par photo-élicitation couvrent un très large éventail : photos prises par le chercheur, par des photographes professionnels travaillant avec des chercheurs, par des participants à la recherche, photos d’archives ou encore photos de famille des enquêtés (Twine, 2006, p. 487). Quelles que soient les sources iconographiques mobilisées, le dispositif vise à permettre « l’accès aux significations pour les personnes interviewées de l’objet photographié » (Harper, 1986, p. 25).
C’est une technique d’enquête aussi vieille que la pratique de prises de vue sur le terrain en sciences sociales si l’on en croit Ira Jacknis qui signale que Franz Boas fit commenter certaines de ces photographies dès son expédition de 1886 auprès des Inuits (Jacknis, 1984). C’est cependant à John Collier, dans son ouvrage Visual Anthropology : Photography as a Research Method (1967), que l’on doit d’avoir posé les bases de la méthode en y consacrant un chapitre entier intitulé « Interviewing with Photographs » (Collier, 1967, p. 46-66). Suivant la tonalité générale de cet ouvrage pionnier en anthropologie visuelle, l’argumentaire de l’auteur repose sur un postulat de plus-value épistémologique inhérent à l’usage de la photographie en entretien, comme dans la démarche de recherche de façon plus générale où l’usage de l’outil est paré des vertus de « facilitateur inconditionnel » de l’enquête de terrain (« can opener »). Ainsi, comme il est souvent de règle avec les ouvrages qui visent à promouvoir une méthode nouvelle, la contribution importante de l’auteur au développement de l’usage de la photographie en sciences sociales s’est construite sur un contournement de toute analyse critique, que ce soit par rapport à la dynamique de la relation enquêteur-enquêtés tout comme celle des effets induits de la construction sociale des images dans la production des données de l’enquête.
Je voudrais proposer à la discussion ici, après avoir rappelé les postulats inauguraux de John Collier, la thèse d’une certaine persistance contemporaine d’un double impensé épistémologique. Il me semble en effet que l’on ne se soit pas complètement affranchi aujourd’hui d’une illusion persistante de transparence de l’image photographique tout comme d’une épistémologie positiviste conjuguant dénégation de la relation d’enquête comme relation sociale et persistance d’un idéal d’observateur témoin invisible. Cet article se propose donc, à partir d’une revue de la littérature récente sur le sujet, de rendre compte de la persistance contemporaine de ce double impensé épistémologique concernant l’usage des images photographiques comme support d’entretien dans l’enquête de terrain.
la photo-elicitation interview comme outil de neutralisation de la situation d’enquête : les fonts baptismaux
Comme je l’ai déjà évoqué dans des articles antérieurs (2012, 2017), la façon dont on a pensé l’usage de la photographie dans la démarche de recherche en sciences sociales est indissociable de la manière dont on a pensé la relation d’enquête dans l’histoire des sciences sociales. Quels que soient le lieu et l’époque, un chercheur qui utilise la photographie pendant ses enquêtes de terrain est situé socialement, tout comme son instrumentation et sa production iconographique. Cette dernière en particulier obéit d’abord et avant tout à des codes et conventions de construction qui sont ceux de son milieu social d’appartenance. Tout document photographique érige en effet l’objet photographié en objet digne de l’être par celui qui l’a saisi et s’inscrit dans le champ des possibles que Pierre Bourdieu a proposé d’appeler dans les années 1960 l’aire du photographiable, pour souligner que
si, abstraitement, la nature et les progrès de la technique photographique tendent à rendre toutes choses objectivement « photographiables », il reste qu’en fait, dans l’infinité théorique des photographies qui lui sont techniquement possibles, chaque groupe sélectionne une gamme finie et définie de sujets, de genres et de compositions.
Bourdieu, 1965, p. 24
Si l’on s’accorde à reconnaître aujourd’hui que la relation enquêteur/enquêtés constitue bien le pivot central de la démarche de recherche et une dimension importante des conditions de production des données de terrain, elle n’a pas toujours été, loin de là, sous les projecteurs de l’épistémologie des sciences sociales. On peut même considérer que l’assertion, somme toute des plus banales pour des sciences dites « sociales », de la relation d’enquête comme relation sociale a longtemps constitué une sorte de point aveugle de la réflexion épistémologique (Papinot, 2014). Question stérile avant que ne s’impose le principe de sciences sociales fondées empiriquement, elle a ensuite longtemps fait l’objet de dénégation ou de contournement. Si l’on regarde d’abord la situation à l’origine des sciences sociales, la question ne se pose pas, tant « les débuts de la sociologie et de l’anthropologie ont été fortement marqués par l’idéologie positiviste associée à l’évolutionniste alors dominant » (Olivier de Sardan, 2000, p. 423) ; cette question étant au fond indissociable du contexte sociopolitique dans lequel elle s’inscrit — la cécité épistémologique sur la situation d’enquête étant fortement corrélée à la cécité politique sur la situation coloniale comme l’a bien montré Michel Leiris au moment des premiers mouvements de décolonisation. Ainsi appelait-il ses collègues à sortir de « l’indifférence de l’entomologiste » (Leiris, 1969 [1951], p. 85) dans leurs relations d’enquête.
En effet, dans les premiers textes méthodologiques relatifs à l’usage d’une instrumentation visuelle, en amont donc de cette prise de conscience politique, la question des incidences de la pratique photographique sur la situation d’observation apparaît tout simplement sans objet, car compte tenu de la situation de pouvoir qui prévalait, l’opérateur intervenait de manière significative pour constituer la scène à photographier en instituant les personnes observées en « figurants » (Rouillé, 1986). Dans le rapport de domination produit par la situation coloniale, la présence d’un observateur n’est pas subordonnée à l’acceptation des autres, elle est autorisée de fait par son appartenance à la société dominante. La démarche de recherche de Bronislaw Malinowski, si elle contribue à tourner la page de l’anthropologie évolutionniste en définissant les « conditions propres au travail ethnographique » (Malinowski, 1989/1922, p. 63-81), représente un exemple paradigmatique de cette non-prise en compte de la relation d’enquête et de ses effets induits sur les données produites. Si son Journal d’ethnographe témoigne du fait qu’il n’ignorait rien de la situation coloniale dans laquelle son travail de terrain s’inscrivait (Malinowski, 1985/1967), pas un mot en revanche dans Les argonautes du Pacifique occidental du rapport de domination coloniale dans lequel s’est déployée sa démarche d’observation. La cécité à la situation coloniale y a constitué un écran à l’analyse des conditions réelles de l’enquête. En même temps qu’il pose les bases de l’ethnographie moderne, il pose donc les premiers jalons de ce que Pierre Bourdieu va appeler le « parti pris participationniste » qui va constituer la voie classique pour « évacuer la question de la relation vraie de l’observateur à l’observé et surtout les conséquences critiques qui s’ensuivent pour la pratique scientifique » (Bourdieu, 1980, p. 57). De façon plus générale, le relativisme culturel absolutisé (Cuche, 1996) des monographies des premiers chercheurs de terrain (par opposition aux « armchair anthropologists » de la génération précédente) a généralement fait l’impasse sur la mise en perspective historique et contextuelle des cultures étudiées (Copans, 1974 ; Amselle, 1990) et donc sur l’analyse des situations d’enquête. S’impose ainsi dès les premiers travaux des chercheurs de terrain une représentation positiviste du travail scientifique, réduisant le rôle du sujet connaissant à l’exécution de tâches d’enregistrement et considérant le modèle d’un observateur témoin invisible, extérieur à la scène observée, en apesanteur sociale, comme idéal à atteindre. Dans cette veine épistémologique, le présupposé d’« impartialité mécanique » de l’instrumentation audiovisuelle va même apporter du crédit à cette illusion scientiste d’une posture d’extériorité du sujet observant dans le champ de l’observation : « la photographie (…) a tous les avantages et les inconvénients d’un enregistrement mécanique effectué en dehors de la personne de l’enquêteur » (Griaule, 1957, p. 76).
Bronisław Malinowski among Trobriand tribe
À partir de la prise de conscience de « l’observateur dans le champ de l’observation », émerge ensuite progressivement la question des effets de la présence de l’observateur mais uniquement sous l’angle d’obstacles à la connaissance, banalisant corrélativement une nébuleuse de pseudo-concepts-écrans comme « biais », « distorsions », « perturbation de l’observateur » qui vont s’imposer avec la force de l’évidence pour penser les conditions de production des données de l’enquête (Papinot, 2013), et surtout procéder à l’invalidation des données induites par la situation d’enquête, réduites au rang d’artefacts. Cette posture épistémologique a ainsi engendré différents types d’attitudes, de conseils techniques ou tactiques, visant soit à éviter soit à atténuer les effets de la « perturbation » de l’observateur implicitement considérée comme un obstacle à la connaissance que l’on a documenté dans un article précédent (Papinot, 2012). Si on laisse de côté le cas particulier (quoique non marginal) du déni pur et simple de la relation d’enquête comme relation sociale, force est de constater l’étendue des réponses possibles au « paradoxe de l’observateur » (Papinot, 2013), depuis le contournement de la question par le recours au truc technique jusqu’à l’illusoire fusion dans le groupe dans la longue durée du terrain.
Exemple de conseils tactiques de Marcel Maget : « tourner, autant que possible, quand les acteurs ne s’en doutent pas » « recourir au téléobjectif » (Maget, 1953 : 205)
Dans cette préoccupation de neutralisation des situations d’enquête se trouvent donc en bonne place des considérations d’intégration/fusion de l’observateur dans le groupe qui renvoient à un des mythes récurrents de la démarche d’observation en sciences sociales : l’« indigénisation » du chercheur ; façon radicale de contourner l’analyse réflexive des situations d’enquête en avançant l’idée que les effets de la présence de l’observateur sont annihilés par la longue durée de sa présence dans le groupe. Il s’agit dès lors non plus de se cacher ou de cacher son appareil de prise de vue (Maget, 1953) mais au contraire de s’en servir comme outil pour devenir « comme un membre du groupe ».
Ainsi la contribution fondamentale de John Collier au développement de l’usage de la photographie en sciences sociales s’est-elle construite de façon assez classique pour l’époque à partir d’un contournement du questionnement réflexif sur la relation d’enquête et des effets de la dimension de construction sociale de la photographie sur la production des données dans cette période positiviste de l’histoire des sciences sociales où il s’agit de tendre vers cet idéal de non-perturbation de l’observateur sur son objet. Bien entendu, il ne faut jamais perdre de vue ici le contexte d’émergence de ces écrits pionniers, à commencer par les très fortes réticences académiques à l’usage de l’image comme objet et comme outil en sciences sociales. Même si la photographie apparaissait assez systématiquement dans les premiers manuels de méthode ethnographique en France : Marcel Mauss (1947), Marcel Maget (1953), Marcel Griaule (1957), persistait (persiste ?) encore alors une certaine frilosité à l’appropriation scientifique de l’image dans les sciences sociales françaises. Un constat déjà souligné par Pierre Naville en 1966 et réitéré par Jean-Paul Terrenoire vingt ans plus tard, qui tient au fait que « les sciences sociales ont depuis toujours accordé aux sources écrites ou “quasi écrites” un privilège » et que donc « dans le cadre de cet habitus scientifique, l’image en tant que donnée ne pouvait avoir qu’un statut mineur, excentrique au sens propre comme au sens figuré » (Terrenoire, 1985, p. 510). Donc comme le rappelle Douglas Harper (2003), il n’a pas suffi que Margaret Mead et Gregory Bateson publient The Balinese Character en 1942 pour que « l’usage de l’image s’impose comme outil de recherche » (La Rocca, 2007, p. 37). Un tournant significatif serait plutôt à relever à partir de la création du réseau de l’International Visual Sociology Association en 1981 et du journal de l’association Visual Sociology (Meyer et Maresca, 2013, p. 17).
Aussi en 1957, lorsque paraît le premier article de John Collier Jr. sur le sujet, il s’agit donc d’abord de convaincre malgré de nombreuses réticences institutionnelles. Aussi, la promotion du recours à l’image-outil de recherche pour cet auteur va donc passer de façon logique en fonction des normes épistémologiques de l’époque par l’idée que l’appareil photo sur le terrain offrirait au chercheur un rôle de « participant observer », rôle qu’il justifie en disant que l’observateur se trouve en position d’avoir quelque chose à faire au sein du groupe étudié (Collier, 1967, p. 10-16)[1]. Il faudra attendre la publication dix ans plus tard de l’ouvrage de Georges Devereux « From anxiety to method in the behavioral sciences » en 1967 pour que s’amorce un renversement épistémologique et que débutent des perspectives critiques de cet idéal positiviste de l’observateur témoin invisible en anthropologie.
Dans les observations de la communauté de pêcheurs canadiens, qui servent à John Collier dans sa démonstration, la place de chercheur au sein de la communauté autochtone s’est trouvée pour lui d’emblée introduite et légitimée par cette activité elle-même : le skipper le présente comme la personne ayant des photos à faire. Ainsi, pour lui, le chercheur est présenté comme quelqu’un qui, tout comme les pêcheurs en question, a un travail à accomplir et « le délicat problème de sa place d’observateur se trouve ainsi, selon lui, résolu » (Collier, 1967, p. 11). En effet, la photographie constituerait pour lui une « activité visible et reconnue par les personnes observées dont la finalité première — produire des photographies — fait toujours l’objet d’une acceptation minimale », car « prendre des photos est une activité facilement compréhensible, et chaque fois que le chercheur prend une image, son intention est d’emblée reconnue » (Collier, 1967) ; avec donc un raccourci symptomatique dans l’argumentation entre visibilité de l’acte de prise de vue par les enquêtés et compréhension de l’intentionnalité du photographe…
C’est à partir de ces considérations que l’auteur développe l’idée selon laquelle la photographie sur le terrain fonctionnerait comme « can opener », comme un facilitateur du travail d’enquête et de l’accès à l’information et surtout de la coopération des personnes enquêtées.
En déclinaison de ce postulat général d’une pratique photographique facilitant nécessairement le travail de terrain, John Collier va, au cours du chapitre « Interviewing with Photographs » (Collier, 1967, p. 46-66), passer en revue les principaux avantages qu’il entrevoit à l’usage de la technique de « photo-elicitation interview ». Cela concerne d’abord en tout premier lieu la négociation de l’entrée sur le terrain qui serait facilitée par le fait que « les photographies prises et rapportées réalise(raie)nt un motif d’introduction suffisant permettant d’entrer dans le milieu ou plus concrètement chez les personnes enquêtées sans avoir à justifier d’autres motifs » (Collier, 1967, p. 47). Les photographies permettraient même de « remplacer, une exposition pas toujours aisée des motifs de la venue, du rôle du chercheur, des buts de l’interview et des objectifs de la recherche » (Collier, 1967, p. 46), ne laissant supposer aucune équivocité des images montrées.
Concernant l’interview proprement dite, le recours à la présentation de documents photographiques représenterait à ses yeux un certain nombre d’avantages à la fois pratiques et méthodologiques, principalement une capacité de la photographie à faciliter l’échange verbal, et permettant de tendre vers un idéal de non-directivité. Ainsi, le fait de montrer des photographies contribuerait à introduire directement le thème de l’entretien sans la nécessité de sa présentation verbale, et à approfondir ou à orienter directement l’entretien vers le coeur du sujet de recherche, sans avoir à le formuler explicitement (Collier, 1967, p. 47).
De la même façon, d’après lui, l’examen d’une nouvelle photographie ferait revenir sans heurts la conversation vers le champ de l’étude sans avoir à l’exprimer verbalement (Collier, 1967, p. 48). Cette interview à base de photographies n’empêchant pas par ailleurs une bonne structuration de l’entretien sans aucun des effets inhibiteurs d’un questionnement verbal trop directif (Collier, 1967, p. 48). Il décrit, à cet effet, la manière dont la photographie fonctionnerait pendant l’interview, sa capacité à susciter spontanément des commentaires, à stimuler la mémoire et à faire se projeter immédiatement le spectateur dans le sujet de la représentation en encourageant par la photographie un retour sur son activité par exemple (Collier, 1967, p. 48).
Un point important de l’argumentation de l’auteur concerne également la propension de la technique de photo-elicitation interview à « susciter l’expression verbale en réduisant la tension liée à la violence symbolique de l’entretien », car d’après lui, « l’informateur, au lieu d’apparaître comme le sujet de l’enquête, deviendrait l’expert (permettant de) guider le chercheur dans la découverte du contenu des images » (Collier, 1967, 48). Le détachement produit par la photographie, la distance instituée en tant que représentation, autoriseraient ainsi un détachement personnel de l’informateur qui n’aurait pas le sentiment de divulguer des confidences. Ce qui autoriserait également le chercheur à prendre des notes ou à enregistrer, car cela serait perçu comme des notes au sujet des photographies et non comme des « jugements sur la vie de l’informateur » (Collier, 1967).
Dans le même ordre d’idées, pour John Collier, comme la présentation de photographies fournirait en soi un sujet de conversation (Collier, 1967, p. 48), l’interview présenterait ainsi un niveau d’intérêt identique de la première à la troisième visite (Collier, 1967, p. 47). Aussi, renouveler des entretiens avec les mêmes personnes deviendrait donc possible contrairement aux méthodes classiques qui iraient en s’appauvrissant et deviendraient difficiles, voire impossibles, à réaliser à la deuxième ou troisième rencontre (Collier, 1967).
Enfin, selon lui, le recours au support photographique par sa nature intrinsèque semblerait particulièrement adapté dans les recherches interculturelles pour « aider à surmonter la barrière de la langue » (Collier, 1967, p. 58). En réponse à nombre de ses collègues lui objectant qu’il ne pourrait pas employer sa méthode avec de nombreuses populations indigènes appartenant à des civilisations orales — qui, sauf pour celles qui sont occidentalisées, n’ont eu aucune expérience de la photographie et ne peuvent penser en images à deux dimensions (Collier, 1967, p. 53) -, il évoqua ses propres expériences avec les Indiens Navajo et en déduisit que « la lecture de photographie constitue(rait) un phénomène ne relevant pas d’une acculturation moderne, telle qu’elle peut apparaître avec la fréquentation du cinéma ou la lecture de magazines, mais plutôt d’une perception sensorielle », qu’il estime particulièrement développée dans les sociétés sans écriture, car « la survie de l’homme y exige une analyse visuelle très fine de l’environnement » (Collier, 1967, p. 54).
Au final, l’argumentaire de l’auteur repose donc sur l’idée d’une plus-value épistémologique inconditionnelle du recours à la photographie dans l’entretien de recherche, censée améliorer en soi la production des données, faciliter l’intégration du chercheur, l’expression des enquêtés, quels que soient les contextes, les objets, les circonstances… Il repose sur deux postulats majeurs. Le premier rejoint un présupposé ancien d’illusion de la transparence de l’image et repose sur le déni du caractère socialement construit de la représentation photographique. Le deuxième rejoint une posture classique de l’épistémologie positiviste consistant à attribuer des vertus épistémologiques intrinsèques à un dispositif technique. Il s’agit de la propension supposée de la technique de photo-élicitation à renverser l’asymétrie de l’enquête. L’enquêté promu « expert » de l’objet photographié par cette technique ne ressentirait plus la violence symbolique inhérente à la situation d’enquête. Par conséquent, de la non-directivité pourrait se déployer dans la conduite de l’entretien et par là même toute influence inductrice des questions de l’interviewer s’estomper.
Aussi, la contribution importante de l’auteur au développement de l’usage de la photographie en sciences sociales s’est-elle construite à partir d’un contournement de toute analyse réflexive sur les conditions de production des données de l’enquête par photo-elicitation interview, que ce soit par rapport à la dimension de production culturelle des documents photographiques montrés tout comme par rapport à la relation d’enquête comme relation sociale.
2. de l’illusion de la transparence de l’image à l’inversion de l’asymétrie d’enquête
Qu’en est-il des écrits plus contemporains ? Ce qui est assez frappant, à quelques exceptions près (Meyer, 2017 ; Harper, 2002 ; Meo, 2010 ; etc.), c’est non pas le fait que le travail pionnier de John Collier Jr soit systématiquement convoqué, mais que soit si peu discutée cette proposition mécaniste du recours à la photographie comme plus-value inconditionnelle de l’enquête de terrain au vu de la généralisation aujourd’hui des démarches d’analyse réflexive des situations d’enquête en sciences sociales.
Vingt ans après la première publication de l’ouvrage de John Collier, c’est Dona Schwartz, dans un article souvent cité, qui donne le ton en reprenant et en entérinant le postulat d’un travail de terrain facilité par la pratique photographique dans ses recherches d’ethnologie rurale dans l’Iowa (Schwartz, 1989). Elle a suivi les recommandations de John Collier en commençant par photographier l’environnement physique parce que « les sujets de telles prises de vue sont les moins équivoques et réalisent un bon point de départ » (Schwartz, 1989, p. 125). Puis elle a fait en sorte que « ses activités soient visibles afin que les habitants soient informés de sa présence », ce qui a eu pour effet, selon ses propos, « de provoquer la curiosité de ceux-ci et lui a permis d’expliquer le but de son étude » (Schwartz, 1989, p. 125). Ainsi, explique-t-elle, « l’utilisation de l’appareil photo a facilité (son) entrée au sein de la communauté et son travail de terrain » (Schwartz, 1989, p. 125). Cela lui a permis de discuter avec les gens et « plus (elle) a utilisé l’appareil photo plus (elle) a rencontré de personnes » (Schwartz, 1989, p. 125). L’usage de l’appareil photo lui aurait ainsi permis « de se faire connaître, de se faire accepter chez les gens pendant tout son travail de terrain » (Schwartz, 1989, p. 125). La réflexion sur l’usage de l’instrumentation visuelle se limite donc ici comme très souvent à la question de l’entrée sur le terrain comme condition de possibilité de l’enquête et passe sous silence toute incidence de son usage dans la production des données tout au long de la recherche, tout en reprenant également un argumentaire de type mécanique faisant de la photographie un outil « facilitateur ».
Concernant la technique de photo-elicitation interview plus spécifiquement, elle produit là aussi une démonstration assez proche de celle de John Collier, tout en apportant toutefois une nuance de conditionnalité liée pour elle à un préalable indispensable d’usage de la photographie par le groupe social enquêté. De la sorte, s’ils sont « encouragés à parler et ceci sans hésitation (c’est qu’) il s’agit de photographies de leur village, de leur voisinage, ou de leur famille » (Schwartz, 1989, p. 151). Mais cela ne serait possible pour elle que parce que « cette technique d’enquête s’apparente(rait) à un événement ordinaire des pratiques culturelles de la famille (telle que la consultation d’un album de photos de famille), (que cela) (ferait) de l’interview une situation moins étrange, effaçant la présence de l’interviewer et ses questions » (Schwartz, 1989, p. 151-152).
Dona Schwartz met donc toutefois un bémol au raisonnement mécanique de John Collier : la pratique habituelle de la photographie au sein du groupe étudié comme condition nécessaire à la mise en oeuvre de la technique d’enquête, sans pour autant aller jusqu’à prendre en considération d’éventuelles divergences d’aires du photographiable entre les mondes sociaux de l’enquêteur et des enquêtés. Au-delà de cette réserve sur le champ d’application de la méthode, elle contribue donc à valider ce postulat de facilitation de l’enquête par le recours à la technique d’entretien en photo-élicitation.
Et de fait, cette capacité supposée de facilitation de l’entretien est régulièrement reprise comme allant de soi dans de nombreux articles plus contemporains qui mettent en avant par exemple sa fonction « brise-glace » (Epstein et al., 2006, p. 8), car le dispositif constituerait un « espace de discussion confortable et ouvrant des possibilités d’impliquer les enquêtés (les enfants en l’occurrence ici) en encourageant leurs réponses » (Epstein, Stevens, McKeever et Baruchel, 2006, p. 2). Pour Woodward et Jenkings, il s’agirait également d’un « moyen de faciliter la communication et de partager la compréhension entre le chercheur et le répondant en utilisant des images fixes photographiques » (Woodward et Jenkings, 2011, p. 252-268). Jean-Yves Trépos écarte même toute discussion possible sur ce point en affirmant qu’il est « convenu aujourd’hui chez les spécialistes de tenir la photo-elicitation pour un moyen de faciliter la communication entre enquêteur et enquêté, en favorisant la création d’un monde commun » (Trépos, 2015, p. 192)… En convoquant l’argument d’autorité de ce qui serait convenu par les « spécialistes » et en prenant presque systématiquement appui sur les assertions de John Collier, sont ainsi assénées des considérations de type mécanique sur la propension inhérente au dispositif à « faciliter la communication », car cela relèverait pour Éva Bigando de « la conséquence de l’instauration d’une relation triangulaire (enquêteur/enquêté/photos) qui se substitue(rait) au face-à-face binaire lié à une situation d’entretien classique (enquêteur/enquêté) et en amoindri(rai)t les éventuels effets inhibiteurs pour l’informant » (Bigando, 2013, p. 8)… Dans le même ordre d’idées, on retrouve dans l’article de Dona Shaw ou celui d’Anita Norlund l’idée émise par John Collier que la méthode s’avérerait particulièrement utile lorsque l’on travaille avec des enquêtés dont la langue maternelle n’est pas celle du chercheur (Shaw, 2013, p. 787 ; Norlund, 2020, p. 204). En conclusion de son article, Dona Shaw recommande même sans réserve l’utilisation de cette « vieille » méthode « chaque fois que la qualité, la richesse et la profondeur de la communication sont souhaitées » (Shaw, 2013, p. 797). Quel chercheur ne le souhaiterait pas ? Plus récemment, la méthode est encore qualifiée là aussi sans réserve de « facilitatrice de communication et d’expression lors d’un entretien » comme une « qualité évidente de cette méthode » (Braizaz, Toffel, Tawfik et Longchamp, 2020, p. 102). On a donc affaire à toute une déclinaison de postures mécaniques qui attribuent des qualités intrinsèques à une technique d’enquête.
De la « facilité de communication » à la « révision de l’asymétrie d’enquête », il n’y a qu’un pas, franchi par plusieurs auteurs également. Ainsi, Loeffler, en se servant lui aussi de la caution de « spécialistes », présente-t-il la technique comme « (redéfinissant) les relations essentielles de la recherche en réduisant l’asymétrie de pouvoir entre le chercheur et le participant, car l’entretien se concentre sur les sujets de recherche plutôt que sur le participant à la recherche ». Et de poursuivre, « la photo-élicitation est un processus collaboratif par lequel le chercheur devient un auditeur tandis que le participant interprète la photographie pour le chercheur. Ce processus invite les participants à la recherche à jouer le rôle principal dans l’entrevue et à tirer pleinement parti de leur expertise » (Loeffler, 2004, p. 539). Il y aurait de la même façon pour Jean-Yves Trépos, dans l’application de cette technique d’enquête, « plus qu’une simple implication dans l’entretien (…) une révision de la dissymétrie d’enquête » (Trépos, 2015, p. 209). Pour Xanthe Glaw, Kerry Inder, Ashley Kable et Michael Hazelton, la méthode offrirait plus de pouvoir aux enquêtés en les amenant à guider l’interviewer dans l’entretien (Glaw, Inder, Kable et Hazelton, 2017, p. 3), en inversant donc l’asymétrie d’enquête. Plus récemment encore, Linda Hopkins et Eleanor Wort estiment également que « l’utilisation de la photo-élicitation photographique renforce le pouvoir des participants, les “émancipant” pour en faire des co-chercheurs » (Hopkins et Wort, 2020, p. 180). Des co-chercheurs vraiment ?
Le fait enfin que les images soient prises par les enquêtés amène Éva Bigando à franchir un seuil supplémentaire dans ce postulat d’inversion présumée de l’asymétrie d’enquête en affirmant qu’il s’agit d’un dispositif qui « permet de limiter les éventuelles inférences liées à la présence et au statut du chercheur qui abandonne sa position dominante pour libérer la parole habitante. Il n’y a pas un habitant « profane » face à un chercheur « expert », mais un habitant qui, fort de sa posture réflexive, est devenu « expert » de sa propre existence et un chercheur « profane » face à un objet dont la maîtrise se trouve du côté de l’habitant » (Bigando, 2013, p. 9). On est donc plus très loin, dans cette acception populiste, de l’« immaculée conception » des données d’enquête tant le recours à cette technique permettrait « d’amener l’informant à la construction d’un discours réfléchi et cohérent, quasi indépendamment de l’intervention du chercheur » (Bigando, 2013, p. 9). Quasi indépendamment ! On le voit donc, il semble toujours tentant aujourd’hui de céder à une épistémologie selon laquelle le chercheur pourrait évoluer sur son terrain en pur observateur, autorisant une collecte de données authentiques qui ne seraient pas « biaisées » par les effets induits de la présence de l’enquêteur.
Dans ce type d’assertions mécaniques, le dispositif technique de photo-élicitation n’est donc pas uniquement pensé sous l’angle d’avantages méthodologiques potentiels mais bien comme étant paré de vertus épistémologiques intrinsèques permettant d’accéder à des faits qui ne seraient pas « contaminés » par les effets de la présence de l’enquêteur. Les justifications du recours à la technique de photo-elicitation interview s’inscrivent donc dans le droit fil de considérations plus anciennes visant à tendre vers un idéal d’observateur invisible. Elles reposent surtout sur le postulat qu’il existerait une « vérité des pratiques, des représentations, qui serait antérieure à la démarche d’observation » (Mauger, 1991, p. 129). Le dispositif d’enquête par ses vertus présumées d’inversion de l’asymétrie d’enquête permettrait donc de s’approcher au plus près du déroulement des événements supposés « authentiques », c’est-à-dire tels qu’ils seraient advenus en l’absence de l’observateur. Dans cette conception de l’enquête, la perturbation de l’enquêteur, la distance sociale enquêteur-enquêtés sont d’emblée considérées comme un problème et les effets de la situation d’enquête ne sont pensés qu’en termes de biais, distorsions ou erreurs, c’est-à-dire uniquement sous l’angle d’obstacles à la connaissance. De telles approches positivistes laissent en effet entendre qu’une forme d’objectivité et de neutralité soit rendue possible, du fait de la séparation radicale de l’objet de l’étude du sujet qui l’étudie. Elles vont donc viser à invisibiliser la situation d’enquête, car « source de déformations et d’erreurs », à la neutraliser pour en annihiler les effets sur les matériaux d’enquête, pensés principalement ici comme « recueillis » et non produits dans un contexte d’enquête singulier. Ce dispositif, en neutralisant la situation d’enquête, passe également sous silence la dimension de production culturelle socialement déterminée de la photographie, qui, si elle introduit effectivement dans la configuration d’enquête des documents tiers, n’en sont pas moins pour autant situés socialement, et donc participant également de la distance sociale enquêteur/enquêtés que ceux-ci soient réalisés par l’enquêteur ou par les enquêtés.
Ce qui frappe donc d’abord dans cette revue de la littérature (évidemment non exhaustive tant l’usage du dispositif méthodologique est désormais répandu, mais suffisamment diversifiée pour pouvoir souligner une tendance très récurrente) de différentes recherches contemporaines ayant utilisé les photographies pour faire parler, c’est l’angle mort de la prise en compte de la nature des documents auxquels on a eu recours dans l’enquête, comme si ces documents photographiques étaient pensés en apesanteur sociale. Pourtant, montrer une image photographique ne saurait se réduire à en montrer le référent réel. Si on prête habituellement une attention soutenue aux différents « paramètres » de l’interview, aux lieux, aux moments, aux questions posées, aux relances, au vocabulaire utilisé dans l’interaction, etc., en veillant parfois à leurs effets induits dans la production des récits, tout se passe comme si, dès lors qu’il s’agit d’images pour susciter la parole des enquêtés, ne comptaient plus que les référents réels déconnectés de leurs dimensions de documents situés socialement (composition, mise en scène, cadrage, angle de vue, etc.), comme si tous les choix de prises de vue d’un même objet ne contribuaient pas à déterminer le contenu du message iconique. L’illusion de transparence de l’image est une illusion persistante.
Ce qui est notoire ensuite, c’est la récurrence de cette assertion attribuant au dispositif méthodologique une propension mécanique à réduire, voire inverser, l’asymétrie d’enquête. Par quelle alchimie mystérieuse le fait de présenter des photographies de l’objet dans une interview viendrait-il modifier radicalement les dimensions structurelles de la configuration d’enquête ? Comment se pourrait-il que cette option technique modifie fondamentalement « cette sorte d’intrusion toujours un peu arbitraire qui est au principe de l’échange » (Bourdieu, 1993, p. 905). De façon générale, l’interview constitue une offre de parole de l’enquêteur acceptée par un enquêté. Elle est donc par définition asymétrique, en ce qu’elle porte sur un sujet de discussion imposé à l’enquêté, dans des termes qui peuvent même être assez éloignés de la façon dont l’enquêté pense les choses ordinairement et assez éloignés de ses préoccupations habituelles. Ce n’est pas non plus l’enquêté qui a défini les questions qui sous-tendent la recherche, et même s’il s’agit de ses photos, il a bien été invité à les faire et à les montrer par un enquêteur qui a bien été amené à justifier sa demande en faisant valoir l’intérêt de l’exercice pour l’enquête, et en amont l’intérêt de l’enquête… Bref, l’enquêteur n’est en pratique ni absent ni en position de « co-chercheur » ou de simple « auditeur » dans des acceptions populistes assez déconcertantes. L’enquêteur n’est pas non plus absent dans l’interaction d’échange, même s’il s’abstient de poser des questions, car c’est à lui que sont destinés ces commentaires sur les photos, de même lorsqu’il relance l’interviewé pour l’amener à compléter sa réponse. Il n’abandonne pas davantage la direction de l’échange lorsqu’il l’invite à revenir sur le sujet de la discussion en cas de digression. Et c’est bien lui encore qui définit les règles du jeu comme celle d’enregistrer l’échange… Il est donc assez naïf de penser que la nature asymétrique de la relation pourrait s’inverser et la violence symbolique se dissoudre par le simple recours au médium photographique. Et quid des configurations les plus courantes où l’enquêteur occupe une position sociale supérieure à l’enquêté, c’est-à-dire là où une dissymétrie sociale vient renforcer la dissymétrie structurelle de la relation d’enquête ? Suffit-il vraiment d’introduire des images photographiques dans l’échange pour que les rapports d’inégalité et de domination qui régissent tout espace social deviennent évanescents ? On ne peut évidemment pas décréter de façon unilatérale avoir aboli un rapport de domination par son seul désir de l’abolir. Un rapport de communication relève d’une dynamique d’échange entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Il ne dit rien du rapport social dans lequel s’instaure cette communication ; la notion de communication n’est pas un antonyme de celle de domination. La relation d’enquête ne se déploie pas en apesanteur sociale et de ce fait, elle ne déroge pas aux logiques, codes et conventions, qui régissent tout espace social. Elle ne relève pas d’un monde à part, séparé et clos. Elle n’est ni extérieure ni indépendante des dynamiques sociales qu’elle se donne pour objectif d’étudier.
Et par quelle alchimie mystérieuse l’intimidation engendrée par la distance sociale enquêteur/enquêtés disparaîtrait-elle subitement parce qu’aux questions orales on substituerait des images à commenter ? Cela rejoint la réflexion de Jean-Baptiste Legavre sur l’entretien non directif et la part de naïveté qui en a souvent justifié l’usage : « les spécialistes des entretiens sont dans une quête sans fin, depuis l’origine, du « bon » lieu et des « bonnes » manières d’être dans l’interaction qui permettraient à l’enquêteur de se neutraliser et à la parole d’être enfin libérée, c’est-à-dire sans aucune contrainte qui l’influencerait » (Legavre, 1996, p. 213). De même que les effets induits par la configuration d’enquête ne se limitent pas aux seuls effets des questions posées, de même il est extrêmement réducteur ici de penser les effets de la situation d’enquête aux effets seuls des photos montrées en entretien. Ces assertions illustrent assez bien ce que Gérard Mauger a appelé « l’illusion de faire illusion » à propos de la croyance répandue de « s’être fait oublier » par les enquêtés dans les démarches d’observation de terrain : « accueilli « comme l’un des leurs » par des enquêtés de bonne volonté, l’enquêteur risque plus encore de « se prendre pour l’un des leurs » et de croire qu’il passe inaperçu » (Mauger, 1991, p. 128). Il convient donc de rappeler que « le recours aux images ne constitue pas une option méthodologique miracle qui résoudrait à elle seule les difficultés propres à l’enquête de terrain » et que si l’image peut faciliter la verbalisation, elle peut aussi faire taire ou « éloigner les discussions des objectifs de la recherche » (Meyer, 2017) comme l’ont bien montré Rebecca Raby, Wolfgang Lehmann, Jane Helleiner et Rachel Easterbrook dans leur recherche sur les premiers emplois des jeunes au Canada (Raby, Lehmann, Helleiner et Easterbrook, 2018, p. 8). Il convient de reconnaître en effet que la technique ne fonctionne pas tout le temps et qu’elle ne facilite pas systématiquement les interactions d’enquête et la production des données, comme le font remarquer Elisa Bignante dans sa recherche auprès des Maassai (Bignante, 2010, p. 33) ou bien Analía Inés Meo dans son enquête sur habitus de classe et scolarité dans deux établissements scolaires de Buenos Aires (Meo, 2010).
Dans ce panorama de comptes rendus d’usage de la méthode, le recours à ce dispositif technique permet surtout de contourner à peu de frais la question de l’objectivation des conditions de production des données d’enquête et l’analyse des effets induits par le dispositif sur les discours produits. Sa mobilisation se présente comme « solde de tout compte » de l’analyse réflexive des conditions réelles d’enquête. On peut donc, à l’issue de ce passage en revue d’articles méthodologiques récents, avancer l’idée d’une certaine persistance de cette posture positiviste comme horizon des pratiques et idéal à atteindre.
3. alors que faire de la distance sociale enquêteur-enquêtés ?
Jean-Paul Terrenoire nous invitait dans un article qui garde tout son intérêt quarante ans plus tard à considérer qu’en « toute rigueur, l’analyse de l’image devrait précéder son appropriation comme outil », car
l’usage de l’image comme instrument de la recherche et l’approche scientifique de l’image comme objet social vont de pair. Ils se nourrissent l’un l’autre. En bonne logique, l’usage raisonné d’un nouvel instrument devrait s’appuyer sur la connaissance non seulement de sa nature mais aussi de ses divers emplois potentiels et de leurs conséquences.
Terrenoire, 1985, p. 512
L’image photographique est d’abord le produit d’une intentionnalité qui est celle du preneur d’image. C’est donc d’abord une production culturellement déterminée avant de renvoyer à un référent réel. Ce rappel est d’autant plus nécessaire qu’avec la photographie, la convention qui fait l’image n’est en effet pas immédiatement perceptible. La photographie offre un « effet de réel » qui tend à en occulter le processus de production. Un des premiers éléments à considérer relève donc de ce statut de représentation conventionnelle et codée de la réalité. En référence à Magritte, on pourrait dire que montrer une photographie de pipe dans un entretien de recherche, ce n’est pas montrer une pipe, c’est montrer une certaine représentation de cet objet, prise sous un certain angle, dans un certain cadre, etc.
Et si au fond le moteur de la production des données en entretien par photo-élicitation ne venait pas justement du fait que « les photos n’ont pas forcément le même sens pour l’enquêteur et pour l’enquêté, ce dernier se rend(ant) rapidement compte à quel point son univers cognitif est différent de celui de la personne qui lui pose des questions » ? (Harper, 1986, p. 25) Autrement dit, n’est-ce pas justement de cette distance sociale que viendrait le potentiel heuristique de la méthode ?
Accepter le principe de cette relation d’enquête comme relation sociale, c’est se donner les moyens de comprendre ce qui se joue dans ces interactions, à commencer par la confrontation d’aires du photographiable qui est inhérente à l’exercice de photo-elicitation interview, tout comme, plus globalement, l’exercice ordinaire de la photographie sur le terrain, ainsi que l’a par exemple très bien montré Cornelia Hummel dans sa recherche sur les religieuses en couvent où « les réactions verbales et physiques suscitées par les prises de vues photographiques (ont permis de mettre) au jour des dimensions qui (auraient été) difficiles à saisir par le biais d’observations routinières ou par la conduite d’entretiens » (Hummel, 2017, p. 14).
Comme j’ai pu l’expérimenter auprès des travailleurs du transport en commun à Madagascar ou des ouvriers de l’industrie métallurgique en France (2007, 2017), l’exercice visant à montrer des photos interpelle d’abord sur le caractère et le degré de « photographiable » des photographies montrées et suscite des remarques engendrées à partir du décalage entre ce qui est concrètement montré et ce qu’il « aurait dû y avoir » du point de vue endogène, à commencer par l’intérêt de les produire, de les montrer et d’en parler. Est-ce que ce qui est montré et comment c’est montré « mérite de l’être » ? Est-ce que cela relève en amont d’un motif légitime de prise de vue, d’un cadrage légitime ? Mais aussi est-ce que ce qui est montré paraît en congruence avec l’annonce de l’objet de la recherche et le sujet de la conversation en amont ?… Sans aller jusqu’à affirmer une similitude avec un exercice « naturel de visionnement photographique comme la consultation de l’album familial » (Schwartz, 1989, p. 151), l’exercice suscite bien des attendus relatifs aux usages ordinaires de la photographie et à « l’univers du photographiable » endogène. L’introduction d’images dans cette situation d’entretien contribue ainsi de manière implicite à des formes d’orientation de points de vue sur l’objet qui participent au questionnement. L’exercice, dans un contexte culturel comme celui du Nord malgache dans les années 1990, pouvait ainsi faire remonter les commentaires du contenu au contenant, si je peux me permettre cette dissociation arbitraire, susciter la discussion sur les choix de prises de vue, voire amener à des propositions de photos qui « auraient dû être faites à leur place » (Papinot, 2007). Quelle que soit la formulation de la consigne inaugurale, les documents à commenter posent donc leur lot de « questions muettes » indissociables de la construction sociale des documents montrés en mobilisant des ressources liées à ce type d’exercice de visionnement. Prévenir le risque d’illusion de la transparence de l’image dans l’exercice de photo-elicitation interview, invite donc d’abord à « garder à l’esprit que la nature même du matériel photographique structure l’image et définit dans une certaine mesure ce qui est représenté » (Croghan, Griffin, Hunter et Phoenix, 2008, p. 348) et le fait que les images soient produites par les enquêtés n’éludent pas davantage la confrontation d’ « aires du photographiable » dans l’économie de l’échange avec l’enquêteur.
conclusion
Tout comme on attend des historiens qu’ils fassent l’analyse critique de leurs sources, les sociologues sont explicitement invités aujourd’hui à se détourner des techniques et tactiques de neutralisation des situations d’enquête et du modèle positiviste qui y préside (Papinot, 2014) afin d’expliciter les conditions de production de données d’enquête qui « ne sont jamais tout à fait dissociables des dynamiques à l’oeuvre dans la recherche elle-même » (Schwartz, 1993, p. 274). Déconstruire ce statut implicite, « déjà là », du matériau de recherche, tel qu’il a pu se sédimenter dans l’histoire des sciences sociales, passe par la remise en cause de l’imposition d’une problématique consistant à faire démarrer la réflexion épistémologique sur la démarche d’enquête à partir de la « perturbation de l’observateur » qui tend à focaliser sur un idéal d’avant enquête. Il y a un parti de connaissance à tirer des effets induits par la situation d’enquête en les considérant tout simplement comme des données ordinaires de celle-ci. De même qu’il est intéressant de mettre à distance cet idéal fantasmé de l’objet préexistant à l’observation, il paraît important de refuser de continuer à se cacher derrière son petit doigt et de reconnaître pleinement que l’enquêteur — quelles que soient les modalités effectives de sa présence et de ses productions — constitue un nouvel élément sur l’échiquier de la configuration sociale étudiée. Il s’agit ainsi de se doter des moyens, non pas d’évaluer le degré d’altération subie, mais de rendre tout simplement les données plus intelligibles par l’explicitation de leurs conditions de production. Quelles que soient les configurations d’enquête, l’enquêteur, en pratique, n’est jamais absent. Le contexte de l’énonciation ou de l’observation n’est jamais neutre, sauf à penser qu’il puisse y avoir des lieux et des moments en apesanteur sociale.
L’analyse réflexive des situations d’enquête conduit donc à interroger la photographie dans la démarche d’enquête au même titre que les autres dimensions constitutives de celle-ci. Montrer des photographies en entretien n’est ni neutre ni sans conséquence sur le mode de questionnement, la dynamique de l’enquête et évidemment les données d’enquête ainsi produites. C’est donc avec une certaine naïveté que l’exercice est affirmé stimuler l’expression, alléger le questionnement, faire disparaître les malentendus culturels ou réduire le caractère intimidant de l’entretien. Le caractère socialement déterminé des photographies montrées, le corpus dans lequel elles sont insérées, le moment ou la manière dont elles sont montrées peuvent tout à fait questionner, déranger, intriguer, stimuler, etc. ; bref, laisser les interviewés sans voix, tout comme les rendre enthousiastes et diserts, les modalités d’acceptation ou de refus de l’exercice étant bien sûr toutes intéressantes à analyser pour la compréhension de l’objet.
Si l’on ne peut que souscrire à la fécondité heuristique de l’utilisation de la photographie en entretien, il conviendrait de se prévaloir de toute posture naïve à son égard. La voie promotionnelle de cette technique d’enquête n’a vraiment rien à gagner à entrer dans l’argumentaire classique sur l’efficacité comparée des techniques de neutralisation de la situation d’enquête, aussi vieille que l’histoire des sciences sociales et toujours aussi stérile. Si on peut effectivement attribuer des possibilités heuristiques indéniables à l’usage de la photographie en entretien, il n’y a pas lieu pour autant de lui prêter une efficacité supérieure dans le processus de production de données en sciences sociales : ni facilitation de la démarche de recherche ni données d’enquête de qualité supérieure… À condition donc d’interroger « ce que faire parler à partir d’images veut dire » dans la démarche de recherche, même et y compris lorsque cela ne marche pas ou pas comme on avait prévu, la photographie compléterait souvent bien utilement la boîte à outils ordinaire du sociologue.
Parties annexes
Note
-
[1]
Tous les extraits d’articles anglophones cités dans l’article ont été traduits en français.
Bibliographie
- Amselle, J.-L. (1990). Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs. Payot.
- Bigando, E. (2013). De l’usage de la photo elicitation interview pour appréhender les paysages du quotidien : retour sur une méthode productrice d’une réflexivité habitante. Cybergeo : European Journal of Geography. Politique, Culture, Représentations, document 645. https://doi.org/10.4000/cybergeo.25919
- Bignante, E. (2010). The use of photo-elicitation in field research. EchoGéo, (11). https://doi.org/10.4000/echogeo.11622
- Bourdieu, P. (1965). Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Minuit.
- Bourdieu, P. (1980). Le sens pratique. Minuit.
- Bourdieu, P. (1993). La misère du monde. Seuil.
- Braizaz, M., Toffel, K. Tawfik, A. et Longchamp, P. (2020). Montrer son corps, parler de son sport : Usages de la photo elicitation auprès d’ex-sportives et ex-sportifs de haut niveau. Staps, 3(129), 99-115.
- Bunster, X. (1978). Talking Pictures : A Study of Proletarians Mothers in Lima Peru. Studies in the Anthropology of Visual Communication, 5(1), 37-55.
- Collier, J. (1967). Visual Anthropology : Photography as a Research Method. Holt, Rinehart & Winston.
- Copans, J. (1974). Critiques et politiques de l’anthropologie. Maspero.
- Croghan, R., Griffin, C., Hunter, J. et Phoenix, A. (2008). Young People’s Constructions of Self : Notes on the Use and Analysis of the Photo-Elicitation Methods, International Journal of Social Research Methodology, 11(4), 345-356.
- Cuche, D. (1996). La notion de culture dans les sciences sociales. La Découverte.
- Devereux, G. (1980). De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement. Flammarion. (Version originale publiée en 1967)
- Epstein, I., Stevens, B., Mc Keever, P. et Baruchel, S. (2006). Photo elicitation interview (PEI) : Using photos to elicit children’s perspectives. International Journal of Qualitative Methods, 5(3). https://doi.org/10.1177/16094069060050030
- Griaule, M. (1957). Méthode de l’Ethnographie. PUF.
- Harper, D. (1986). Meaning and Work : A Study in Photo-Elicitation. Current Sociology, 34(3), 24-46.
- Harper, D. (2002). Talking about pictures : a case for photo elicitation. Visual Studies, 17(1), 13-26.
- Harper, D. (2003). Framing photographic ethnography. A case study. Ethnography, 4(2), 241-266.
- Hopkins, L. et Wort, E. (2020). Photo Elicitation and Photovoice : How Visual Research Enables Empowerment, Articulation and Dis-Articulation. Ecclesial Practices, 7, 163-186.
- Hummel, C. (2017). Porter un regard photographique sur le vieillissement en couvent. Que disent les frontières mouvantes du « photographiable » ?. ethnographiques.org, (35). https://doi.org/10.25667/ethnographiques/2017-35/003
- Jacknis, I. (1984). Franz Boas and Photography. Studies in Visual Communication, 10(1), 2-60.
- La Rocca, F. (2007). Introduction à la sociologie vsuelle, Sociétés, (95), 33-40.
- Legavre, J.-B. (1996). La « neutralité » dans l’entretien de recherche. Politix, (35), 213.
- Leiris, M. (1969). Cinq études d’ethnologie. Denoël-Gonthier. (Version originale publiée en 1951)
- Loeffler, T. A. (2004). A Photo Elicitation Study of the Meanings of Outdoor Adventure Experiences. Journal of Leisure Research, 36(4), 536-556.
- Maget, M. (1953). Guide d’étude directe des comportements culturels. CNRS.
- Malinowski, B. (1985). Journal d’ethnographe. Seuil. (Ouvrage original publié en 1967)
- Malinowski, B. (1989). Les argonautes du Pacifique occidental. Gallimard. (Ouvrage original publié en 1922)
- Maresca, S. et Meyer, M. (2013). Précis de photographie à l’usage des sociologues. PUR.
- Mauger, G. (1991). Enquêter en milieu populaire. Genèses, (6), 125-143.
- Meo, A. (2010). Picturing Students’ Habitus : The Advantages and Limitations of Photo Elicitation Interviewing in a Qualitative Study in the City of Buenos Aires. International Journal of Qualitative Methods, 9(2), 149-171.
- Meyer, M. (2017). La force (é)vocative des archives visuelles dans la situation d’enquête par entretiens. Une étude par photo-elicitation dans le monde ambulancier. Revue Française des Méthodes Visuelles, (1). https://rfmv.u-bordeaux-montaigne.fr/numeros/1/articles/la-force-evocative-des-archives-visuelles-dans-la-situation-d-enquete-par-entretiens/
- Naville, P. (1966). Instrumentation audio-visuelle et recherche en sociologie. Revue française de sociologie, (7), 158-168.
- Norlund, A. (2021). Using Photo Elicitation Interviews to Explore Newly Arrived Pupils’ Social and Academic Experiences. Nordic Journal of Migration Research, 11(2), 202-219. https://doi.org/10.33134/njmr.410
- Olivier de Sardan, J.-P. (1995). La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie. Enquête, (1), 71-109.
- Papinot, C. (2007). Le malentendu productif. De quelques photographies énigmatiques comme supports d’entretien. Ethnologie française, (1), 79-86.
- Papinot, C. (2012). La photographie dans la démarche de recherche en sciences sociales. Déclinaisons historiques et persistance de neutralisation des situations d’enquête. Revue de l’Institut de sociologie, (1-4), 39-54.
- Papinot, C. (2013). « Erreurs », « biais », « perturbations de l’observateur » et autres « mauvais génies » des sciences sociales. Sociologies. https://doi.org/10.4000/sociologies.4534
- Papinot, C. (2014). La relation d’enquête comme relation sociale. Épistémologie de la démarche ethnographique. Presses de l’Université Laval.
- Papinot, C. (2017). La machine à café, l’atelier et la chaîne. Quelques réflexions sur l’usage de la photographie comme support d’entretien. Images du travail Travail des images, (3). https://doi.org/10.4000/itti.1083
- Papinot, C. et Meyer, M. (2017). Le travail des images dans la démarche de recherche. Analyse réflexive et compréhension de l’objet. Images du travail, travail des images, (3). https://doi.org/10.4000/itti.1053
- Raby, R., Lehmann, W., Helleiner, J. et Easterbrook, R. (2018). Reflections on Using Participant-Generated, Digital Photo-Elicitation in Research With Young Canadians About Their First Part-Time Jobs, International Journal of Qualitative Methods, 17, 1-10.
- Rouillé, A. et Marbot, B. (coll.) (1986). Le corps et son image — Photographies du dix-neuvième siècle. Contrejour.
- Samuels, J. (2004). Breaking the Ethnographers’ Frames. Reflections on the Use of Photo Elicitation in Understanding Sri Lankan Monastic Culture. American Behavioral Scientist, 47(12), 1528-1550.
- Schwartz, D. (1989). Visual Ethnography : Using Photography in Qualitative Research. Qualitative Sociology, 12(2), 119-154.
- Schwartz, O. (1993). L’empirisme irréductible. Dans A. Nels (dir.), Le hobo. Sociologie du sans-abri (p. 265-308). Nathan.
- Shaw, D. (2013). A New Look at an Old Research Method : Photo-Elicitation », TESOL Journal, vol. 4, n° 4, p. 785-799.
- Terrenoire, J.-P. (1985). Images et sciences sociales : l’objet et l’outil. Revue française de sociologie, 26, 509-527.
- Trépos, J.-Y. (1996). Des images pour faire surgir des mots : puissance sociologique de la photographie. L’Année sociologique, 65(1), 191-223.
- Twine France, W. (2006). Visual ethnography and racial theory : Family photographs as archives of interracial intimacies. Ethnic and Racial Studies, 29(3), 487-511.
- Woodward, R. et Jenkings, N.K. (2011). Military identities in the situated accounts of British military personnel. Sociology, 45(2), 252-268.
- Xanthe, G., Inder, K., Kable, A. et Hazelton, M. (2017). Visual Methodologies in Qualitative Research : Autophotography and Photo Elicitation Applied to Mental Health Research. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1-8.
Liste des figures
Bronisław Malinowski among Trobriand tribe