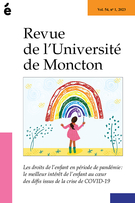
Revue de l'Université de Moncton
Numéro hors-série, 2005 Des actes sélectionnés du 30e Congrès international sur Byron « Byron and The Romantic Sublime » Sous la direction de Paul M. Curtis
Sommaire (21 articles)
Keynote Address
-
Genres of the Sublime: Byronic Tragedy, Manfred, and “The Alpine Journal” in the Light of some European Contemporaries
Ian Balfour
p. 3–25
RésuméFR :
Cet article aborde un aspect négligé des écrits sur le sublime : celui du genre. Je ferai valoir que les critiques abordent trop souvent le sublime comme s’il opérait transcendentalement par rapport à ses instantiations, cherchant peu à comprendre comment le mode du sublime s’agence avec les genres à l’intérieur desquels il est encodé.
Quand Byron gravite vers le sublime, il a tendance à le faire dans le mode tragique. Les prédicats traditionnels de la sublimité (l’infinité, l’obscurité, l’ineffable, etc.) s’appliquent bien à des oeuvres comme celle de Manfred, la réécriture chargée du Faust de Goethe, dans laquelle rien de moins sinistre n’est présenté dans la forme d’un personnage dramatique. Dans cet article, je situerai les réussites de Byron en tragédie par rapport à celles de ses contemporains européens. Celles-ci seront également examinées à la lumière de réflexions sur la tragédie et le sublime des idéalistes allemands.
Byronic Transformations of the Sublime
-
The Shakespearean Sublime and the Reception of Byron’s Writing
Jane Stabler
p. 27–39
RésuméFR :
Cet article explore la possibilité que la nouvelle critique de Shakespeare, survenue vers la fin du dix-huitième siècle, ait pu aider à définir un sublime anglais qui conditionnait la réception de l’oeuvre de Byron et la perception de Byron dans un sens plus large. Au cours du dix-huitième siècle, ces mêmes caractéristiques qui avaient été classées par les critiques comme des défauts chez Shakespeare (emploi de superstitions primitives, rudesse, inégalités, digressions, contrastes abrupts) devinrent peu à peu admirées comme étant la preuve de la fidélité de Shakespeare à la nature, de sa pénétration psychologique et de son imaginaire sublime. Divergeant de l’association primaire par Edmund Burke du sublime et de la terreur, le sublime anglais de Shakespeare récupérait les défauts du climat anglais et montraient le potentiel moral et esthétique caché d’un mode déviant sublime. Suivant un aperçu des courants conflictuels de la critique de Shakespeare (axé surtout sur une discussion de Antony and Cleopatra), j’analyserai les moyens par lesquels les critiques contemporains de Byron (et Byron lui-même) adaptaient l’application du sublime shakespearien dans l’oeuvre de Byron ou bien y résistaient.
-
‘Congenial with the Night’: The Sublime and Byron’s Tragedies
Yoshie Kimura
p. 41–50
RésuméFR :
Cet article fait valoir que le sentiment du sublime joue un rôle quasi-dramatique dans les tragédies de Byron, et surtout dans Marino Faliero et Sardanapalus. Marino Faliero est une pièce axée sur une injure subie par Marino dans sa vie familiale qui pousse le Doge à participer à la Révolution et ce, dans un temps et un lieu bien précis. La pièce montre également une conscience aiguë de la position élémentaire et sublime de Venise dans le cosmos qui forme une sorte d’arrière-trame à l’action locale. Cet arrière-plan sublime relativise et exalte l’action de la pièce. Nous prêterons une attention particulière au monologue de Lioni au début de l’acte IV et à la malédiction prophétique proférée par Marino contre Venise à la conclusion de la pièce.
Pour poursuivre cet argument, Sardanapalus présente un roi qui évite délibérément tout sentiment du sublime associé à la vie d’une nation. Or, à la conclusion de l’intrigue, lorsque ce dernier s’enlève dramatiquement la vie, il déclare comme Manfred qu’il est « on the brink » et qu’il sent « an inward shrinking ». Ainsi, on voit qu’il s’aventure vers l’Abysse et qu’il accepte de vivre un rapport sublime à l’histoire qu’il transcende.
-
How Sublime (and Prolific) was Byron? What the Reviewers Said
Charles E. Robinson
p. 51–62
RésuméFR :
Cet article propose un survol des livres, des articles et des critiques (et lettres) écrits sur Lord Byron et son oeuvre de son vivant et peu de temps après sa mort, soit de 1807 à 1830 environ, de sorte à déterminer à quel point les contemporains de Byron le trouvaient « sublime ». Walter Scott, en faisant le compte rendu de Childe Harold 4, affirmait avec enthousiasme qu’il s’agissait de « la poésie la plus sublime », mais d’autres, comme William Hazlitt, étaient d’avis que « l’auteur de Childe Harold et de Don Juan est… un poseur, encore qu’il soit provoquant et sublime ». En parlant de Don Juan, John Wilson Croker s’exclamait quant à lui : « Quelle sublimité! quelle légèreté! quelle audace! quelle tendresse! quelle majesté! quelle insignifiance! quelle variété! quel ennui!1 ». Ma discussion sur un grand nombre de ces jugements sur l’oeuvre de Byron par ses contemporains nous permettra de determiner si le terme « sublime » définit adéquatement l’esprit de la poésie de Byron, surtout ce « sublime » tel qu’il a été compris par Longin, Burke et d’autres.
The Sublime of Byronic Tragedy
-
Manfred and the Sublime
Itsuyo Higashinaka
p. 63–74
RésuméFR :
Dans sa Dédicace à Don Juan (strophe 10), Byron s’exprime sur Milton en expliquant que le mot « Miltonique » est devenu synonyme du sublime à cause de la façon que choisissait de vivre Milton le poète et l’homme. Selon Byron, Milton est resté fidèle à son crédo politique et religieux malgré l’opposition de ses contemporains, suivant la Restauration. Aux yeux de Byron, il y a quelque chose de très sublime et grand dans la conduite de Milton, « le vieillard aveugle1 », qui vivait une situation difficile alors qu’il était « défait, pâle et pauvre2 ». Cette perspective sur Milton rappelle une création de Byron, Manfred, qui reste fidèle à son crédo jusqu’à la fin et choisit de mourir plutôt qu’accepter toute intervention du clergé ou de l’Église qui puisse le sauver. Dans ses Observations sur le sentiment du beau et du sublime, Kant explique que l’homme mélancolique « a surtout le sentiment du sublime3 ». On peut se demander si Kant expliquait certaines des caractéristiques du héros de Byron. Il est certainement vrai que Manfred, comme Kant le souligne ailleurs, « brave le danger et méprise la mort ». Avant de mourir, il prononce ces derniers mots : « Vieillard! Ce n’est pas si difficile, mourir . . .4 » À cet égard, l’attitude du samurai japonais face à la vie et à la mort nous rappelle la notion du sublime. Le samurai est souvent prêt à s’engager dans une bataille perdue d’avance et à y laisser sa vie afin de rester fidèle à son credo. Une telle attitude nous apparaît « sublime ». Selon Kant, « soumettre ses passions par des principes est sublime ».
Une autre caractéristique de Manfred en termes du concept du sublime repose sur le lieu dans lequel se déroule le drame, qui relève du sublime à son tour. En effet, Byron choisit comme lieu de l’action « les Hautes-Alpes5 ». Ainsi, on y trouve plusieurs scènes que Burke et Kant pourraient appeler des exemples du « sublime-terrible ». Autrement dit, Manfred est une oeuvre dans laquelle le décor et l’état d’esprit du protagoniste peuvent être qualifiés de sublime.
The Sculptural, Pictorial and Sartorial Sublime
-
Bend it Like Byron: The Sartorial Sublime in Byron, Bonaparte, and Brummell, with Glances at Their Modern Progeny
John Clubbe
p. 75–91
RésuméFR :
Cet article prend pour point de départ une déclaration surprenante de Byron selon laquelle les trois plus grandes figures de son époque étaient lui-même, Napoléon Bonaparte et George Brummell — le plus grand des trois étant le dandy Brummell du Regency. Aujourd’hui, on dit de Byron qu’il est l’un des grands poètes de la littérature mondiale, et les gens s’intéressent encore beaucoup à ses écrits (on trouve à l’heure actuelle des sociétés byroniennes dans plus de trente pays). On dit de Napoléon qu’il est l’un des plus grands génies politiques et militaires de tous les temps; et Brummell — il semblerait n’être qu’une figure historique connue de ses contemporains pour sa mine grave et dédaignante puis son style vestimentaire impeccable. Pourtant, Byron avait raison : l’impact de Brummell sur la société d’aujourd’hui perdure beaucoup plus que celui du poète ou de l’empereur. On n’a qu’à regarder les publicités que referment nos magazines et nos journaux. Le style, c’est tout; tout relève du style. Les mannequins nous font la moue, imitant Brummell sans le savoir, nous regardent d’un air hautain. L’obsession de notre société pour les marques de commerce tire son origine de la fascination que stimulait un dandy du Regency à l’endroit du style personnel et des parures particulières il y a de cela près de deux cent ans. Cet article, un exercice en relativisme culturel entre l’époque de Byron et la nôtre, explore pourquoi Byron aurait proposé une telle juxtaposition — et pourquoi son assertion sur la primauté de Brummell s’est avérée être d’une étonnante précision.
-
Byron, Hobhouse, Thorvaldsen and the Sculptural Sublime
Christine Kenyon Jones
p. 93–114
RésuméFR :
Cet article, accompagné d’illustrations, aborde l’approche de Byron à la sculpture. Malgré ce qu’il pouvait penser de son aptitude en arts visuels, je montrerai que Byron avait un engagement très informé à l’endroit de l’esthétique qui régissait la sculpture à son époque, surtout en ce qui a trait au débat entre le naturalisme et l’idéalisation. Ce débat est passé au premier plan en Angleterre à partir de 1807 surtout, lorsque le Lord Elgin amenait en Angleterre les marbres du Parthenon dans l’espoir de les vendre au gouvernement britannique. Au début de 1816, un rapport parlementaire sur l’achat éventuel des marbres fait une distinction entre le naturalisme des figures de la collection d’Elgin et l’Apollon du Belvédère, « la représentation la plus élevée et la plus sublime de la forme idéale et de la beauté que n’a jamais concrétisé la Sculpture1 ».
Le buste de Bertel Thorvaldsen et la statue commémorative de Byron sont les oeuvres d’art les plus distinguées qui soient associées au portrait du poète, et ont été créées par un artiste bien en vue du milieu artistique en Europe. Cet article place la commande du buste par Hobhouse et l’engagement de Byron au processus dans le contexte du débat entre la forme naturaliste et sublime, débat dans lequel s’entremêlaient les préoccupations esthétiques des disciples du néoclassicisme, de Burke et du romantisme à l’égard du napoléonisme et des politiques de l’ère post-révolutionnaire. La discussion portera également sur les lettres écrites par Hobhouse à Thorvaldsen en 1829 (en français), jamais publiée dans aucune autre étude sur Byron, dans lesquelles on peut lire une description physique de Byron par Hobhouse.
-
Byron, Delacroix and the Oriental Sublime
Naji Oueijan
p. 115–125
RésuméFR :
Parmi les artistes de l’ère romantique, Delacroix se distingue par sa fine perception du sublime oriental dans l’oeuvre de Byron. Il était attiré par les scènes tragiques de Byron qui dépeignaient les instants les plus intenses, les plus périlleux et les plus passionnés de la vie de l’homme. Un grand nombre des tableaux de Delacroix ont été inspirés par l’oeuvre de Byron; dans cet article, cependant, mes observations se limiteront à l’illustration de scènes de violence tirées de The Giaour. De telles scènes produisent l’expérience du sublime oriental qui, selon Delacroix, forme la base esthétique des contes orientaux de Byron. Avant d’entamer une discussion sur le sublime dans les oeuvres de Byron et de Delacroix, je fournirai quelques balises théoriques sur les normes du sublime en rapport aux scènes de violence entourant la rencontre du Soi avec l’Autre, différent. J’entends non seulement révéler l’importante influence de Byron sur Delacroix, mais aussi montrer comment et pourquoi Byron et Delacroix ont réussi à évoquer le sublime oriental dans leurs oeuvres. Le concept du héros chez Byron, celui du héros occidental et oriental, vivant des instances de violence horrifiante dans un lieu oriental, sera analyser à la lumière de l’impact émotif et érotique sur la stimulation du sublime oriental.
The Romantic Sublime on Stage and Film
-
Performing Byron: Alongside Liszt, Chopin, and Keats
Janet Hammock et Robert Lapp
p. 127–139
RésuméFR :
Que se produit-il quand Childe Harold’s Pilgrimage est présenté à voix haute ? Quels effets produit une juxtaposition des Années de pèlerinage de Liszt et des passages de Childe Harold qui l’ont inspiré ? Quelles caractéristiques partagent « l’Ode to a Nightingale » de Keats et la Nocturne op. 9 no 3 en si majeur de Chopin ? Voilà autant de questions que soulève un récital de poésie et de musique au piano par les professeurs Janet Hammock et Robert Lapp de l’Université Mount Allison. Hammock et Lapp collaborent depuis 2002, unis par un désir de partager leur expertise en musique et en littérature de l’ère romantique avec un public plus vaste. Le résultat : un répertoire formé de juxtapositions thématiques, dont deux qui seront présentées le 16 août 2005 : les pèlerinages parallèles de Byron et de Liszt, puis les « nocturnes » de Keats et de Chopin. Le récital sera suivi de réflexions sur les conséquences de cette collaboration interdisciplinaire, qu’il s’agisse de découvertes interprétatives faites au cours de la mémorisation ou du rôle du contexte de la représentation.
-
Byron and the Greek Sublime
Peter W. Graham
p. 141–147
RésuméFR :
Le destin aura voulu que le premier paysage sublime grec qu’a vu Byron depuis la terre ferme soit également le dernier sur lequel ont reposé ses yeux avant sa mort : les paysages terrestres et maritimes de la ville de Messolonghi, un mélange de montagnes rocailleuses et des plateaux marécageux surmontés d’un ciel vaste aux lumières changeantes reflété dans les eaux calmes d’un lagon et les eaux plus troubles du golfe de Patras. Malgré d’importants changements apportés à la ville elle-même au cours du dernier siècle, le paysage terrestre et les lagunes de Messolonghi restent à peu près inchangés. Suivant une brève présentation sur l’histoire et la géographie de la région, nous regarderons un court-métrage sur le sublime paysage d’Étolie-Akarnanie qui entourait Messolonghi à l’époque de Byron et qui, en grande partie intacte, l’entoure encore.
Byronic Variations on the Sublime
-
The Prolix Sublime
Shobhana Bhattacharji
p. 149–162
RésuméFR :
Prolixe : qui est trop long et verbeux (de prolixus « allongé », pro « en avant », liquidus « liquide »).
Prolifique, fertile, fécond, abondant (de proles « descendance » et -fique).
Byron était généreux avec ses mots. Il traduisait sa vie (plutôt qu’en faire la transcription) par des lettres, des journaux intimes et des vers; il enrobait ses vers de préfaces et de notes écrites en prose; il écrivait des critiques et des lettres aux éditeurs; il ne pouvait ni ne voulait-il terminer ses longs poèmes, disant qu’il y ajouterait peut-être quelque chose plus tard; il lui arrivait d’écrire sur un seul événement dans plus d’une demi-douzaine de lettres adressées à diverses personnes; il notait une idée dans son journal et l’étirait pour en faire une pièce de théâtre; son épouse, peu admiratrice, le traitait de monarque des mots; ceux qui le connaissaient se souviennent de l’infinie variété de ses conversations « sans réserves ». Il trouvait plaisir dans les mots et aimait les étirer dans toutes les directions : interrompant le flux de la narration dans Childe Harold’s Pilgrimage pour y insérer des méditations, faisant de longues digressions dans Don Juan, jouant sur les mots des autres, gonflant ses écrits de citations. Et pourtant, ses longs poèmes et sa prose abondante coulent à flots dans une profusion du langage. Il faut aussi se rappeler que Byron était un écrivain populaire. Les lecteurs de l’époque devaient donc apprécier son caractère prolixe, fécond. En 1909, A. C. Bradley faisait valoir que les poètes de l’époque de Wordsworth n’avaient pas le talent d’écrire de longs poèmes, et qu’ils ne faisaient qu’enfiler des paroles sur une ficelle de vers tout au plus ordinaires. À la manière de son époque, Bradley supposait que le goût des gens s’était amélioré avec le temps et que les Victoriens qui avaient succédé à Byron pouvaient apprécier la bonne poésie, contrairement à Byron et ses contemporains. Selon moi, l’écriture copieuse de Byron était délibérée, une sorte de principe de créativité. Un peu avant Bradley, J. A. Symonds affirmait qu’il nous fallait, pour juger de la grandeur d’un poète, une vaste quantité de mots et de poèmes de sa plume. Est-ce pourquoi Byron écrivait tant? Ou croyait-il, comme Burke, qu’une « idée claire, c’est . . . une autre façon de nommer une petite idée1 »? Associait-il au sublime une plénitude de mots? L’abondance de mots n’est pas toujours synonyme de longs poèmes, pas plus qu’il y a un seul point de vue critique sur le bien ou mal-fondé du non-minimalisme. Mais dans sa pratique de la profusion, Byron semble avoir absorbé quelques-unes des attitudes des poètes qui le précédaient immédiatement et anticipé sur celles des poètes de la fin du vingtième siècle.
-
Byron, The Suffragettes and Romancing the Sublime
Gale Bouchard
p. 163–175
RésuméFR :
« Fou, voyou, une dangereuse connaissance2 » : voilà ce qu’aurait pu dire une femme en parlant du Lord Byron comme entité sexuelle. Mais qu’aurait-elle dit de lui dans son rôle de poète? Était-il aussi dangereux? M’inspirant de recherches récentes sur le mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne, sur le militantisme des suffragettes et l’importance des mots dans leur cause, je ferai valoir dans cet article que les féministes étaient radicalement attirées à Byron. Les suffragettes avaient adopté le cri de guerre « De la parole aux actes », mais celui-ci s’avérait être une lame à double tranchant. La parole, et pas seulement les actes, était d’une importance vitale à Emmeline Pankhurst et ses disciples, et les paroles de Byron figuraient parmi celles qu’elles préféraient. Plus d’une fois, le Lord Byron se trouvait à la scène d’un crime commis par les suffragettes. Celles-ci avaient inscrit « Ceux qui veulent être libres doivent s’affranchir de leurs propres mains3 » (Childe Harold 2. 76) sur des bouts de papier qu’elles avaient fixés avec de la corde aux pierres destinées aux fenêtres du palais de Westminster – pierres qui furent lancées, avec un flair byronnien, par des mains vêtues de gants et parées de plumes. Lord Byron, donc, l’irrépressible coureur de jupons de l’ère romantique, serait l’instigateur de la première vague du mouvement féministe.
Childe Harold’s Pilgrimage
-
Soil and Sublimity in Childe Harold’s Pilgrimage
Michael R. Edson
p. 177–187
RésuméFR :
Cet article commence par une brève description des moyens par lesquels la terminologie et les conventions régissant la description de paysages sublimes informent le discours géologique de la fin du dix-huitième et du début du dix-neuvième siècle, tel qu’exemplifié par Theory of the Earth de James Hutton (1789) et Essays on the Theory of the Earth de Georges Cuvier (1813). Je ferai ensuite valoir que les réflexions de Byron sur l’érosion graduelle mais inévitable des empires et des cultures dans Childe Harold’s Pilgrimage et The Age of Bronze montrent une perspective (in)formée par la géologie, et que le sublime, dans ces poèmes, est produit par la rencontre avec les processus historiques et le temps géologique, qui sont vastes, auto-anéantissants et inimaginables. Dans ces poèmes, non seulement la description par Byron de l’être humain fait d’argile renvoie aux origines et au destin ultime de notre substance corporelle, elle associe l’humain (le culturel) à la strate érodée et soulevée par les forces naturelles et incontenables. Dans ces poèmes, les lieux physiques deviennent temporels; les ruines, souvent associées au pittoresque, deviennent sublimes. Elles ne sont pas de terrifiants symboles du transitoire culturel ou de l’insignifiance de l’être humain, mais plutôt des affleurements minéralisés et exposés temporairement dans lesquels le sujet percevant (le narrateur, puis le lecteur par la suite) peut lire le passage du temps et contempler l’éventualité horrifiante de sa propre désintégration et de sa mort.
-
The Rise of the Sublime and the Fall of History
Vitana Kostadinova
p. 189–202
RésuméFR :
Cet article explore l’engagement de Byron à l’endroit du sublime dans le chant 2 de Childe Harold’s Pilgrimage, contre l’arrière-plan de son traitement dans ses poèmes de l’histoire et de la correspondance entre l’expérience personnelle et les processus historiques. Sur le plan théorique, il prendra appui sur la discussion par Kant du sublime, selon qui nous jugeons quand nous évaluons les objets; le concept sera lié au relativisme esthétique et éthique introduit au dix-huitième siècle. L’argument sera centré sur les instances de parallélisme (produits par la métaphore et la comparaison) entre l’objet sublime et l’esprit de la personne qui le contemple.
Water, Wings and Wrath
-
Lord Byron : Du Parnasse à l’Océan, errance romantique et geste sublime
Christiane Vigouroux
p. 203–217
RésuméFR :
Le sublime est à la mode . . . il l’est à Paris et chez les théoriciens, qui s’y réfèrent souvent depuis quelques années (Marin, Derrida, Lyotard et quelques autres), aussi bien qu’à Los Angeles et chez les artistes, lorsque l’un d’eux intitule ‘The sublime’ une récente exposition . . . . On trouverait d’autres témoignages à Berlin, Rome ou Tokyo. (Sans parler de l’usage du mot sublime dans la langue la plus courante !).
-
Longinus, Sappho’s Ode, and the Question of Sublimity
Peter Cochran
p. 219–232
RésuméFR :
De prime abord, cet article peut sembler porter sur les attitudes à l’endroit de l’autorité des anciens, mais il porte en fait sur l’ironie du ton et sur la difficulté qu’on peut avoir à la déceler, même quand le locuteur ou l’écrivain est un de nos proches. Dans Don Juan, chant premier, strophe 42, par exemple, Byron écrit : « je ne crois pas que l’ode de Sapho soit d’un bon exemple, quoique Longin prétende qu’il n’est point d’hymne où le sublime prenne un essor plus élevé . . .1 », suite à quoi il cite des passages du pseudo-Longin auquel il fait référence. Dans les marges de l’épreuve, J. C. Hobhouse le corrige — ou du moins il tente de le faire — en proposant une autre interprétation de ce qu’entend Longin, différente de celle que communique la strophe de Byron. Dans les marges de la même épreuve, Byron réagit « robustement » comme il avait parfois l’habitude de le faire et refuse d’apporter les modifications proposées.
Dans cet article, j’examinerai les deux attitudes qu’illustre le micro-argument entre Hobhouse et Byron à l’égard de l’autorité classique, et je verrai ce qu’on peut en déduire sur la difficulté qu’avaient les tout premiers lecteurs de Don Juan à cerner le ton de Byron et son attitude à l’égard de l’autorité et au précédent. Ce faisant, j’espère nous donner une idée de ce qu’aurait pu signifier le terme « sublime » pour (1) Byron avant Don Juan, (2) Byron à l’ère de Don Juan, et (3) un lecteur conservateur comme Hobhouse (qui représente le lecteur averti moyen vers 1819). J’examinerai également ce qu’aurait pu être la signification de l’Ode de Sapho pour chacun de ces deux hommes, et je me demanderai si la nature même de l’ode a une incidence sur notre perception de ce qu’entend Byron en parlant du « Sublime ».
-
Byron, Milton, and Psalms: Sublime Wrath, Poetic Justice
Joan Blythe
p. 233–249
RésuméFR :
Dans les Psaumes, la violence et les terribles malédictions se trouvent parfois juxtaposés par le biais du langage à quelques-uns des plus beaux passages poétiques en Occident. Un aspect important de cette association est le lien entre le phénomène sublime de la colère de Dieu — dirigée soit vers le narrateur-psalmaudier, soit vers les ennemies de ce dernier — et le droit poétique. Je ferai valoir qu’on retrouve souvent cette dynamique dans les oeuvres de Milton et de Byron, deux auteurs dont la conscience poétique était imbue des Psaumes. De façon générale, la dette qu’avait Milton à l’endroit des Psaumes a souvent été soulignée; or, on a largement négligé l’influence de la violence de ces textes sur sa langue. Pour ce qui est de Byron, on a peu étudié ce dernier à cette lumière, peut-être parce qu’il fait peu directement référence aux Psaumes. Pourtant, sa poésie regorge de leur influence. Cet article explore, depuis la perspective de la psychologie et du langage sublime des Psaumes, la passion de Milton et Byron pour la justice sociale et la très forte croyance qu’ils avaient en leurs talents poétiques singuliers.
Aesthetics and Intertextuality
-
Byron in 1816 and the Intertextual Sublime
Terrance Riley
p. 251–264
RésuméFR :
« Churchill’s Grave » et « Monody on the Death of Sheridan » sont les premiers textes à indiquer que Byron commençait à songer sérieusement aux aspects métaphysiques de l’identité de l’auteur. L’immortalité ambiguë qui s’attache au nom d’un poète, un thème mineur ayant toujours subi un traitement conventionnel, devient un thème majeur pendant les huit dernières années de la vie de Byron. « Churchill’s Grave » et les autres écrits de 1816 surtout témoignent d’une plus grande sensibilité à la textualité du poème. Aussi « personnels » ou passionnés qu’auraient pu être ces textes dans la vie naturelle de l’auteur, tous les écrits publics glissent immédiatement vers une sphère intertextuelle dans laquelle l’identité naturelle devient un marqueur sans vie, un « nom » assujetti à d’innombrables appropriations et réappropriations. Les deux poèmes ont formé le style qu’adoptera Byron par la suite puis la façon dont il abordera la célébrité et la notoriété.
-
‘An awful wish to plunge within it’: Byron’s Critique of the Sublime
Bernard Beatty
p. 265–276
RésuméFR :
Cet article porte sur deux aspects importants. Le premier est le sens du sublime depuis Longin jusqu’à la résurrection de Longin par Boileau, soit le sublime que connaissait Byron (pas celui de Kant); le second concerne la citation suivante, de Byron : « c’est le sublime de cette sorte d’écriture-là1 ». Boileau et Longin soulignent ce qui est noble et qui élève l’esprit, tandis que le « cette sorte-là » de Byron est humble, contingent et fondé sur des bases empiriques. Je ferai valoir que la phrase « sorte d’écriture » lie les deux aspects, car même si Byron saisit intuitivement le nouveau sublime dont il fait la promotion tout en soulignant le burlesque en parlant du « terrible désir de vous y plonger2 », il n’associe pas au sublime un modèle de conscience mais bien un type d’écriture. C’est dans l’abysse du langage et de la véritable profondeur ontologique que veut plonger Byron. Je soutiendrai que la clé à cette singularité se trouve dans la position religieuse particulière de Byron.



