Nous vous présentons un numéro thématique sur les relations école-familles immigrantes. Face aux multiples défis auxquels doit répondre l’école dans nos sociétés, l’intérêt pour la persévérance et la réussite scolaire des élèves est manifeste, autant à travers les énoncés de politique qu’à travers les thèmes de recherche. Ces derniers portent sur les conditions d’efficacité des politiques éducatives, de la gestion scolaire, de l’enseignement, de l’apprentissage, des environnements scolaires, de la socialisation familiale, des relations entre protagonistes institutionnels et individuels, etc., parmi ces relations, celles entre l’école et les familles, ou les acteurs scolaires et les parents font l’objet d’une attention particulière. Pour un élève, l’apprentissage est un processus de construction de sens pour lire, interpréter et interagir avec son environnement. Cependant, l’élève-enfant se meut dans des espaces de socialisation divers, dont la famille et l’école, qui influencent cette construction de sens. Donc faire avec l’élève se décline en parallèle avec faire avec sa famille. Se pose ainsi la nécessité pour l’école de transiger avec ce qu’on pourrait appeler la double culture de l’élève-enfant. Au Québec, par exemple, à la suite d’une réforme des programmes de formation des maîtres, le nouveau référentiel des compétences en formule une de cette façon : Établir des relations entre la culture seconde prescrite dans le programme de formation et celle des élèves (ministère de l’Éducation du Québec, 2001). La complexité de la relation institutionnelle école-famille a été très largement documentée (Bourdieu et Passeron, 1970) et continue à l’être (De Queiroz, 2005). Souvent, les attentes de l’école vis-à-vis de l’engagement des parents se posent plus en termes de soutien du parent à l’action de l’école. Si la recherche de ce soutien est légitime et nécessaire à la réussite scolaire de l’enfant, l’invitation du parent à la prise de parole ne devrait pas être que pure courtoisie mais nécessité (Favre et Montandon, 1989 ; Migeot-Alvarado, 2000). L’étude de la relation école-famille considère de plus en plus l’impact des autres espaces professionnels de prise en charge des besoins des familles et des enfants (Santé et services sociaux ; milieu communautaire et mouvement associatif) (Falconnet et Vergnory, 2001 ; Glasman, 2001). Cette relation se complexifie davantage dans le cas des familles immigrantes ou de minorités ethnoculturelles. L’école joue dans l’activation, la désactivation ou la modification de l’ethnicité et de ses frontières (Banks, 1988 ; Lorcerie, 2003 ; McAndrew 2001, Verhoeven, 2002). Également, la construction de sens pour l’élève immigrant, afin d’appréhender le monde à travers l’apprentissage, puise en partie dans son histoire migratoire, sa trajectoire scolaire et sa culture familiale, plus ou moins éloignées de la culture scolaire de la société d’accueil. Cette différence a été souvent interprétée sous l’angle du différend, de l’inconciliable, qui expliquerait les difficultés scolaires chez ces élèves. Lahire (1995) insiste cependant sur la possibilité pour les enfants de vivre ce qu’il appelle une schizophrénie heureuse, c’est-à-dire une articulation réussie entre ces deux cultures. Les conditions de cette réussite sont certainement liées à la reconnaissance et au respect mutuel des deux milieux en présence, qui font l’économie d’un jeu de disqualification réciproque (Kanouté, 2002 ; Bouteyre, 2004), à la concertation sur des balises éthiques, psychopédagogues et parfois juridiques (Hohl et Normands, 1996), tout autant qu’aux capacités adaptatives des enfants en question. En effet, la collaboration familles-écoles n’est pas qu’un duo : elle se joue dans un triangle où l’enfant acteur a une place essentielle, mais aussi dans un contexte où la communauté locale, sociale et politique colore les univers de possibles (Dagenais, 2003 ; Lorcerie, 2001 ; Manço, 2006 ; Vatz-Laaroussi, 2001 ; Verhoeven, 2002). Il existe de multiples façons familiales de se …
Parties annexes
Références
- Banks, J. A. (1988). Multiethnic education : theory and practice (2e édition). Boston, Massachusetts : Allyn et Bacon.
- Bourdieu, P. et Passeron, J. (1970). La reproduction. Paris, France : Éditions de Minuit.
- Bouteyre, E. (2004). Réussite et résilience scolaires chez l’enfant de migrants. Paris, France : Dunod.
- Dagenais, D. (2003). Accessing imagined communities through multilingualism and immersion education. Language, Identity and Education, 2(4), 269-283.
- De Queiroz, J.-M. (2005). L’école et ses sociologies. Paris, France : Presses universitaires de France.
- Falconnet, G. et Vergnory, R. (2001). Travailler avec les parents, pour une nouvelle cohésion sociale. Paris, France : ESF éditeur.
- Favre, B. et Montandon, C. (1989). Les parents dans l’école. Cahier no 30. Genève, Suisse : Service de la recherche sociologique, Département de l’instruction publique.
- Glasman, D. (2001). L’accompagnement scolaire. Sociologie d’une marge de l’école. Paris, France : Presses universitaires de France.
- Kanouté, F. (2002). Les profils d’acculturation d’élèves issus de l’immigration récente à Montréal. Revue des sciences de l’éducation, 28(1), 171-190.
- Lorcerie, F. (2003). L’école et le défi ethnique, éducation et intégration. Paris, France : ESF éditeur.
- Manço, A. (2006). Processus identitaires et intégration. Approche psychosociale de l’immigration. Paris, France : L’Harmattan.
- Migeot-Alvarado, J. (2000). La relation école-famille : peut mieux faire. Paris, France : Paris ESF.
- Ministère de l’Éducation (2001). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.
- Vatz Laaroussi, M. (2001). Le familial au coeur de l’immigration : stratégies de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France. Paris, France : L’Harmattan.
- Verhoeven, M. (2002). École et diversité culturelle. Regards croisés sur l’expérience scolaire de jeunes issus de l’immigration. Louvain-la-Neuve, Belgique : Academia Bruylant.

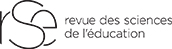
 10.7202/007154ar
10.7202/007154ar