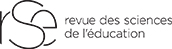Résumés
Résumé
Cette étude, organisée dans une perspective phénoménographique, décrit les conceptions d’apprentissage d’élèves de terminale et d’étudiants de maîtrise, recueillies à l’aide d’entrevues semi-directives. Les principaux résultats se réfèrent, d’une part, à la connaissance des diverses conceptions des étudiants et, d’autre part, aux similitudes et différences entre les conceptions émergentes des élèves des deux niveaux de scolarité. Apprendre est quelque chose d’extensif et de diversifié ; c’est un acte d’acquisition, d’incorporation et d’application de quelque chose d’extérieur au sujet et, en même temps, un acte transformateur de la pensée propre du sujet qui traverse toute l’existence et tous les contextes de vie. Les résultats présentés seront discutés en tenant compte de leurs implications dans le processus d’enseignement et d’apprentissage.
Mots clés:
- conceptions d’apprentissage,
- approches à l’apprentissage,
- perspective phéménographique
Abstract
This study, using a phenomenography perspective, describes students’ conceptions of learning at the “terminal” and at the master level, as obtained through the use of semi-structured interviews. The principal results are related to students’ knowledge of various conceptions, and on the other hand, to similarities and differences between students’ developing conceptions at these two levels of schooling. Learning is both an object that is extensive and diversified, it is an activity of acquisition, of incorporation, and of application of something outside of the individual and at the same time an activity that transforms an individual’s own thinking as he traverses life and all life’s contexts. The authors discuss the results in the light of their involvement in the teaching and learning process.
Resumen
Este estudio, organizado en una perspectiva fenomenográfica, describe las concepciones de aprendizaje de alumnos de Terminal y de estudiantes de Maestría, recolectadas por medio de entrevistas semidirectivas. Los principales resultados hacen referencia, por un lado, al conocimiento de las diversas concepciones de los estudiantes y, por otro lado, a las similitudes y diferencias entre las concepciones emergentes de los alumnos de los dos niveles de escolaridad. Aprender es algo extensivo y diversificado; es un acto de adquisición, de incorporación y de aplicación de algo exterior al sujeto y, al mismo tiempo, un acto transformador del pensamiento propio del sujeto que atraviesa toda la existencia y todos los contextos de vida. Los resultados presentados serán analizados tomando en cuenta sus implicaciones en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Corps de l’article
Introduction
La recherche phénoménographique traditionnelle a pour objectif d’enquêter sur les conceptions – ou formes qualitativement différentes – à partir desquelles les individus comprennent un phénomène donné. Ce sont ces conceptions qui constituent des unités de description dans ce domaine (Marton et Pong, 2005). Bien que la distinction entre les conceptions et l’expérience ne soit pas parfaitement claire, Marton (1983) considère qu’elles peuvent se distinguer si l’on considère la conception comme quelque chose qui se réfère à l’idée générale de ce que nous savons de notre expérience et de ses nombreux exemples, et l’expérience comme quelque chose de concret et lié à une situation et à un contenu particuliers. Chaque conception de l’apprentissage englobe des aspects référentiels (signification globale) et des aspects structurels (combinaison de traits qui furent différenciés et abordés) dialectiquement reliés (Marton, 1988 ; Marton et Pong, 2005). Les conceptions d’un phénomène donné divergent habituellement aussi bien au niveau de la manière dont ses parties sont délimitées et en relation les unes avec les autres (aspect structurel) qu’au niveau de la signification globale du phénomène (aspect référentiel). Le plus récent développement de la phénoménographie, désigné comme « Théorie de la Variation », se situe au niveau de l’aspect structurel d’une conception, c’est-à-dire dans l’analyse de sa structure interne (à l’intérieur de chaque conception) et non parmi les conceptions, comme il advient dans la phénoménographie traditionnelle (Marton et Pong, 2005).
La phénoménographie présente une vision non dualiste de la cognition humaine en décrivant l’expérience humaine comme une relation interne entre le sujet et le monde. Le monde de l’apprentissage et de l’enseignement émerge ainsi comme quelque chose d’essentiellement expérimenté et l’apprentissage est alors perçu comme une relation interne entre l’individu et le monde, lesquels se trouvent en rapport au travers de la conscience que l’individu possède de ce même monde (Prosser et Trigwell, 2000).
Dans cette perspective, l’apprentissage est un changement qualitatif dans la façon dont une personne voit, conceptualise, expérimente et comprend quelque chose dans le monde réel (Ramsden, 1988). Dans le domaine de la recherche sur l’apprentissage, le principe est donc de prendre la valorisation du regard de l’apprenti comme point de départ, en recueillant directement des données des élèves au travers d’autorécits et d’entrevues. L’objectif de cette recherche est de décrire qualitativement les différentes façons d’expérimenter l’apprentissage en mettant l’accent sur les significations dans la relation sujet/contexte (Marton, 1981 ; Marton et Booth, 1997). Le centre d’intérêt de la recherche phénoménographique est, depuis son début, la variation et la différence comprises comme étant le reflet des aspects de l’expérience humaine (Marton et Säljo, 1984).
Quelques-unes des principales découvertes des recherches phénoménographiques se rapportent à des conceptions, à la manière d’aborder l’apprentissage, aussi bien qu’à ses relations et à ses effets au niveau des résultats de l’apprentissage. En ce qui concerne la pensée des élèves sur l’apprentissage, il a été constaté que ceux-ci présentent différentes conceptions qu’ils expriment et matérialisent dans des situations concrètes d’apprentissage en les abordant également de manière distincte, obtenant ainsi des résultats qualitativement différents. Des recherches ont permis d’obtenir des données quant à la manière dont l’apprentissage est conceptualisé (c’est-à-dire les conceptions de l’apprentissage), à la manière dont la situation d’apprentissage est expérimentée et à la manière dont une tâche spécifique est accomplie (c’est-à-dire la manière d’aborder l’apprentissage). Ces trois aspects, qui font partie de l’idée que l’élève se fait de l’apprentissage, apparaissent en corrélation (Marton, 1983). Cependant, bien que les conceptions, les résultats de l’apprentissage et la manière de l’aborder doivent être considérés comme étant présents en simultanéité dans la conscience des élèves, un ou plusieurs de ces aspects peuvent, dans certains contextes, se retrouver au premier plan et d’autres au second (Prosser et Trigwell, 2000).
Les travaux de Perry (1970) sont à l’origine de l’étude sur les conceptions d’apprentissage. Ils contribuent de façon significative à la compréhension de la nature des transitions développementales des étudiants, surtout en ce qui concerne leurs croyances épistémologiques. En donnant la parole aux élèves, Perry découvre que lorsque ces derniers entrent à l’université, ils croient que le savoir est simple, certain et déterminé par l’autorité, mais que, progressivement, ils commencent à l’envisager comme complexe et pouvant englober des ambiguïtés et des vérités conflictuelles. D´après Perry, l’apprentissage se révélerait difficile pour certains élèves parce que leurs conceptions du savoir sont différentes de celles de leurs professeurs.
Les développements postérieurs aux travaux de Perry ont pris deux directions. L’une étudie les croyances épistémologiques des élèves en les considérant comme faisant partie d’un processus sous-jacent de métacognition. L’autre suit une perspective phénoménographique en identifiant deux macrocatégories de conceptions d’apprentissage qui contrastent : l’une superficielle et l’autre profonde (Marton et Säljo, 1976a, 1976b). Dans les premières études phénoménographiques réalisées par Säljo (1979), cinq conceptions d’apprentissage furent identifiées au travers d’entrevues individuelles et de séances d’apprentissage. Il s’agit de l’accroissement de connaissance, la mémorisation, l’application (c’est-à-dire l’acquisition de faits, de procédés, etc. qui peuvent être retenus et/ou utilisés dans la pratique), la compréhension (c’est-à-dire l’abstraction de signification) et le fait de voir quelque chose de manière différente (c’est-à-dire un procédé interprétatif dirigé vers la compréhension de la réalité). De telles conceptions furent de nouveau validées par des études postérieures (Rosário, 1999). Cependant, en 1993, Marton, Dall’Alba et Beaty identifient pour la première fois une nouvelle conception : changer en tant que personne. Une telle conception ajoute à l’apprentissage un aspect existentiel dans la mesure où l’apprentissage est vu comme conduisant à une vision différente du monde. Cette conception a seulement été identifiée par quelques étudiants de fin de maîtrise et par ceux qui avaient élaboré la conception de l’apprentissage en tant que « voir quelque chose de manière différente ». Cela est en accord avec la considération initiale de Säljo selon laquelle les conceptions qu’il a lui-même identifiées représentent une hiérarchie développementale.
Marton (1983) interprète ces conceptions en suggérant une organisation en deux grands groupes. Le premier groupe englobe des conceptions génériquement désignées comme reproductives ou superficielles, étant donné que l’accent est placé dans le stockage et la reproduction de l’information ; le savoir étant envisagé comme quelque chose d’extérieur au sujet. De telles conceptions aboutissent généralement à de faibles résultats d’apprentissage. Le second groupe englobe, quant à lui, des conceptions transformatives ou constructives de l’apprentissage en mettant en évidence l’attribution de signification et la transformation de l’information. Cette vision profonde de l’apprentissage et le fait que le savoir soit perçu comme quelque chose d’interne rendent possible l’intériorisation de sa signification (Entwistle, 1998a, 1998b, 1990). Il est généralement associé à des résultats d’apprentissage qui indiquent la complexité du traitement cognitif.
Les conceptions d’apprentissage sont ainsi à l’origine de différentes manières d’aborder l’apprentissage dans la mesure où, lorsque les élèves affrontent des tâches d’apprentissage, ils présentent différentes façons de penser et de comprendre ce qu’ils sont en train de réaliser (Marton et Säljo, 1976a, 1976b). De telles conceptions sont donc matérialisées dans des situations concrètes d’apprentissage en les abordant différemment – de manière superficielle ou profonde – et en obtenant des résultats d’apprentissage qualitativement différents.
La division entre ces deux groupes de conceptions (apprentissage comme reproduction/apprentissage profond ou transformatif, c’est-à-dire comme recherche de signification) est analogue à la différence décrite entre les approches de l’apprentissage superficielle et profonde : la première se centrant sur la tâche d’apprentissage elle-même et la deuxième partant des tâches vers la découverte du sens sous-jacent (Marton et Booth, 1996, 1997). De cette manière, on s’aperçoit que les approches de l’apprentissage (profonde et superficielle) sont associées aux conceptions des élèves à l’égard des matières qu’ils étudient. Ainsi, tant les conceptions d’apprentissage que les conceptions sur la matière spécifique à apprendre peuvent constituer des facteurs qui limitent l’approche que les élèves adoptent vis-à-vis de l’apprentissage (Prosser et Trigwell, 2000). Il existe de nombreuses évidences au sujet de l’existence d’une relation entre les conceptions d’apprentissage du sujet et les niveaux de traitement utilisés dans la réalisation de tâches d’apprentissage (Van Rossum et Schenk, 1984 ; Marton et Säljo, 1997 ; Rosário, 1999).
Les études avec des étudiants universitaires, développées dans la perspective des approches des élèves par rapport à l’apprentissage, révèlent des différences individuelles très marquées au niveau des formes d’apprentissage élaborées pendant leurs apprentissages. La littérature présente avec clarté deux niveaux de traitement de l’information : un niveau de traitement profond et un niveau de traitement superficiel (Marton et Säljo, 1976a, 1976b). Dans le premier, l’élève focalise son attention sur le contenu intentionnel du matériel d’apprentissage et s’oriente vers la compréhension du message de l’auteur. Dans le deuxième type de traitement, l’élève concentre son attention sur le texte lui-même ou sur le signe. Cette dernière approche suggère une conception reproductive de l’apprentissage.
Ces deux manières de traiter le matériel d’apprentissage s’organisent dans un continuum qualitatif et elles sont également en rapport avec les résultats ou niveaux de compréhension acquis par les élèves qui, concrètement, peuvent s’orienter vers la reproduction des principaux thèmes traités dans le texte ou vers l’insertion et la compréhension des détails dans un tout. Les implications éducatives sont claires : d’après la littérature phénoménographique, changer de sujet pour améliorer le processus d’apprentissage n’a aucun sens, alors que modifier son expérience ou sa conception de la tâche en détient un (Marton, Hounsell et Entwistle, 1997). Effectivement, dans une perspective phénoménographique, on considère que les sujets agissent non en fonction des données objectives des situations éducatives, mais en accord avec les perceptions qu’ils construisent à leur propos (Marton et Booth, 1996, 1997). Cela implique non seulement le changement de la situation objective, mais également des perceptions personnelles des activités dans lesquelles les sujets sont impliqués, c’est-à-dire la conception de l’apprentissage (Barca, Porto et Santorum, 1997 ; Ramsden, 1984). L’élève, considéré individuellement, ne doit pas être envisagé comme la cible principale de la recherche éducative : la recherche doit plutôt se centrer « sur l’apprenant en contexte » (Marton, 1988, p. 76).
Tant que l’on conçoit que l’apprentissage se limite à une simple augmentation quantitative de connaissances obtenue au travers de mémorisations automatiques et de répétitions, il sera extrêmement difficile d’adopter des pratiques qui conduisent à un apprentissage de haute qualité. Au contraire, envisager l’apprentissage comme un procédé interprétatif dirigé vers la compréhension de l’apprentissage rend possible l’adoption d’une approche profonde (Marton et Säljo, 1997). Cela est de la plus haute importance si nous considérons qu’une telle approche est reconnue comme décisive pour l’amélioration des résultats d’apprentissage des élèves (Ramsden, 1992).
Notre étude s’insérant dans la recherche traditionnelle phénoménographique, nous l’orientons vers la compréhension de l’apprentissage en tant que reflet de l’expérience de l’apprenant dans le monde, en cherchant à découvrir les variations sur le phénomène de l’apprentissage tel qu’il est vécu. Cette étude constitue une contribution sur la compréhension du sujet apprenant, en ayant comme objectif général d’analyser les variations dans la manière dont les élèves expérimentent et conceptualisent leur apprentissage.
En considérant que la signification donnée à l’apprentissage est influencée par l’interrelation entre les individus (âge, développement cognitif, motivation et conception de soi), le contexte familial, le contexte d’enseignement ainsi que la culture (Steketee, 1997), nous avons comme objectifs de circonscrire, décrire et comparer les conceptions d’élèves portugais de terminale et d’étudiants de dernière année de maîtrise. Notre échantillon a été déterminé dans la mesure où le contexte d’enseignement est considéré comme un des facteurs qui agit sur la signification donnée à l’apprentissage. Notre intention était de pouvoir observer si la panoplie d’aspects empiriques et développementaux impliqués tout au long de quatre années d’études universitaires se traduit en changement conceptuel par rapport à la conception de l’apprentissage.
Méthodologie
Échantillon
Trente-deux élèves d’un lycée et de l’Université d’Évora, dans le sud du Portugal, ont participé à cette étude. L’échantillon est constitué de 16 sujets de chacun des niveaux de scolarité. Parmi les élèves de terminale, huit sont dans un profil scientifique. Les autres sont dans un profil littéraire. Le même critère a été considéré pour les étudiants de maîtrise. Ainsi, huit étudiants appartiennent à la maîtrise en mathématiques et les huit autres à la maîtrise en portugais/français.
Pour chaque niveau de scolarité, nous nous sommes assurés d’une parité des sexes. Cependant, comme la population dans le cas des étudiants de maîtrise en portugais/français est majoritairement féminine, cela ne fut pas possible. En effet, nous avons à peine pu interviewer un élève de sexe masculin. La tranche d’âge des élèves de l’échantillon se trouvait entre 17 et 27 ans. Les élèves de terminale présentent une moyenne d’âge de 17,5 ans et ceux de maîtrise de 22,4 ans. La majorité des élèves présentent un âge adapté à l’année de scolarité fréquentée.
La composition de l’échantillon du point de vue de la différentiation des sexes et des profils d’études se rattache exclusivement à notre préoccupation d’augmenter potentiellement l’accès à la variété et à la diversité des discours sur l’apprentissage.
Instruments de collecte de données
L’objectif primordial de la recherche phénoménographique consiste à accéder à la manière dont le monde apparaît aux individus (Marton et Säljo, 1984). De cette façon, la méthodologie phénoménographique s’appuie sur des entrevues semi-structurées pour questionner les gens sur la manière dont ils conceptualisent ou expérimentent un phénomène ou une situation donnés (Marton et Booth, 1997). Dans ce cadre, nous avons tenté d’accéder aux conceptions des élèves au travers de leurs récits personnels. À cet effet, nous leur avons posé oralement plusieurs questions sur l’apprentissage. Les conceptions sur l’apprentissage ont fréquemment été étudiées au travers de la question : « Pour toi, qu’est-ce qu’apprendre ? » Cette méthode a suscité quelques interrogations et nous a conduits à une phase d’exploration préalable au cours de laquelle cette question a été posée à des sujets de sexe masculin et de sexe féminin de chaque année de scolarité. Ces entrevues ont été enregistrées, transcrites et soumises à une analyse de contenu ; elles ont permis d’identifier les grands aspects thématiques qui ont conduit à l’élaboration d’un guide d’entrevue définitif et à la formulation d’autres questions. Nous pouvons observer la relation entre les questions de l’entrevue et les dimensions de la recherche dans le Tableau 1.
Tableau 1
Relation entre les questions de l’entrevue et la structure de l’étude
Afin de nous en tenir au thème principal de cet article, nous nous reporterons seulement à l’une des questions posées, à savoir : « Qu’est-ce qu’apprendre ? » Nous avons choisi de privilégier cette question en raison de son caractère central et du large contenu trouvé dans les réponses des participants. Les entrevues, d’environ 45 minutes chacune, furent réalisées individuellement, enregistrées et postérieurement transcrites dans leur totalité. En prévision des résultats à tirer de notre recherche, nous avons construit des catégories de description, c’est-à-dire que nous avons procédé à l’identification du nombre de formes qualitativement différentes de caractérisation du phénomène « apprentissage » par les étudiants. Les catégories ont émergé de la lecture des réponses, sans que des catégories d’analyse existantes dans la littérature n’aient été préalablement repérées. Un premier système de catégorisation des conceptions de l’apprentissage a d’abord été construit pour chacune des questions. Dans un premier temps, trois chercheurs ont procédé de manière indépendante à la lecture et à la catégorisation d’environ 20 % des réponses données pour chaque question. La construction et la discussion de la grille d’analyse ont suivi, puis les chercheurs ont de nouveau procédé à la catégorisation indépendante des réponses.
Les calculs accordés entre les chercheurs ont eu pour base la formule PA = (NA/[NA+ND])100, où « PA » correspond au pourcentage d’accord ; « NA » correspond à la fréquence des accords ; et « ND » correspond à la fréquence des désaccords (Bakeman et Gottman, 1986). Les chercheurs indépendants en sont arrivés à un accord interjuges supérieur à 85 %.
Le critère de sélection a consisté à noter la présence de conceptualisations appartenant à une catégorie ou une sous-catégorie déterminée dans le discours des sujets ; la fréquence de leur apparition dans le discours des individus n’a donc pas été considérée. Le discours des élèves sur l’apprentissage nous a en outre permis de découvrir de plus amples significations sous-jacentes à leurs verbalisations.
Les caractéristiques inhérentes à la recherche phénoménographique amènent une représentation des catégories de conceptualisation d’apprentissage non pas en tant que types d’individus, mais de formes de compréhension du phénomène. De cette manière, les catégories ne sont pas exclusives du point de vue individuel, car, par rapport à une même question, un élève peut exprimer différentes conceptions de l’apprentissage. De ce fait, nous avons d’abord dressé le registre des conceptions exprimées par chaque élève. Cela justifie que nous ayons, pour les conceptions, une fréquence supérieure au nombre de sujets.
Résultats
Nous réitérons le fait qu’il est nécessaire de faire une distinction entre les conceptions de l’apprentissage et les catégories de description. Les premières renvoient aux expériences, aux compréhensions et aux conceptualisations que les personnes ont de divers phénomènes. Les secondes sont, quant à elles, de simples instruments abstraits pour caractériser les conceptions (Marton, Dall’Alba et Beaty, 1993). Dans cette étude, lorsque nous utilisons le terme « conception », nous nous reportons aux catégories de description identifiées dans le domaine de la question « Qu’est-ce qu’apprendre ? ».
Diverses conceptions ont émergé des entrevues réalisées dans le cadre de cette recherche. Nous les analyserons de façon succincte, en raison de la nature spécifique de cette étude.
Dans l’ensemble de l’échantillon, nous avons trouvé 14 façons différentes de comprendre l’apprentissage.
Apprendre est quelque chose d’extensif et de diversifié. Cette conception regroupe les discours des élèves centrés sur l’objet de l’apprentissage, sur la manière d’apprendre et sur les sources d’apprentissage. Ce sont exclusivement les élèves de terminale qui ont soulevé cette dimension de l’activité d’apprentissage (élèves de terminale : n = 3 ; étudiants de maîtrise : n = 0).
Apprendre, c’est augmenter les connaissances. La principale caractéristique de cette conception se réfère à l’absorption de connaissance dans une logique informivore. Elle présente un caractère global et se caractérise par la concentration sur l’acquisition ou la possession de connaissances. Bien que soutenue par des élèves des deux niveaux de scolarité (élèves de terminale : n = 12 ; étudiants de maîtrise : n = 8), nous avons observé quelques différences qualitatives de cette conception, selon les niveaux. Ainsi, si le caractère de nouveauté des connaissances est présent indépendamment de l’année de scolarité, le caractère quantitatif des connaissances est rapporté par les élèves de terminale, tandis que l’acquisition de connaissances relatives aux compétences constitutives d’une personnalité (par exemple : les comportements, les attitudes, les valeurs et la manière d’aborder l’apprentissage) est exclusivement rapportée par les étudiants de maîtrise.
Apprendre, c’est mémoriser. Dans cette conception, les élèves considèrent la mémorisation comme une façon de retenir l’information sans l’associer, explicitement ou implicitement, à la reproduction ou à la compréhension. Bien que faiblement rapportée, cette conception est exprimée par des élèves appartenant aux deux niveaux de scolarité analysés (élèves de terminale : n = 1 ; étudiants de maîtrise : n = 1).
Apprendre, c’est appliquer. Selon cette conception, l’apprentissage est entendu comme l’application de connaissances ou de procédés. Appliquer signifie retrouver ce qui a été appris et l’utiliser (élèves de terminale : n = 1 ; étudiants de maîtrise : n = 1).
Apprendre, c’est comprendre. Cette conception englobe les discours dans lesquels l’apprentissage est compris comme un processus réflexif et compréhensif où l’accent est mis sur la signification sous-jacente. Apprendre est quelque chose que le sujet fait pour comprendre ou pour essayer de connaître le pourquoi des événements. La compréhension commence par les notions apprises et évolue vers les situations concrètes vécues au jour le jour, donc vers le monde et vers soi-même. En d’autres mots, elle se rapporte non seulement aux contenus d’apprentissage, mais également à la réalité qui entoure l’individu. Bien que la compréhension apparaisse aux deux niveaux de scolarité, elle est plus souvent évoquée par les étudiants de maîtrise (élèves de terminale : n = 2 ; étudiants de maîtrise : n = 5).
Apprendre, c’est voir quelque chose différemment. Dans la présente conception, c’est le processus de changement qui est mis en évidence. Le changement dans la manière d’envisager la réalité prend, dans ces discours, soit un sens restreint, c’est-à-dire la substitution d’une idée par une autre, soit un contour plus global relatif à un changement étendu de la manière de penser (élèves de terminale : n = 1 ; étudiants de maîtrise : n = 2).
Apprendre, c’est changer en tant que personne. L’apprentissage est compris comme conduisant à un changement et à un développement personnel et social. Dans ces discours se trouve présente l’idée qu’apprendre est une opportunité d’acquérir des compétences qui conduisent à un développement personnel. Cette conception est exprimée par les élèves des deux niveaux de scolarité, avec néanmoins des incidences et des nuances différentes (élèves de terminale : n = 5 ; étudiants de maîtrise : n = 5).
Apprendre, c’est se réaliser. Dans cette conception, l’attention est portée sur l’aspiration du sujet à accéder à un statut ou à obtenir quelque chose dans le futur. Ce sont uniquement les élèves de terminale qui mentionnent cette conception (n = 3).
Apprendre est un processus qui n’est limité ni par le temps ni par le lieu. Dans ces discours, l’apprentissage est mis en rapport avec une variété de contextes quotidiens et scolaires. Il est également compris comme un processus continu et graduel qui débute à la naissance et prend fin à la mort. En d’autres termes, ces discours considèrent l’apprentissage comme un processus infini, dans la mesure où l’on considère que le sujet n’accédera jamais à la totalité des connaissances. Cette conception est plus souvent évoquée par les élèves de terminale (élèves de terminale : n = 11 ; étudiants de maîtrise : n = 5).
Apprendre est un processus individualisé. L’apprentissage apparaît comme un processus personnel qui est influencé par des aspects internes au sujet. Cette conception est peu évoquée (élèves de terminale : n = 1 ; étudiants de maîtrise : n = 1).
Apprendre est un processus expérientiel. Dans cette conception, l’apprentissage est entendu comme le résultat des expériences de vie du sujet. Ce sont les élèves de terminale qui l’évoquent le plus fréquemment (élèves de terminale : n = 6 ; étudiants de maîtrise : n = 3).
Apprendre est un processus interactif. L’apprentissage émerge comme un processus de médiation sociale au travers duquel les connaissances sont transmises (élèves de terminale : n = 4 ; étudiants de maîtrise : n = 4).
Apprendre est un processus d’enseignement. Apprendre apparaît ici comme synonyme d’une action d’enseignement dans des contextes d’instruction. Les élèves des deux niveaux présentent cette conception (élèves de terminale : n = 3 ; étudiants de maîtrise : n = 3).
Apprendre est important et positif. Cette dernière conception est très peu évoquée. Seuls quelques élèves de terminale y font référence (n = 1).
En guise de résumé, nous pourrions dire que pour les deux niveaux de scolarité, la conception de l’apprentissage comme un accroissement de connaissances est la plus fréquemment mentionnée par les élèves. Toutefois, elle a tendance à diminuer avec la progression dans la scolarité. Une analyse purement descriptive nous permet de vérifier que cette tendance à la baisse est également évidente dans les conceptions qui considèrent l’apprentissage comme quelque chose « d’extensif et de diversifié », comme une « réalisation », comme un « processus ni limité par le temps, ni par le lieu » et enfin comme un « processus expérientiel ». Seule la conception de l’apprentissage comme « compréhension », c’est-à-dire comme abstraction de la signification, augmente relativement dans le groupe des étudiants de maîtrise.
À leur tour, les conceptions d’apprentissage comme « mémorisation », « application », « processus individualisé » et « quelque chose d’important et de positif » sont très peu mentionnées dans les discours des élèves de terminale et des étudiants de maîtrise.
Discussion
Cette recherche, centrée sur l’analyse des perceptions de l’apprentissage des élèves portugais, nous a permis de vérifier deux aspects particuliers. D’une part, nous avons pu établir la concordance avec des études antérieures sur les conceptions d’apprentissage (Säljo, 1979 ; Marton, Dall’Alba et Beaty, 1993 ; Purdie, Hattie et Douglas, 1996 ; Rosário, 1999). D’autre part, nous avons constaté de nouveaux résultats qui pourront être associés à des aspects méthodologiques (notamment le fait que nous ayons tenu compte, de manière exhaustive, de toutes les verbalisations énoncées par les étudiants dans le cadre de la question posée) ou à la spécificité de l’échantillon. Relativement à la dimension « Qu’est-ce qu’apprendre ? », nous avons, au total, identifié 14 conceptions d’apprentissage (Grácio, 2002). Parmi elles, sept sont également évoquées dans des études antérieures : augmenter les connaissances, mémoriser, appliquer, comprendre, voir quelque chose de manière différente, changer en tant que personne (Säljo, 1979 ; Marton, Dall’Alba et Beaty, 1993) et se réaliser (Purdie, Hattie et Douglas, 1996). En même temps, de nouvelles conceptions d’apprentissage ont été identifiées pour la première fois : un processus individualisé, expérientiel, interactif, d’enseignement, extensif et diversifié. De telles conceptions traduisent non seulement l’idée de l’apprentissage comme un phénomène complexe et multiforme, mais explicitent également ses diverses composantes.
Nous considérons que les conceptions reproductives et de recherche de signification ne décrivent pas totalement les conceptions d’apprentissage des étudiants portugais. En effet, si, d’un côté, l’apprentissage émerge de conceptions externes (augmenter les connaissances, mémoriser, appliquer) ainsi qu’internes et transformatives (comprendre, voir quelque chose de manière différente, se réaliser), il apparaît également comme une conception processuelle, contextuelle, individuelle et sociale (processus qui n’est limité ni par le temps, ni par le lieu ; processus individualisé ; processus expérientiel ; processus interactif ; et processus d’enseignement) et qui détient un caractère de valorisation.
La perception fonctionnelle, centrée sur l’utilité de ce que l’on apprend, apparaît critique aux yeux des élèves. Elle doit par conséquent être prise en compte par le système éducatif et doit devenir une cible lors de l’intervention des différents agents éducatifs impliqués. L’objectif du processus d’enseignement-apprentissage devrait être centré sur l’aide afin que les élèves arrivent à penser par eux-mêmes (approche profonde) et à créer des situations qui, en les motivant ainsi intrinsèquement, soient signifiantes du point de vue de leur expérience (Entwistle, 1991). Marton, Hounsell et Entwistle (1984) ainsi que Säljo (1982) considèrent que l’apprentissage en profondeur requiert un contexte compréhensif non seulement dans les contenus, mais également dans sa présentation et son exploration, afin d’être expérimenté de façon importante par les élèves. En ce sens, la manière dont les connaissances apprises se mettent en rapport avec le monde réel et la façon dont elles s’opérationnalisent pour résoudre des problèmes au jour le jour devraient être intentionnelles de la part de l’élève.
Les données présentées révèlent que l’apprentissage est principalement conceptualisé dans les discours des élèves comme une augmentation de connaissances. Ce résultat suggère l’importance d’aider les élèves à comprendre que l’apprentissage n’est pas une simple accumulation ou mémorisation d’informations, mais qu’ils doivent comprendre et réfléchir par eux-mêmes. Pour cela, une réadaptation du savoir et une redéfinition du sens de l’apprentissage et des connaissances par l’individu doit se faire. Des méthodologies éducatives susceptibles d’aider les élèves à distinguer mémorisation et compréhension et à les faire réfléchir sur la complémentarité qui peut exister entre les deux procédés en fonction des contenus et des tâches spécifiques d’apprentissage apparaissent très importantes. De telles pratiques éducatives devront, cependant, se tenir dans des contextes d’enseignement incitant à la compréhension sans néanmoins mépriser des actions qui conduisent à la permanence des savoirs. Le fait que les élèves conçoivent l’apprentissage en rapport avec les aspects processuels et valorisants nous amène à penser que les actions éducatives dirigées vers le développement de conceptions d’apprentissage qualitativement plus complexes et porteuses d’un apprentissage davantage compréhensif ne peuvent pas être séparées d’interventions qui favorisent également de la compréhension de l’apprentissage, sur la manière d’apprendre et la valeur et l’utilité des apprentissages. La découverte de l’existence de conceptions processuelles nécessite un plus grand approfondissement. En effet, jusqu’à ce jour, une relation entre les conceptions et la manière d’aborder l’apprentissage a été trouvée, mais les aspects relatifs aux conceptions processuelles de l’apprentissage continuent d’être peu explorés. Ils sont surtout inférés et explorés à partir des six conceptions de l’apprentissage identifiées par Säljo (1979) et Marton, Dall’Alba et Beaty (1993).
La (re)découverte des compétences et potentialités réflexives des élèves devient urgente, avec pour but la réalisation d’actions qui promeuvent la pensée des élèves et la conscience d’eux-mêmes, de façon à ce qu’ils développent des façons de conceptualiser et d’aborder l’apprentissage qualitativement plus riches et plus profondes. Ce renforcement d’autonomie contribuerait à ce que ceux-ci puissent assumer une autorégulation et un contrôle de leur propre apprentissage. Après avoir vérifié que, dans leur ensemble, les étudiants conceptualisent l’apprentissage comme quelque chose qui habilite l’individu à savoir, agir, comprendre, changer et se réaliser, il serait pertinent que l’action éducative de la communauté scolaire ait en permanence de tels objectifs, en se dirigeant de manière intentionnelle vers l’accomplissement de ces finalités. Comment de telles transformations peuvent-elles avoir lieu ? Dans une perspective phénoménographique, le changement, dans des contextes sociaux et éducatifs, implique non seulement une modification des situations et des tâches objectives auxquelles le sujet se voit confronté, mais surtout une modification des perceptions personnelles de celles-ci (Ramsden, 1984). Dans le cas concret de l’éducation formelle, nous savons que les méthodes d’enseignement sont en relation étroite avec les approches de l’apprentissage des étudiants – dans la mesure où celles-ci sont une réponse aux exigences perçues du contexte – de telle sorte qu’un changement dans le processus de formation des enseignants, dans leur manière de concevoir l’apprentissage et l’enseignement, et dans les méthodes concrètes d’enseigner et d’évaluer, provoquera aussi des changements dans la manière dont les élèves perçoivent l’apprentissage et, par conséquent, dans la manière dont ils apprennent. Cette réforme éducative implique de repenser les conceptions de l’apprentissage elles-mêmes, les méthodes d’enseignement qui sont enseignées aux nouveaux enseignants et les expériences d’apprentissage et d’évaluation qui s’y rattachent.
Il devient donc urgent que l’école prenne conscience du rôle tenu par les conceptions d’apprentissage relativement à ce qui s’apprend, à la qualité de ce qui s’apprend et à la manière d’apprendre, en créant des espaces de réflexion et de dialogue sur les idées des élèves en matière d’apprentissage, et en les aidant à se construire une conscience plus profonde de ce qu’est l’apprentissage et de ce que sont les processus et stratégies d’apprentissage, aussi bien en termes généraux que par rapport aux différentes tâches et aux contextes concrets d’apprentissage. Nous espérons que ce travail donne un nouveau souffle à la réflexion sur le processus d’apprentissage vu par des élèves. Ainsi, les changements dans le processus d’enseignement-apprentissage, dont bon nombre sont urgents, ne doivent pas perdre de vue cet angle particulier.
Parties annexes
Références
- Bakeman, R. et Gottman, J. (1986). Observing interaction : An introduction to sequential analysis. Cambridge, MA : Cambridge University Press.
- Barca, A., Porto, A. et Santorum, R. (1997). Los enfoques de aprendizaje en contextos y situaciones educativas. Una aproximación conceptual y metodológica. In A. Barca, J.L. Malmierca, J. Núñez, A. Porto et R. Santorum (dir.), Procesos de aprendizaje en ambientes educativos (p. 387-435). Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces.
- Entwistle, N. (1990). Teaching and the quality of learning in higher education. In N. Entwistle (dir.), Handbook of Educational Ideas and Practices (p. 669-680). Londres : Routledge.
- Entwistle, N. (1991). La comprensión del aprendizaje en el aula. Barcelone : M.E.C./Paidos Ibérica.
- Entwistle, N. (1998a). Approaches to learning and forms of understanding. In B.C. Dart et G.M. Boulton-Lewis (dir.), Teaching and Learning in Higher Education From Theory to Practice (p. 72-101). Melbourne : Australian Council for Educational Research.
- Entwistle, N. (1998b). Conceptions of learning, understanding and teaching in higher education. Document téléaccessible à l’adresse URL : http://www.scre.ac.uk/fellow98/entwistle.html.
- Grácio, M.L.F. (2002). Concepções do aprender em estudantes de diferentes graus de ensino. Do final da escolaridade obrigatória ao ensino superior : Uma perspectiva fenomenográfica. Thèse de doctorat, Université d’Évora, Évora.
- Marton, F. (1981). Phenomenography – describing conceptions of the world around us. Instructional Science, 10, 177-200.
- Marton, F. (1983). Beyond individual differences. Educational Psychology, 3(3-4), 289-303.
- Marton, F. (1988). Phenomenography : Exploring different conceptions of reality. In D.M. Fetterman (dir.), Qualitative approaches to evaluation in education : The silence scientific revolution (p. 176-205). New York, NY : Praeger.
- Marton, F. et Booth, S. (1996). The Learner’s experience of learning. In D. Olson et N. Torrance (dir.), The handbook of education and human development. New models of learning, teaching and schooling (p. 543-654). Cambridge, MA : Blackwell.
- Marton, F. et Booth, S. (1997). Learning and awareness. Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum.
- Marton, F., Dall’Alba, G. et Beaty, E. (1993). Conceptions of learning. International Journal of Educational Research, 19(3), 277-300.
- Marton, F., Hounsell, D.J. et Entwistle, N.J. (1984). The experience of learning. Édimbourg : Scottish Academic Press.
- Marton, F., Hounsell, D.J. et Entwistle, N.J. (dir.) (1997). The experience of learning : Implications for teaching and studying in higher education. Edimbourg : Scottish Academic Press. (2e éd.).
- Marton, F. et Pong, W.Y. (2005). On the unit of description in phenomenography. Higher Education Research and Development, 24(4), 335-348.
- Marton, F. et Säljo, R. (1976a). On qualitative differences in learning I – Outcomes and processes. British Journal of Educational Psychology, 46, 4-11.
- Marton, F. et Säljo, R. (1976b). On qualitative differences in learning II – Outcome as a function of the learner’s conception of the task. British Journal of Educational Psychology, 46, 115-127.
- Marton, F. et Säljo, R. (1984). Approaches to learning. In F. Marton, D. Hounsell et N. Entwistle (dir.), The experience of learning (p. 36-70). Édimbourg : Scottish Academic Press.
- Perry, W.G. (1970). Forms of Ethical and Intellectual Development in the College Years- A Scheme. San Francisco, CA : Jossey-Bass.
- Prosser, M. et Trigwell, K. (2000). Understanding learning and teaching : the experience in higher education. Birmingham : Society for Research into Higher Education/Open University Press.
- Purdie, J., Hattie, N. et Douglas, G. (1996). Student conceptions of learning and their use of self-regulated learning strategies : A cross-cultural comparison. Journal of Educational Psychology, 88(1), 87-100.
- Ramsden, P. (1984). The context of learning. In F. Marton, D. Hounsell et N. Entwistle (dir.), The experience of learning (p. 144-164). Édimbourg : Scottish Academic Press.
- Ramsden, P. (1988). Improving learning. New perspectives. Londres : Kogan Page.
- Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. Londres : Kogan Page.
- Rosário, P. (1999). Variáveis Cognitivo-motivacionais na Aprendizagem : As “Abordagens ao Estudo” em Alunos do Ensino Secundário. Thèse de doctorat non publiée, Université deMinho, Braga.
- Säljo, R. (1979). Learning about learning. Higher Education, 8, 443-451.
- Säljo, R. (1982). Learning and understanding : A study of differences in constructing meaning from a text. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis.
- Steketee, C. (1997). Conceptions of learning held by students in the lower, middle and upper grades of primary school. Proceedings of Western Australian Institute for Educational Research Forum. Document téléaccessible à l’adresse URL : http://cleo.murdoch.edu.au/waier/forums/1997/steketee.html.
- Van Rossum, E.J. et Schenk, S.M. (1984). The relationship between learning conception, study strategy and learning outcome. British Journal of Educational Psychology, 54(1), 73-85.
Liste des tableaux
Tableau 1
Relation entre les questions de l’entrevue et la structure de l’étude