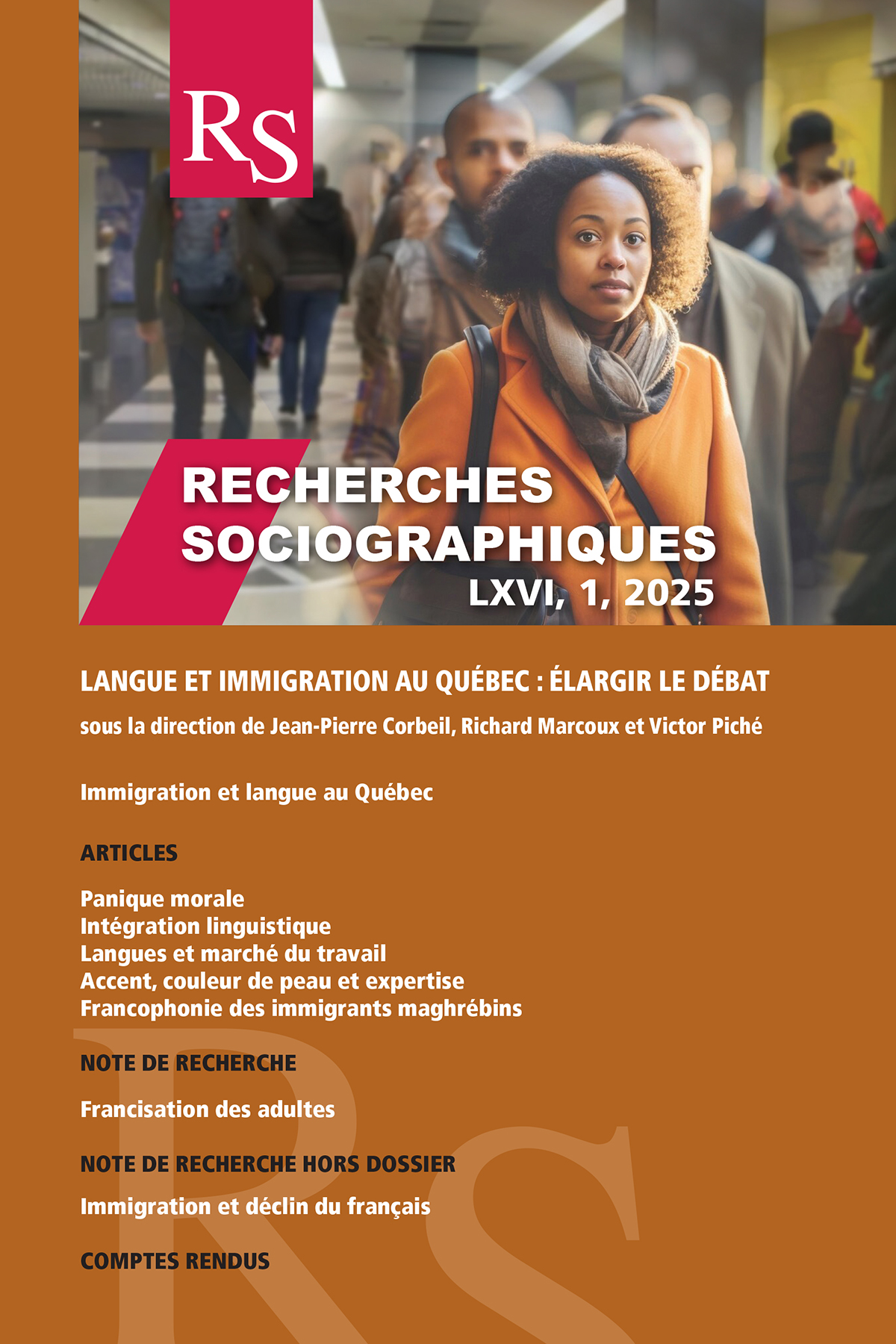L’ouvrage Le français en déclin? entend dépasser les perspectives qualifiées de « jovialistes » et de « déclinistes » sur la langue française au Québec. L’ouvrage comprend 22 chapitres portant sur l’analyse des indicateurs les plus connus – langue de travail, langue d’enseignement, le français à Montréal, l’immigration et les lois portant sur la langue – couvrant donc un très large éventail d’aspects sur la situation du français au Québec. On n’y trouve ainsi que des essais à portée théorique visant à « clarifier ce dont on parle » et portant sur différents enjeux autour de la langue, ainsi que des témoignages provenant de personnes connues par leur présence dans les médias (Julius Grey, Marco Micone, Jean-Benoît Nadeau). Les trois directeurs de la publication constatent que « la fragilité du français ne fait pas de doute », mais il leur paraît « essentiel de proposer un débat éclairé et nuancé qui s’éloigne de la vision sombre, monolithique et réductrice du discours dominant actuel » (4e de couverture). Je ferai référence dans ce texte à ces deux perspectives qui s’opposent. Le fil rouge et la ligne directrice de l’ouvrage mettent l’accent sur la connaissance de la langue française et sur son usage dans la sphère publique en conformité avec l’article 160 de la nouvelle mouture de la Charte de la langue française adoptée par le gouvernement du Québec en 2022. Cet article privilégie en effet l’examen des indicateurs de l’usage du français dans l’espace public – travail, enseignement, services publics, commerces, activités culturelles – et non plus prioritairement les indicateurs linguistiques associés à l’espace privé tels que la langue maternelle ou la langue parlée à la maison. Les indicateurs linguistiques caractérisant l’espace privé sont l’objet de polémiques sur le sens à leur attribuer et ils ont alimenté les discours alarmistes. La référence à la langue maternelle a perdu la fonction qu’elle avait à une époque maintenant lointaine où elle caractérisait l’appartenance aux deux grands groupements linguistiques typiques de la dualité nationale canadienne, avant que l’immigration internationale diversifiée ne change complètement le paysage national. De même, l’indicateur langue parlée à la maison a maintes fois été mal interprété comme synonyme de non-intégration à la majorité francophone. Parler sa langue maternelle au foyer est un comportement bien compréhensible, comme en ont témoigné les premières générations de Canadiens français ayant migré vers la Nouvelle-Angleterre entre 1840 et 1929. Jack Kerouac a parlé français avec « mémère » à la maison jusqu’à l’âge de 7-8 ans sans connaître l’anglais. La forte immigration internationale, la présence des réfugiés ainsi que celle des travailleurs/étudiants temporaires ont rendu ces deux indicateurs « classiques » au siècle dernier de moins en moins pertinents, d’où la nécessité pour les contributeurs de cet ouvrage de revoir le choix des indicateurs ainsi que leur interprétation. Cela dit, les deux indicateurs langue maternelle et langue parlée au foyer demeurent utiles pour certaines analyses sociologiques, comme celle portant sur les transferts linguistiques, comme on le verra plus loin. Le chapitre très documenté de Jean-Pierre Corbeil expose bien la perspective de l’ouvrage collectif et il dresse un large inventaire de tous les indicateurs disponibles pour mesurer l’usage des langues dans l’espace public québécois, sans oublier les résultats de maintes recherches par enquêtes ou sondages sur ce dernier. S’il revient sur les deux indicateurs de la langue dans l’espace privé remis en question, c’est pour les interpréter conjointement avec ceux qui caractérisent l’espace public. Dans cette perspective, quelle que soit la langue parlée au foyer, ce qui importe est de considérer l’usage des langues dans la sphère publique. « Par exemple, une personne dont l’anglais …
Jean-Pierre Corbeil, Richard Marcoux et Victor Piché (dir.), Le français en déclin? Repenser la francophonie québécoise, Montréal, Del Busso éditeur, 2023, 464 p.
…plus d’informations
Simon Langlois
Université Laval
simon.langlois@soc.ulaval.ca
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès