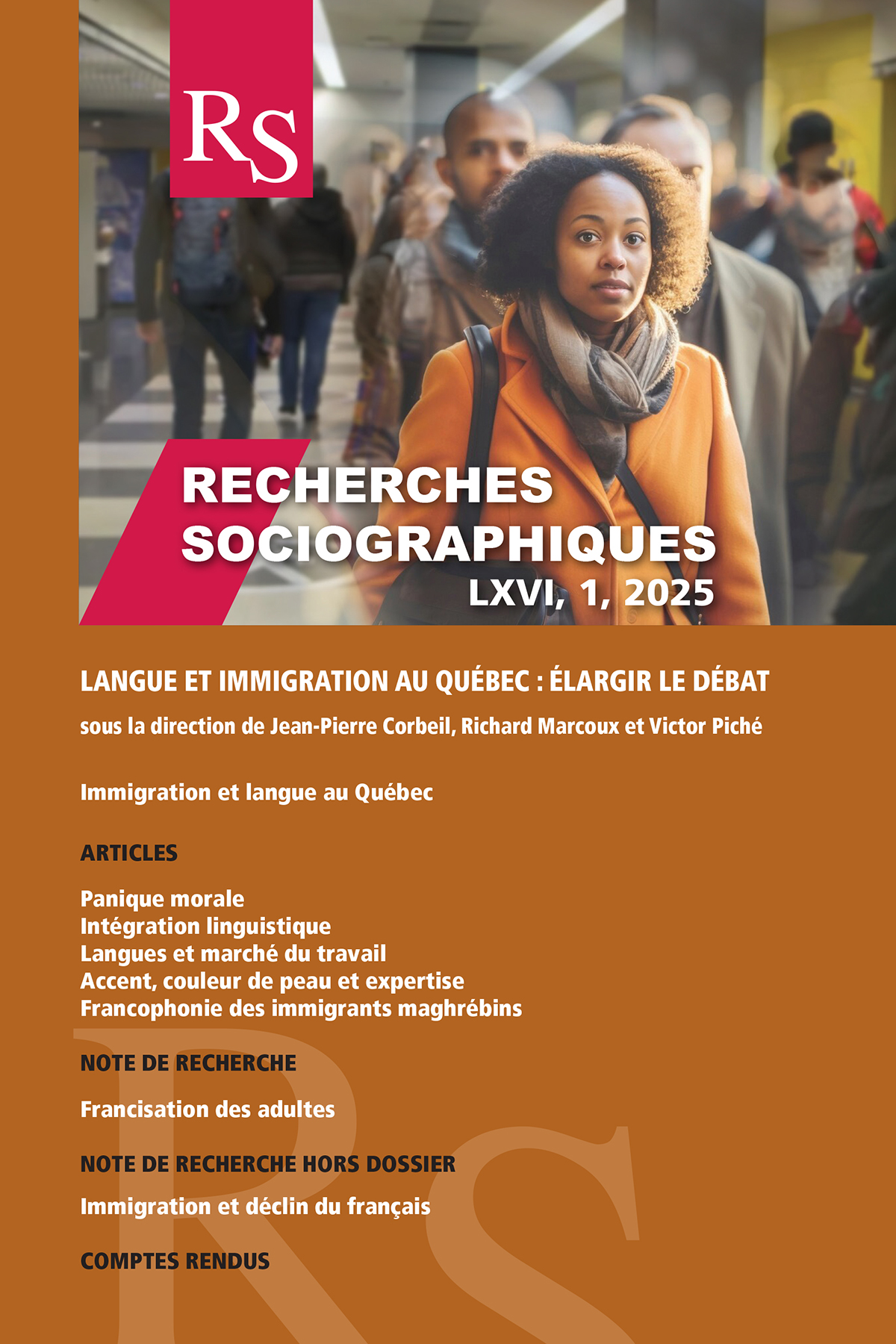Pouvoir vivre, ou continuer à vivre, dans un logement confortable et sécuritaire, dans un quartier où elles se sentent chez elles, est l’un des plus grands souhaits des personnes âgées – et sans doute des gens de tous âges. Ce souhait est cependant parfois compromis ou menacé par la gentrification et les transformations urbaines, qui engendrent chez les personnes âgées les plus vulnérables une grande insécurité. C’est ce que montre très bien Julien Simard dans son étude portant sur quatre quartiers de Montréal : Villeray, Rosement, Le Petite-Patrie et le Plateau-Mont-Royal. L’arrivée dans un quartier de groupes mieux dotés en capital économique et culturel conduit à une transformation des logements et une augmentation des prix des loyers. Elle modifie l’offre commerciale, moins accessible ou intéressante pour les résidents de longue date, qui ne se reconnaissent plus dans leur quartier. Ces transformations engendrent un conflit d’appropriation et d’usage de l’espace, entre les anciens résidents âgés et les nouveaux arrivants, et une transformation des rapports de force entre les propriétaires et les locataires, éventuellement un départ forcé d’individus, qui doivent quitter leur logement et leur quartier. Les personnes âgées, qui vivent seules et avec un faible revenu, tout particulièrement celles qui habitent au même endroit depuis longtemps et qui paient leur loyer en dessous du prix du marché, sont particulièrement menacées d’éviction. Julien Simard analyse longuement la précarité dans laquelle vivent des personnes âgées en raison de leur revenu, de la faiblesse de leur réseau social et des transformations urbaines. Il décrit l’insécurité que cette précarité engendre : un avenir imprévisible, la peur de devoir quitter son logement, être obligé de vivre dans un appartement mal entretenu et parfois insalubre, perdre de l’autonomie et du contrôle sur sa vie, être isolé. Il identifie les différentes menaces qui contribuent à accroître leur insécurité et briser leur attachement à leur logement, comme les différentes formes de pression et de violence exercées par les propriétaires : envoi d’un avis d’expulsion, intimidation et dénigrement, intrusion dans leur domicile, surveillance exagérée, instauration d’un climat de peur. Les locataires âgés directement menacés ont le choix entre partir ou résister. Ils peuvent tenir tête à leur propriétaire par diverses tactiques et en contestant la tentative d’expulsion à la Régie du logement. Ils pourront aussi participer à un comité de logement, où l’on défend les droits des locataires. Julien Simard analyse la nature de la participation à ces groupes, le soutien et la sociabilité qu’elle procure aux personnes en situation de précarité, la manière dont elle permet de changer le rapport de force entre le propriétaire et le locataire. Ce faisant il ajoute un nouveau chapitre à l’histoire des luttes urbaines, sur lesquelles on a beaucoup écrit au Québec. Comme l’auteur le souligne à plusieurs reprises dans son ouvrage, les personnes âgées ne veulent pas rester à tout prix dans leur logement. Elles ne veulent pas nécessairement continuer à vivre dans un appartement mal entretenu et hantées par les conflits avec les propriétaires. Elles veulent pouvoir vivre dans un logement confortable, auquel elles pourront consacrer une part raisonnable de leur revenu, et dans un quartier où elles se reconnaissent. Mais elles n’ont pas toutes accès au logement social, et elles ont souvent de la difficulté à se reloger. Par-delà la connaissance de la situation difficile et pénible dans laquelle se trouvent les locataires âgés menacés d’expulsion, cette étude apporte un éclairage sur les conditions d’existence des personnes vieillissantes dans un statut précaire, et plus largement, elle souligne l’importance du logement dans l’expérience du vieillissement, l’importance de pouvoir vivre dans un appartement où l’on se sent chez soi et en sécurité, …
Julien Simard, Vieillissement et crise du logement. Gentrification, précarité et résistance, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2024, 285 p.
…plus d’informations
Éric Gagnon
Vitam-Centre de recherche en santé durable
eric.gagnon2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès