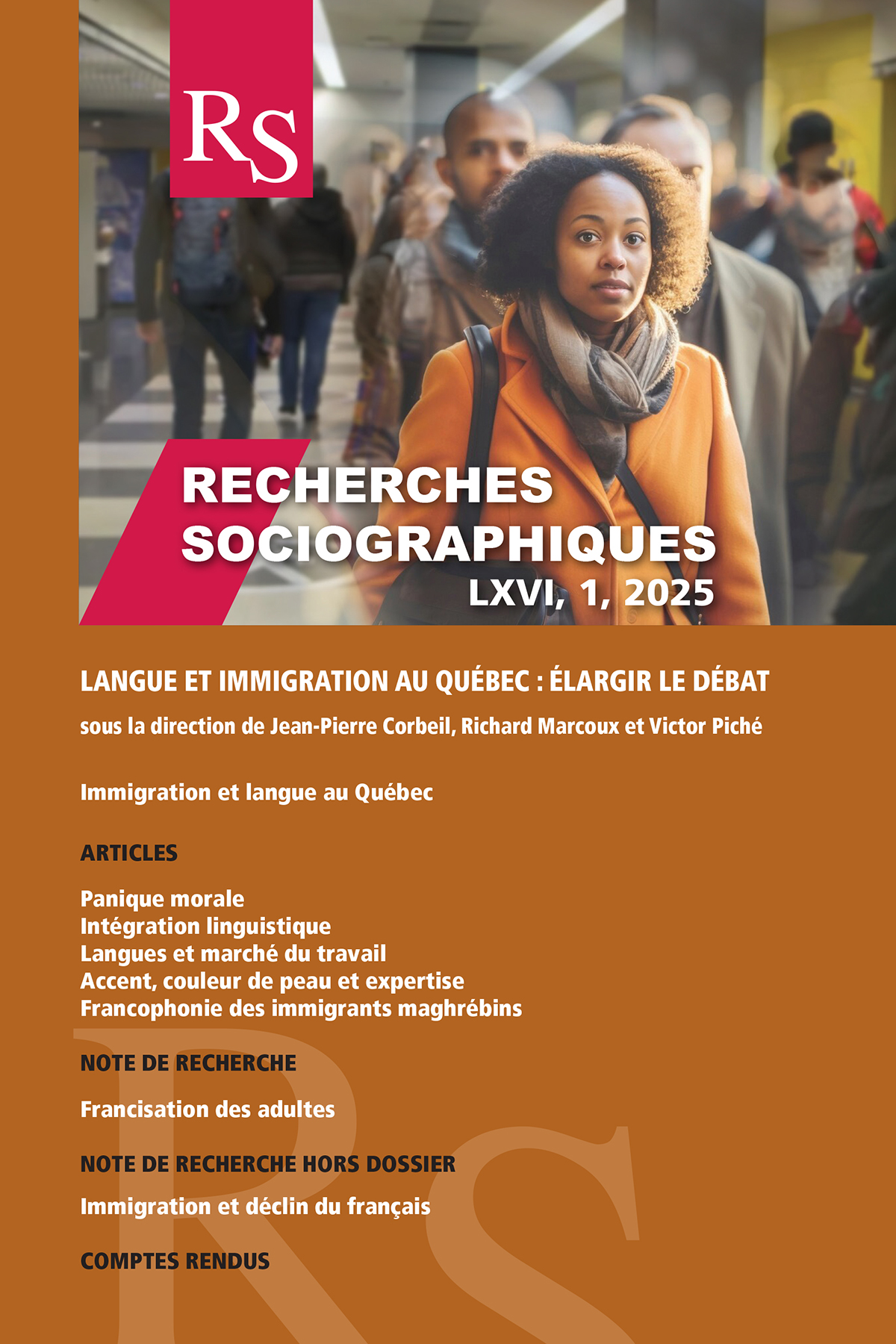Au Québec, comme ailleurs dans le monde, les jeunes font face à un marché du travail en perpétuelle transformation. Les avancées technologiques, la mondialisation et les changements démographiques ont redéfini les attentes envers les jeunes professionnels. Par ailleurs, la récente pandémie a influencé l’emploi, modifiant les modes de travail et accentuant certaines inégalités. Divisé en huit chapitres, cet ouvrage dirigé par Maria Eugenia Longo et Mircea Vultur explore diverses facettes du travail des jeunes au Québec au 21e siècle. Du paysage numérique à l’entrepreneuriat, en passant par la transition écologique et l’insertion des jeunes réfugiés et immigrants, les différents auteurs tentent de mettre en lumière les défis, les tendances émergentes et les questions importantes qui façonnent l’expérience professionnelle des jeunes actuellement. Après une introduction qui replace l’objet d’étude, le travail des jeunes, comme étant toujours « un sujet central de la recherche scientifique et des préoccupations politiques des sociétés modernes » et un premier chapitre qui traite des « nouvelles et anciennes dynamiques d’insertion des jeunes sur le marché du travail », l’ouvrage se décline en deux parties. La première aborde le « renouvellement sectoriel et les nouveaux emplois pour les jeunes ». L’économie des plateformes numériques est le premier sujet abordé (chapitre 2). Les résultats présentés soulignent la grande diversité des travailleurs sur ces plateformes et toute la complexité qui en découle notamment concernant l’impact des « conditions de travail » sur les travailleurs. L’économie verte et la place des jeunes dans la transition écologique sont ensuite présentées (chapitre 3). La définition d’emploi vert, les opportunités d’emploi dit vert ainsi que les politiques publiques qui façonnent ce paysage sont discutées. « L’imprécision conceptuelle de la notion d’emploi vert et les conséquences » que cela peut avoir sur le plan politique actuel et de la recherche sont ainsi soulignées par les auteurs. Le chapitre sur l’entrepreneuriat chez les jeunes Québécois (chapitre 4) et celui mettant en lumière l’économie sociale : une forme alternative d’entrepreneuriat dans les régions (chapitre 5) examinent le rôle crucial des jeunes dans ces domaines. L’écosystème de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes au Québec est particulièrement bien détaillé. Il est intéressant de noter que le choix de s’engager dans l’économie sociale est influencé par de multiples dimensions de la vie des individus. La deuxième partie, quant à elle, traite de l’emploi des jeunes en fonction de leur appartenance à un groupe en particulier ou selon leur statut. La conciliation entre la famille, le travail et les études est au coeur du chapitre six, où sont explorés les soutiens nécessaires pour les parents étudiants afin de réussir dans tous les aspects de leur vie. Le septième et le huitième chapitre s’intéressent aux jeunes issus de l’immigration. Tout d’abord, l’insertion socioéconomique des jeunes réfugiés admis au Québec durant leur enfance, puis les parcours d’insertion en emploi des jeunes immigrants au Québec. Concernant les jeunes réfugiés, il en ressort que ces jeunes ont des niveaux de scolarité plus élevés que les natifs, mais qu’ils sont plus à risque de chômage, et d’occuper des emplois de moindre qualité et d’avoir un revenu plus faible. L’approche choisie dans le chapitre huit est très intéressante. Les résultats montrent que l’insertion des jeunes se fait souvent un peu plus vite et un peu mieux que pour les immigrants plus âgés. Les auteurs soulignent aussi que la migration des jeunes est effectivement motivée et développée en lien avec l’emploi, mais qu’elle s’inscrit aussi fréquemment à l’intérieur d’un projet d’études. Nous pouvons souligner la volonté des auteurs de proposer « une lecture interdisciplinaire de la question du travail des jeunes au Québec et au Canada …
Maria Eugenia Longo et Mircea Vultur, Le travail des jeunes au XXIe siècle : état de la situation et nouveaux enjeux, Presses de l’Université Laval, 2024, 254 p.
…plus d’informations
Annabelle Cesaro
PRÉCA
acesaro@preca.ca
L’accès à cet article est réservé aux abonnés. Seuls les 600 premiers mots du texte seront affichés.
Options d’accès :
via un accès institutionnel. Si vous êtes membre de l’une des 1200 bibliothèques abonnées ou partenaires d’Érudit (bibliothèques universitaires et collégiales, bibliothèques publiques, centres de recherche, etc.), vous pouvez vous connecter au portail de ressources numériques de votre bibliothèque. Si votre institution n’est pas abonnée, vous pouvez lui faire part de votre intérêt pour Érudit et cette revue en cliquant sur le bouton “Options d’accès”.
via un accès individuel. Certaines revues proposent un abonnement individuel numérique. Connectez-vous si vous possédez déjà un abonnement, ou cliquez sur le bouton “Options d’accès” pour obtenir plus d’informations sur l’abonnement individuel.
Dans le cadre de l’engagement d’Érudit en faveur du libre accès, seuls les derniers numéros de cette revue sont sous restriction. L’ensemble des numéros antérieurs est consultable librement sur la plateforme.
Options d’accès