Dans les contextes actuels au Québec et au Canada où les questions liées à l’immigration sont constamment au coeur de l’actualité politique, économique et sociale, et compte tenu du fait que la croissance de la population est désormais essentiellement attribuable à l’immigration (ISQ, 2024), les enjeux et les défis entourant l’intégration et l’adhésion des immigrants à la francophonie québécoise sont de plus en plus au premier plan des discussions et des débats sur l’évolution de la présence et de l’usage du français au Québec. À tort ou à raison, on s’interroge de plus en plus sur les comportements linguistiques des immigrants, sur les seuils optimaux d’immigration, sur ce qu’on appelle les limites de la capacité d’accueil de la société québécoise − sans trop que l’on sache de quoi il s’agit exactement ni comment la mesurer − ou sur l’influence de l’immigration sur l’évolution de la situation linguistique au Québec. Le gouvernement québécois actuel s’est notamment engagé à tout mettre en oeuvre pour freiner le recul du français au Québec, lequel serait grandement attribuable, selon lui, à la diminution du français comme langue maternelle et comme principale langue d’usage à la maison et au fait que les immigrants ne parleraient pas ni n’utiliseraient suffisamment cette langue. Toutefois, cette lecture de la réalité tend souvent à reposer sur des indicateurs démolinguistiques dont l’interprétation et la pertinence peuvent s’avérer limitées en regard des objectifs de la politique linguistique québécoise centrés sur l’usage du français comme langue publique commune (Marcoux, 2023). De plus, les analyses qui en découlent tendent également à faire l’économie d’une prise en compte de la complexité et de la diversité des processus d’intégration, des dynamiques associées au plurilinguisme ainsi que des défis de la présence concomitante du français comme langue publique commune et de l’anglais comme lingua franca globale (Marcoux, Corbeil et Piché, 2023). Un consensus semble toutefois se dégager concernant la nécessité d’une meilleure gestion et d’une meilleure planification du nombre d’immigrants temporaires des diverses catégories qui sont admis au Québec (Grammond, 2024; Colpron, 2024), en particulier depuis 2022, ainsi que le besoin de meilleures analyses de l’influence qu’exerce une telle poussée migratoire sur les dynamiques linguistiques (Commissaire à la langue française, 2024). Il nous faut cependant prendre un certain recul face au discours de sens commun actuel concernant l’intégration linguistique des immigrants et leur contribution à la francophonie québécoise. Ce discours et les représentations alarmistes et souvent fausses qui l’alimentent ont précédé de plusieurs années cette forte poussée de l’immigration temporaire. Il nous semble dès lors important de remettre en question les exigences souvent démesurées qui se dégagent des récentes politiques linguistiques quant au rapport à la langue française que devraient rapidement développer et entretenir les immigrants et les nouveaux arrivants. Mentionnons, par exemple, l’article de la loi 14 selon lequel six mois après l’arrivée au pays des personnes immigrantes, les services d’accueil de l’Administration ne leur seront offerts qu’en français. L’objectif premier de ce numéro de Recherches sociographiques sur l’immigration et la langue au Québec est donc de jeter un éclairage sur quelques-unes des dimensions clés de ce rapport qu’entretiennent les immigrants avec la langue française de même que sur les rôles et les responsabilités, tant de ces immigrants que de la société d’accueil, en matière d’intégration à une société québécoise principalement de langue française, mais où l’anglais est aussi présent, voire omniprésent dans plusieurs secteurs. Si tant est que l’on cherche des solutions aux problèmes susmentionnés – en favorisant un plus grand usage du français par les immigrants et une plus grande présence du français dans l’espace public, notamment −, il …
Parties annexes
Bibliographie
- Atak, Idil et François Crépeau, 2013 « The securitization of asylum and human rights in Canada and the European Union », dans : S. Singh Juss et C. Harvey (dir.), Contemporary Issues in Refugee Law, Edwark Elger Publishings, p. 227-257.
- Banting, Keith et Will Kymlicka, 2015 The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies, EUI Working Paper RSCAS 2015/73, San Domenico di Fiesole, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute.
- Barry, Brian, 2001 Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Cambridge, Polity Press.
- Benjamin, C., 2011 Compte rendu de : Benoît Dubreuil et Guillaume Marois, Le remède imaginaire: pourquoi l’immigration ne sauvera pas le Québec, Les Éditions du Boréal, 2011, Cahiers québécois de démographie, 40 (1) : 155-170.
- Bouchard, Gérard, 2012 L’interculturalisme : Un point de vue québécois, Montréal, Boréal.
- Calinon, Anne-Sophie, 2015 « Légitimité interne des politiques linguistiques au Québec : le regard des immigrants récents », Minorités linguistiques et sociétés/Linguistic Minorities and Society, 5 : 122-142.
- Calinon, Anne-Sophie, 2013 « L’“intégration linguistique” en question », Langage et société, 144, 2 : 27-40.
- Carens, Joseph H., 2000 Culture, Citizenship and Community: A Contextual Exploration of Justice as Evenhandedness, New York, New York, Oxford University Press.
- Carens, Joseph H., 2013 The Ethics of Immigration, New York, Oxford University Press.
- Champagne, Sarah, 2021 « Québec veut stimuler l’immigration temporaire », Le Devoir, 2 novembre. [https://www.ledevoir.com/economie/644451/emploi-quebec-veut-donner-un-coup-de-fouet-a-l-immigration-temporaire], consult é le 16 novembre 2024.
- Chouinard, Marie-Andrée, 2024 « Sur la question de l’immigration, la stratégie des petits pas », Le Devoir, 24 août. [https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/818605/editorial-question-immigration-strategie-petits-pas], consulté le 24 août 2024.
- Colpron, Suzanne , 2024 « Le fédéral est-il responsable de 420 000 immigrants temporaires au Québec? », La Presse, 28 août, [https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2024-08-28/vu-lu-verifie/le-federal-est-il-responsable-de-420-000-immigrants-temporaires-au-quebec.php], consulté le 30 août 2024.
- Commissaire à la langue française, 2024 Rapport sur l’immigration temporaire : choisir le français, 125 p. [https://commissairelanguefrancaise.quebec/publications/rapports/immigration-temporaire-choisir-francais.pdf]
- Corbeil, Jean-Pierre, 2025 « Politique linguistique et immigration au Québec : d’une intégration inclusive à un assimilationnisme identitaire », Politique et Sociétés, à paraître.
- Corbeil, Jean-Pierre, Richard Marcoux et Victor Piché (dir.), 2023 Le français en déclin ? Repenser la francophonie québécoise, Montréal, Del Busso Éditeur.
- Danican, Malika, 2023 « Francophone ou Québécois : quand “parler français” ne garantit pas l’intégration », dans : Jean-Pierre Corbeil, Richard Marcoux et Victor Piché (dir.), Le français en déclin ? Repenser la francophonie québécoise, Montréal, Del Busso Éditeur, p. 387-400.
- Gouvernement du Québec, 1977 La politique québécoise de la langue française, présentée à l’Assemblée nationale et au peuple du Québec, Québec, Gouvernement du Québec, 67 p.
- Gouvernement du Québec, 1991 Au Québec pour bâtir ensemble. Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration (réimpression de l’édition de 1990), Québec, Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, 104 p.
- Gouvernement du Québec, 1996 Le français langue commune. Enjeu de la société québécoise. Bilan de la situation de la langue française au Québec en 1995, Rapport du comité interministériel sur la situation de la langue française, Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 319 p.
- Gouvernement du Québec, 2015 Ensemble, nous sommes le Québec. Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et d’inclusion, Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Québec, 61 p.
- Gouvernement du Québec, 2022 Francisation Québec : une porte d’entrée unique pour l’apprentissage du français, 15 juin, Archives des communiqués relatifs au Cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. [https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/francisation-quebec-une-porte-dentree-unique-pour-lapprentissage-du-francais-41390], consulté le 20 août 2024.
- Gouvernement du Québec, 2023 Consultation publique 2023. La planification de l’immigration au Québec pour la période 2024-2027, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
- Grammond, Stéphanie, 2024 « Où sont passées les clés de notre système d’immigration », La Presse, 17 août. [https://www.lapresse.ca/actualites/editoriaux/2024-08-17/ou-sont-passees-les-cles-de-notre-systeme-d-immigration.php], consulté le 18 août 2024.
- Grenier, Gilles, 2019 « Quebec’s language policy and economic globalization », Language Problems and Language Planning, 43, 2 : 179-197.
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2023 Bilan démographique du Québec, Édition 2023, 113 p.
- Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2024 Bilan démographique du Québec, Édition 2024, 103 p.
- Le Devoir, 2024 « Le PLQ presse la ministre Fréchette de corriger le tir en francisation », 29 août. [https://www.ledevoir.com/societe/education/818960/plq-presse-ministre-frechette-corriger-tir-francisation, consulté le 25 janvier 2025], consulté le 30 août 2024.
- Leydet, Dominique, 1995 « Intégration et pluralisme : le concept de culture politique », dans : François Blais, Guy Laforest et Diane Lamoureux (dir.), Libéralismes et nationalismes. Philosophie et politique, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, p. 117-130.
- Marcoux, Richard, 2023 « Indicateurs linguistiques. Les limites de la langue maternelle pour renseigner sur la réalité francophone au Canada et au Québec », Diversité canadienne, 19, 3 : 42-45.
- Marcoux, Richard, Jean-Pierre Corbeil et Victor Piché, 2023 « À propos du plurilinguisme et de quelques indicateurs sur la langue française au Québec à la suite du recensement de 2021. Les langues maternelles et parlées à la maison. Québec », Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone, Université Laval, note de recherche de l’ODSEF.
- Oakes, Leigh, 2023 L’intégration linguistique des nouveaux arrivants au Québec : jusqu’où une société libérale peut-elle aller dans ses exigences?, Conférence d’ouverture du colloque « Au-delà des clichés sur les immigrants et la langue au Québec : l’heure juste sur les enjeux et les défis d’une réalité aux contours multiples », 90e Congrès de l’ACFAS, Montréal.
- Oakes, Leigh et Yael Peled, 2018 Normative Language Policy. Ethics, Politics, Principles, Cambridge University Press, Cambridge.
- Oakes, Leigh et Jane Warren, 2009 Langue, citoyenneté et identité au Québec, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Office québécois de la langue française (OQLF), 2024 Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec, 150 p.
- Pagé, Michel, 2005 « La francisation des immigrants au Québec en 2005 et après », dans : Alexandre Stefanescu et Pierre Georgeault (dir.), Le français au Québec. Les nouveaux défis, Conseil supérieur de la langue française, Fides, p. 191-232.
- Pagé, Michel, 2006 « Propositions pour une approche dynamique de la situation du français dans l’espace linguistique québécois », dans : Pierre Georgeault et Michel Pagé (dir.), Le français, langue de la diversité québécoise : Une réflexion pluridisciplinaire, Montréal, Québec Amérique, p. 27-76.
- Pagé, Michel, 2010 L’intégration linguistique des immigrants au Québec (en collaboration avec Patricia Lamarre), Étude IRPP, no 3, Institut de recherche en politiques publiques.
- Pagé, Michel, 2011 Politiques d’intégration et cohésion sociale, Québec, Conseil supérieur de la langue française.
- Patten, Alan, 2001 « Political theory and language policy », Political Theory, 29, 5 : 691-715.
- Piché, Victor, 2004 « Immigration et intégration linguistique : vers un indicateur de réceptivité sociale », Les Cahiers du Gres, vol. 4, n° 1 : 7-22.
- Piché, Victor, 2009 « Migrations internationales et droits de la personne : vers un nouveau paradigme », dans : François Crépeau, Delphine Nakache et Atak Idil (dir.), Les migrations internationales contemporaines. Une dynamique complexe au coeur de la globalisation, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 350-369.
- Piché, Victor, 2018 « Les théories migratoires à l’épreuve du temps », dans : Deirdre Meintel, Annick Germain, Danièle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud, L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 41-57.
- Piché, Victor, 2023 « Langue et choix de société », dans : Jean-Pierre Corbeil, Richard Marcoux et Victor Piché (dir.), Le français en déclin ? Repenser la francophonie québécoise, Montréal, Del Busso Éditeur, p. 39-41.
- Porter, Isabelle, 2024 La demande en francisation explose, mais pas son financement, Le Devoir, 16 août, [https://www.ledevoir.com/societe/education/818278/demande-francisation-explose-mais-pas-financement], consulté le 18 août 2024.
- Rubio-Marín, Ruth, 2003 « Language rights: exploring the competing rationales », dans : Will Kymlicka et Alan Patten (dir.), Language Rights and Political Theory, Oxford, Oxford University Press, p. 52-79.
- Ruhs Martin et Chang Ha-Joon, 2004 « The Ethics of Labor Immigration Policy », International Organization, vol. 58, hiver : 69-102.
- Statistique Canada, 2023 Tableau 17-10-0008-01, Estimations des composantes de l’accroissement démographique, annuelles. [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000801], consulté le 15 janvier 2024.
- Therrien, Steven et Richard Marcoux, 2023 « L’expression “déclin du français” dans les médias au Québec de 2017 à 2022 », dans : Jean-Pierre Corbeil, Richard Marcoux et Victor Piché (dir.), Le français en déclin ? Repenser la francophonie québécoise, Montréal, Del Busso Éditeur, p. 35-38.
- Vaillancourt, François, 2020 Analyse économique des politiques linguistiques au Québec: 40 ans de Loi 101, Groupe de recherche « Économie et langue », Belfast, Ulster University. [https://www.ulster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/571877/20-4-Vaillancourt.pdf], consulté le 24 août 2024.
- Xhardez, Catherine, 2022 « L’immigration et l’élection québécoise de 2018 », dans : Mireille Pâquet (dir.), Nouvelles dynamiques de l’immigration au Québec, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, p. 217-234.


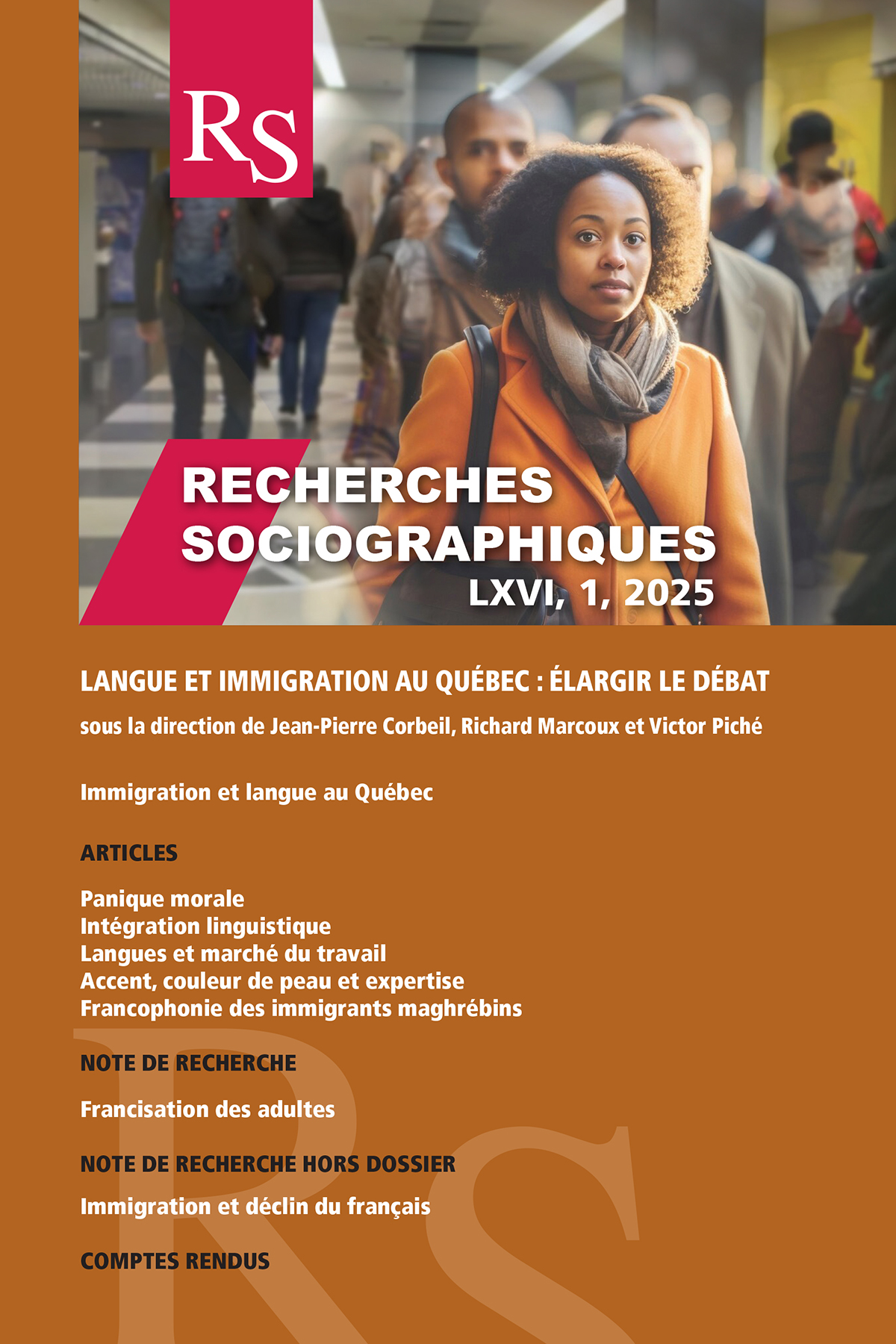
 10.7202/1006636ar
10.7202/1006636ar