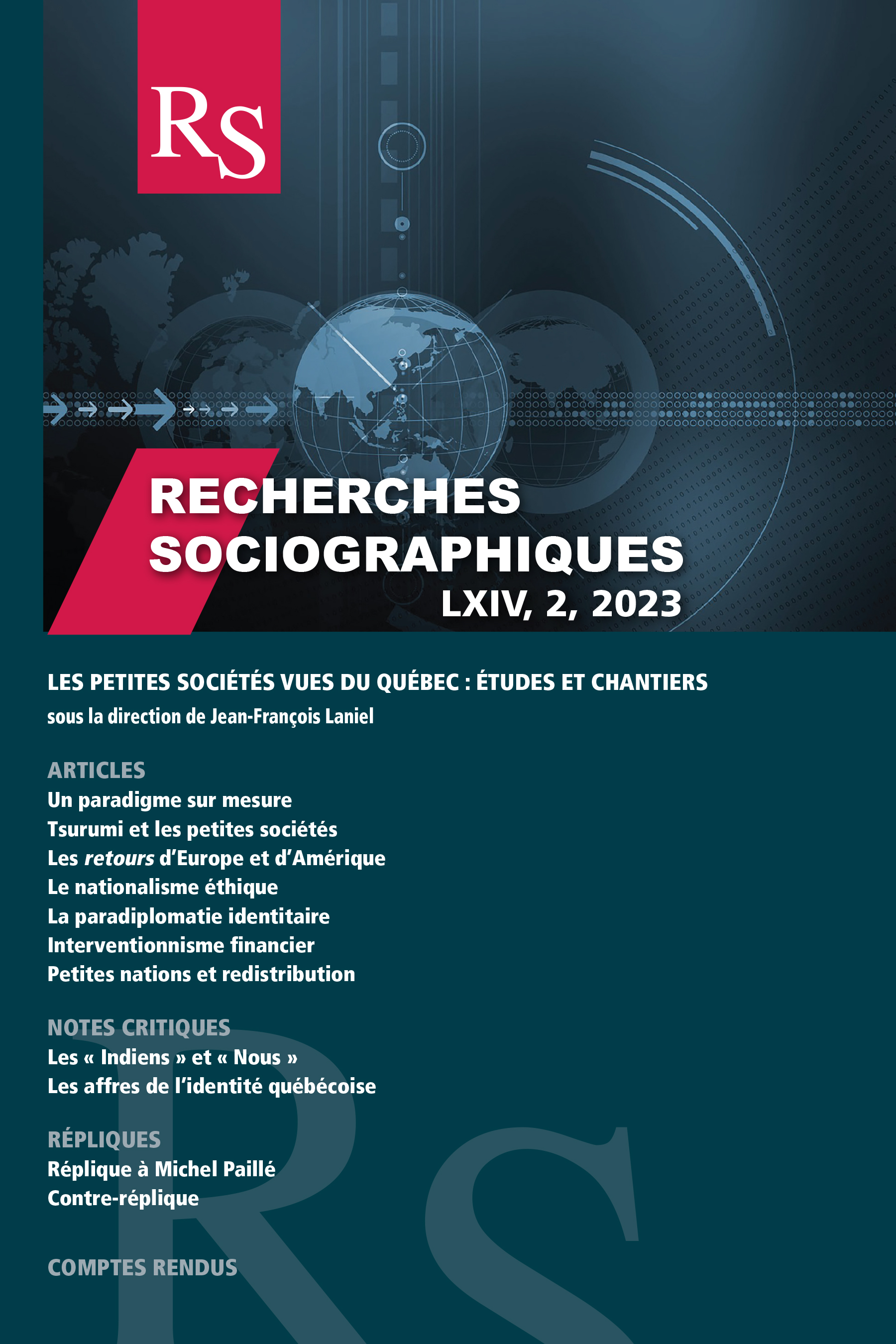Corps de l’article
Ce livre s’ouvre sur la démonstration d’une augmentation marquée de l’itinérance chez les femmes ces dernières décennies au Québec. Malgré cette aggravation de la condition des femmes, il existe encore très peu d’études scientifiques abordant le phénomène des mères en situation d’itinérance. Ceci nuit au développement de plans d’action et à l’élaboration de politiques nationales permettant d’intervenir adéquatement sur la situation. Cette absence d’intervention contribue en effet à l’invisibilité du phénomène d’itinérance au féminin, comme le montrent bien les autrices du livre.
Comment intervenir auprès des mères et des enfants en situation d’itinérance, telle est la question centrale du livre qui cherche en outre à mesurer l’efficacité des interventions qui leur sont destinées. Il débute en dressant le portrait de l’itinérance au féminin au Canada et au Québec. L’enjeu est de parvenir à comptabiliser « l’itinérance cachée » des femmes, à travers la diversité, dans le temps et dans l’espace, tant de ses parcours que de ses visages, ce afin d’offrir les ressources qui manquent cruellement.
La dimension cachée de l’itinérance des mères s’explique par le fait que ces femmes cherchent le plus souvent des alternatives à la rue qui peuvent les mettre en danger. Le caractère inattendu de l’itinérance chez les femmes se révèle en effet extrêmement stigmatisant lorsque celles-ci sont des mères. Par ailleurs, et c’est sur ce point que les autrices innovent dans leur propos, peu de ressources sont offertes aux familles itinérantes parce que les services sont dirigés soit vers les femmes, soit vers les enfants et rarement, sinon jamais, en tenant compte des besoins des deux à la fois dans un contexte familial. L’étude répertorie systématiquement l’aide accordée aux femmes de façon temporaire ou transitoire à travers les maisons d’hébergement, et celle administrée par la DPJ, centrée sur les besoins d’un milieu de vie stable pour les enfants qui lui sont confiés. L’ouvrage montre bien les limites des interventions dont le but n’est pas orienté vers l’aide à apporter aux familles, précisément parce que les services ne sont pas interconnectés. Cette situation redouble la souffrance de ces femmes qui ont l’impression de faire porter le poids de leur itinérance à leurs enfants.
La vulnérabilité et la stigmatisation des mères les entraînent souvent dans des situations critiques auxquelles les services sociaux ont du mal à répondre; ajuster les services à cette réalité apparaît souvent impossible. Les autrices mettent en évidence une stigmatisation des mères itinérantes sous-jacente à l’ensemble des interventions qui leur sont destinées. Il n’est alors pas étonnant de voir que ce sont les services reçus eux-mêmes qui en viennent à être le plus souvent dommageables à la vie des mères ainsi qu’à celle de leur enfant, et notamment au lien d’attachement. Ceci conduit des mères à faire de mauvais choix affectant leur sécurité, leur santé physique et mentale.
Les autrices cherchent, à l’aide d’une revue systématique des textes scientifiques, à mesurer l’effet des interventions psychosociales sur la vie des familles itinérantes. Elles concluent en dégageant de ce corpus des biais importants, montrent que les études sont inégalement fiables sur le plan scientifique, que les échantillons sont trop petits pour en généraliser les résultats, et déplorent une grande hétérogénéité des modèles d’intervention. Elles constatent que les résultats tirés des études quantitatives ne permettent pas de mesurer les effets des interventions destinées aux mères et aux enfants en itinérance.
Il est, par ailleurs, difficile de comprendre les raisons ayant motivé les autrices à exclure les études qualitatives de leur corpus. Ces études narratives auraient certainement pu contribuer à expliquer les effets des interventions vécues par les mères et même par les enfants, permettant de mieux dégager des pistes de solution, et d’unifier les services offerts à ces populations. Loin de mesurer les effets des interventions, les résultats se limitent à ordonner les types d’intervention, de manière descriptive en formulant des constats et des recommandations. Les recommandations portent sur la stabilité résidentielle et économique; sur l’aide à la parentalité et au fonctionnement familial des mères itinérantes; et sur le bien-être et le développement des enfants. On ne tient cependant pas suffisamment compte de la crise du logement qui sévit depuis plusieurs années au Québec, de la marginalisation et de la stigmatisation sociale et économique des mères itinérantes et des femmes en général, du profil de dépendance aux substances chez ces mères. L’ouvrage néglige l’approche de réduction des risques et des méfaits et le manque de ressources criant dont souffre la DPJ. Ce sont là des réalités qui montrent l’échec d’un système visant surtout à exercer un contrôle social sur des personnes qui sont parmi les plus vulnérabilisées de notre société.