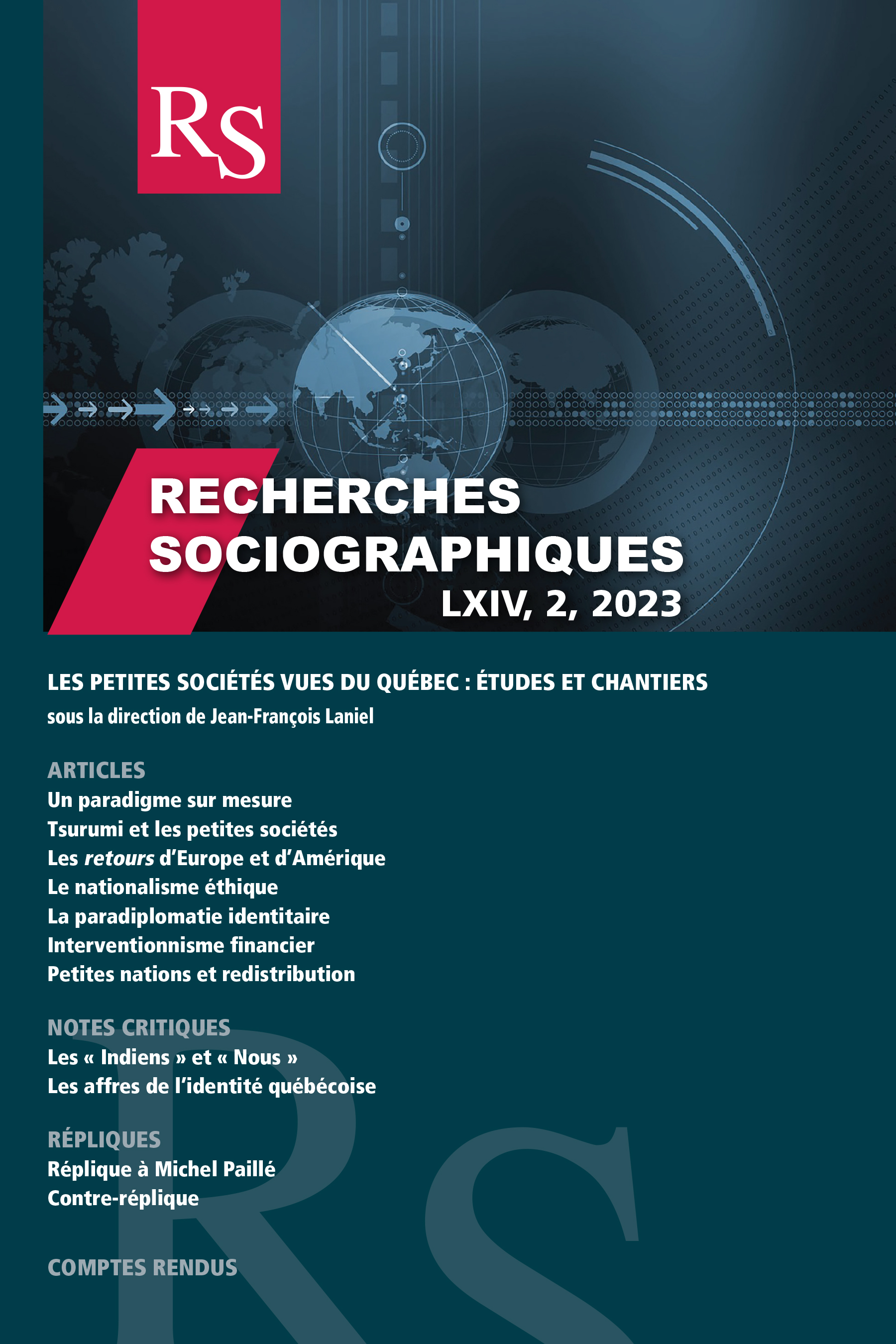Corps de l’article
L’ouvrage a vieilli. Il est devenu témoignage. Il nous en révèle plus sur une thèse datée qu’il nous instruit sur la complexité de l’objet traité.
L’écrit a eu ses gloires. À ses élèves, Séguin a fourni un cadre d’interprétation pédagogique pour décrire la condition québécoise dans le temps. Il les a munis d’un schéma rhétorique pour statuer sur le sens à donner à une expérience historique. D’influents disciples ont disséminé sa parole aux quatre coins du Québec français. La conscience historique collective en a été fortement nourrie. Encore de nos jours, la thèse de Séguin est reprise dans sa vulgate par une majorité de Québécois déclamant un passé qu’ils connaissent mal, mais dont ils ont une vision forte, soufflée par le maître. « On s’est fait avoir », lancent les inspirés. Je parle évidemment des Québécois d’héritage canadien-français, sujets exclusifs des affections de Séguin. Suivant la thèse du professeur, les Anglais, en leur qualité de persécuteurs des Canadiens français, sont en effet (des) étrangers au Québec. Profiteurs (au sein) de la société établie sur cette terre, ils sont extérieurs au Nous l’habitant. Les Autochtones et les Allophones? Absents du topo.
Dans son opuscule, Séguin entend retracer la genèse de l’idée d’indépendance au Québec. Il explique plutôt comment cette idée a dégénéré en son contraire, soit le consentement à l’annexion. Relevant du raisonnement logique plus que de l’examen empirique, sa problématique est péremptoire. Elle se décline en six propositions : 1) Les peuples ont pour vocation naturelle et dessein historique de vivre dans la séparation. 2) L’histoire du Québec est celle de la quête d’abord reportée, puis avortée et enfin dénaturée d’un peuple pour s’élever dans la séparation. 3) L’échec du projet séparatiste québécois tient notamment à la candeur des Québécois, celle-ci découlant de leur aliénation, maladie les menant à prendre des vessies pour des lanternes, par exemple à confondre le séparatisme avec le fédéralisme. 4) Être un peuple minoritaire dans une fédération, c’est être un peuple annexé. 5) Pour sortir de cette condition, l’indépendance est une nécessité historique. 6) La survivance est la conséquence de la dépendance.
Cette thèse convainc-t-elle? Non. Elle n’est même pas fondée. Pour au moins trois raisons :
1- La prémisse selon laquelle les peuples auraient quelque vocation naturelle et destinée attendue est indéfendable. Pareille position émane d’une métaphysique évolutionnaire délaissée depuis longtemps par la méthode historienne. Il n’y a pas de voie prescrite ou normative au devenir des entités – nations, peuples ou sociétés. Il n’y a pas non plus, pour elles, de forme idéale ou de trajectoire réussie. Les entités se construisent et deviennent par l’action humaine. Faire oeuvre savante commande de les analyser dans leurs formes observables, non de les envisager dans leurs architectures désirables. Que les Canadiens français ne se soient pas séparés des Canadiens anglais et que le Québec n’ait pas accédé au rang d’État indépendant, voilà qui consterne Séguin. L’Histoire n’a cure de pareil ressenti. Celle-ci prend consistance dans les singularités qui la composent et qu’elle engendre dans l’indétermination de son cheminement.
2- Séguin a raison de dire que l’idée d’indépendance traverse l’histoire du Québec. Le désir de séparation constitue une variable importante dans l’équation politique québécoise. D’autres variables – la volonté de coopération par exemple, amplement soutenue par la population – doivent cependant entrer dans la formule si on la veut démonstrative.
En considérant l’ensemble des éléments composant l’intention nationale des Québécois, celle-ci apparaît dans son ensemble plurivoque et multiforme. Si, pour Séguin, la réponse à la question du Québec est claire : la séparation et rien d’autre, ce rien étant pour l’historien la condition du tout, soit la nécessité pour un peuple de s’achever dans l’État-nation souverain, les choses ne luisent pas autant pour les Québécois. La solution indépendantiste n’a jamais remporté la faveur de l’opinion élitaire et populaire. D’hier à aujourd’hui, les Québécois, dont Séguin aurait voulu qu’ils agissent comme un peuple uni et une nation soudée, n’ont jamais communié à la même eucharistie patriotique ni endossé le même programme oecuménique. Divisés politiquement, ils ont toujours appuyé plusieurs projets d’avenir en simultané. Historiquement, la cité québécoise s’est reproduite dans les différends et les dissonances. Allergiques aux aménagements plurivoques, les ultras ont invariablement occupé la place de minoritaires bruyants. Ouverts aux arrangements multivalents, à celui de souveraineté-association notamment, qui a une longue histoire, mais sous diverses appellations, les modérés ont immanquablement remporté les mains du pays.
Voué comme historien à l’étude des inattendus de l’agir individuel et collectif, Séguin aurait dû saisir les Québécois comme ils sont principalement lorsqu’on les prend dans leur totalité : un groupement flexible et tranquille qui désavoue l’effréné et apprécie le tempéré. Le dogmatisme et le radicalisme n’ont jamais pris au Québec. Les Québécois affectionnent les rénovateurs de présomption qui se révèlent conservateurs d’horizon et réformateurs d’exécution. Ils n’adhèrent pas à l’idée voulant que le refus de la démesure engendre la sagesse pauvre. De la prudence, tel est leur mantra. Quant à leur culture politique, elle s’appuie sur trois piliers : le réformisme tranquille, le progressisme conservateur et le pragmatisme libéral. La résistance aux excès vécus ou perçus est l’enseigne sous laquelle se regroupent la grande majorité des Québécois. L’analyste enregistre pareille conduite. L’idéologue la déplore.
3- Séguin est pessimiste, mais pas aveugle. Dans la pratique politique des Canadiens français, il détecte des postures qui font état d’un désir manifeste d’association, vivifié par des leaders ouverts à l’idée de fédération par exemple. Au lieu de reconnaître cette réalité, il sermonne les « démissionnaires », capitulards du bon sens, dit-il, et réprouve leurs « idées illusoires ». Pourquoi les siens n’ont-ils pas fait ce que doit et arrimé leur finalité à leur fatalité?
Les circonstances de l’histoire n’ont pas aidé. Ses avatars ont été souvent néfastes au destin québécois, l’éloignant de son dessein. Ce n’est pourtant pas l’argument principal du professeur. Pour Séguin, la capacité du gagnant, l’Anglais, à imposer sa loi au perdant, le Canadien français, est plus probante. À partir de 1760, le Canadien n’aurait eu d’autre choix que de suivre la route tracée par son maître l’Anglais, d’autant que celui-ci, rusé, allait border de murs dorés le chemin obligé, celui de la minorisation et de l’infériorisation. C’est ainsi que les Québécois allaient former « la nation annexée la mieux entretenue au monde » (p. 53). Gavés de promesses, ils ne se défieraient pas des alliances périlleuses, allant jusqu’à louer les rapprochements compromettants. Pourquoi? Par innocence devant les avances du maître, cette naïveté découlant de leur envahissement par un mal sournois : l’aliénation, source de leur contentement béat (p. 92).
Le concept d’aliénation ouvre aux démesures interprétatives. Un sujet aliéné, comme l’est pour Séguin le Québécois, s’avère incapable d’embrasser autre chose que ce qui lui est dicté, tout en ignorant la présence du diktat, qu’il n’arrive même pas à imaginer. Que reste-t-il de la liberté et de la volonté du sujet? Rien. Un sujet aliéné nie sa subjectivité, qu’il assujettit au pouvoir de son dominateur. Tout le contraire de l’agir pour soi, notion cardinale chez Séguin. Pour ce dernier, la montée de l’option fédéraliste à partir des années 1840 est le produit de l’aliénation par l’Autre du désir naturel du Soi de se séparer, qui à cause de cette aliénation choisit l’union à l’Autre, posant du coup les conditions de son incorporation dans l’Autre, qui ce faisant mue en hydre à deux corps et à deux têtes : l’Autre hors Soi, qui gruge le Self par l’extérieur, et l’Autre en Soi, qui le ronge de l’intérieur. La déperdition du Soi est totale.
Pour saisir l’intention nationale des Québécois et comprendre leur refus de se séparer à ce jour, peut-on vraiment endosser pareille explication?
Avec ce texte doctoral et doctrinal, Séguin erre sur le plan analytique comme sur le plan politique. Sa thèse ne lui permet ni d’éclairer le passé, ni de clarifier le présent, ni d’instruire l’avenir. Ses « enseignements » achoppent – ce que pleure le préfacier du livre – parce que les Québécois, allergiques aux traités eschatologiques, ont appris à se méfier des écrits canoniques et des textes liturgiques. La décision de republier son ouvrage tient de la dévotion évangélique envers une Idée et son prophète, non de l’intention académique de capter le souffle d’une société à partir du travail serré de ses exégètes.