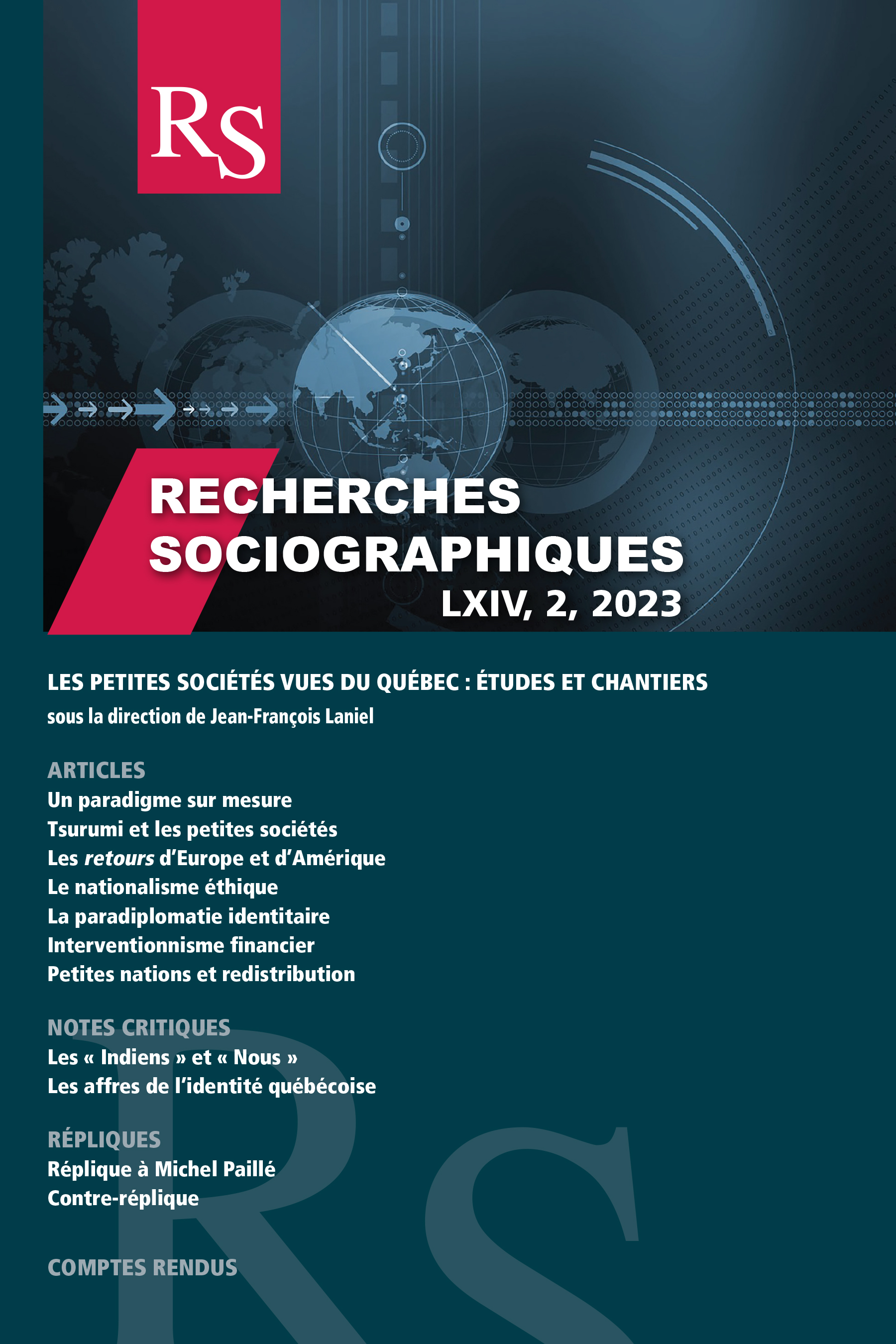Corps de l’article
La publication de ce recueil doit être saluée puisqu’elle permet de combler un vide dans l’écriture de l’histoire de la sociologie canadienne-française. Quoique négligé et maintenant peu connu, sinon méconnu, Philippe Garigue n’en a pas moins produit durant les années 1950 et 1960 des travaux importants sur la famille, la société et la nation canadiennes-françaises. Le fait qu’il fut un conservateur catholique en pleine montée de la sécularisation et de l’État-providence explique peut-être ce désintérêt. La radicalité de sa critique de la doxa qui fit de la communauté canadienne-française une société traditionnelle ou paysanne, bref une folk society, l’explique sans doute davantage. Soulignons aussi que Garigue eut un parcours singulier. Né en Angleterre en 1917 d’une famille anglo-française, il émigra au Canada en 1954 alors qu’il devint professeur à l’Université McGill, avant de devenir, en 1957, doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal. Il occupa ce poste jusqu’en 1972. En 1980, il devint principal du Collège universitaire Glendon à Toronto où il enseigna jusqu’en 1997. Ce départ définitif du Québec explique sans doute aussi cette sorte d’oubli puisqu’il ne participa plus véritablement aux débats sociologiques québécois, s’intéressant à d’autres domaines de recherche comme les études stratégiques et la francophonie ontarienne.
Radicale fut en effet la remise en question dans un contexte intellectuel peu enclin à la critique. Comme il le souligne avec raison, il existait une quasi-unanimité dans le domaine de l’analyse de la communauté nationale : à partir de Gérin, la nation canadienne-française fut considérée comme une société traditionnelle et de plus en plus par ceux qui s’en inspirèrent comme une sorte d’anomalie en marge de la société urbaine triomphante. Garigue ne contesta jamais l’idée que le Canada français formait une société et une nation, bref, comme on le disait à l’époque, une société globale et homogène. Il refusa radicalement d’admettre cependant qu’il ait pu se développer en marge, voire à l’extérieur de la modernité, ce qu’il paraît lire en sous-texte dans les travaux des sociologues anglophones et francophones. À l’origine, selon lui, les travaux de Gérin auraient été invalides, ceux s’inspirant de la théorie de la folk society tout simplement faux et naïfs, et la production de Falardeau et de Rioux sujette à caution. Il rejeta l’approche idéal-typique inspirant les tenants de l’École de Chicago et considéra que les concepts proposés dans le cadre des travaux sur le Canada-français étaient des mythes idéologiques.
À l'évidence, je ne peux rendre compte ne serait-ce que de l'essentiel des débats que ne manquèrent pas de susciter les positions de Garigue. Ce dernier défendit la thèse, aujourd'hui largement admise, que la Nouvelle-France n'avait rien d'une société rurale d'Ancien Régime, mais fut plutôt une entreprise d'abord et avant tout commerciale, instituée de façon fortement centralisée par le pouvoir colonial et l'Église catholique. S'inspirant des historiens Frégault et peut-être Séguin, il soutint que le repli dans l’agriculture résultait de la Conquête, mais refusa de considérer le Canada français comme une société paysanne. La nation canadienne-française demeura selon lui une société homogène, sans doute, mais diversifiée qui s’inséra dans la modernité en luttant pour son autonomie culturelle, au nom de la nécessité de sa survivance. En cette fonction, Garigue proposa que le fédéralisme soit transformé en un État binational, à tout le moins, au niveau du gouvernement fédéral.
Je terminerai en signalant ce qui me semble un évident paradoxe. À tout prendre, on doit reconnaître que, dans les débats sur la pertinence du concept de folk society, c’est bel et bien Garigue qui paraît s’approcher de la position la plus juste si, à tout le moins, on s’appuie sur les travaux des historiens et des sociologues réalisés depuis les années 1980. Se pourrait-il cependant que Garigue ait affirmé la modernité du Canada français pour mieux défendre l’institutionnalisation d’une époque révolue? Il soutint avec raison que le Québec sortait alors de ce qu’il appelle l’État libéral traditionnel. Il souligna en même temps certains traits du passage à l’État-providence, sans cependant utiliser ce concept. Il s’avéra malgré tout beaucoup plus disert dans sa défense et illustration, par ailleurs fort élégante, des idées de survivance et d’autonomie culturelle, tout en empruntant à Groulx la notion d’intentionnalité. En somme, bien qu’ayant eu raison sur le fond, il semble avoir souhaité la reproduction de ce que certains sociologues et historiens appellent aujourd’hui la société consociationnelle, soit une société formée de deux nations et de deux complexes institutionnels séparés, réunis sous l’égide de l’État libéral. Dit autrement, Garigue me paraît finalement avoir défendu la modernité libérale qui se constitua d’abord dans le Canada-Uni et subsista jusqu’en 1960, bien qu’il eût préféré un fédéralisme binational. Soyons clairs, Garigue ne minimisa pas les problèmes du Canada français mais il considéra qu’ils étaient d’ordre organisationnel plutôt qu’institutionnel ou structurel.
Il faut donc saluer la production de ce recueil préparé et présenté par Linda Cardinal et Martin Normand. Tout en contribuant à l’histoire de la sociologie, ce livre paraît susceptible de relancer la réflexion sur la macrosociologie des sociétés particulières. Quel rapport peut-on établir entre cette sociologie et l’idéologie? Comment déterminer le lieu théorique et empirique d’une société et d’une nation particulières, quand il n’est pas donné mécaniquement par la pseudo-évidence de l’État mononational.
En fin de course, il me manque l’espace nécessaire au traitement des intéressantes réflexions de l’auteur sur la francophonie ontarienne et la nécessité d’y repenser ce que fut la nation canadienne-française.