Résumés
Résumé
Comment arrimer ou concilier l’histoire des Autochtones et celle des Québécois dans un récit de synthèse ayant pour objet le passé du Québec? Telle est la question qu’adressent Dorais et Nootens à une douzaine de collaborateurs, qui manquent toutefois de lui fournir une réponse concluante, faute de s’attaquer à trois problèmes sous-jacents : 1) Quelle place accorder aux Autochtones dans une histoire générale du Québec (à distinguer d’une histoire des Autochtones au sein de l’espace dit québécois)? 2) Comment accorder l’« épistémè autochtone » et l’« épistémè allochtone » dans un mode convergent de production des connaissances? 3) Québécois et Autochtones peuvent-ils échapper à leurs représentations réciproques pour s’offrir mutuellement des brèches de compréhension porteuses de réconciliation – au moins narrative? Optimiste (ou candide), l’auteur, à défaut de solutionner les problèmes laissés en suspens, suggère des pistes pour les amadouer.
Mots-clés :
- Premiers Peuples,
- Québécois,
- mise en récit du passé,
- conciliation narrative,
- histoire juste
Corps de l’article
L’ouvrage aborde une question cruciale sur le plan politique et capitale sur le plan historiographique avec des retombées évidentes sur le plan éducationnel[1] : comment arrimer ou concilier l’histoire des Autochtones et celle des Québécois dans un éventuel récit de synthèse ayant pour objet l’histoire du Québec[2]? Les intervenants conviés à la discussion sont spécialistes de l’histoire des Premiers Peuples ou membres de nations amérindiennes. Les textes sont de nature réflexive (Getler et Bernard) ou démonstrative (Arsenault, Bouchard et Brodeur-Girard). Quatre chapitres consistent en des entrevues – magistrale de Dorais avec Delâge, serrée de Bédard avec Bibeau, permissive de Dubé avec Gill et franchement laxiste de Roy-Grégoire avec Deer, qui en profite pour exprimer un point de vue militant à relents identitaristes.
Le livre peut être lu comme un dialogue virtuel entre les auteurs sur un sujet sensible et compliqué. Le résultat de l’« échange» est mi-figue, mi-raisin. Si Getler a le mérite de bien amorcer la discussion, si Arsenault effectue un survol éclairé de la production savante touchant l’histoire commune des Québécois et des Autochtones, et si les textes de Bernard, de Bouchard et de Brodeur-Girard sont captivants, en particulier celui de Bernard, Abénakis d’Odanak et doctorant à l’Université de Montréal, aucune proposition globale ne permet de trancher l’interrogation formulée par les directeurs de la publication et que reprend le titre de l’ouvrage. Rompus aux hésitations du monde savant, qui disserte plus qu’il n’arrête, Dorais et Nootens devaient savoir que la question énoncée par eux demeurerait irrésolue. N’écrivaient-ils pas en introduction du livre, comme pour diminuer les attentes du lecteur envers toute épiphanie conclusive, que leur but était d’ouvrir le débat, non de le fermer? Malgré l’importance et la pertinence de la question soulevée par les collègues, il est permis de douter que l’on puisse un jour la dénouer tant les enjeux qu’elle porte – politiques, idéologiques, épistémologiques et méthodologiques – sont pesants. Peut-on, autour d’un ensemble de propositions narratives, rassembler toutes les confréries d’interprètes, qu’elles soient d’obédience autochtoniste, québéciste, décoloniste, nationaliste ou postcolonialiste, quand le passé, en dépit des exhortations lancées pour en respecter l’intégrité et l’intégralité, fait l’objet d’autant de litiges pour l’articuler en fonction de finalités désirées, souvent radicalement opposées?
La leçon à tirer du livre est peut-être qu’il n’y a pas, qu’il n’y aura jamais moyen de s’entendre sur un exposé de l’expérience historique québécoise qui, dans un récit structuré d’histoire, engloberait l’ensemble des acteurs ayant façonné le lieu du Québec d’hier à aujourd’hui, y compris bien sûr les Premiers Peuples et les Inuits. À la question posée par Dorais et Nootens, il n’y a vraisemblablement qu’une seule réponse (désolante de mon point de vue; j’y reviendrai en finale), soit celle de la pluralité des voix et de la diversité des perspectives. Dit autrement : la dynamique relationnelle entre Autochtones et Québécois ayant été, depuis cinq siècles environ, simultanément agrégée, emmêlée et séparée, il est fort difficile, peut-être impossible, d’en rendre compte autrement qu’à travers une multitude de récits faisant état de l’histoire tout à la fois commune, croisée et parallèle des deux groupes génériques, ceux-ci vivant dans des situations de proximités distantes, d’interdépendances contraintes et de partenariats disjoints au sein d’un espace qu’ils habitent ensemble-séparément, dans une relation duale autant que duelle.
⁂
Le livre ne manque pas d’intérêt non plus que de profondeur. On s’étonne toutefois de trouver chez la majorité des auteurs, sinon chez tous, mais à tour de rôle et chaque fois de façon différente, certaines confusions qui ne semblent pas déranger.
La première est de poids, car elle touche au sujet même de l’ouvrage, à savoir l’histoire qui est en cause : celle du Québec (en y intégrant évidemment les Premiers Peuples et les Inuits), celle des Autochtones au sein de l’espace québécois, celle du Québec du point de vue autochtone ou celle du monde autochtone saisi en lui-même et pour lui-même, que Dorais et Nootens appellent une « histoire autochtone autonome et autoréférentielle ». La chose ne va pourtant pas de soi. Faire l’histoire du Québec en incluant les Premières Nations et les Inuits représente en effet un projet différent des trois autres, notamment du quatrième[3]. La distinction est d’autant plus flagrante que le Québec (territoire, État et population allochtone), tout en constituant un référent inévitable pour les Autochtones et un élément structurant de leur histoire, n’est pas pour eux une entité qui a du sens sur le plan identitaire, historique, géographique ou administratif, non plus que sur le plan chronologique (datation des événements) et temporel (détermination des périodes historiques), comme l’illustre brillamment Bernard dans son texte[4].
Si, répondant à l’appel d’une maison d’édition, un auteur s’attelait à la tâche de produire une histoire générale duQuébec, il ne pourrait accorder aux Autochtones un rôle décisif du début à la fin de son récit. Certes, il lui faudrait octroyer aux Premiers Peuples, jusque dans les années 1820 environ[5], une place importante, voire déterminante – « fondatrice » revendiquerait peut-être Gérard Bouchard[6] –, dans l’évolution des choses. Par la suite, il n’aurait d’autre choix que de réduire cette place, voire de la ramener à peu de chose, en tout cas de la situer en périphérie du récit plutôt qu’au centre, sans pour autant la négliger ou la néantiser, loin de là[7]. Pourquoi faire ainsi? Parce que les Autochtones, à partir de la deuxième décennie du 19e siècle, sont graduellement écartés comme acteurs majeurs de ce qui se déroule principalement au Canada-Québec[8], victimes résistantes et résilientes de l’entreprise de canadianisation du pays[9], projet réalisé sous l’égide des descendants des Britanniques, mais auquel les descendants des Français participent aussi, à plusieurs niveaux d’ailleurs, y compris à l’échelle municipale[10], et ce, nonobstant le processus de « provincialisation » qu’ils connaissent concurremment et qui les projette dans une situation synchrone de dominateurs et de dominés. Parler des Autochtones dans le cadre d’une histoire générale du Québec-(Canada), c’est donc faire état avant tout – mais pas exclusivement, car la condition de colonisé n’épuise pas la condition autochtone – du combat mené par les Premiers Peuples et les Inuits contre l’oppression, la dépossession et la marginalisation qu’ils subissent au sein du monde allochtone, combat éprouvant jusque dans les années 1960, mais percutant et conséquent par la suite, au point où les Autochtones, de nos jours, malgré bien des embûches et des résidus institutionnels (pensons à la Loi sur les Indiens, maintes fois amendée, mais toujours controversée), occupent dans l’agora québécoise, et canadienne bien sûr, des sièges en cuir(ette) plutôt que des strapontins en bois.
Il existe évidemment, en deçà, au-delà et à côté de cette lutte de survivance, éclatante manifestation d’agentivité faut-il le souligner, allant de l’insoumission à l’insurrection en passant par l’agitation, l’argumentation, le recours à la tradition et l’atout de la constitution, mais aussi par l’adaptation et la participation au monde allochtone (le cas des Wendat est ici patent), une histoire autochtone, voire des histoires autochtones, qui ont, ou n’ont pas, le Québec-(Canada) comme tenant et aboutissant. Ces histoires concernent l’évolution spécifique de chaque peuple, si ce n’est de chaque communauté distincte, voire de chaque hameau isolé, comme Sujet principal d’histoire, dans ses défis, contraintes, soucis, conflits internes et autres enjeux particuliers. Jusqu’à quel point peut-on faire état de ces histoires singulières dans le cadre d’une histoire générale du Québec qui inclut les réalités autochtones? Même une somme de 10 000 pages n’y suffirait pas. Un récit d’histoire ne peut allouer en sa trame et son intrigue une place semblable à tous les acteurs qui ont agi ou surgi dans le temps, car le passé, dans sa substance et son déroulement, n’a ni cette nature ni cette facture[11]. Le passé est inégalitaire et violent. Quant à sa teneur, elle est non négociable, serait-ce pour arranger les promoteurs de valeurs rassembleuses, les partisans d’une histoire à parts égales ou les adeptes de rectitude politique et historiale.
J’ignore par ailleurs pourquoi certains auteurs, plutôt que de parler du Québec comme lieu de déroulement d’une partie de l’histoire autochtone ou théâtre d’articulation des histoires québécoise et autochtone, préfèrent employer l’expression « histoire nationale du Québec ». Tic agaçant lorsqu’il est inconscient[12], la toquade devient franchement déplacée quand elle se fait intentionnelle. L’histoire nationale du Québec est celle de la formation du peuple québécois, héritier du peuple canadien puis canadien-français, et de sa constitution en nation autodésignée et instituée. De nos jours encore, ce peuple-nation peine à se définir et à exister autrement que sous la figure et dans le corps des descendants des Français du Saint-Laurent auxquels se sont ajoutés de nombreux immigrants (intégrés) et ressortissants (assimilés). Il est clair que les Autochtones, qui s’identifient comme membres de différentes nations autonomes, n’appartiennent pas à ce peuple-nation ni ne le souhaitent. Pourquoi vouloir les incorporer à une entité, donc les insérer dans une histoire nationale, qui ne les concerne pas, sauf indirectement, par suite des contacts ordinaires ou institués qu’ils ont eus avec les Québécois d’héritage canadien-français, autre peuple-nation avec lequel l’interrelation a été grande, mais l’intégration non advenue et l’unification encore moins survenue? Arsenault est clair à ce chapitre et il a raison : malgré la bonne foi des penseurs, la réconciliation entre Autochtones et Québécois (lui parle de colonisés et de colonisateurs) ne peut se faire sur la base d’une appropriation de l’altérité autochtone au profit d’un élargissement forcé ou forgé du cercle de la nation québécoise[13].
⁂
La deuxième confusion commise par certains auteurs touche à ce qu’il faut entendre par « histoire ». Il est clair que la conception autochtone de l’histoire et sa pratique, telles que présentées par Deer, Bernard et Gill en tout cas, respectivement Mohawk, Abénakis et Innue (mais « Abénakise et Québécoise aussi », ajoute la poétesse), sont assez différentes de celles qui marquent le monde allochtone[14]. Les Autochtones privilégient l’interprétation, soit la production du sens, cadrée par rapport à une philosophie, une cosmogonie, une spiritualité et une ontologie préalables, donc fondée dans les croyances et la mémoire, tout en mobilisant régulièrement la tradition orale et, au besoin et de façon subsidiaire, l’information écrite et archéologique. Pour sa part, la pratique allochtone de l’histoire, réputée factuelle, donc fondée sur la preuve et l’examen critique des documents, s’appuie sur les archives et les artefacts ainsi que, de plus en plus, sur les sources orales et la linguistique. Elle cherche elle aussi à déboucher sur l’interprétation (le sens), mais en évitant toute contamination extrascientifique pour y parvenir, ce qui est un objectif recherché plus qu’atteint.
On pourrait dire les choses autrement. La démarche autochtone vise à réconcilier le sens et la vie pour reproduire la communauté historique dans sa totalité, incluant l’environnement dans lequel elle s’intègre, compris aussi comme une matière vivante, ce qui relève du holisme. Dans ce contexte, l’épistémique et l’ontologique se conjuguent dans un régime de vérité marqué par la subjectivité assumée de l’interprétant au bénéfice de l’équilibre et de l’harmonie générale du groupe, et ce, dans une perspective globale et une temporalité circulaire. Ici, tout est compris et rien n’est perdu. Le cercle se reconstitue dans une récurrence au sein de laquelle survient éventuellement le changement désiré ou désirable. La démarche allochtone est différente. Elle cherche, dans un premier temps du moins, à distancer l’interprétation de l’action pour, dans un deuxième temps, en réconciliant explication et exécution, à faire évoluer la société dans le sens d’une certaine idée de progrès associable à une temporalité linéaire obéissant au principe causal (dynamique de l’occurrence). Ici, l’épistémique et l’ontologique sont séparés. L’évidence factuelle et l’objectivité rationnelle sont au coeur de la vérité poursuivie par l’interprétant, vérité sans cesse questionnée et remise en cause, donc toujours en état de probation et de perturbation, la chose se répercutant jusqu’au coeur de la société, celle-ci étant continuellement examinée et critiquée en vue de sa transformation, ce qui la place dans une situation de perpétuelle tension et dissension avec elle-même, laquelle est source de dissonance créative et vecteur d’avancement aussi, dit-on. Dans l’écosystème cognitif et narratif allochtone, la reproduction réside dans le changement perçu et conçu comme salutaire et profitable.
Est-il possible d’accorder l’épistémè autochtone et l’épistémè allochtone, ainsi que leurs méthodologies respectives bien sûr, dans un mode convergent de production des connaissances? À l’encontre de ce qu’affirme Deer, qui postule l’incompatibilité des savoirs autochtone et allochtone en idéalisant le premier et en dénigrant le deuxième[15], certains rapprochements sont possibles et ont effectivement eu lieu. Capable d’autocritique et de mutation épistémique, comme le rappelle Bédard à Bibeau, l’histoire allochtone a singulièrement changé depuis cinquante ans, à la faveur surtout des travaux menés en anthropologie historique et en ethnohistoire, mais aussi, depuis une vingtaine d’années, voire plus, à la suite de l’importance acquise dans les milieux savants par les courants déconstructivistes, décolonialistes et post-colonialistes, pour ne rien dire de l’impact des cultural studies, des subaltern studies et de la New Indian History, sans compter l’apport des nouvelles pratiques de recherche relevant de la mobilisation des connaissances, de la co-construction du savoir et des démarches inclusives (Inksetter, 2020-2021).
Il est cependant une limite difficilement franchissable pour l’épistémè allochtone, celle entre histoire et mythologie. Certes, les mythes, dont la fumée renvoie au feu de la réalité, dit-on, peuvent être porteurs de sagesse, offrir matière à réflexion et livrer quelques intuitions perspicaces sur la condition humaine. Spécialiste des discours mythiques, Marcel Detienne n’affirmait-il pas que les mythologies, qui incidemment ne sont pas antinomiques avec la modernité et l’hypermodernité, accueillaient l’essentiel des cultures? Quoi qu’il en soit, c’est comme puits d’omniscience que les Premiers Peuples et les Inuits considèrent leurs mythes, d’où la prégnance de ces histoires réputées sacrées dans l’univers cognitif, interactif et performatif des intéressés. Il va de soi que connaître ces mythes est nécessaire à tout chercheur qui ambitionne de comprendre les cultures autochtones de l’intérieur. Dans cette ouverture envers le système de pensée de l’« Autre », pratiquée par l’anthropologie allochtone depuis des lustres, il y a assurément reconnaissance d’une différenceéquivalente, c’est-à-dire acceptation d’une pluralité épistémique, admission des mérites propres à chaque mode de connaissance et rejet de toute forme de colonialisme historiographique. L’intention est certainement heureuse. Pour autant, la « décolonisation » du savoir ne peut se satisfaire d’une attitude débonnaire envers toute approche ou méthode autoprésumée valable et valide. Commodément convoqué par Bibeau pour justifier certaines lectures inhabituelles du passé, le concept de « régime de vérité », par exemple, a ses limites. Que le projet savant allochtone, bien qu’il se fasse souvent naïf par rapport à ses propres prétentions d’intelligence et de clairvoyance, se distancie d’un mode de production des connaissances qui brouille les frontières entre histoire, philosophie, cosmogonie, spiritualité et ontologie, donc entre les faits, la morale, les mythes, les croyances et la métaphysique, n’a rien d’inapproprié et encore moins d’infécond. Accepter certaines facettes de l’épistémè autochtone n’oblige aucunement un chercheur à en cautionner béatement toutes les prémisses et déductions, pas plus que l’ouverture en cause n’implique de sa part le désaveu de l’épistémè allochtone comme vecteur de saisissement et de compréhension du monde. Faut-il rappeler que le bilan scientiste n’est pas exclusivement négatif? D’ailleurs, le mode autochtone de production du savoir, si tant est qu’il soit irréductible et univoque, ce qui n’est pas le cas, peut accueillir favorablement la démarche scientifique parmi ses moyens de préhension, comme Bernard le montre par son texte. Inutile de dire qu’il en est de même du mode allochtone de production du savoir par rapport à sa contrepartie autochtone.
Du coup, quel arrimage envisager entre l’épistémè autochtone et l’épistémè allochtone? Au-delà de leurs différences, concurrences et autres discordances, il existe, de la part de ceux qui s’associent à l’un ou l’autre « système » de connaissances, une responsabilité commune de parvenir à ce que l’on pourrait appeler une juste représentation et compréhension des choses, y compris de l’histoire, bien sûr. Juste, il va sans dire, du point de vue de la rigueur empirique et analytique; mais juste aussi par la mesure et la complémentarité des interprétations proposées pour saisir ce qui fut et ce qui est. Chose certaine, il ne peut y avoir de conciliation, à propos de l’histoire à relater et à raconter, concernant la part autochtone de l’expérience historique québécoise en particulier, si la suffisance d’un côté et l’intransigeance de l’autre font office de postulat méthodologique et de posture épistémique. Ni le scientisme ni l’authenticisme n’offrent en effet de solution entière au désir de comprendre et au défi d’y parvenir. Dit clairement : mieux vaut penser conjointement en s’ouvrant aux perspectives altéritaires que de réfléchir isolément en se murant dans ses certitudes identitaires. Intéressant de considérer dans ce contexte l’article de Brodeur-Girard, qui montre à quel point deux ontologies du territoire réputées incompatibles sont peut-être accommodables, sachant que la conception autochtone du rapport à la terre, fondée sur l’idée de pratique relationnelle plutôt que sur celle de droit exclusif de propriété, ouvre d’attrayantes possibilités du point de vue du partage responsable de l’espace, et ce, envers et contre son appropriation privée ou son occupation jalouse[16]. Avis aux partisans et opposants de la « reconnaissance territoriale des Premiers Peuples », qui interprètent la formule controversée de manière étroite, dans l’optique de s’attribuer entièrement la terre habitée ou de n’en rien céder, ce qui contredit la tradition autochtone du droit territorial tout en interrogeant résolument le système allochtone de la propriété privée, pour ne rien dire de l’idée impériale de « territoire conquis » ou de celle, absolument bancale, de Terra Nullius[17].
⁂
Il est une troisième confusion qui, selon moi, caractérise plusieurs contributions à l’ouvrage. Elle touche la distinction à faire entre « savoir fin » et « savoir grossier » ainsi qu’entre histoire et mémoire.
Éric Bédard et Denys Delâge, qui ne peuvent être associés aux courants en vogue du décolonisme ou du postcolonialisme, ont raison de souligner que la recherche allochtone portant sur les Autochtones – ou faite avec eux – a beaucoup changé depuis trente ans. Il existe en français ou en anglais, pour s’en tenir à ces deux langues, une profusion d’ouvrages retraçant les présences autochtones dans leur prodigalité, vitalité et qualités propres. S’il faut admettre que certains interprétants, nationalistes en particulier, ont du mal à reconnaître le côté également colonisateur des descendants des Français du Saint-Laurent, préférant s’accrocher à la formule consacrée de Parkman pour apprécier le colonialisme mené « à la française[18] », la chose est admise par de plus en plus de chercheurs, notamment par la jeune recherche, ainsi que par une partie significative de la population québécoise (Jedwab, 2023), car la thèse est fondée empiriquement. Qu’on le veuille ou non, les Canadiens, Canadiens français et Québécois ont effectivement participé à ce que l’on pourrait appeler, avec Delâge, une « culture transimpériale » (p. 260).
Certes, il existe des bagarres conceptuelles et positionnelles entre décolonistes, postcolonialistes et autochtonistes, comme il en existait antérieurement entre substantialistes, structuralistes et culturalistes. On s’accuse ainsi de ne pas aller assez loin dans l’exercice d’autocritique ou d’étirer indûment l’élastique de l’empathie méthodologique. On se blâme d’être inconsciemment soumis aux anciens paradigmes ou d’être inconsidérément affiliés aux nouveaux. On se reproche enfin d’écarter des choses ou de les surinterpréter. Rien de neuf sous le soleil, diront les habitués des controverses du monde savant. Il n’en demeure : la recherche allochtone s’est extirpée de plusieurs ornières dans lesquelles elle était embourbée depuis longtemps. On ne peut minimiser les transformations survenues non plus que les mitiger. La part autochtone de l’expérience historique québécoise, pour s’en tenir à ce sujet qui n’épuise évidemment pas toutes les facettes de la présence autochtone au sein de l’espace appelé québécois, est de plus en plus reconnue, exposée, détaillée, et même valorisée.
Le problème – connu et classique – est d’opérer le transfert des résultats provenant du monde érudit vers l’univers des représentations populaires, celles-ci s’abreuvant intensément à la mémoire collective, laquelle nourrit largement le discours public tout en continuant à infuser l’enseignement de l’histoire en classe, malgré des avancées notables sur ce terrain aussi[19].
Il faut l’avouer : bien qu’elle évolue dans ses contenus, la mémoire collective québécoise reste empreinte de représentations surannées de la condition autochtone. Pis, à partir de cette mémoire, qui a des racines lointaines[20], on interprète ce qui advient, par exemple une revendication ou une manifestation autochtone, en l’encodant à travers un répertoire caractérisé d’anciens scripts – l’Indien paresseux, profiteur, puéril, chialeur, malcommode, réfractaire, licencieux, désordonné, insoumis, et ainsi de suite (King, 2012). Il faudra du temps avant que disparaissent de la mémoire collective québécoise certaines perceptions enracinées de l’Autochtone, d’autant que l’inverse est vrai aussi, à savoir que les Québécois sont également stigmatisés par les Premiers Peuples et les Inuits, ce qui rend ardu le dépassement de toute vision obsolète du Nous-Autres, chaque partie voyant dans l’oeil du prochain une image déformée de la sienne[21]. Bien que les propositions théoriques émanant du corps intellectuel, et pratiques venant de la classe politique et des groupes intermédiaires, soient nombreuses pour sortir les deux groupes génériques de leurs représentations désuètes, Québécois et Autochtones restent empêtrés dans leurs mythistoires respectifs, dont on connaît le pouvoir suggestif, c’est-à-dire limitatif. Pourrait-on accélérer le processus de déconstruction de ces mythistoires afin d’ouvrir la porte à de plus amples (r)accords narratifs entre histoire québécoise et histoire autochtone? Peut-être, mais l’opération sera lente, sinon laborieuse. Heureusement, le temps est patient et les humains, astucieux.
⁂
J’ai mentionné l’intérêt du livre tout en avouant mon insatisfaction devant la conclusion (ou la « non-conclusion », selon moi) qui en ressort, soit que la seule avenue de réconciliation possible entre Québécois et Autochtones, en ce qui touche au récit historique de leur interrelation au sein du lieu désigné et institué Québec, était d’assumer narrativement la nature plurielle – tout à la fois commune, croisée et parallèle – de leur expérience relationnelle, ce qui rendait à peu près impossible la production d’un récit intégré de leur cohabitation, et ce, pour des raisons politiques (différend majeur à propos de la place occupée par chacun dans l’histoire partagée) ou épistémologique (désaccord profond sur les tenants et aboutissants de l’histoire racontée, ainsi que sur sa forme).
Il est toujours désolant de s’avouer vaincu, d’autant que la défaite pourrait ici découler d’un manque d’imagination conceptuelle et narrative[22]. Peut-on effectivement produire un récit partagé ou partageable de l’expérience historique des Autochtones et des Québécois dans le cadre d’une histoire générale du Québec? Ma réponse est oui. Comment y arriver? De trois manières : 1) en suivant les faits avérés et en les interprétant de façon aussi sobre et multilatérale, c’est-à-dire polyfocale et plurivoque, que possible; 2) en faisant preuve d’une disponibilité, mais de façon critique, envers différents modes de fabrication et de disposition des connaissances; 3) en n’ayant crainte d’explorer la capacité littéraire ou narrative des langues et d’exploiter le potentiel métaphorique des cultures, façon de reconnaître que les instruments froids de la science ne permettent ni forcément ni toujours de conceptualiser et de saisir au mieux les objets convoités de connaissance. Ajoutons un quatrième point, majeur, que l’on énoncera comme suit : la responsabilité de parvenir à une juste appréciation de ce qui fut, dans le cas d’une histoire à élaborer du Québec qui fasse une part épistémique et empirique convenable aux Autochtones, échoit à toutes les parties engagées dans un échange de bonne foi concernant le récit à élaborer, parties reconnaissant la possibilité d’une complémentarité heureuse entre science et sagesse ainsi que celle d’une interdépendance harmonieuse entre vérité et beauté[23].
Les articles formant le contenu du livre et les nombreux travaux cités par les auteurs montrent qu’il existe une recherche abondante et florissante touchant le monde autochtone. Ils indiquent aussi la présence d’un formidable capital de disponibilité et de réciprocité des interprétants pour trouver, dans le foisonnement infini de ce qui a été, les filons narratifs – les « petites brèches du passé » dirait Gill – rendant possible l’articulation de l’histoire des Québécois et de celle des Autochtones dans un récit d’histoire du Québec-(Canada) qui, pour être complet, devrait intégrer aussi la part des Anglophones et celle des Allophones du Québec dans l’expérience collective[24]. C’est ce projet colossal que poursuit Gilles Bibeau depuis quelques années (Bibeau, 2021, 2023).
À travers les contributions d’une douzaine d’auteurs, l’ouvrage dirigé par Dorais et Nootens offre un panorama instructif de la réflexion sur un projet historiographique qui appelle impérativement un suivi, voire une finalité narrative, soit-elle provisoire et imparfaite. Le temps est en effet venu de produire le récit attendu – celui d’une histoire du Québec incluant les apports, perspectives, sensibilités et impératifs autochtones, sans pour autant sombrer dans la miséricorde historiale envers les Premiers Peuples, forme sournoise de néocolonialisme – en acceptant les risques inhérents à l’exercice de synthèse et en cessant de tergiverser sur les périls qui lui sont afférents. Il y a un quart de siècle, Denys Delâge traçait le chemin à suivre pour parvenir au but souhaité : « Simplement faire l’histoire de toutes les populations d’un territoire, écrivait l’éminent historien, avec toutes les traces du passé et en appelant histoire le résultat obtenu[25] » (Delâge, 2000, p. 524). Voilà, clairement formulé, le programme à réaliser, ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu’il soit facile de l’achever. Il n’est jamais simple de passer d’une version de l’histoire n’intéressant à peu près personne à une histoire du passé captivant tout le monde.
Parties annexes
Notes
-
[1]
Dimension toutefois laissée de côté dans le cadre du livre, sauf entre les p. 19 et 21. Dommage, car l’histoire enseignée aux jeunes du secondaire reste centrée sur l’histoire du Québec-(Canada) et le demeurera encore longtemps. Quelle place accorder aux Premiers Peuples et aux Inuits dans le cours d’« histoire nationale »? Quelle histoire du Québec enseigner aux jeunes Autochtones? Cette histoire doit-elle être semblable à celle qui est transmise aux jeunes Allochtones du Québec? Ces questions auraient mérité l’attention des auteurs, d’autant qu’elles font débat.
-
[2]
Par Autochtones, on entend dans cet article, comme c’est le cas dans l’ouvrage discuté, les Premières Nations (et les Inuits), mais non les Métis (reconnus ou autodéclarés) vivant sur le territoire du Québec. Nous mettons Inuits entre parenthèses étant donné le peu de place qui leur est accordée dans le livre. Cette absence n’a cependant rien à voir avec un manque de considération de la part des auteurs.
-
[3]
Pour des exemples d’histoire autochtone autonome et autoréférentielle, qui ne sont pas incritiquables par ailleurs, voir Assiniwi (1973-74) et Sioui (1998). Pour un exemple d’histoire du Québec (et du Canada) du point de vue autochtone, voir Faries et Pashagumskum (2002); le livre a cependant été éreinté, notamment parce que l’événement d’Oka n’était pas couvert dans l’ouvrage (il faut dire qu’il s’agissait d’une histoire crie du Québec et du Canada). La liste des ouvrages où les Autochtones apparaissent comme sujets principaux du récit historien, qu’il soit descriptif ou argumentatif, est longue. Voir entre autres Trigger (1991), Sioui (1994), Dickason(1996), Beaulieu (2000), mais aussi Dufour (2021), Viau (2021), et combien d’autres.
-
[4]
L’article de Bernard se distingue de tous les autres textes. Il s’agit d’un exemple remarquable de ce que l’on pourrait appeler une histoire autochtone et autochtonisée du passé, histoire élaborée à partir d’une sensibilité autochtone, d’une problématique autochtone et de méthodes afférentes aux épistémologies autochtone et allochtone. Ouvert et sagace, l’auteur ne tombe pas dans l’autochtonisme militant et intransigeant. S’il ne nie pas l’expérience coloniale vécue par les Amérindiens (les Abénakis dans son cas), il ne réduit pas leur condition à cette seule dimension. Sa démarche est originale. Elle s’apparente à celle de Brook (2008) tout en la dépassant. Bernard fait du panier w8banaki, staple des Abénakis d’Odanak et de W8linak, un objet social total, qu’il piste dans ses circulations spatiales, ses ramifications globales, ses racines transcendantales, ses significations mentales, ses propriétés sociales et ses charges métaphoriques, pour s’en tenir à ces facettes de l’abaznodal (panier de frêne noir). La voie qu’il emprunte mène à ce que l’on pourrait appeler une histoire autochtone polycontextualisée, polyhistorisée et polyépistémologisée. La perspective est prometteuse et convaincante. Le problème reste celui d’articuler pareille histoire à un récit d’histoire générale du Québec-Canada.
-
[5]
Dans le cas des Inuits, dont les contacts avec le monde allochtone sont plus distendus jusqu’à la fin du 19e siècle, cette temporalité ne convient évidemment pas.
-
[6]
Je dis peut-être, car Bouchard, capable de revirements interprétatifs étonnants, défendait clairement l’idée, il y a quelques années, de sacrer les Autochtones fondateurs de la société québécoise, au point de vouloir faire des Premiers Peuples les « premiers Québécois » (Bouchard, 1999, p. 117-118). Pareille opération d’« historisation » visait à fournir aux Québécois d’aujourd’hui une mythologie consensuelle et oecuménique des origines, ce qui leur manquait tragiquement selon l’historien, ceux-ci restant accrochés à leurs référents européens au lieu de valoriser leurs enracinements nord-américains. Il semble que le collègue ait depuis nuancé ses positions (Bouchard, 2023, p. 103), bien que de manière ambiguë (Idem, p. 211). Dans son chapitre, Arsenault se livre à une critique sévère des interprétations autochtonistes ou autochtonisantes de la société québécoise, très en vogue à l’heure actuelle (voir par exemple Lisée, 2023).
-
[7]
La majorité des historiens (ex. : Dickinson et Young, 1988; Gossage et Little, 2015; Létourneau, 2020) suivent ce scénario narratif, qui n’a pas pour but d’atrophier la part autochtone de ou dans l’histoirequébécoise, mais d’accorder aux Premiers Peuples et aux Inuits la juste place qu’ils ont occupée dans les régimes coloniaux ou nationaux qui se sont succédé au sein de l’espace québéco-canadien depuis le 17e siècle.
-
[8]
Nous parlons du Québec pour ne pas alourdir notre propos. En réalité, il faudrait parler du Bas-Canada jusqu’en 1841, du Canada-Est jusqu’en 1867, puis de la province de Québec à partir de cette date. Soulignons par ailleurs qu’il ne nous paraît pas possible de faire une histoire des Autochtones dans le cadre d’un récit de l’histoire du Québec amputé de sa (ou de la) variable canadienne, ce que tous les auteurs de l’ouvrage semblent reconnaître implicitement.
-
[9]
Parlons-en comme d’un projet d’uniformisation culturelle, linguistique et identitaire, doublé d’un projet d’imposition de ce que McKay (2000) a appelé l’« ordre libéral », celui-ci reposant sur la valorisation capitaliste du territoire, la production industrielle des biens et des services, la modernisation des institutions et la bureaucratisation des modes de gestion.
-
[10]
Voir le texte persuasif d’Isabelle Bouchard dans l’ouvrage.
-
[11]
Il va sans dire que cette observation ne s’applique pas qu’aux Premiers Peuples et aux Inuits, mais concerne tous ceux et celles qui, suivant l’objet ou le sujet d’un ouvrage et son ampleur, sont susceptibles d’être couverts ou laissés-pour-compte par un auteur. À l’encontre d’une opinion commune, les « oubliés de l’histoire » ne sont pas toujours négligés pour des motifs politiques.
-
[12]
Dans l’ouvrage, le mot nation semble employé à bien des sauces : comme synonyme du mot société (le Québec en tant que collectivité intégrée), comme équivalent de l’adjectif global (l’histoire du Québec dans la totalité de ses constituantes), comme homologue du mot espace (le Québec en tant que territoire borné) ou comme analogue au mot État (le Québec comme communauté politique instituée). De manière générale, l’ajout du terme paraît superflu et relève du pléonasme ou tient d’une allégeance politique implicite.
-
[13]
Dire, comme Bibeau (p. 109), que les Premiers Peuples ont participé « de manière substantielle à la construction de ce qui deviendra un jour la nation du Québec », est, de mon point de vue, contestable dans cette formulation. C’est le contraire qui est vrai : cette participation, si tant est qu’elle ait été désirée par les intéressés, a été empêchée par une politique ordonnée d’exclusion et de dépossession des Autochtones. Bien sûr, pareille affirmation ne nie pas l’importance des transferts culturels émanant des Premiers Peuples vers les Européens pas plus qu’elle ne dispute le rôle initialisant des Autochtones dans ce qui allait s’élever et se structurer au sein de la vallée du Saint-Laurent, à savoir une société de type européen marquée d’apports indigènes. Elle ne réfute pas non plus la contribution des Autochtones à l’édification de la société industrielle au Québec, bien que, dans ce processus, leur position ait été largement auxiliaire.
-
[14]
Il n’y a bien sûr pas qu’une conception et pratique de l’histoire chez les Autochtones, pas plus que chez les Allochtones, du reste. Je suis conscient de m’en tenir ici à une description archétypale des deux épistémès, avec les avantages et les inconvénients de pareille façon de faire.
-
[15]
Mais peut-être est-il simplement conscient et inquiet de la puissance brûlante des « lumières » allochtones, qui absorbent tout rayonnement concurrent comme le font les trous noirs avec les luminosités croisant leur orbite ou pénétrant dans leur espace gravitationnel. Il reste que certaines affirmations de Deer intriguent au point d’inquiéter. Par exemple (p. 89-90) : « […] Il y a deux genres d’historiens chez les Mohawks. Il y a ceux qui font un excellent travail de recherche de la vérité, en regardant les choses de notre point de vue […]. Ensuite, il y a ceux qui se fient beaucoup trop aux méthodes dominantes. […] Même si c’est une petite minorité, c’est plutôt agaçant de les voir étudier l’histoire de la même manière que les Allochtones. » La vérité serait-elle uniquement (du côté) autochtone? De la part de l’activiste, un peu plus d’autocritique aurait été de bonne guerre.
-
[16]
Sur les différentes formes de propriété – ou de « formation de la propriété » – qui ont prévalu en Amérique du Nord depuis l’époque précolombienne, voir Greer, 2018. Gardons en tête que les systèmes fonciers autochtones n’étaient pas antinomiques avec l’idée d’une propriété de la terre, bien que les droits et usages du sol par de multiples intervenants – individus, communautés et institutions politiques – rendaient difficile, voire impossible, pour quiconque de la posséder de manière entière.
-
[17]
A-t-on raison de penser que certains linéaments de l’entente Québec-Cris sur le développement de la baie James (Convention de la baie James et du Nord québécois) sont conformes à l’idée de « partage responsable du territoire »? Le cas échéant, malgré les inévitables accrochages et frustrations découlant de pareil accord d’envergure (qui a tout de même donné lieu à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec), un avenir conjoint, à défaut d’un passé commun, ne serait pas inconcevable entre Québécois et Autochtones.
-
[18]
L’énoncé de Parkman, célèbre, est le suivant (il s’agit d’une traduction de l’anglais) : « La civilisation espagnole a écrasé l’Indien; la civilisation anglaise l’a méprisé et négligé; la civilisation française l’a étreint et chéri » (Parkman, 1867, p. 44). La citation a été reprise par de nombreux interprètes, incluant Rioux (2021), pour atténuer la nature déstructurante du projet colonial français envers les Premiers Peuples et pour en souligner le caractère distinctif, presque distingué.
-
[19]
Le programme actuel d’Histoire du Québec et du Canada (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017) fait une place aux réalités autochtones qui n’a évidemment rien à voir avec l’« image de l’Indien » que Vincent et Arcand décrivaient et dénonçaient en 1979. La situation est-elle idéale? Non (Bories-Sawala et Martin, 2020). Satisfait-elle aux attentes des Premiers Peuples et des Inuits sur le plan épistémique et empirique? Non (Battiste, 2017). L’histoire enseignée du Québec-Canada répond-elle au désir des jeunes Autochtones d’en apprendre plus sur « leur » histoire? Non (Duquette, 2022). Cela dit, des avancées ont été faites (disons au moins que des dérives ont été refrénées), que l’on ne peut déconsidérer.
-
[20]
Des racines lointaines, certes, mais non pérennes. La mémoire collective québécoise a connu, sous l’empire de la pensée nationaliste, un important travail de restructuration aux 19e et 20e siècles. La part autochtone au sein du Nous a été écartée, puis niée, et enfin largement effacée (Bibeau, 2021), ce que Delâge appelle l’« altérisation de l’Autochtone ». La mémoire collective est évolutive dans ses contenus, ce qui veut dire qu’elle pourrait à nouveau changer – pour le mieux.
-
[21]
Ces visions respectives de l’Autre sont évidemment tributaires de l’entreprise coloniale et du lien colonial, mais aussi de l’entreprise national(isant)e, qui trace une frontière ferme entre Nous et les Autres.
-
[22]
Imagination, non pas au sens d’invention, d’affabulation ou de divagation, mais au sens d’acuité, de créativité, de perspicacité, de lucidité, sorte de capacité à trouver des manières de concevoir et de dire qui, articulant un récit d’histoire, créent de fructueux passages narratifs vers l’avenir sans trahir ce qui fut.
-
[23]
Cette reconnaissance permettrait-elle aux narrateurs d’inscrire au coeur du récit composé (ou plutôt à composer) ce que Vincent attribuait en propre à l’épistémologie autochtone (mais a-t-elle raison?), à savoir la contradiction, la luxuriance, la fluidité, le flottement, la relativité, le symbolisme des explications, la nature des préoccupations, et quoi encore? Au début des années 2000, la regrettée chercheure était fort dubitative face à la possibilité d’une harmonisation des versions autochtone et allochtone de l’histoire (Vincent, 2002). Comme Deer, elle croyait peut-être que, dans l’éventualité d’un entremêlement des cultures narratives autochtone et allochtone, différentes pour dire le moins, la première – contemplative, compréhensive, circulaire, inclusive et vouée à la révélation, donc dédiée à la suggestion de voies de passage à des esprits en recherche de sens – soit simplement bulldozée par la deuxième – expansive, explicative, linéaire, exclusive et destinée à l’élucidation, donc attachée à trouver des solutions aux problèmes. Le cas échéant, le monde animé par les récits autochtones serait évidemment destiné à disparaître. Pour une argumentation en ce sens, qui bouleverse la perspective assez optimiste défendue dans ce texte sur l’articulation possible des récits autochtones et allochtones, voir Richler (2008, chap. 3, 4 et 5).
-
[24]
Si le générique « Autochtones » est simplificateur de la réalité qu’il prétend recouvrir, il va sans dire que celui de « Québécois » l’est tout autant.
-
[25]
Intéressant de considérer sous cet angle le titre de la traduction française du livre d’Allan Greer sur les habitants de la Nouvelle-France. Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France (Greer, 1998) permettait d’anticiper une narration centrée sur la description des relations – collaboratives, tendues et antagoniques tout à la fois – entre Autochtones et Français du début du 16e siècle au milieu du 17e, narration offrant à chaque protagoniste une part équivalente dans le récit global. En réalité, le titre anglais : The People of New France (Greer, 1997) sied mieux au contenu du livre, qui brosse un portrait populationnel de la Nouvelle-France en décrivant la condition de ses résidants d’origine française surtout et en exposant leurs relations avec d’« autres » acteurs habitant l’espace dit français d’Amérique du Nord, en particulier les Premiers Peuples. Nous sommes loin ici du projet envisagé par Delâge. Par ailleurs, pourrait-on, sans se montrer extravagant, intituler « Histoire des peuples du Québec » un ouvrage de synthèse qui couvrirait l’histoire du territoire québécois et de ses groupes divers depuis l’époque précolombienne? Les Anglo-québécois forment-ils un peuple? À quel titre intégrer les Allophones dans le récit d’ensemble? Faut-il, dans un cas comme dans l’autre, en distinguer les constituantes suivant l’origine ethnique ou culturelle de leurs membres?
Bibliographie
- Assiniwi, Bernard, 1973-1974 Histoire des Indiens du Haut et du Bas Canada, Montréal, Lémeac, 3 vol.
- Battiste, Marie, 2017 Decolonizing Education. Nourishing the Learning Spirit, Vancouver, Purish Publ.
- Beaulieu, Alain, 2000 Les Autochtones du Québec, Montréal/Québec/Rennes, Fides/Musée de la civilisation/Musée de Bretagne.
- Bibeau, Gilles, 2021 Les Autochtones. La part effacée du Québec, Montréal, Mémoire d’encrier.
- Bibeau, Gilles, 2023 Une histoire d’amour-haine. L’Empire britannique en Amérique du Nord, Montréal, Mémoire d’encrier.
- Bories-Sawala, Helga et Thibault Martin, 2020 Eux et Nous. La place des Autochtones dans l’enseignement de l’histoire nationale du Québec, Brème, Université de Brème, 3 vol. [https://media.suub.uni-bremen.de/handle/elib/3438], consulté le 8 novembre 2023.
- Bouchard, Gérard, 1999 La Nation au futur et au passé, Montréal, VLB éditeur.
- Bouchard, Gérard, 2023 Pour l’histoire nationale. Valeurs, nation, mythes fondateurs, Montréal, Boréal.
- Brook, Timothy, 2008 Vermeer’s Hat. The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World, Londres, Bloomsbury Press.
- Delâge, Denys, 2000 « L’histoire des Premières Nations : approches et orientations », Revue d’histoire de l’Amérique française, 53, 4 : 521-527.
- Detienne, Marcel, 1981 L’invention de la mythologie, Paris, Gallimard.
- Dickason, Olive Patricia, 1996 Les Premières Nations du Canada : depuis les temps les plus lointains jusqu’à nos jours, Sillery, Septentrion.
- Dickinson, John A. et Brian Young, 1988 Brève histoire socio-économique du Québec, Québec, Septentrion.
- Dufour, Emmanuelle, 2021 C’est le Québec qui est né dans mon pays. Carnet de rencontres, d’Ani Kuni à Kiuna, Montréal, Écosociété.
- Duquette, Catherine, 2022 « Trouver des perspectives autochtones dans le curriculum d’histoire du Québec », Public History Weekly, 10 (2022) 2. [https://public-history-weekly.degruyter.com/10-2022-2/indigenous-perspectives-quebec-history], consulté le 8 novembre 2023.
- Faries, Emily et Sarah Pashagumskum, 2002 Une histoire du Québec et du Canada, Chisasibi, Commission scolaire crie.
- Gossage, Peter et Jack I. Little, 2015 Une histoire du Québec. Entre tradition et modernité, Montréal, Hurtubise.
- Greer, Allan, 1997 The People of New France, Toronto, University of Toronto Press.
- Greer, Allan, 1998 Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Montréal, Boréal.
- Greer, Allan, 2018 Property and Dispossession. Natives, Empires and Land in Early Modern North America, Cambridge, Cambridge University Press.
- Inksetter, Leila, 2020-2021 « Histoire et historicité autochtones. Nouveaux défis, nouvelles possibilités », Recherches amérindiennes au Québec, 50, 3 : 43-54.
- Jedwab, Jack, 2023 « Québec : colonisé et colonisation? », Montréal, Projet Métropolis/Association d’études canadiennes. [https://acs-metropolis.ca/wp-content/uploads/2023/09/Quebec-coloniser-et-colonisation-.pdf], consulté le 8 novembre 2023.
- King, Thomas, 2012 The Inconvenient Indian. A Curious Account of Native People in North America, Toronto, Doubleday.
- Létourneau, Jocelyn, 2020 La Condition québécoise. Une histoire dépaysante, Québec, Septentrion.
- Lisée, Jean-François, 2023 « L’étincelle autochtone des Lumières », Le Devoir, 10 juin. [https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/792718/chronique-l-etincelle-autochtone-des-lumieres], consulté le 8 novembre 2023.
- Mckay, Ian, 2000 « The Liberal Order Framework: A Prospectus for a Reconnaissance of Canadian History », The Canadian Historical Review, 81, 4 : 616-645.
- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017 Programme de formation de l’école québécoise, enseignement secondaire. Histoire du Québec etdu Canada. Troisième et quatrième secondaire, Québec, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Gouvernement du Québec. [http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/histoireQuebecCanada.pdf], consulté le 8 novembre 2023.
- Parkman, Francis, 1867 The Jesuits in North America in the Seventeenth Century, Boston, Little Brown.
- Richler, Noah, 2008 Mon pays, c’est un roman. Un atlas littéraire du Canada, Montréal, Boréal.
- Rioux, Christian, 2021 « L’assimilation », Le Devoir, 18 juin. [https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/611985/l-assimilation].
- Sioui, George E., 1994 Les Wendats. Une civilisation méconnue. Québec, Presses de l’Université Laval.
- Sioui, George E., 1998 Pour une autohistoire amérindienne, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Trigger, Bruce, 1991 Les enfants d’Aataentsic. L’histoire du peuple huron, Montréal, Libre expression.
- Viau, Roland, 2021 Gens du fleuve, gens de l’île. Hochelaga en Laurentie iroquoienne au XVIe siècle, Montréal, Boréal.
- Vincent, Sylvie, 2002 « Compatibilité apparente, incompatibilité réelle des versions autochtones et occidentales de l’histoire », Recherches amérindiennes au Québec, 32, 2 : 99-106.
- Vincent, Sylvie et Bernard Arcand, 1979 L’image de l’Amérindien dans les manuels scolaires du Québec ou comment les Québécois ne sont pas des sauvages, Montréal, Hurtubise HMH.

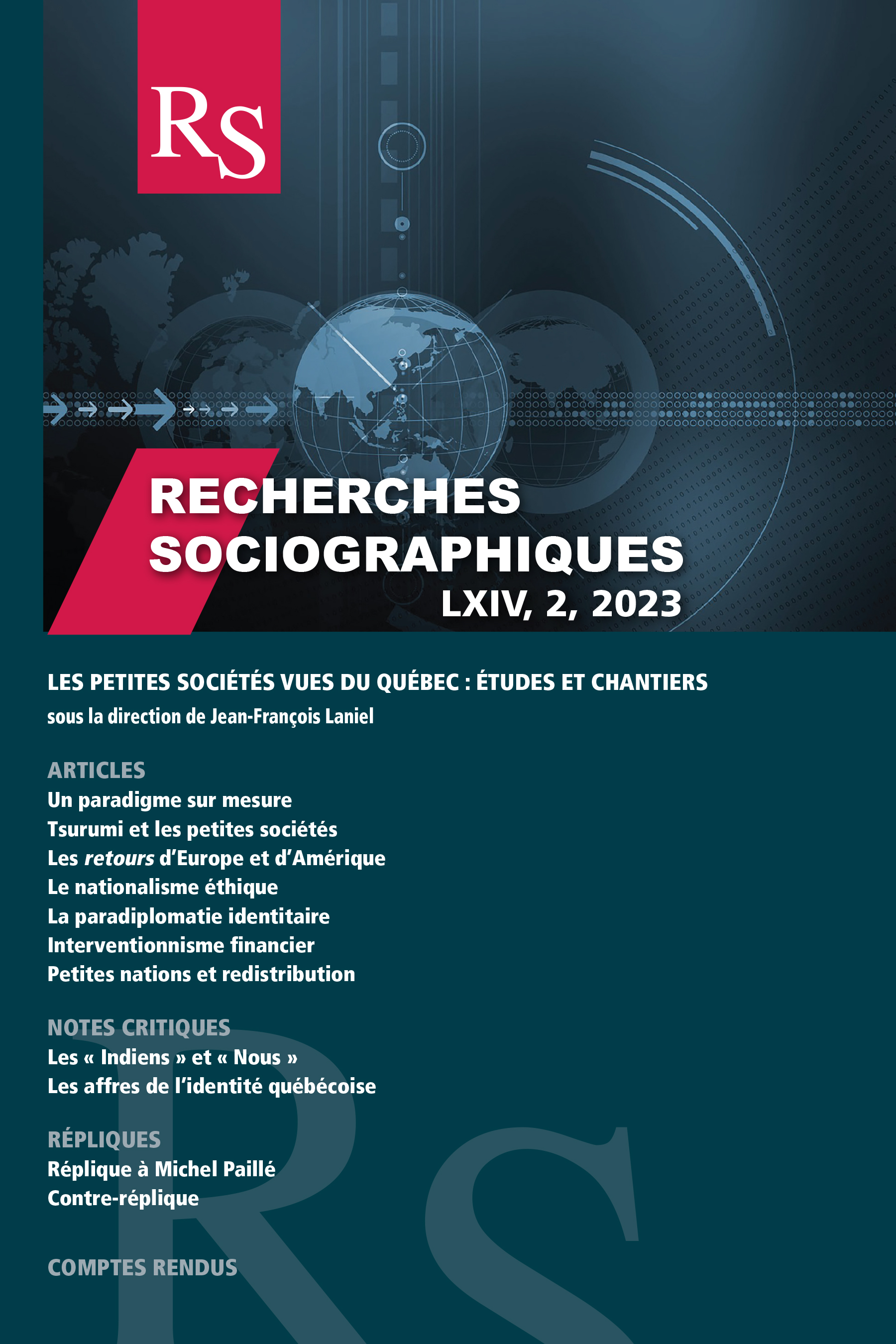
 10.7202/005383ar
10.7202/005383ar