Résumés
Résumé
Les politiques de construction et de renforcement de l’identité nationale constituent un objectif fondamental de tout entrepreneur identitaire qui oeuvre au sein d’une petite nation non souveraine comme le Québec. Les petites nations non souveraines, caractérisées par un fort sentiment national, sont susceptibles de s’aventurer sur l’échiquier international pour faire reconnaître la légitimité de leurs aspirations et pour trouver les ressources et le soutien qui leur manquent à l’intérieur de leurs frontières. Malgré cela, une grande partie de la littérature sur le sujet assimile toute action internationale des petites nations non souveraines à de la protodiplomatie, c’est-à-dire à des stratégies visant à favoriser la reconnaissance internationale d’une petite nation non souveraine qui cherche à faire sécession. Cet article clarifie les concepts de paradiplomatie identitaire et de protodiplomatie et met en garde contre les pièges du nationalisme méthodologique. Il démontre également que les actions internationales des petites nations non souveraines s’expriment généralement dans le registre de la paradiplomatie identitaire. Il s’appuie principalement sur le cas du Québec et fournit quelques éléments de comparaison.
Mots-clés :
- petites nations non souveraines,
- identité,
- nationalisme méthodologique,
- paradiplomatie identitaire,
- protodiplomatie,
- Québec comparé
Abstract
The politics of building and consolidating national identity is a fundamental objective of any identity entrepreneur working within a small, non-sovereign nation such as Quebec. Small non-sovereign nations, which are characterized by a strong sense of nationhood, are likely to venture into the international arena in order to gain recognition for the legitimacy of their aspirations and to find the resources and support they lack within their own borders. Despite this, much of the literature on the subject equates any international action by small, non-sovereign nations with protodiplomacy, in other words, strategies aimed at fostering international recognition for a small, non-sovereign nation seeking secession. This article clarifies the concepts of identity paradiplomacy and protodiplomacy and warns against the pitfalls of methodological nationalism. It also demonstrates that the international actions of small, non-sovereign nations are generally expressed in the register of identity paradiplomacy. It draws mainly on the case of Quebec and provides some elements of comparison.
Keywords:
- small non-sovereign nations,
- identity,
- methodological nationalism,
- identity paradiplomacy,
- protodiplomacy,
- comparative Quebec
Corps de l’article
Les politiques de construction et de renforcement de l’identité nationale constituent un objectif fondamental de tout entrepreneur identitaire qui oeuvre au sein d’une petite nation non souveraine[1]. Les petites nations non souveraines comme le Québec, où le sentiment national est très vif, développent des stratégies internationales afin de légitimer leurs politiques identitaires, mais également pour accéder à des ressources qui leur font défaut à l’intérieur de leurs frontières. C’est notamment le cas lorsque les acteurs du gouvernement central sont indifférents, voire hostiles, aux demandes de développement économique et industriel, de protection culturelle de la petite nation non souveraine, et de reconnaissance de ce qui fait sa spécificité (Gagnon, Lecours et Nootens, 2011).
Nous utilisons l’expression « petites nations non souveraines » pour distinguer celles-ci du phénomène de « nationalisme minoritaire »; en effet, certaines petites nations, comme la Flandre, ne sont pas minoritaires au sein de leur pays[2]. Ce qui caractérise ces petites nations, c’est moins le fait d’être minoritaire que d’avoir intégré la conscience d’une « vulnérabilité existentielle » qui rend cruciale pour elles l’adoption de stratégies de résistance à l’assimilation. Le concept de petites nations est issu d’un article de Milan Kundera (1983) intitulé « Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale ». Pour distinguer les petites nations auxquelles nous nous intéressons des nations d’Europe de l’Est qui sont au coeur de l’article de Kundera, nous ajoutons qu’elles sont « non souveraines » plutôt que « sans État », puisque le Québec, la Catalogne, l’Écosse ou la Flandre contrôlent un gouvernement qui dispose d’importantes compétences constitutionnelles, de ressources financières et bureaucratiques ainsi que d’une légitimité démocratique.
Le nationalisme identitaire des petites nations non souveraines est certainement l’une de leurs caractéristiques les plus importantes, bien qu’elle demeure négligée et même mal comprise dans le champ d’étude de la paradiplomatie, c’est-à-dire la diplomatie parallèle à celle de l’État central que pratiquent des États non souverains ou des gouvernements non centraux. Selon Justin Massie et Marjolaine Lamontagne, les petites nations non souveraines mettent en oeuvre ce qui ressemble à une « politique étrangère » de plus en plus ambitieuse. Cette politique étrangère est révélatrice d’une quête d’autonomie politique et parfois même d’indépendance politique (Massie et Lamontagne, 2019, p. 2). Ils écrivent : « les nations minoritaires démontrent de manière éclatante que ce n’est ni le régime constitutionnel ni les bouleversements induits par la mondialisation qui génèrent les paradiplomaties les plus ambitieuses. C’est plutôt le nationalisme » (Massie et Lamontagne, 2019, p. 17). David Criekemans, tout comme André Lecours et Luis Moreno avant lui, vont dans le même sens. Selon ces derniers, les régions les plus actives sur la scène internationale partagent toutes une caractéristique : le nationalisme (Criekemans, 2010; voir aussi Lecours et Moreno, 2001).
À titre comparatif, alors que l’ensemble des 16 länder allemands comptait 140 représentations à l’étranger, pour une moyenne de 8 par land, et que l’ensemble des États américains en avaient 212 en 2015, soit une moyenne de quatre par État, le Québec à lui seul possède en 2023 un réseau international de 34 représentations dans 19 pays, dont celle de Paris qui a un statut comparable à celui d’une ambassade. Si on ajoute à ce nombre les représentations en matière d’immigration, les bureaux de la société d’État Investissement Québec et les représentations de la Caisse de dépôt et placement, le total s’élève à 65 représentations de toute nature. De son côté, la Flandre dispose de 113 représentations de toutes sortes (politiques, économiques et touristiques), tandis que la Catalogne possédait en 2015, avant la crise actuelle avec le gouvernement central, 71 représentations de toute nature. Bref, l’intensité des actions internationales de ces petites nations non souveraines est inégalée parmi les États subnationaux comparables (Paquin, 2022a).
L’élaboration de stratégies internationales par des petites nations non souveraines est un phénomène banal qui a fortement progressé depuis les années 1960 et 1970, d’abord au Québec, mais aussi un peu partout dans le monde. Le succès de leurs mobilisations internationales leur confère une pertinence renouvelée dans l’analyse de la politique internationale et des pratiques diplomatiques, et dans le cadre d’études sur le fédéralisme, le régionalisme et la sociologie du nationalisme.
Malgré ces constats, il existe sur le plan conceptuel un vide qui rend difficile de décrire cette réalité pourtant incontournable. Même si les travaux sur la paradiplomatie sont en forte progression depuis les années 1990, la majorité des spécialistes utilisent toujours, en effet, le concept de protodiplomatie pour décrire les politiques internationales d’États fédérés comme le Québec, la Catalogne ou encore la Flandre, même lorsque ces États fédérés ne mettent pas en oeuvre une politique internationale visant l’accession au statut de pays souverain. De plus, on ne trouve dans le Google books Ngram viewer aucune entrée pour les concepts d’« identity paradiplomacy » (en anglais) et de « paradiplomacia identitaria » (en espagnol) alors qu’il en existe pour les concepts de paradiplomatie et de protodiplomatie dans ces deux langues (voir figure 1).
Cet article vise justement à proposer une clarification conceptuelle des divers types de paradiplomatie (paradiplomatie fonctionnelle, paradiplomatie identitaire et protodiplomatie), et à décrire la rationalité à l’oeuvre derrière ces stratégies afin de mieux rendre compte des pièges du nationalisme méthodologique pour la recherche sur la paradiplomatie. Cette clarification conceptuelle est toujours nécessaire plus de 20 ans après l’introduction du concept de paradiplomatie identitaire par Paquin (2002)[3], car même si on note en français l’émergence, quoiqu’encore modeste, d’une littérature consacrée à ce concept, celui-ci demeure toujours largement inexistant en anglais tout comme en espagnol.
Figure 1
Les concepts de « paradiplomatie », « paradiplomatie identitaire » et de « protodiplomatie » en anglais et en espagnol selon Google book Ngram Viewer
Figure 1
Suite
Le problème fondamental posé par ce vide conceptuel est lié au fait que le concept de protodiplomatie est devenu si élastique dans la littérature récente qu’il en vient à englober toutes les actions internationales du Québec, de la Flandre ou encore de la Catalogne, puisqu’on peut toujours retrouver dans ces actions des éléments de différenciation et de conflit. En effet, les petites nations non souveraines ont toutes des « protoambassades » et ont toutes conclu des « prototraités », notamment avec des pays souverains. Conséquemment, la littérature sur la paradiplomatie est influencée par le biais du nationalisme méthodologique et le préjugé selon lequel l’État-nation doit être au centre de l’analyse, qu’il est seul garant de l’ordre dans le monde moderne, que le nationalisme identitaire des petites nations non souveraines représente une pathologie conduisant au désordre et à la délégitimation de l’État-nation. L’ignorance par la recherche de l’importance de ces phénomènes peut également jouer son rôle dans le renforcement de ce biais[4]. Cette conception extensive de la protodiplomatie repose sur l’idée implicite selon laquelle tout mouvement identitaire est fondamentalement « séparatiste ». Elle ne fait que traduire les préjugés favorables à l’ordre établi pour lequel tout mouvement nationaliste est ethnocentriste, subversif et producteur de divisions (Keating, 1997, p. 23). Pourtant, le fait d’exprimer son opposition – et d’agir sur cette base – dans une société pluraliste et démocratique ne relève pas automatiquement du registre de la sédition et du séparatisme. La grande contribution de notre recherche est de critiquer ces a priori afin de mieux comprendre le phénomène de la paradiplomatie identitaire.
Afin d’illustrer notre propos, après avoir présenté une revue de la littérature récente, nous exposerons à partir du cas du Québec les différences fondamentales entre la protodiplomatie et la paradiplomatie identitaire, car les deux concepts ne relèvent pas du même registre ni de la même logique. Dans un second temps, nous soulignerons les effets du nationalisme méthodologique sur les études sur la paradiplomatie. Nous mobiliserons des exemples à partir du cas québécois avec divers points de comparaison.
Cadre conceptuel : paradiplomatie, paradiplomatie identitaire et protodiplomatie
Dans la littérature sur la paradiplomatie, plusieurs auteurs comme Ivo Duchacek (1986), Panayotis Soldatos (1990), Gulnaz Sharafutdinova (2003) Gloria Totoricagüena (2005), James McHugh (2015), Noé Cornago (2018), Jorge Schiavon (2019), Yasin Mahmood Ababakr (2020), María Gabriela Zapata Morán et Daniel Javier De la Garza Montemayor (2022), et Gonzalo Álvarez et Cristian Ovando (2022) n’utilisent globalement que deux concepts, ceux de paradiplomatie et de protodiplomatie afin de parler de la politique internationale des petites nations non souveraines comme le Québec, la Catalogne, le Pays basque, l’Écosse ou encore la Flandre.
À quoi ces concepts font-ils référence? Dans la littérature sur la politique internationale des États non souverains, l’inventeur du concept de paradiplomatie[5], le professeur Panayotis Soldatos, définit celle-ci comme étant [traduction] « […] une participation directe et, dans certains cas, autonome aux activités de relations extérieures » (Soldatos, 1990, p. 37). La paradiplomatie largement banalisée dans le monde contemporain, répond à des besoins fonctionnels des gouvernements non centraux concernant le développement économique ou la mobilité des étudiants, par exemple. Les principaux champs d’intervention paradiplomatique sont la politique économique et commerciale, la promotion des exportations, l’attraction des investissements étrangers, les politiques visant à attirer les centres de décision et les événements internationaux – par exemple des événements sportifs –, la coopération en matière de science et la technologie, l’énergie, l’environnement, le transport et la lutte aux changements climatiques, l’éducation, l’immigration, la solidarité internationale et la mobilité de la main-d’oeuvre. Les acteurs paradiplomatiques s’intéressent également de plus en plus aux questions non traditionnelles de sécurité, particulièrement la sécurité transfrontalière dans le contexte nord-américain après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, mais également la cybersécurité ou encore la lutte aux pandémies.
Dans le cas du Québec, pour la période 2018-2019, c’est-à-dire avant la pandémie de la Covid-19, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) disposait d’un budget d’environ 120 millions de dollars et d’un effectif de 505 employés, dont 220 occupaient des postes à l’étranger. Le gouvernement du Québec avait organisé 1 209 rencontres avec des personnalités influentes, plus de 1 315 activités de promotion et de communication liées au positionnement stratégique du gouvernement, notamment dans le domaine économique et commercial, plus de 124 projets de solidarité dans 25 pays. De plus, environ 5 000 jeunes ont bénéficié d’aides à la mobilité internationale grâce aux Offices jeunesse internationaux du Québec (MRIF, 2019b, 2020). Comme on le constate, l’essentiel des activités internationales du MRIF participe d’une paradiplomatie que l’on peut qualifier de « fonctionnelle », c’est-à-dire que la dimension protodiplomatique en est largement absente.
Au concept de paradiplomatie, Soldatos oppose la notion de « protodiplomatie[6] », laquelle sert à décrire la politique internationale d’un État non souverain qui cherche à faire sécession. Selon le professeur Ivo Duchacek, la protodiplomatie implique une mise en avant de la dimension « séparatiste » dans le développement de liens économiques, culturels ou sociaux avec les autres pays ou acteurs de la scène internationale (Duchacek, 1986, p. 240; 1988, p. 22; 1990, p. 18, 27 et 32). Selon cette logique, les gouvernements régionaux ou subnationaux peuvent chercher à ouvrir à l’étranger des « protoambassades » et à conclure des « prototraités ».
Cette conception de la protodiplomatie est partagée par María Gabriela Zapata Morán et Daniel Javier De la Garza Montemayor (2022) dans un article récent. Selon ces derniers, les actions internationales des États non souverains peuvent être considérées comme de la paradiplomatie, mais, ajoutent-ils, [traduction] « lorsqu’elle s’accompagne de mouvements nationalistes ou indépendantistes, elle devient un phénomène complètement différent, celui de protodiplomatie[7] ». Windy Dermawan et ses coauteurs utilisent également le concept de protodiplomatie pour décrire les actions internationales de la province d’Aceh en Indonésie. Ils écrivent : [traduction] « La protodiplomatie est la paradiplomatie mise en oeuvre pour promouvoir l’identité politique, obtenir la reconnaissance internationale d’autres acteurs pour devenir un État souverain, et faire avancer un programme séparatiste dans un pays » (Dermawanet al., 2022, p. 336). Gloria Totoricagüena (2005), pour sa part, mobilise les concepts de « postdiplomatie » et de « protodiplomatie » pour expliquer les politiques internationales du Pays basque en relation avec sa diaspora.
James McHugh (2015, p. 244) affirme également que tout ce qui va dans le sens de l’indépendance, mais aussi de l’autonomie politique, constitue de la protodiplomatie. Selon lui, les stratégies qui visent à publiciser l’identité et l’intérêt national d’une petite nation non souveraine, ou encore des éléments importants comme la rencontre avec des chefs d’État étrangers, la signature d’ententes internationales ou toute action qui dépasse les champs de compétence des États fédérés appartiennent au registre de la protodiplomatie. Il affirme même que la doctrine Gérin-Lajoie, qui est la base des actions internationales du Québec depuis 1965, est une doctrine « protodiplomatique » (McHugh, 2015, p. 250). Dans ce contexte, McHugh précise que la protodiplomatie est nécessairement très conflictuelle et considérée avec méfiance par l’État-nation puisque selon cette logique les entrepreneurs de la protodiplomatie contestent la légitimité même de la politique étrangère de l’État-nation (Mc Hugh, 2015, p. 250).
Jaume Pinos et Jeremy Sacramento partagent ce point de vue. Selon ces derniers, la paradiplomatie d’un État fédéré ne se développe pas nécessairement en harmonie avec les intérêts de l’État souverain. Tout acteur qui construit ses actions internationales en épousant certains intérêts a le potentiel de nuire aux intérêts d’un autre acteur, et ce, pas seulement dans un contexte sécessionniste. Cette observation est vraie a fortiori lorsque les gouvernements non centraux poursuivent des objectifs sécessionnistes. Pour prévenir les actions internationales de nature protodiplomatique des gouvernements non centraux, les États souverains peuvent s’adonner à des actions de contre-paradiplomatie ou encore à des actions de sabotage. La counter-paradiplomacy représente ainsi les efforts des États souverains pour limiter l’engagement international des gouvernements non centraux (Pinos et Sacramento, 2022).
Cela dit, certains auteurs préfèrent définir toutes ces actions internationales en se servant du seul concept de paradiplomatie. Alexander Kuznetsov, par exemple, l’utilise en dépit de son caractère de concept parapluie pour y inclure sans distinction tous les types d’activités internationales des régions, y compris celles qui sont [traduction] « fortement motivées politiquement » et visent à favoriser l’acquisition du statut de pays souverain (Kuznetsov, 2015, p. 26). C’est ce que font aussi Mohammed et Owtram (2014) lorsqu’ils analysent le cas du gouvernement régional du Kurdistan, ou de Klyszcz (2022) lorsqu’il analyse le cas de la Tchétchénie. Pour ces auteurs, on peut ainsi parler de paradiplomatie culturelle, économique, sécessionniste, etc.
Chez Leah Sarson (2019), le concept de paradiplomatie est un concept suffisamment large pour inclure également la dimension identitaire. Sarson s’intéresse spécifiquement au cas de la gouvernance autochtone, car bien que les autochtones ne cherchent pas à créer un nouveau pays, ils souhaitent obtenir plus que de simples relations commerciales et veulent être reconnus en tant que nation à part entière. Selon Hunt et Minto analysant le cas du Pays de Galles, le concept de paradiplomatie couvre les entreprises de nation-building et les tentatives de légitimer [traduction] « une identité nationale distincte au-delà de l’État » (Hunt et Minto, 2017, p. 649). Selon eux, le pays de Galles ne met pas de l’avant, contrairement à l’Écosse, une protodiplomatie dans ses actions dirigées vers l’Union européenne.
Enfin, Sri Issundari et ses collègues (2021) utilisent le concept de « paradiplomatie culturelle » plutôt que ceux de protodiplomatie ou de paradiplomatie identitaire pour parler des dimensions identitaires des actions internationales du territoire spécial de Yogyakarta, l’équivalent d’une province en Indonésie, même si selon eux, cette politique est fondamentalement identitaire par opposition à séparatiste.
De notre côté, pour résoudre cette confusion conceptuelle, nous soutenons que la conception binaire (paradiplomatie et protodiplomatie) et l’utilisation du seul concept de paradiplomatie ne rendent pas justice aux actions entreprises par les petites nations non souveraines pour se projeter sur la scène internationale, notamment lorsque ces actions sont dirigées par des entrepreneurs identitaires résolument opposés à la sécession, comme c’était le cas par exemple du gouvernement de Jean Charest au Québec entre 2003 et 2012. Bien que ce dernier ait été très actif sur la scène internationale, plus même que ses prédécesseurs à la tête de gouvernements souverainistes, son ambition n’était certainement pas de préparer en douce la reconnaissance internationale du Québec en cas de sécession (Jeyabalaratnam et Paquin, 2016). De plus, même lorsqu’elle est dirigée par des mouvements favorables à l’accession à la pleine souveraineté, la politique internationale des petites nations non souveraines ne provient pas exclusivement du registre de la protodiplomatie, c’est-à-dire qu’elle ne se réduit pas à des stratégies internationales pour favoriser la transition vers le statut de pays souverain (Paquin, 2022a).
Ainsi, il est préférable d’ajouter un troisième concept, celui de paradiplomatie identitaire, pour expliquer les activités internationales des petites nations non souveraines qui ne visent pas à préparer la transition vers le statut de pays souverain. Le but premier de la paradiplomatie identitaire est de construire et de renforcer l’identité nationale en entretenant des relations sur le plan international. Elle diffère donc de la protodiplomatie, car elle ne cherche pas à atteindre l’objectif d’indépendance politique (Paquin, 2005). Animés par un nationalisme identitaire, le Québec de même que la Flandre et la Catalogne ont ainsi adopté des stratégies internationales qui poursuivent un double objectif : promouvoir le développement de la nation et être considéré comme une nation à part entière par d’autres acteurs internationaux.
Le gouvernement du Québec a mis sur pied depuis les années 1960 une paradiplomatie identitaire dont l’objectif premier est de défendre « la politique internationale du Québec, comme celle de toutes les autres nations, ses intérêts et ses valeurs », pour reprendre les mots de l’ancien ministre des Relations internationales du Québec Jean-François Lisée (Paquin, 2014, p. 440). Par « intérêts nationaux », on entend l’idée que le Québec forme une nation distincte de la nation canadienne et que la politique étrangère du Canada ne prend pas convenablement en compte les intérêts et l’identité nationale du Québec. Si les actions internationales du Québec sont généralement complémentaires et même souvent coordonnées avec celles du gouvernement canadien, il arrive cependant qu’elles s’y opposent, ce qui a pour effet de projeter sur la scène internationale les conflits internes du Canada.
Cette paradiplomatie identitaire fait consensus parmi les diverses formations politiques du Québec. Malgré des épisodes sporadiques de protodiplomatie autour des référendums de 1980 et de 1995, les activités internationales du Québec relèvent généralement d’un autre registre. La Coalition Avenir Québec et le Parti libéral du Québec sont aussi, la plupart du temps, des partis nationalistes qui souhaitent faire connaître et promouvoir le caractère distinctif de l’identité québécoise. En juillet 2006, le premier ministre libéral du Québec, Jean Charest affirme que
sur la défense de notre identité, nous, fédéralistes, sommes aussi agressifs que les souverainistes peuvent l’être. Sur la scène internationale, nous vivons aujourd’hui une période d’affirmation très forte du Québec.
Il poursuit :
Sur le plan international, nous menons nos affaires sans inhibition et nous ne voyons pas beaucoup de limites à nos actions.
cité dans L’Express, 2006
Ce discours est comparable à celui de la Coalition Avenir Québec. En 2019, le gouvernement de la Coalition affirme : « nous sommes fiers à l’international d’être Québécois, et fiers d’être francophones. Affirmons-le toujours plus fort » (MRIF, 2019a, p. 13). Pour Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, la « diplomatie identitaire » représente un des trois piliers de la politique internationale du Québec avec l’économie et la diplomatie d’influence.
Comme vous le savez, le gouvernement de la CAQ est résolument nationaliste et laïque. L’adoption des lois n° 21 et n° 96 en fait foi. Nous sommes déterminés à protéger la langue française partout au Québec et à tout mettre en oeuvre pour que notre culture soit forte et en santé. Ces valeurs qui habitent notre peuple sont également à la base de toutes nos actions diplomatiques. Nous comptons les faire valoir avec vigueur partout sur notre passage. Nous croyons profondément en l’égalité des hommes et des femmes, en un Québec français, laïque et fier de sa culture, autant ici qu’ailleurs.
Biron, 2023
Cet extrait montre que la paradiplomatie identitaire n’est pas un synonyme de protodiplomatie, ni même de paradiplomatie culturelle. Cette dernière vise à favoriser le déploiement international de la production culturelle d’une petite nation non souveraine, que ce soit par le financement de tournées à l’étranger d’écrivains, d’artistes ou par le financement de productions musicales et cinématographiques.
Le concept de protodiplomatie n’est pas complètement inutile pour autant, car les entrepreneurs identitaires s’accordent tous sur un point : le droit à l’autodétermination. Puisque la souveraineté est de nature intersubjective, il faut établir des contacts avec des acteurs internationaux reconnus afin d’obtenir leur appui en cas de tentative de sécession. C’est en France qu’en 1980 comme en 1995, le gouvernement québécois cherche un appui en espérant une victoire souverainiste. La situation est la même lors de la tentative ratée de la Catalogne d’obtenir la reconnaissance internationale après sa déclaration unilatérale d’indépendance en 2017 (Paquin, 2022a; Garcia Segura, 2019; Lecours, 2019).
Le concept de protodiplomatie ne peut cependant pas expliquer les raisons ayant poussé le Parti Québécois à opérer d’importantes compressions dans le budget alloué aux actions internationales du Québec en 1996-1997 sous Lucien Bouchard et en 2012-2013 sous Pauline Marois. Il ne saurait non plus expliquer pourquoi le Parti libéral du Québec sous Jean Charest et la Coalition Avenir Québec valorisent autant les relations internationales fortes ni pourquoi d’anciens premiers ministres libéraux et fédéralistes, tels Jean Charest ou Jean Lesage, ont été des acteurs de premier plan dans les activités internationales du Québec. L’héritage qu’ont légué Charest et Lesage en matière de présence à l’étranger est remarquable et surpasse à bien des égards celui de René Lévesque, de Lucien Bouchard ou de Pauline Marois, trois anciens premiers ministres pourtant issus du Parti Québécois (Jeyabalaratnam et Paquin, 2016).
État-nation, monopole des relations internationales et nationalisme méthodologique
L’élasticité du concept de protodiplomatie soulève plusieurs problèmes. Ceux qui l’utilisent dans son acception large en viennent, en effet, à considérer que toutes les tendances centrifuges au sein des régimes fédéraux, et pas seulement celles à caractère sécessionniste, correspondent à de la protodiplomatie. De ce point de vue, le concept contient également un biais favorable à l’ordre constitutionnel en place, et aussi implicitement à la centralisation des pouvoirs dans les régimes fédéraux. Les défenseurs de cette définition large finissent, en effet, par appuyer l’idée que les gouvernements centraux possèdent le monopole de la représentation internationale alors que ce n’est pas toujours le cas sur le plan constitutionnel.
Il est vrai qu’en Espagne les relations internationales, y compris la négociation et la ratification des traités internationaux, sont du ressort de l’État central. La Constitution de 1978 accorde en effet au gouvernement espagnol le monopole des relations internationales (Garcia Segura, 2019; 1995, p. 124). L’article 149.1.3 de la Constitution fait des relations internationales une des 32 compétences exclusives de l’État espagnol, et les articles 56.1, 63.2, 94.1 et 97 confirment l’étendue des pouvoirs de l’État central en matière de traités internationaux et de droit de représentation internationale. Cela dit, ces articles de la constitution se sont avérés inapplicables dans les faits. Comme l’a démontré Caterina Garcia Segura (2019), le Tribunal constitutionnel espagnol, pourtant de tendance centralisatrice, a lui-même renversé sa propre jurisprudence pour accorder une place plus grande aux communautés autonomes en politique internationale. Le Tribunal constitutionnel espagnol a reconnu, à la suite d’un contrôle en constitutionnalité demandé par Madrid contre le gouvernement basque, que les communautés autonomes ont le droit de développer des activités extérieures dans leurs domaines de compétence, de conclure des accords internationaux dans la mesure où ces derniers ne relèvent pas du domaine de la politique étrangère espagnole.
La situation est bien différente au Canada et en Belgique. Au Canada, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, appelé Loi constitutionnelle de 1867 depuis 1982, aborde peu la question des relations internationales (Cyr et de Mestral, 2017). Contrairement à d’autres fédérations, on n’y trouve aucune attribution constitutionnelle formelle de la compétence exclusive des affaires étrangères, même de nos jours (Paquin, 2022b), ni de disposition qui spécifierait qui peut conclure des traités au Canada, puisque le Canada n’est pas devenu un pays souverain en 1867, mais un membre du Commonwealth britannique[8]. Dans ce contexte, il était inutile de préciser qui détenait le monopole des relations internationales puisque celui-ci revenait au gouvernement britannique.
De plus, contrairement aux cas espagnol et britannique, la Loi constitutionnelle de 1867 n’interdit pas explicitement aux provinces de jouer un rôle à l’échelle internationale. Certains articles sont si ambigus qu’ils semblent même permettre aux provinces d’ouvrir des bureaux à l’étranger (l’article 92.4). Aussi, selon l’article 95, l’immigration est une compétence partagée avec prépondérance fédérale. Or, pour recruter des immigrants, il est nécessaire d’ouvrir des bureaux à l’étranger. L’Ontario a ainsi posté son premier agent d’immigration au Royaume-Uni en 1869 et le Québec a fait de même au Royaume-Uni et aux États-Unis en 1871 (Paquin, 2022b). De plus, l’article 92.16 stipule que les provinces ont la compétence exclusive des « matières d’une nature purement locale ou privée dans la province ». Depuis 1867, la signification de ce qu’est une matière de nature locale a beaucoup évolué, et certaines de ces matières (éducation, culture, travail, santé, etc.) ont désormais une dimension internationale ou font l’objet de discussions dans les négociations internationales. Bref, l’affirmation selon laquelle le fédéral a le « monopole » des relations internationales du Canada est, au mieux, sujette à discussion.
La Belgique va encore plus loin. À la suite de l’accord de Saint-Michel de 1993, le fédéralisme belge, défini par l’article premier de la Constitution comme « un État fédéral qui se compose de communautés et de régions », a des conséquences importantes sur les relations internationales. L’État belge, qui avait une compétence exclusive en matière de relations internationales avant 1993, conserve son rôle, mais le tient selon l’article 167 de la Constitution, « sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci ». Toujours selon la Constitution belge, les « Gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur Parlement. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement » (Constitution belge, 2009, article 167(3)). Avec les accords du Lambermont de 2001, qui sont de nature constitutionnelle, même le pouvoir sur le commerce extérieur (ou la promotion du commerce à l’étranger) a été régionalisé (Paquin, 2021).
Depuis la révision constitutionnelle de 1993, l’autonomie des États fédérés belges en matière de politique extérieure est très poussée et découle de la reconnaissance du principe constitutionnel in foro interno, in foro externo, qui signifie que les régions et les communautés belges sont également compétentes à l’extérieur pour toutes les matières qui relèvent de leurs compétentes internes. Il y a également absence de hiérarchie entre les différents ordres de gouvernement. Ainsi, le gouvernement fédéral n’a pas de prépondérance sur les régions ou les communautés, même en matière de relations internationales. Les communautés et les régions opèrent chacune dans les limites de leurs compétences respectives, y compris en ce qui concerne la conclusion de traités. Ainsi, les États fédérés belges possèdent une véritable personnalité juridique internationale, ce qui signifie en pratique que les pays étrangers et les organisations internationales doivent accepter de négocier et de conclure des traités avec les États fédérés d’un État fédéral (Criekemans, 2019).
Biais favorable à la centralisation
Poursuivons avec les problèmes que cause l’élasticité du concept de protodiplomatie : il repose également sur un biais favorable à la centralisation des pouvoirs dans les régimes fédéraux. En matière de négociation de traités internationaux, les États fédéraux (Canada, Belgique) ou à structures décentralisées (Espagne) agissent comme s’ils étaient des États unitaires même lorsque l’objet du traité ne relève pas de leurs compétences propres, car en droit international public, l’élaboration de traités est perçue comme une fonction classique des États souverains.
Le fédéralisme n’est pourtant pas compatible avec les principes du droit international public, car il suppose que la souveraineté peut être exercée sur un même territoire, sur une même société, par plus d’un ordre de gouvernement (Shaw, 2017). Le problème tient au fait que les États fédéraux ou à structures décentralisées sont considérés en droit international comme des acteurs unitaires, alors qu’en réalité un gouvernement fédéral doit composer avec la division constitutionnelle des pouvoirs lorsqu’il négocie avec d’autres pays pour s’assurer qu’il est en mesure de respecter les obligations internationales qu’il assume (Lequesne et Paquin, 2017; Kukucha, 2017; Paquin, 2015; 2021).
Lorsqu’un État négocie un traité international et qu’il en impose la mise en oeuvre à tous les échelons de gouvernement, il centralise les pouvoirs et se trouve, en outre, à légiférer indirectement dans les champs de compétence des États fédérés ou gouvernements infranationaux.
La question qui se pose, par exemple en Espagne, est celle-ci : lorsqu’une communauté autonome comme la Catalogne adopte, par exemple, une politique en matière d’éducation et que cette politique a une dimension internationale, le gouvernement central devient-il immédiatement responsable de cette politique en vertu de l’article 149.1.3 de la Constitution espagnole?
Si la réponse est « oui », comme le suggèrent ceux qui ont un préjugé favorable envers l’État-nation, cela conduirait à l’une des plus importantes remises en question de l’ordre constitutionnel espagnol depuis la promulgation de la Constitution de 1978. L’État espagnol n’aurait, en effet, qu’à conclure des traités dans un domaine de compétence des communautés autonomes puis d’en imposer la mise en oeuvre. Ce phénomène, qu’on peut qualifier d’effet boomerang, est amplifié par la prolifération du multilatéralisme et par le processus d’intégration européenne. L’adoption des directives communautaires européennes, par exemple, a de fortes conséquences sur la distribution des pouvoirs entre le gouvernement central espagnol et les communautés autonomes. Les directives communautaires mettent en relief les incohérences et les lacunes de la Constitution espagnole en matière de distribution des pouvoirs et de relations internationales. Comme le soulignait déjà il y a plus de 20 ans l’ancien président catalan Jordi Pujol [traduction libre] : « Il est à craindre que des enjeux liés à l’Europe soient utilisés afin de récupérer des compétences des communautés autonomes » (Börzel, 2002, p. 129). Pujol redoutait que le gouvernement espagnol se serve du processus d’intégration européenne comme « alibi » pour centraliser le pays (Börzel, 2002, p. 103). Les nationalistes catalans, aidés par les nationalistes basques et dans une moindre mesure par d’autres communautés autonomes, dénoncent ces transferts de souveraineté vers l’Europe qui privent les régions d’une partie de leurs compétences (Garcia Segura, 1995, p. 126).
En raison de ce contexte, on constate depuis plusieurs années une croissance du rôle des États infranationaux dans les négociations internationales, et ce rôle ne se limite pas à la simple mise en oeuvre des traités internationaux négociés par l’État central (Borghetto et Franchino, 2010; Tatham, 2018). On n’a qu’à penser au cas de la Wallonie qui a été en mesure de bloquer la signature de la Belgique lors de la ratification de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG). La situation est similaire en Écosse post-Brexit en ce qui a trait aux négociations des traités commerciaux de la Grande-Bretagne. Les Écossais revendiquent, en effet, à cet égard, le statut dont jouit le Québec dans la négociation de l’AECG. Ils veulent pouvoir s’exprimer de leur propre voix afin de protéger leur autonomie législative. Jörg Broschek, expert en la question, parle d’un phénomène de plus en plus répandu dans les cas de négociations commerciales (Broschek, 2021). Et avec la montée en puissance des autorités régionales dans le monde, ce phénomène pourrait s’accentuer (Hooghe, Marks et Schakel, 2010; Tatham, Hooghe et Marks, 2021).
Paradiplomatie identitaire et conflits
Les analyses sur la protodiplomatie font souvent l’impasse sur le fait que les petites nations non souveraines ne sont pas les seules à entrer en conflit avec la politique internationale des gouvernements centraux. Le Québec est loin d’être la seule province à posséder des délégations à l’étranger et à déployer des stratégies internationales qui entrent parfois en contradiction avec celles de l’État canadien. Il n’est pas non plus la seule province à avoir conclu des ententes internationales, même si c’est lui qui en a signé le plus grand nombre (plus de 780), pour la plupart avec des pays souverains. Dès les années 1950, l’Ontario avait conclu des ententes sur les permis ou droits d’immatriculation des automobiles et sur l’exécution des ordonnances alimentaires avec d’autres pays membres du Commonwealth. En 1965, le Nouveau-Brunswick avait signé un accord avec le Maine au sujet d’un projet de pont (Gouvernement du Canada, 1968, p. 26). Au Canada, dès la fin des années 1970, 7 provinces avaient ouvert plus de 35 délégations à l’étranger, réparties sur 3 continents (Blanchette, 1980, p. 302). Au début des années 1990, l’Ontario avait près de 20 représentations à l’étranger (Dyment, 2001, p. 61).
Certes, les stratégies internationales du Québec ont souvent entraîné de vifs conflits avec le gouvernement fédéral et pas exclusivement lorsque le Parti Québécois, au pouvoir, préparait un référendum. Lors des négociations internationales qui ont suivi la visite du général de Gaulle et qui visaient à mettre sur pied l’Agence de coopération culturelle et technique, les relations étaient si tendues que le ministre québécois Jean-Guy Cardinal, quittant le pays pour assister à une rencontre internationale de pays francophones et craignant d’être arrêté à son retour et emprisonné pour « haute trahison », avait en poche un sauf-conduit délivré par le gouvernement français (Godin, 1991, p. 325)!
Malgré ces événements retentissants et les guerres de drapeaux à l’étranger, le Québec n’est pas la seule province à générer des conflits; il suffit de penser aux actions internationales de l’Alberta dans le domaine de l’énergie. Cette dernière s’est par exemple beaucoup activée auprès des décideurs à Washington pour que soit approuvé le projet de pipeline Keystone XL (Wingrove, 2014). On peut également songer à la réaction de l’Ontario et de l’Alberta devant le refus d’Ottawa de participer à la guerre en Irak en mars 2003. L’Alberta a soutenu publiquement la position américaine, son premier ministre, le conservateur Ralph Klein, a même envoyé une lettre d’appui à George W. Bush par l’entremise de l’ambassadeur américain à Ottawa. Dans cette lettre rendue publique, Klein salue le « leadership exemplaire » du président Bush, un leadership à l’image de celui dont il a fait preuve lors des attentats du 11 septembre 2001 (Robitaille, 2003). Quelques jours plus tard, le premier ministre conservateur de l’Ontario, Ernie Eves, imite son homologue albertain (Robitaille, 2003). Les deux déclarations, qui ont plongé le gouvernement fédéral dans l’embarras, témoignent d’une volonté de se distinguer d’Ottawa sur des questions de sécurité internationale.
Selon Justin Massie et Marjolaine Lamontagne, lorsque les représentants de l’Ontario et de l’Alberta se sont prononcés en faveur d’une participation canadienne à la guerre en Irak en mars 2003, leurs actions étaient également guidées par la peur de représailles économiques américaines (Massie et Lamontagne, 2018).
On ne peut donc pas considérer tous les conflits avec le gouvernement central comme relevant de la protodiplomatie, ce qui oblige à la distinguer du concept de paradiplomatie. Soldatos, Duchacek et bien d’autres encore s’entendent d’ailleurs pour dire que la paradiplomatie peut entrer en conflit avec la politique étrangère de l’État central, bien qu’elle puisse aussi être menée en collaboration avec lui[9]. Il devient ainsi presque risible de penser que tout ce qui sort du registre de l’harmonie relèverait de la protodiplomatie.
Les origines de la paradiplomatie identitaire au Québec
Pour comprendre l’émergence de la paradiplomatie identitaire au Québec, il faut la replacer dans son contexte historique, celui de la Révolution tranquille. Ivo Duchacek, Daniel Latouche et Garth Stevenson (1988), tout comme Gordon Mace, Louis Bélanger et Ivan Bernier (1995) soutiennent que le décollage de la paradiplomatie québécoise dans les années 1960 est attribuable à l’effervescence nationaliste au Québec.
Cette dernière était liée à un besoin de légitimation, dimension importante dans le processus de nation-building de la Révolution tranquille. Le gouvernement du Québec avait une délégation à New York depuis la Seconde Guerre mondiale et avait également eu des représentations à Paris, Bruxelles et Londres au début du 20e siècle, mais ses efforts internationaux étaient plutôt modestes et se situaient fondamentalement dans le registre de la paradiplomatie fonctionnelle.
Le développement d’une paradiplomatie identitaire au Québec dans les années 1960 relève d’un autre registre et répondait à un fort besoin de reconnaissance de l’existence de la nation québécoise par des acteurs tiers, au premier chef la France. Ce besoin était d’autant plus grand que d’importantes négociations constitutionnelles sur le statut du Québec devaient avoir lieu et que la reconnaissance de la France comme partenaire venait singulariser davantage, si besoin était, le Québec dans l’ensemble canadien.
C’est ici que la distinction entre la paradiplomatie, la paradiplomatie identitaire et la protodiplomatie est le plus clair. Selon Claude Morin, sous-ministre du gouvernement du Québec dans les années 1960 et responsable des questions internationales, les motivations des entrepreneurs identitaires, comme Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme ou Paul Gérin-Lajoie, ne proviennent pas exclusivement du registre de la protodiplomatie ni même exclusivement de celui de la paradiplomatie identitaire. En effet, comme le souligne Morin, la paradiplomatie québécoise n’était pas le fait d’entrepreneurs identitaires qui préparaient en douce l’indépendance du Québec. Les causes sont bien plus simples selon lui. La volonté du gouvernement du Québec de jouer un rôle actif sur la scène internationale était « reliée à des problèmes ou à des besoins concrètement ressentis en ce temps-là », notamment en ce qui concerne l’éducation, la culture et le développement économique (Morin, 1987, p. 35). En somme, les motivations du gouvernement du Québec jouent largement sur le registre de la paradiplomatie fonctionnelle.
Dans le contexte du Québec de la Révolution tranquille, le rapprochement avec la France était un outil devant favoriser la construction de l’État québécois : le Québec faisait face à des problèmes que la coopération avec la France pouvait contribuer à résoudre. C’est ainsi que les premières ententes internationales vont porter sur des questions de coopération, d’éducation et de culture. Le monde de l’éducation se transformait rapidement depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage, qui ont d’ailleurs créé le premier ministère de l’Éducation en 1965. Les lacunes en ce domaine étaient nombreuses, en particulier sur le plan technique. Les politiques de coopération avec l’État français allaient permettre au Québec de combler son retard plus rapidement. En somme, la France avait les moyens et les ressources pour fournir au Québec les spécialistes nécessaires à son développement. Dès le début des années 1960, le Québec édifiera ainsi un ensemble de politiques de coopération avec la France (Mesli, 2014).
Cela dit, la dimension identitaire est également présente. Pour justifier leurs actions internationales, les représentants du Québec ne mettent pas uniquement de l’avant des arguments de nature fonctionnelle. Le coeur de leur argumentation est, en effet, identitaire. Dans son discours d’inauguration de la Maison du Québec à Paris, le premier ministre Jean Lesage insiste sur le fait que le Québec n’est pas une province comme les autres au Canada. « L’État du Québec », et non plus la province de Québec, représente pour lui le levier fondamental apte à contrer la menace d’assimilation des francophones en contexte nord-américain. Selon Lesage (1961), la Maison du Québec à Paris est « le prolongement de l’action que nous avons entreprise dans le Québec même ».
L’ouverture sur le monde est selon Claude Morin la principale motivation du gouvernement québécois. Le néonationalisme québécois naissant avec la Révolution tranquille entend rompre avec le nationalisme étroit de l’époque précédente. Le gouvernement canadien pratiquait la discrimination à l’endroit des francophones, notamment en matière d’affaires étrangères, c’est pourquoi on fondait beaucoup d’espoir sur l’État québécois. La sous-représentation des francophones dans la fonction publique fédérale, le manque d’intérêt pour les questions relatives à la francophonie internationale et le peu de connaissance des enjeux politiques québécois engendreront une réaction identitaire chez les dirigeants québécois, qui favorisera le développement d’une paradiplomatie identitaire. Dans le contexte des années 1960, il semblait évident que c’était du côté de la France que le gouvernement du Québec serait susceptible de trouver le plus d’appuis (Patry, 2006).
L’émergence des relations internationales du Québec est également liée aux intérêts constitutionnels, comme le mentionne le ministre Paul Gérin-Lajoie dans son discours devant les membres du corps consulaire de Montréal (Gérin-Lajoie, 1965). Cette allocution, appelée aujourd’hui la « doctrine Gérin-Lajoie du prolongement externe des compétences internes du Québec », est fondamentale, car pour la première fois, un ministre affirmait devant des dignitaires étrangers « la détermination du Québec de prendre dans le monde contemporain la place qui lui revient » (Gérin-Lajoie, 1965). Elle est depuis le fondement de l’action internationale du Québec. Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis lors ont cependant maintenu leur adhésion à la doctrine Gérin-Lajoie.
À partir de l’élection de Jean Lesage jusqu’au second mandat du Parti québécois dans les années 1980, plusieurs initiatives d’importance structurent la paradiplomatie identitaire du Québec : l’ouverture de la Maison du Québec à Paris en 1961; la conclusion de la première « entente » avec l’État français en matière d’éducation en 1965; la formulation de la doctrine Gérin-Lajoie, base juridique de l’action internationale du Québec la même année; la mise sur pied d’un service du protocole en 1966 en prévision de l’Expo 67 où le gouvernement québécois accueillera 44 chefs d’État – dont le président de Gaulle – ou leurs représentants; la création du nouveau ministère des Affaires intergouvernementales en 1968, ancêtre du MRIF; la participation du Québec, aidé par la France et généralement contre la volonté du Canada, à des conférences de ministres de l’éducation francophones dont les rapports permettront la création de l’Organisation internationale de la Francophonie. L’addition de ces précédents structurera le cadre du déploiement de la paradiplomatie identitaire du Québec jusqu’à nos jours. C’est largement grâce à l’appui de la France, et notamment du général de Gaulle, que tout cela a été possible.
⁂
Les cas du Québec, de la Catalogne et de la Flandre sont riches d’enseignements. Celui du Québec montre d’abord qu’il n’y a pas de déterminisme en matière de paradiplomatie identitaire. Parce que les gouvernements des petites nations non souveraines ne sont pas toujours dirigés par les mêmes partis politiques, leurs objectifs changent en ce qui a trait au renforcement de l’identité nationale, de l’autonomie et de l’autodétermination. En règle générale, l’État central est plus méfiant et agressif même quand un gouvernement favorable à la sécession de la petite nation non souveraine est au pouvoir (Lecours, 2019, p. 31).
Les entrepreneurs identitaires provenant des gouvernements centraux considèrent comme leur chasse gardée la politique internationale et la représentation du pays à l’étranger. Les gouvernements centraux voient donc dans la perte du monopole de ces domaines un grave danger pour l’unité nationale et une atteinte à l’image du pays sur la scène internationale. Il est bon de rappeler que les acteurs du centre sont également nationalistes.
L’attitude hostile, voire agressive, des acteurs de gouvernements centraux donne l’occasion aux entrepreneurs identitaires de se mobiliser contre la prétention hégémonique du centre. Puisque la politique étrangère est souvent présentée comme un domaine réservé de l’État et qu’elle vise à promouvoir un intérêt national au singulier, le développement de la paradiplomatie identitaire devient dans ce contexte une lutte de pouvoir et de légitimité.
Cela dit, les conflits ne sont pas toujours inévitables. En Espagne, les relations internationales de la Catalogne ont d’abord provoqué de nombreux conflits avec Madrid dans les années 1980 et 1990. Les relations se sont ensuite graduellement normalisées sous l’administration de Jordi Pujol, mais les hostilités ont repris de plus belle avec l’échec des réformes constitutionnelles et la déclaration unilatérale d’indépendance de 2017 (Paquin, 2022a).
Dans le cas québécois, les relations avec l’État fédéral ont d’abord été bonnes sous les libéraux de Jean Lesage, puis elles se sont dégradées avec la formulation de la doctrine Gérin-Lajoie, la visite du général de Gaulle et l’arrivée au pouvoir des libéraux fédéraux de Pierre Elliott Trudeau. Après l’échec du premier référendum, l’élection des progressistes-conservateurs de Brian Mulroney au palier fédéral et celle des libéraux de Robert Bourassa au Québec, les relations internationales du Québec ont été beaucoup moins dérangeantes pour le pouvoir fédéral.
Le retour au pouvoir des libéraux fédéraux sous la direction de Jean Chrétien dans les années 1990, la réélection en 1994 du Parti Québécois et le référendum de 1995 ont entraîné un retour aux relations conflictuelles. Depuis, la baisse tendancielle de l’appui à l’indépendance du Québec et le long règne libéral à partir de 2003 au Québec ont durablement normalisé les rapports entre ce dernier et le gouvernement fédéral. Plus personne « ne déchire sa chemise » à Ottawa parce que le Québec entretient des relations directes et privilégiées avec la France.
Les cas de paradiplomatie identitaire nous révèlent également que ce n’est pas l’élaboration de relations internationales par de petites nations non souveraines qui pose problème, mais plutôt le refus d’accepter cette réalité en raison, notamment, des préjugés liés au nationalisme méthodologique. La paradiplomatie est pourtant de nos jours inévitable, banale et même souhaitable, ne serait-ce que pour favoriser les échanges étudiants ou les exportations.
Finalement, assimiler toutes les actions internationales des États fédérés à de la protodiplomatie pose problème lorsqu’on fait une analyse à long terme. Afin de se développer et de s’institutionnaliser, la paradiplomatie et la paradiplomatie identitaire ont, en effet, besoin de cultiver un climat de coopération entre l’État fédéré et les pays avec lesquels il entretient des relations. Il est impossible de développer des programmes de coopération, par exemple dans le domaine de l’innovation et de la science, de l’éducation ou de la culture, ou encore de conclure des ententes internationales à long terme dans un climat permanent de tensions et de conflits entre le gouvernement central et l’État non souverain. La protodiplomatie relèverait plus du stade transitoire vers le statut de pays souverain que d’un phénomène observable dans la durée. Les entrepreneurs identitaires ne ferment pas complètement la porte à l’éventualité de la sécession, mais cette option n’est pas toujours l’objectif primordial de leurs actions internationales.
Pour les chantiers de recherche future, plusieurs questions seraient dignes d’intérêt. Il y a d’abord celle de l’élargissement de la comparaison à de nombreux autres cas. Pour le moment, on dénombre beaucoup d’études sur le cas québécois, mais aussi le cas catalan et dans une moindre mesure le cas flamand, mais peu sur celui de l’Écosse ou du Pays basque. De plus, il n’existe à peu près rien sur les dynamiques non occidentales. Pour s’en tenir au cas spécifique du Québec, deux questions émergent : quel sera l’effet du déclin de l’appui à la souveraineté du Québec sur la paradiplomatie identitaire, notamment dans les relations du Québec avec la France et les pays de la Francophonie? Est-ce que la paradiplomatie fonctionnelle prendra le dessus sur la paradiplomatie identitaire, notamment en raison de l’accent mis sur les questions de développement économique? Cette seconde question porte sur les relations avec le gouvernement du Canada : la banalisation de la paradiplomatie au Québec, mais également au sein des autres provinces, favorisera-t-elle une meilleure coopération entre les provinces et le gouvernement fédéral? Les provinces ont été mobilisées dans la renégociation de l’ALENA, mais également dans la négociation de l’AECG par le gouvernement fédéral. Est-ce que cela indique un changement de culture à l’échelon fédéral? Seul le temps le dira.
Parties annexes
Note biographique
Stéphane Paquin est titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la confiance et le leadership politique de l'UQTR et professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique et directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’international et le Québec (GÉRIQ). Il a rédigé, corédigé ou dirigé 35 livres ou numéros de revues scientifiques et publié plus d’une centaine d’articles sur l’économie politique internationale, sur la réforme de l’État et la social-démocratie, sur le nationalisme minoritaire et sur la politique internationale des États fédérés. Il a obtenu de nombreuses bourses prestigieuses, dont une Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée et une Fulbright distinguished Chair à la State University of New York. Il a également été le président du comité local d’organisation du congrès mondial de sciences politiques qui s’est tenu à Montréal en 2014.
Notes
-
[1]
Le concept d’entrepreneur identitaire provient des travaux de Bertrand Badie. À ce sujet, voir Paquin et Hatto, 2018.
-
[2]
Sur ces questions, voir Laniel et Thériault, 2020; Boucher et Thériault, 2005.
-
[3]
C’était le sujet de notre thèse de doctorat dirigée par Bertrand Badie.
-
[4]
À ce sujet, voir notamment Dumitru, 2014; Jefferey, 2014, p. 1-2; Jeffery et Schakel, 2013; ou encore Wimmer et Glick-Schiller, 2002.
-
[5]
Dans la littérature scientifique, le concept de paradiplomatie a été utilisé avant les années 1980-1990 notamment par Rohan Butler en 1961, mais avec un tout autre sens. Pour Butler, la paradiplomatie signifie [traduction] « le plus haut niveau de diplomatie personnelle et parallèle, complétant ou concurrençant la politique étrangère régulière du ministre concerné, [c’]est donc une tentation récurrente pour le chef de l’exécutif, qu’il soit premier ministre ou président, dictateur ou monarque » (Butler cité dans Kuznetsov, 2015, p. 26).
-
[6]
Ce concept peut aussi être utilisé pour désigner les efforts diplomatiques d’États de facto ou encore de quasi-États comme Taïwan, l’Abkhazie ou l’Ossétie du Sud-Alanie. L’appui à ce type d’initiatives est souvent source de conflits, comme en témoignent les actions diplomatiques très agressives de la Chine contre les pays qui tissent des liens avec Taïwan (Newland, 2022).
-
[7]
Notre traduction de « Pero cuando va acompañada de movimientos nacionalistas o independentistas se transforma completamente en un fenómeno diferente, la protodiplomacia » (Zapata Morán et De la Garza Montemayor, 2022, p. 87).
-
[8]
Ce fait est reconnu par le gouvernement fédéral lui-même. À ce sujet, voir Gouvernement du Canada, 1968, p. 8.
-
[9]
Selon Duchacek [traduction] : « Au départ, j’utilisais le terme “microdiplomatie”, mais puisqu’on peut y voir un sens péjoratif, j’accepte volontiers le bien meilleur terme “paradiplomatie” que propose le professeur Soldatos. Non seulement ce mot n’a-t-il pas de sonorité désobligeante, mais le préfixe “para-” exprime avec précision ce dont il est question : parallèle à, souvent coordonnée avec, complémentaire à et parfois en conflit avec la “macrodiplomatie” de centre à centre » (Duchacek, 1990, p. 32, nous soulignons).
Bibliographie
- Ababakr, Yasin Mahmood, 2020 « Iraqi Kurdistan Region: from paradiplomacy to protodiplomacy », Review of Economics and Political Science. [https://www.emerald.com/insight/content/doi/10,1108/REPS-01-2020-0002/full/html], consulté le 20 mars 2023.
- Álvarez, Gonzalo et Cristian Ovando, 2022 « Indigenous peoples and paradiplomacy: confronting the state-centric order from Latin American transborder spaces », Territory, Politics, Governance. [https://www.researchgate.net/publication/358732990_Indigenous_peoples_and_paradiplomacy_confronting_the_state-centric_order_from_Latin_American_transborder_spaces], consulté le 20 mars 2023.
- Biron, Martine, 2023 « Ce qu’elles ont dit : les trois sphères diplomatiques des relations internationales du Québec », Le courrier parlementaire/ L’actualité gouvernementale, 23 janvier. [https://old.lcp-lag.com/categories/relations-internationales/salaire-de-181-534-pour-david-brulotte-40822/], consulté le 20 mars 2023.
- Blanchette, Arthur E. (dir.), 1980 Canadian Foreign Policy, 1966-1976: Selected Speeches and Documents, Ottawa, Carleton University.
- Borghetto, Enrico et Fabio Franchino, 2010 « The Role of Subnational Authorities in the Implementation of EU Directives », Journal of European Public Policy, 17, 6 : 759-780,
- Börzel, Tanja A., 2002 States and Regions in the European Unions: Institutional Adaptation in Germany and Spain, Cambridge, Cambridge University Press.
- Boucher, Jacques et Joseph Yvon Thériault (dir.), 2005 Petites sociétés et minorités nationales, Québec, Presses de l’Université du Québec.
- Broschek, Jörg, 2021 « The Federalization of Trade Politics in Switzerland, Germany and Austria », Regional & Federal Studies, 33, 1, juin : 91-112.
- Constitution belge, 2009 Chambre des représentants, janvier 2009. [https://personal.eur.nl/crutzen/POLI-D-517/Constitution%20Belge.pdf], consulté le 20 mars 2023..
- Cornago, Noé, 2018 « Paradiplomacy and Protodiplomacy », dans : Gordon Martel (dir.), Encyclopedia of Diplomacy, Oxford, Wiley-Blackwell.
- Criekemans, David, 2010 « Regional Sub-State Diplomacy from a Comparative Perspective: Quebec, Scotland, Bavaria, Catalonia, Wallonia and Flanders », The Hague Journal of Diplomacy, 5, 1-2 : 37-64.
- Criekemans, David, 2019 « De la paradiplomatie identitaire à la diplomatie à paliers multiples? Le cas de la Belgique et de ses entités fédérées », dans : Justin Massie et Marjolaine Lamontagne (dir.), Paradiplomatie identitaire : nations minoritaires et politiques extérieures, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 103-123.
- Cyr, Hugo et Armand de Mestral, 2017 « International Treaty-Making and the Treaty Implementation », dans : Peter Oliver, Patrick Macklem et Nathalie Des Rosiers (dir.), The Oxford Handbook of the Canadian Constitution, New York, Oxford University Press, p. 595-621.
- Dermawan, Windy, Ivan Darmawan, Mustabsyirotul Ummah Mustofa et Yusa Djuyandi, 2022 « Paradiplomacy practices in Indonesia: Comparative analysis of Aceh-Quebec », Politics & Policy, 50 : 363-379.
- Duchacek, Ivo D., 1986 The Territorial Dimension of Politics: Within, Among and Across Nations, Boulder, Westview Press.
- Duchacek, Ivo D., 1988 « Multicommunal and Bicommunal Polities and Their International Relations », dans : Ivo D. Duchacek, Daniel Latouche et Garth Stevenson (dir.), Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments, New York, Greenwood Press, p. 3-28.
- Duchacek, Ivo D., 1990 « Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations », dans : Hans J. Michelmann et Panayotis Soldatos (dir.), Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, Oxford, Oxford University Press, p. 1-33.
- Duchacek, Ivo D., Daniel Latouche et Garth Stevenson (dir.), 1990 Perforated Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational Governments, New York, Greenwood Press.
- Dumitru, Speranta, 2014 « Qu’est-ce que le nationalisme méthodologique? », Raisons politiques, 2, 54 : 9-22.
- Dyment, David M., 2001 « The Ontario Government as an International Actor », Regional and Federal Studies, 11, 1 : 55-79.
- Gagnon, Alain-G., André Lecours et Geneviève Nootens (dir.), 2011 Contemporary Majority Nationalism, Montréal, McGill-Queen’s University Press.
- Garcia Segura, Caterina, 1995 « The Autonomous Communities and External Relations », dans : Richard Gillespie, Fernando Rodrigo et Jonathan Story (dir.), Democratic Spain: Reshaping External Relations in a Changing World, Londres, Routledge, p. 123-140,
- Garcia Segura, Caterina, 2019 « Catalogne en quête d’indépendance : l’outil de la diplomatie publique », dans : Justin Massie et Marjolaine Lamontagne (dir.), Paradiplomatie identitaire : nations minoritaires et politiques extérieures, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 51-75.
- Gérin-Lajoie, Paul, 1965 Allocution de M. Paul Gérin-Lajoie, vice-président du Conseil exécutif du Québec et ministre de l’Éducation, aux membres du Corps consulaire de Montréal, Montréal, 12 avril. [https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/positions-historiques/positions-du-qc/partie2/PaulGerinLajoie1965.pdf], consulté le 20 mars 2023.
- Godin, Pierre, 1991 La difficile recherche de l’égalité. La Révolution tranquille, vol. 2, Montréal, Boréal.
- Gouvernement du Canada, 1968 Fédéralisme et relations internationales, Ottawa, Secrétaire d’État aux Affaires extérieures.
- Hooghe, Liesbet, Gary Marks et Arjan Schakel, 2010 The Rise of Regional Authority: A Comparative Study of 42 Democraties, New York, Routledge.
- Hunt, Jo et Rachel Minto, 2017 « Between intergovernmental relations and paradiplomacy: Wales and the Brexit of the regions », The British Journal of Politics and International Relations, 19, 4 : 647-662.
- Issundari, Sri, Yanyan Mochamad Yani, R. Widya Setiabudi Samadinata et R. Dudy Heryadi, 2021 « From Local to Global: Positioning Identity of Yogyakarta, Indonesia through Cultural Paradiplomacy », Academic Journal of Interdisciplinay Studies, 10, 3 : 177-187.
- Jeffery, Charlie, 2014 « Introduction: Regional Public Attitudes beyond Methodological Nationalism », dans : Ailsa Henderson, Charlie Jeffery et Daniel Wincott (dir.), Citizenship after the Nation State, Londres, Palgrave Macmillan, p. 1-30,
- Jeffery, Charlie et Arjan Schakel, 2013 « Insights: Methods and Data Beyond Methodological Nationalism », Regional Studies, 47, 3 : 402-404.
- Jeyabalaratnam, Gopinath et Stéphane Paquin, 2016 « La politique internationale du Québec sous Jean Charest : l’influence d’un premier ministre », Revue québécoise de droit international, numéro hors-série, juin : 165-183.
- Keating, Michael, 1997 Les défis du nationalisme moderne, Québec, Catalogne, Écosse, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal.
- Klyszcz, Ivan Ulises, 2022 « Chechnya’s Paradiplomacy 2000-2020: The Emergence and Evolution of External Relations of a Reincorporated Territory », Nationalities Papers : 1-17. [https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/chechnyas-paradiplomacy-20002020-the-emergence-and-evolution-of-external-relations-of-a-reincorporated-territory/0529816EDB9DF02B4C46B88D52469967], consulté le 20 mars 2023.
- Kukucha, Chris, 2017 « Federalism and Liberalization: Evaluating the Impact of American and Canadian Sub-federal Governments on the Negotiation of International Trade Agreements », International Negotiation, 22, 2 : 259-284.
- Kundera, Milan, 1983 « Un Occident kidnappé ou la tragédie de l’Europe centrale », Le Débat, 5, 27 : 3-23.
- Kuznetsov, Alexander S., 2015 Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs, New York, Routledge.
- L’Express, 006 « Le Québec est une nation », L’Express, 27 juillet. [https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/laquo-le-qu-eacute-bec-est-une-nation-raquo_481225.html], consulté le 5 mars 2020,
- Laniel, Jean-François et Joseph Yvon Thériault (dir.), 2020 Les petites nations : culture, politique et universalité, Paris, Classiques Garnier.
- Lecours, André, 2019 « Paradiplomatie, nationalisme et référendums : l’Écosse et la Catalogne », dans : Justin Massie et Marjolaine Lamontagne (dir.), Paradiplomatie identitaire : nations minoritaires et politiques extérieures, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 31-50,
- Lecours, André et Luis Moreno, 2001 « Paradiplomacy and Stateless nations: a reference to the Basque Country », Working Paper 01-06, IPP - Spanish National Research Council (CSIC).
- Lequesne, Christian et Stéphane Paquin, 2017 « Federalism, Paradiplomacy and Foreign Policy: A Case of Mutual Neglect », International Negotiation, 22, 2 : 183-204.
- Lesage, Jean, 1961 Discours de l’Honorable Jean Lesage, Premier ministre, Inauguration de la Maison du Québec à Paris, 5 octobre. [www.mrif.gouv.qc.ca/document/spdi/fonddoc/fdoc_alloc_1518_19611005_lesage-inauguration.htm], consulté le 20 mars 2023.
- Mace, Gordon, Louis Bélanger et Ivan Bernier, 1995 « Canadian Foreign Policy and Quebec », dans : Maxwell A. Cameron et Maureen AppelMolot (dir.), Canada Among Nations, 1995: Democracy and Foreign Policy, Ottawa, Carleton University Press.
- Massie, Justin et Marjolaine Lamontagne (dir.), 2018 « Par-delà les champs de compétence : l’affirmation du Québec en matière de guerre et de paix », Revue canadienne de science politique, 51, 3 : 573-598.
- Massie, Justin et Marjolaine Lamontagne (dir.), 2019 Paradiplomatie identitaire : nations minoritaires et politiques extérieures, Québec, Presses de l’Université du Québec.
- McHugh, James T., 2015 « Paradiplomacy, Protodiplomacy and the Foreign Policy Aspirations of Quebec and Other Canadian Provinces », Canadian Foreign Policy Journal, 21, 3 : 238-256.
- Mesli, Samy, 2014 La Coopération franco-québécoise dans le domaine de l’éducation de 1965 à nos jours, Montréal, Septentrion.
- Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), 2019a Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde. Vision internationale du Québec, Québec, Gouvernement du Québec.
- Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), 2019b Rapport annuel 2018-2019, Québec, Gouvernement du Québec.
- Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), 2020 Rapport annuel 2019-2020, Québec, Gouvernement du Québec.
- Morin, Claude, 1987 L’art de l’impossible. La diplomatie québécoise depuis 1960, Montréal, Boréal.
- Mohammed, Herish Khali et Francis Owtram, 2014 « Paradiplomacy of Regional Governments in International Relations: The Foreign Relations of the Kurdistan Regional Government (2003-2010) », Iran and the Caucasus, 18 : 65-84.
- Newland, Sara A., 2022 « Paradiplomacy as a response to international isolation: the case of Taiwan », The Pacific Review. [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10,1080/09512748.2022.2025889].
- Paquin, Stéphane, 2002 La Paradiplomatie identitaire. Le Québec et la Catalogne en relations internationales, Thèse (Ph. D.), Sciences Po Paris.
- Paquin, Stéphane, 2005 « La paradiplomatie identitaire : le Québec, la Flandre et la Catalogne en relations internationales », Politique et Sociétés, 23, 3 : 176-194.
- Paquin, Stéphane, 2014 « La politique internationale du Québec », dans : Robert Bernier (dir.), Les défis québécois : conjonctures et transitions, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 439-456.
- Paquin, Stéphane, 2015 « International Relations of Minority Nations: Quebec and Wallonia compared » (avec Marine Kravagna et Min Reuchamps), dans : Min Reuchamps (dir.), Minority Nations in Multinational Federations: A Comparative Study of Quebec and Wallonia, Londres, Routledge, p. 160-180,
- Paquin, Stéphane, 2021 « Trade Paradiplomacy and the Politics of International Economic Law: The Inclusion of Quebec and the Exclusion of Wallonia in CETA Negotiations », New Political Economy, 26, 6 : 1-13.
- Paquin, Stéphane, 2022a « Paradiplomatie fonctionnelle, identitaire et protodiplomatie en Catalogne : un cas unique », Catalonia, 31, 2 :1-20,
- Paquin, Stéphane, 2022b « La réforme inachevée : le fédéralisme canadien et le rôle des provinces dans les négociations internationales », Revue québécoise de droit international, numéro hors-série, janvier : 73-111.
- Paquin, Stéphane et Ronald Hatto, 2018 « Une École française des Relations internationales? La perspective badienne en RI », dans : Delphine Allès, Romain Malejacq et Stéphane Paquin, Un monde fragmenté. Autour de la sociologie des Relations internationales de Bertrand Badie, Paris, CNRS Éditions, p. 19-40,
- Patry, André, 2006 Le Québec et le monde, Montréal, Typo.
- Pinos, Jaume Castan et Jeremy Sacramento, 2022 « Sabotaging Paradiplomacy: A Typological Analysis of Counter-paradiplomacy », Ethnopolitics. [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10,1080/17449057.2022.2137290], consulté le 20 mars 2023
- Robitaille, Antoine, 2003 « Le ROC fissuré par la guerre », Le Devoir, 23 mars, p. B4.
- Sarson, Leah, 2019 « “You Cannot Trade What Is Not Yours”: Indigenous Governance and the NAFTA Negotiations », American Review of Canadian Studies, 49, 2 : 332-347.
- Schiavon, Jorge A., 2019 Comparative Paradiplomacy, New York, Routledge.
- Sharafutdinova, Gulnaz, 2003 « Paradiplomacy in the Russian Regions: Tatarstan’s Search for Statehood », Europe-Asia Studies, 55, 4: 613-629.
- Shaw, Malcolm, 2017 International Law, 8e éd., Cambridge, Cambridge University Press.
- Soldatos, Panayotis, 1990 « An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-Policy Actors », dans : Hans J. Michelmann et Panayotis Soldatos (dir.), Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, Oxford, Oxford University Press, p. 34-53.
- Tatham, Michäel, 2018 « The Rise of Regional Influence in the EU: From Soft Policy Lobbying to Hard Vetoing », Journal of Common Market Studies, 56, 3 : 672-686.
- Tatham, Michaël, Liesbet Hooghe et Gary Marks, 2021 « The Territorial Architecture of Government », Governance, 34, 3 : 607-620,
- Totoricagüena, Gloria, 2005 « Diasporas as Non-Central Government Actors in Foreign Policy: The Trajectory of Basque Paradiplomacy », Nationalism and Ethnic Politics, 11, 2 : 265-287.
- Wimmer, Andreas et Nina Glick-Schiller, 2002 « Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences », Global Networks, 2, 4 : 301-334.
- Wingrove, Josh, 2014 « Alberta’s new man in Washington on getting a ‘yes’ for Keystone », TheGlobe and Mail, 18 septembre. [https://www.theglobeandmail.com/news/politics/albertas-new-man-in-washington-on-getting-to-yes-for-keystone/article20653432/], consulté le 20 mars 2023.
- Zapata Morán, María Gabriela et Daniel Javier De la Garza Montemayor, 2022 « La paradiplomacia y la protodiplomacia: factores que incidieron en la transformación en Cataluña », CIMEXUS, 17, 1 : 87-105.
Liste des figures
Figure 1
Les concepts de « paradiplomatie », « paradiplomatie identitaire » et de « protodiplomatie » en anglais et en espagnol selon Google book Ngram Viewer
Figure 1
Suite

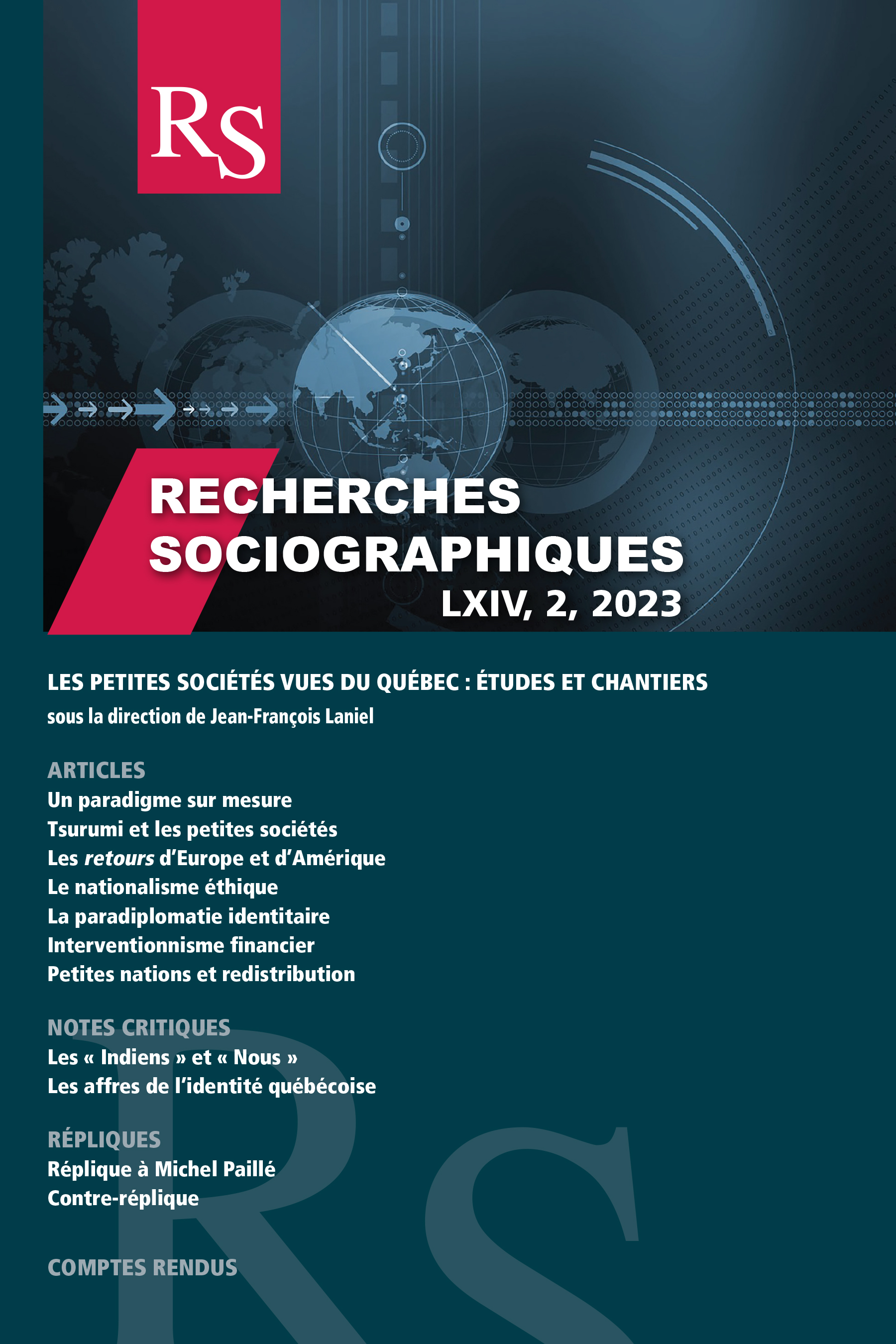


 10.7202/1067654ar
10.7202/1067654ar