Résumés
Résumé
Les expressions « retour d’Europe » et « retour d’Amérique » forment des personnages symboliques propres à l’histoire culturelle du Québec. Conséquence de l’intensification des relations universitaires entre le Québec et le reste du monde durant la première moitié du 20e siècle, elles désignent les étudiants canadiens francophones ayant séjourné sur le continent européen, surtout à Paris, ou encore aux États-Unis, sur ses campus, dans le cadre de voyages d’études, et qui sont par la suite revenus au pays. S’ils s’inscrivent dans l’espace, ces voyageurs lettrés s’inscrivent simultanément dans la culture et la hiérarchie sociale. Immergés dans l’intensité, l’abondance et la puissance – symbolique, culturelle et intellectuelle – des « grandes nations », ces étudiants se sont trouvés pris d’un malaise, sinon d’un vertige. C’est qu’en se mirant dans le miroir rapetissant des grandes villes et des institutions de haute culture, le retour d’Europe ou d’Amérique prend la mesure des lacunes et des insuffisances de sa culture d’appartenance dont la grandeur lui apparaît aussitôt inatteignable, sinon radicalement étrangère. Le choc, ressenti à l’aller comme au retour, se réfracte différemment dans les trajectoires, confinant tantôt au sentiment d’infériorité culturelle, tantôt au dégoût de soi, tantôt au désir de changement et d’amélioration. Dans cet article, nous nous proposons d’explorer les figures – comparables mais non assimilables – du retour d’Europe et du retour d’Amérique en tant qu’elles ont cristallisé, au Québec, un mode d’être au monde qui est caractéristique des nations dites « petites ». Par-delà les expériences singulières qu’ils recouvrent, et dont nous livrons certains exemples, les « retours » s’appréhendent en effet comme des expériences subjectives et concrètes de la marge et de l’excentrement à travers lesquelles s’éprouve la réalité d’un arrimage souvent difficile, sinon parfois conflictuel, de la petite nation avec l’universel.
Mots-clés :
- histoire intellectuelle,
- université,
- migrations savantes,
- petite nation,
- 20e siècle,
- représentation de l’Europe,
- représentation des États-Unis
Abstract
The expressions “return from Europe” and “return from the United States” are tropes in Quebec’s cultural history. A consequence of the intensification of Quebec universities’ relations with those of the rest of the world during the first half of the 20th century, they refer to French-speaking Canadian students who had spent time on campuses in Europe, especially in Paris, or the United States as part of their student travels and who subsequently returned to their homeland. As these literate travelers traversed land and space, they also left their marks on their culture and social hierarchy. Immersed in the intensity, abundance and power—symbolic, cultural and intellectual—of “great nations,” many of these students found themselves gripped by a sense of unease, if not vertigo. Reflecting themselves in the vanishing mirror of major cities and institutions of high culture, those returning from Europe or the United States became conscious of the shortcomings and inadequacies of their own culture, whose grandeur then appeared lackluster or radically foreign. The shock, perceived upon both leaving on and returning from the journey, manifested differently in the trajectories of each individual, leading to a feeling of cultural inferiority for some, to self-loathing for others and to a desire for change and improvement for others still. In this article, we propose to explore the experiences—comparable but not assimilable—of the returns from Europe or the United States insofar as they have crystallized, in Quebec, into a mode of being in the world that is characteristic of so-called small nations. Beyond the singular experiences they encompass, some of which will be described, “returns” can be understood as subjective and concrete experiences of marginality and eccentricity through which the reality of an often difficult, if not conflicting, alignment of the small nation with the universal is experienced.
Keywords:
- intellectual history,
- university,
- scholarly migration,
- small nation,
- 20th century,
- representation of Europe,
- representation of the United States
Corps de l’article
Les expressions « retour d’Europe » et « retour d’Amérique » forment des personnages symboliques propres à l’histoire culturelle du Québec[1]. Conséquence de la consolidation des relations universitaires entre le Québec et le reste du monde durant la première moitié du 20e siècle, elles désignent, dans leur sens concret, les étudiants québécois qui ont séjourné sur le continent européen, surtout à Paris, ou encore aux États-Unis, sur les campus universitaires, dans le cadre de voyages d’études ou de séjours professionnels initiatiques plus ou moins longs, et qui sont par la suite rentrés au pays. Dans le Canada français d’alors, le séjour initiatique en Europe ou en Amérique était la promesse – sinon la condition – d’une « vie agrandie » (Roy citée dans Ricard, 1996, p. 179). Pour tout jeune Canadien français qui entretenait quelque ambition artistique ou intellectuelle, l’exil provisoire était une étape souvent privilégiée[2] dans l’apprentissage du monde et de la vie de l’esprit. C’est dire que s’ils s’inscrivaient dans l’espace, ces voyageurs lettrés s’inscrivaient simultanément dans la culture et la hiérarchie sociale. Pour reprendre les mots d’André Laurendeau, leurs parcours ont défini « une espèce d’homme » (Laurendeau, 1963, p. 3) qui, une fois immergé dans l’intensité, l’abondance et la puissance – symbolique, culturelle et intellectuelle – des « grandes nations », s’est trouvé pris d’une forme de vertige, sinon d’un malaise. Séjourner à Paris en 1920 ou à New York en 1950 n’a en effet rien de banal quand on vient du « petit » Québec français. L’expérience a même quelque chose de déconcertant chez les plus touchés d’entre eux; projeté dans un monde plus vif et plus intense, qui frappe par la beauté de ses monuments anciens, la modernité de ses grandes artères, l’exubérance de ses milieux culturels et la vivacité de ses débats, le Québécois en visite est sujet à un retour sur lui-même, retour vécu tantôt sur le mode de l’exil négatif, où il prend conscience, par effet miroir, de ses lacunes et ses insuffisances, tantôt sur le mode d’un exil formateur et profitable, qui appelle au dépassement et à l’ouverture des possibles. Le choc, ressenti à l’aller comme au retour, se réfracte différemment dans les trajectoires, confinant tantôt au sentiment d’infériorité culturelle et de honte, tantôt au désir de changement et d’amélioration. C’est dire que le voyage extérieur se conjugue avec un profond voyage intérieur, tout aussi dépaysant.
Dans ce texte, nous nous proposons d’explorer les figures – comparables mais non assimilables – du retour d’Europe et du retour d’Amérique en tant qu’elles ont cristallisé, au Québec, un mode d’être au monde qui est emblématique des nations dites « petites ». Bien entendu, l’expérience de la migration vers des pôles culturels plus prestigieux n’est pas exclusif aux petites nations. Elle est un élément structurel du monde de l’éducation occidentale depuis le Moyen Âge (Charle et Verger, 2012). Notre propos consiste plutôt à dire ici que ces expériences migratoires, par le lien qu’elles engagent avec le monde extérieur, mettent en jeu un élément fondamental et existentiel de la réalité des petites nations, à savoir le rapport, toujours en tension et jamais apaisé, qu’elles établissent entre le grand et le petit, l’universel et le particulier, l’hégémonique et le non-hégémonique. Elles révèlent autant qu’elles explorent la condition qui, selon nous, définit la petite nation, à savoir sa « conscience d’être à la marge, non pas la marge de l’exclusion, mais bien celle de l’intégration à un processus dont le ressort principal est senti comme exogène à sa réalité » (Boucher et Thériault, 2005, p. 3). Dit autrement, cette condition s’entend comme celle d’un « monde abrité », c’est-à-dire d’une position à la fois historiquement et géographiquement « à l’abri des grands combats et des grandes décisions de l’Histoire » (Daunais, 2015, p. 18). Cette mise à l’écart suggère un rapport cognitif compliqué à l’universel, qui se joue autant dans l’ordre de la culture que dans celui de la connaissance, où c’est toujours effectivement à l’ombre des grandes traditions savantes, plutôt que dans une adéquation foncière avec celles-ci ou en participant à leur élaboration, que s’est posé l’enjeu de l’acquisition de nos moyens intellectuels et scientifiques. D’où l’équation parfois douloureuse, sinon tendanciellement tragique, du voyage d’études pour qui vient de la périphérie, où l’« on ne peut sortir de soi, se dépasser, que par voie de comparaison avec ce qui est plus grand que soi » (Major, 1996, p. 21). Ainsi, par-delà les expériences singulières que recouvrent les « retours », et dont nous livrerons certains exemples, nous les appréhendons ici comme des expériences subjectives et concrètes de la marge à travers lesquelles s’éprouve la réalité d’un arrimage souvent difficile, sinon conflictuel, de la petite nation avec un modèle de l’universel – tantôt littéraire, tantôt scientifique – qui lui est extérieur et qui postule le défi d’une adaptation et d’une adéquation.
Le « retour d’Europe »
Première figure littéraire « autochtone » créée au Québec (Lacroix, 2014), le retour d’Europe se laisse peut-être saisir au mieux par la célèbre caricature de Berthio, parue en juin 1963 dans les pages de la version québécoise du Magazine Maclean (voir l’image ci-après). On y voit un Québécois qui rentre d’un séjour en France. Coiffé du proverbial béret français, les bras chargés de souvenirs, il descend fièrement l’escalier d’un avion sur lequel est marqué « retour d’Europe ». Un groupe un peu ébahi, en qui il faut voir ses concitoyens ou des membres de sa famille, lui fait face. « Salut, bande de caves! » dit la légende. Figurant parmi les quelques privilégiés qui ont pu goûter la grande culture du Vieux Continent, le voyageur québécois, enivré par ses découvertes, revient vers les siens en les regardant de haut, un peu comme le provincial qui rentre de la capitale. Cette caricature est emblématique des tensions que pouvait susciter, naguère, le séjour européen des Québécois. Ces tensions jouent sur une diversité d’oppositions, entre l’Amérique et l’Europe, d’abord, mais aussi, en fond de scène, entre le centre et la périphérie, l’universel et le particulier, le cosmopolitisme et le nationalisme. Elles sont aussi à la mesure de la distance qui s’installe entre celui qui revient, transformé, et ceux qui, jamais tentés par l’exil ou n’ayant jamais eu la possibilité d’y consentir, pourront ressentir de sa part une forme d’imposture, sinon de trahison.
Figure 1
Le « retour d’Europe » décrit un malaise dont la nature est pour le moins complexe à cerner. Le philosophe Daniel Tanguay le définit comme « une sorte de mal du pays à l’envers ou de nostalgie dont les pôles auraient été inversés » (Tanguay, 1999). Il s’applique à une catégorie spécifique de Québécois en séjour à l’étranger, pour qui l’expérience de l’Europe, loin d’être un délassement, fut plutôt vécue comme une épreuve qui a mis en question, profondément, le rapport à l’identité individuelle et collective. En effet, ce malaise n’affecte pas tous ceux qui font un long séjour en Europe. Ainsi en va-t-il par exemple de l’écologiste et professeur Pierre Dansereau, l’un des étudiants les plus mobiles de sa génération, qui vit son séjour d’étude en Europe avec le sentiment d’une grande curiosité, mais surtout avec la confirmation de son bonheur d’être Nord-Américain. Il s’en confie dans une lettre adressée depuis Paris, au frère Marie-Victorin, en 1936 :
« Dieu me pardonne de n’avoir pas plus que 24 heures éprouvé l’“inferiority complex” commun à tant de Canadiens ici, mais ma foi il y a tant de choses que nous n’avons pas à envier à l’Europe en général et à la France en particulier, que je me crois justifier d’user moi-aussi (sic) de quelque affectation de supériorité. »
Pour Dansereau, la France, avec ses « vieilles maisons », évoquait surtout l’appartenance à un passé révolu alors que « nous avons, nous, un si bel avenir![3] ». Comme quoi « [l]es vieux pays ne collent pas à la peau de certains », souligne à nouveau Tanguay. Car « [p]our que le malaise s’infiltre dans l’âme, elle doit être d’abord touchée ou mordue par son contact avec l’Europe » (Tanguay, 1999).
Pour ceux que cela concerne, le scénario intellectuel classique du retour d’Europe prend la forme d’un double choc culturel. Premier choc : celui, d’abord, du Québec vers Paris, où l’attente d’une communion fraternelle avec l’ancienne mère patrie et la France des racines se heurte à une intégration plus difficile qu’anticipé, à un écart culturel insoupçonné, où le visiteur se trouve toujours renvoyé à son statut d’étranger.
« Tentant de s’imposer en France, [le voyageur québécois] est constamment renvoyé à son provincialisme (à son accent canadien, à ses archaïsmes, à son folklore culturel, à sa faible maîtrise de l’art de la distinction), et il souffre d’habiter une société où il ne peut être reconnu, lui qui ne brille jamais assez aux yeux des Parisiens ».
Lacroix et Warren, 2012, p. 56
Cette souffrance est à la mesure du décalage entre cette France vécue pour la première fois et la France longtemps mythifiée par les romans, les chansons, les contes et les récits historiques. Ce pays mythifié fut, pour plusieurs Canadiens français, tantôt celui de la France « éternelle », avec son catholicisme intransigeant, tantôt celui de la France libérale, source d’émancipation (Savard, 2009, p. 73). Mais dans les deux cas, il s’agissait d’une France rêvée, taillée à la mesure des espoirs de chacun, et pour cela en proie à la réalité d’une rencontre désenchantée. Deuxième choc : celui, ensuite, du retour au Québec, qui apparaît désormais encore plus pauvre, limité et petit en comparaison à la culture supérieurement possédée de la France, dont le souvenir nostalgique devient comme une sorte de refuge mental tant il voudrait revoir chez lui ce qu’il a admiré à l’étranger. Double choc donc, le retour d’Europe s’entend aussi comme une « double défaite » qui, selon Élisabeth Nardout-Lafarge, « prend acte d’une première impossibilité, celle de devenir Européen […]. Et avec le retour coïncide une seconde impossibilité, celle d’implanter de l’Europe au Québec » (Nardout-Lafarge, 2002, p. 136-137).
L’expression a sa genèse, et décrit un phénomène qui remonte loin dans l’histoire du Canada français. Le chercheur Michel Lacroix, qui l’a analysé en profondeur, situe son émergence au tournant du 20e siècle, dans le contexte de transformation des trajectoires scolaires des élites bourgeoises du Québec, plus particulièrement celles qui composent le groupe littéraire des « exotiques » formé de René Chopin, Guy Delahaye, Adrien Hébert, Olivier Maurault, Robert de Roquebrune, Léo-Pol Morin, Marcel Dugas, et d’autres (Lacroix, 2014). C’est par eux que l’expression « retour d’Europe » passera de la simple « dénotation » – pour qui rentrait physiquement d’Europe – à une première « connotation » (Lacroix et Warren, 2012, p. 52). Pourfendeurs du régionalisme littéraire dominant et promoteurs d’une littérature libre et universelle, les exotiques incarnent, dans le Québec des années 1910 et 1920, une nouvelle figure de l’intellectuel critique et autonome, engagée dans un combat contre la figure traditionnelle de l’intellectuel catholique et nationaliste (Lamonde, Bergeron, Lacroix et Livernois, 2015, p. 38-39). Leur discours s’élabore en réaction à l’enfièvrement nationaliste du début du siècle, signalé par les appels à la nationalisation de la littérature (Camille Roy) et la formulation d’une nouvelle doctrine de l’action nationale (Lionel Groulx). Il s’indexe aussi à une première mouture de l’idéologie du rattrapage, liée au libéralisme économique et intellectuel du début du 20e siècle (Lacroix, 2014, p. 254). Pour les exotiques, l’expérience du séjour à Paris, capitale littéraire internationale par excellence et lieu d’inscription dans la grande littérature universelle, revêt une dimension constitutive de leur identité intellectuelle et artistique. Encouragé par la relance des relations universitaires et diplomatiques France-Québec au début du siècle[4], puis facilité par l’institution des bourses d’Europe en 1922 (Gagnon et Goulet, 2020) et les progrès du transport maritime, le pèlerinage parisien devient, pour les exotiques, ce par quoi l’écrivain acquiert sa légitimité, se met au centre du monde, consent à une forme de modernité culturelle et, incidemment, tourne le dos au chauvinisme de la littérature nationale. Plus prosaïquement, il s’agit aussi d’une manière, pour ce groupe, d’intégrer un marché littéraire francophone plus dynamique et stable, dans un contexte où le champ littéraire canadien-français est encore faiblement institutionnalisé et surtout arrimé au développement des écoles et des congrégations religieuses. Bien entendu, les exotiques ne sont pas les premiers à se rendre en France, une destination qui était déjà largement prisée par l’élite cléricale. Ils empruntent toutefois un autre circuit, ce qui leur vaut d’ailleurs l’opprobre d’une partie de l’élite culturelle établie. Loin des couloirs antiques de la Sorbonne et de la France catholique, on les retrouve plutôt dans la bohème du Quartier latin et ses cercles mondains, ses salons, ses cafés et ses conférences (Côté-Fournier, 2010, p. 22-23).
Chez les exotiques, l’acuité du malaise associé aux va-et-vient transatlantiques est à relativiser. Leur expérience de l’Europe demeure globalement positive et exaltante, à contre-jour des contraintes du provincialisme québécois. C’est pourquoi la fréquentation du vieux pays affûtera chez eux surtout une critique élitiste et radicale de la culture canadienne-française. Dans les pages de leur revue, le Nigog, première publication moderniste fondée en 1918, les exotiques en appelleront à la naissance d’une élite cultivée et « libre », détachée des préoccupations exclusivement nationalistes et territoriales du Canada français, capable d’apprécier les fondements esthétiques de l’art indépendamment du sujet traité (Grivel, 2014). Ils adresseront à la littérature du terroir canadienne-française une critique universaliste lui reprochant, par son insistance appuyée sur les sujets canadiens et la morale catholique, de juger de la qualité d’une oeuvre selon des considérations utilitaires, extérieures à l’art. Cette critique débordera aussi sur le mauvais goût des architectes canadiens, sur la médiocrité de certains peintres ou encore sur l’incompétence culturelle de l’élite sociale canadienne-française (Hayward, p. 286). C’est dire que leur complexe d’infériorité vécu à Paris se muera en complexe de supériorité une fois rentré au Québec, double décalage qui trahit une même incertitude du rapport à soi.
Ainsi, dans son sens premier au début du siècle, l’expression « retour d’Europe » émerge dans le complexe discursif de la polémique entre régionalistes et exotiques. Elle prend d’abord les atours d’une insulte, d’une étiquette disqualifiante, employée par ceux qui, comme Jean-Charles Harvey et Alfred DesRochers, critiquent « le snobisme de l’imitation des Parisiens[5] », comme Camille Roy qui les présente comme des « écrivains français égarés sur les rives du Saint-Laurent » (Roy, 1904 [1907], p. 352) ou encore, comme Léo-Paul Desrosiers, pour qui ces « revenus de Paris » ne rapportent « que de nouvelles prétentions, des tics de langage, et des diplômes véreux » (Desrosiers, 1922, dans Rajotte, 2004, p. 32). Les retours d’Europe seront tour à tour dépeints comme des désaxés et des déracinés de la culture québécoise, des esthètes agaçants moins portés à faire du séjour étranger l’occasion d’un rehaussement et d’un enrichissement qu’une voie de sortie, sinon de reniement, de leur culture d’appartenance (Lacroix, 2014, p. 255-256).
D’abord signalée comme un label négatif, symbole d’un rapport élitiste et mimétique à la France, l’expression « retour d’Europe » prendra des contours plus mélancoliques, ambivalents et malaisés, sinon existentiels, chez d’autres figures. C’est le cas d’Édouard Montpetit, premier boursier universitaire officiellement délégué par la province de Québec à Paris, où il séjourne pendant trois ans au début du siècle pour étudier à l’École libre des sciences politiques et au Collège des sciences sociales. Les souvenirs de son séjour dans l’ancienne métropole sont exemplaires des tensions identitaires associées au relais parisien, qui s’accompagne d’une « longue réflexion sur nous-mêmes » (Montpetit, 1928, p. 118). À l’arrivée, l’extase de découvrir le Paris idéalisé par ses lectures de jeunesse laisse place à un réel défi d’acculturation. Le retour d’Europe est d’abord celui qui, en voulant « prendre possession de Paris, de sa lumière et de ses ombres » (Montpetit, 1944, p. 73), constate qu’il doit, pour y arriver, taire ses origines et s’effacer :
Nous sommes en France et non plus loin de la France, nous vivons la vie que nous avons connue à travers les livres, nous lisons la revue et le journal le jour où ils paraissent et non plus vieux de dix ou quinze jours; tout cela est grisant et fort beau, mais tout cela nous oblige aussi à un effort pour ne pas paraître trop étrangers et nous assimiler le plus vite possible au monde nouveau.
[…]
Pour éviter les ennuis auxquels craint d’être en butte l’étranger trop évident, je me donnais des allures de vieux Parisien – sans y arriver, bien entendu.
Montpetit, 1944, p. 66-67 et 71
Le souvenir d’une visite marquante au bourdonnant Quartier latin inspire à un Montpetit conquis cette impression allégorique : « Je participe à l’universelle nervosité et j’apprends, rabroué, à rendre la pareille. » À observer les gens pour « vivre une minute comme si j’étais des leurs » (Ibid., p. 74), il se prend d’engouement, mais la lucidité inquiète du retour n’attend pas de frapper :
Après trois ans d’absence et de douces habitudes, le retour au Canada provoque des impressions complexes. Quelques contacts sont décevants. Les inélégances d’architecture et les pauvretés de langage frappent plus qu’autrefois. On éprouve de la joie à retrouver le pays, ses horizons, le jaillissement des eaux, les interminables plaines crénelées de montagnes – une sorte de joie lente qui serait un réveil. Tout cela s’accompagne de nostalgies qui dorment au fond de l’être, avec des retours parfois aigus. Le remède est de s’entourer des choses que l’on a rapportées, qui évoquent chacun des souvenirs, de se constituer un refuge. Il est surtout dans le travail, dans l’espoir d’être utile et la satisfaction d’entreprendre une tâche.
Montpetit, 1949, p. 7
Dans ce double consentement chez Montpetit, d’abord à renoncer à la grandeur européenne et, ensuite, à accomplir une « tâche » auprès des siens, le journaliste André Laurendeau avait perçu une attitude caractéristique des « meilleurs “retours d’Europe” » (Laurendeau, 1963). Lui-même revenu d’un long séjour initiatique à Paris dans les années trente, où il avait côtoyé des intellectuels comme André Siegfried et Jacques Maritain (Lamonde, 2007), Laurendeau éprouvera, à son tour, une certaine angoisse. Plongé dans l’intensité de la capitale française, il avait lui aussi comparé Paris et Montréal et n’avait pu s’empêcher de « mesurer les lacunes de [sa] propre préparation » (Laurendeau, 1963, p. 3). Comme il l’écrira, le Canadien français en visite « connaît là-bas, ou du moins il frôle, il entrevoit la grande aventure intellectuelle. C’est un alcool qui monte à la tête. C’est très fort pour lui. Ses défenses craquent de toute part » (Ibid.). Le décalage entre la France livresque et la France réelle avait été un choc pour lui également. Dans ses Impressions sur la France (1936), Laurendeau souligne combien ses attentes de sympathie et de solidarité de la mère patrie s’étaient abîmées sur l’indifférence et l’anonymat que suscitait sa présence : « Les Français ne nous connaissent pas beaucoup en général et ne manifestent pas le désir de nous connaître. Il faut comprendre cependant que s’ils ne s’intéressent pas beaucoup à nous, c’est que nous ne sommes pas toujours intéressants » (cité dans Monière, 1983, p. 82-83). À vrai dire, les Français qui l’interpellent ont déjà des idées préconçues sur les Canadiens français, qu’ils voient surtout comme des apôtres de la survivance et du conservatisme. « [L]es uns nous en félicitent, d’autres se moquent un peu de nous » (cité dans Monière, 1983, p. 66) fait-il remarquer en déplorant la difficulté d’engager un réel dialogue au-delà de ces généralités. En même temps, le contact de la nouvelle pensée française non conformiste, en particulier celle de la gauche chrétienne, ouvre chez le jeune Laurendeau de nouveaux horizons intellectuels sur les questions sociale et nationale. Et s’il se love malgré tout aisément, en dilettante, dans la densité intellectuelle parisienne, ce n’est pas sans peine qu’il retrouve le Québec. « Là-bas [en France], j’ai mis quelques semaines à m’adapter superficiellement. Et j’ai mis 4 ou 5 ans au retour à me réadapter » (Laurendeau, 1963, p. 3).
Qu’à cela ne tienne, à la différence des exotiques, dont il avait répudié la « révolte », la « stérilité » et la « perpétuelle nostalgie » (Ibid.), Laurendeau plaidera, en quelque sorte, pour un retour d’Europe réussi[6], exigence qui consistait à faire de l’Europe non plus une part manquante du soi collectif, encore moins un tropisme aliénant, mais plutôt une part intérieure, qu’il s’agissait d’assumer avec la souplesse du coeur et de l’esprit. Dès lors, pour lui, plutôt que de se « livrer avec complaisance à [leur] angoisse », les « meilleurs retours d’Europe » étaient plutôt ceux qui étaient prêts à « s’ajuster […] au milieu où […] restent [leurs] racines », à s’y réconcilier, ceux qui « en acceptant de rentrer chez eux », savent qu’ils « s’amputent d’une partie d’eux-mêmes », sinon qu’ils sacrifient le rêve d’une carrière plus riche et plus gratifiante ailleurs (Laurendeau, 1963, p. 3). Autrement dit, face à la nécessaire dissidence esthétique des retours d’Europe, Laurendeau rappelait l’importance de ne pas céder à la dissidence civique. Aspirer à la grandeur, certes, mais une grandeur qui ne confine pas au rejet de soi et que tempère un réel attachement au pays. Pour reprendre les mots de Jean Larose, qui a longuement médité ce texte de Laurendeau, il s’agissait de savoir concilier l’« amour de la France » et l’« amour du pauvre », avoir « la force de se reconnaître petit et de se faire admiratif ». Par cet acquiescement à l’admiration, dont les motifs lui font trop souvent défaut, le Canadien français en exil pouvait non seulement découvrir la grandeur mais peut-être aussi « un rêve de grandeur pour soi-même et pour les siens ». Selon Larose, assumer de la sorte la petitesse de sa culture faisait de Laurendeau « l’intellectuel canadien-français par excellence » (1998, p. 140).
La leçon de Laurendeau sur l’Europe pourrait être rapprochée de la leçon que Fernand Dumont, lui aussi revenu d’Europe en 1955, livrera à Serge Cantin en 1983. Quelques jours avant son départ pour un séjour d’études en France, Cantin avait reçu une lettre du sociologue lavallois qui, en réponse à une remarque désabusée qu’il avait faite sur l’état du Québec, ce « pays sans bon sens », lui avait rappelé la lourde responsabilité que commanderait son retour de l’exil parisien :
Ce pays, qui n’est pas « sans bon sens », écrivait Dumont, vous aurez à le porter comme on porte un enfant dans ses bras, en tenant la tête haute. Dites-vous bien que, malgré les misères qui nous entourent, vous n’êtes pas le seul (...). Il vous manque peut-être, aux uns et aux autres, une certaine complicité. Créer cette complicité, cette solidarité, ce sera l’une de vos tâches au retour...
Cantin, 1997, p. 36
Cette mise en garde rejoint l’une des grandes idées de Dumont sur la culture et son dédoublement. Aussi nécessaire soit-il, l’éloignement ou le déracinement de la culture première ne doit pas pour autant en commander le reniement. Bien au contraire, le détour par la culture seconde – ici, l’Europe comme horizon – peut induire une saine distance dans la mesure où elle s’assortit, par des médiations construites, d’un retour sur la culture d’appartenance, non pour rompre avec elle, mais pour l’améliorer et l’enrichir. Héritier de la pensée dumontienne, le sociologue Joseph Yvon Thériault, qui avoue lui-même ne pas se reconnaître dans la mauvaise conscience des retours d’Europe (Dorais, Laniel et Thériault, 2020, p. 86), estime lui aussi qu’il y a erreur dans le fait de considérer l’éloignement de la culture première comme une aliénation :
« La capacité de sortir de la culture qui nous est immédiate afin de la modifier, de l’organiser autrement, sans toutefois rompre avec elle, c’est notre capacité, comme société, d’agir sur nous. Si le rapport à l’Europe a été une occasion de prendre une distance par rapport aux déterminations de ce continent, pourquoi donc appeler ça aliénation? ».
Thériault cité dans Robitaille, 2002
Et pourtant, il faut reconnaître que ce pari de la médiation n’a rien d’aisé. Comme le souligne Jean-François Laniel, la problématique moderne de la médiation et de la synthèse entre culture première et culture seconde « ne se trouve peut-être jamais aussi ressentie que chez les intellectuels des petites sociétés » (Laniel, 2013, p. 411). C’est que le dédoublement de la culture y est vécu, en propre, comme un dédoublement de la société elle-même, entre les significations héritées et sécurisantes de la communauté traditionnelle, d’un côté, et les prospections libres et indéterminées qu’engage l’échappée vers l’extérieur, de l’autre (Warren, 2012). Du reste, pour revenir à la mise en garde servie par Dumont à Cantin, c’est aussi dans un rapport à la solidarité de l’intellectuel envers sa communauté d’appartenance que se donne à lire tout le problème existentiel du retour d’Europe.
Le « retour d’Amérique »
Dans l’imaginaire transnational québécois, la figure des retours d’Europe est mieux connue que celle des retours d’Amérique, qui ne s’est jamais formellement établie comme un personnage symbolique de l’histoire culturelle québécoise. L’expression trouve son origine sous la plume de l’économiste Albert Faucher qui, en référence à sa propre formation à l’Université de Toronto, l’évoqua pour une première fois lors de son discours d’intronisation à la Société royale du Canada en 1972 :
À notre retour, nous nous trouvions comme en rupture de tradition. En effet, alors que nos devanciers, pour la plupart, avaient été des « retours d’Europe » que traumatisait la nécessité de travailler, nous étions, nous, des « retours d’Amérique » qu’enthousiasmait l’occasion de travailler. Nous avions pour tempérer notre ardeur le bouillant Père G.-H. Lévesque qui avait fait la synthèse des deux retours : retours d’Europe et retours d’Amérique, puisqu’il avait étudié à Lille et à Ottawa. Je pense que cette innovation « retours d’Amérique » représente une caractéristique à retenir pour l’histoire des Sciences sociales à l’Université Laval : caractéristique de fidélité envers les ancêtres. Nos pères étaient allés dans les « factories » de la Nouvelle-Angleterre, faire le blé dans l’Ouest ou les mines du Klondike; nous avions fait, nous, les universités anglophones. Il en résultait pour l’Université Laval une faculté très consciente et très soucieuse de ses paramètres nord-américains.
Faucher, 1972, p. 13
Ainsi, les retours d’Amérique désignent-ils les étudiants québécois qui, dans les années entourant la Seconde Guerre, décidèrent de partir compléter leur formation universitaire aux États-Unis, souvent avec les encouragements d’une bourse provinciale ou encore de l’une des grandes fondations philanthropiques comme Carnegie et Rockefeller. En cela, ils pointent déjà une première distinction par rapport aux retours d’Europe qui, pour la plupart, étaient des écrivains et des artistes. Ils sont plusieurs dizaines d’étudiants, entre 1940 et 1950, à partir pour les campus américains, en particulier ceux de Harvard, de Chicago et de Cornell, et la majorité reviendra au Québec après des séjours prolongés de quelques années (Gagnon et Goulet, 2011). Il est courant d’attribuer, non sans raison, cette redirection vers les États-Unis aux circonstances exogènes de la guerre, qui ont forcé la mise sur pause momentanée des relations universitaires avec la France. Or, il faut savoir que le nouvel engouement pour le relais américain résulte aussi de facteurs endogènes au milieu culturel et intellectuel québécois.
Voyons-y d’abord l’expression d’un nouveau « consentement » à l’Amérique dans l’imaginaire québécois d’après-guerre, alors que le conflit mondial incite à un rapprochement à la fois militaire, économique et politique avec les États-Unis (Lamonde, 1996). Longtemps tenue en suspicion par le nationalisme traditionaliste canadien-français, l’Amérique acquiert une nouvelle valeur référentielle et stratégique. « De menace, l’Amérique devient peu à peu évidence, épreuve et enfin risque à courir », écrit Pierre Popovic (1991, p. 92). Cette « resignification » de l’Amérique n’est pas étrangère à la défaite française de 1940 qui, vécue comme un « bouleversement intime » (Gallichan, 2005), accentue le sentiment d’un décrochage métropolitain. Ce goût de l’Amérique s’énonce de diverses manières. On le trouve chez le peintre Paul-Émile Borduas qui, déménagé à New York en 1953, voyait dans les États-Unis la condition d’une vue politique universelle et postnationale en phase avec le climat d’après-guerre (Beaulieu, 2019, p. 139). On le trouve également dans la littérature, chez des figures comme Robert Charbonneau (1947) et Jean Lemoyne (1961), pour qui la référence américaine permettait à la fois de penser l’éloignement de la France et l’autonomie nord-américaine de la littérature québécoise. On en trouve aussi un exemple éloquent dans les Reflets d’Amérique d’Édouard Montpetit dont l’américanophilie grandissante (Fabre, 2017) l’amènera à voir dans les États-Unis une nation du progrès qui, face à l’Europe des totalitarismes, était en voie d’incarner la nouvelle figure de l’universel au 20e siècle, susceptible d’inspirer le développement de la société québécoise. Il fallait, écrivait-il, apprendre à « utiliser le progrès américain » tout en gardant le droit de « fortifier [son] attitude française » (Montpetit, 1941, p. 253), autrement dit, savoir « accrocher le char à l’étoile » (Montpetit, 1949, p. 155).
Ce souhait d’une affirmation plus franche du destin américain du Québec se fait sentir jusque dans les universités québécoises qui, au cours des années 1940 et 1950, vont chercher à s’adapter aux conditions nord-américaines de l’enseignement supérieur. Soucieuses de pallier les effets de la crise des années 1930, les autorités universitaires en viendront aussi à considérer que la science pratiquée aux États-Unis, dans la mesure où – et ce n’est pas rien – elle saurait s’accommoder de la foi catholique, pouvait contribuer au mieux-être social et industriel de la société québécoise. Il faut dire que l’accroissement de la réputation des universités américaines était alors à la mesure de leur internationalisation, notamment à la suite de l’accueil favorable qu’elles avaient ménagé à plusieurs savants et intellectuels exilés d’Europe (Loyer, 2005). Cet alignement sur le savoir américain incitera plusieurs facultés, entre autres la jeune faculté des sciences sociales de l’Université Laval, à envoyer des étudiants se former aux États-Unis avant de les embaucher formellement comme professeur au Québec. Ce sera le cas, par exemple, de l’historien Guy Frégault qui séjournera à l’Université Loyola de Chicago de 1940 à 1942 sous la recommandation de Lionel Groulx pour y réaliser son doctorat sous la direction du père Jean Delanglez; du sociologue Jean-Charles Falardeau qui, attiré par le sociologue Everett Hughes, décrochera un doctorat en sociologie à l’Université de Chicago à la même période; de l’historien Marcel Trudel, qui se rendra à Harvard de 1945 à 1947 à titre de visiting professor avant d’être formellement embauché à l’Institut d’histoire de l’Université Laval; de l’historien Michel Brunet, qui séjournera à l’Université Clark à la fin des années 1940 pour y soutenir une thèse en histoire américaine; du sociologue Guy Rocher, qui s’établira à Harvard en 1950 pour compléter un doctorat en sociologie sous la supervision de Talcott Parsons; ou encore de l’anthropologue Marc-Adélard Tremblay qui, de 1950 à 1956, s’initiera à l’anthropologie à Cornell sous le magistère d’Alec Leighton, y prendra la direction d’une équipe anthropologique et réalisera un stage de recherche chez les Navahos. Tous ces étudiants reviendront au Québec pour être embauchés dans les premières cohortes de professeurs laïcs et oeuvrer au développement des universités québécoises.
Michel Lacroix et Jean-Philippe Warren soulignent, à juste titre, qu’à la différence du retour d’Europe, le retour d’Amérique désigne le plus souvent une expérience conçue essentiellement comme « un projet intellectuel […] d’ordre individuel », et « dans l’optique des spécialisations universitaires » (Lacroix et Warren, 2012, p. 61). Cette expérience se vivrait aussi principalement sur un mode positif, sous le signe d’un « optimisme de la connaissance » (Faucher, 1972) pour reprendre encore les mots de Faucher. En témoignent les commentaires, contemporains et rétrospectifs, presque toujours enthousiastes des protagonistes. Dans la correspondance qu’il entretient, depuis les États-Unis, avec Albert Tessier, Marcel Trudel décrit Havard comme « un paradis », dont la dimension et le prestige sont une source d’émerveillement constante : « la bibliothèque contient plus de livres français que Laval. Les affaires y marchent à l’américaine. Cambridge est une ville universitaire charmante. On n’a pas le temps d’assister à tous les concerts gratuits[7] ». Ce séjour lui apporte non seulement la « formation technique[8] » en histoire qui lui manquait, mais il officialise son identification à cette discipline après avoir longtemps aspiré à une carrière d’écrivain. À Trudel, Guy Frégault présentera leur séjour de formation commun aux États-Unis comme l’un des principaux ressorts d’une identité générationnelle. Ce détour salutaire leur avait, déclarera-t-il, « [ouvert] les yeux sur les richesses intellectuelles qui s’étalaient à nos propres portes » et fait prendre conscience de « ce que notre colonialisme moral nous avait jusque-là dissimulé », à savoir « qu’une seule nation ne possède pas le monopole de la vie de l’esprit et qu’il n’est plus indispensable que nos nourritures soient préalablement assimilées par un organisme métropolitain ». Rien de moins. C’est par les États-Unis qu’ils avaient « déposé [leur]s oeillères » et « fait, émerveillés, un tour d’horizon[9] ». Pour sa part, Guy Rocher n’hésite pas à parler de son séjour à Harvard comme d’une « révélation » ou encore d’une « aventure » qui, l’éloignant de sa vocation de militant social et catholique, l’a « ancré dans [sa] vocation d’universitaire ». « Parti avec des préjugés » au sujet du climat joyeusement mondain des universités américaines, il « revenai[t] avec un idéal », celui d’une « orientation intellectuelle disciplinaire en sociologie fondamentale », et avait aussi pour ambition de « hausser le niveau des universités québécoises[10] ». Rocher insiste aussi pour rappeler combien, à la différence des retours d’Europe du début du siècle, ce séjour avait augmenté son capital symbolique dans le milieu universitaire québécois : « Harvard m’avait donné comme un halo [...] Ça avait un prestige, comme si on était passé à travers un rite de passage[11]. » Sentiment partagé par Michel Brunet, dont le séjour à la Clark University de 1947 à 1949 lui ouvre les portes du professorat à l’Université de Montréal, finalité dont il a lui-même conscience, si bien qu’il orchestrera la mise en scène de son propre retour en sollicitant les médias. La parution de la caricature ci-après dans l’édition de La Presse du 18 juin 1949, représentant un Brunet rentrant au pays dans un costume trois-pièces qui rappelle l’esthétique du tailoring américain, signale bien cet élément de distinction du retour d’Amérique dans le marché symbolique encore relativement limité du monde universitaire québécois. Un peu comme pour Rocher, l’expérience des campus américains chez Brunet avait aussi contribué à rehausser le statut de l’université – et de l’universitaire – dans l’équation de la modernisation du Canada français. D’ailleurs, au retour de son séjour américain, il n’hésitera pas à comparer l’universitaire dans la société contemporaine à la figure du bourgeois au 19e siècle[12]. Pour l’historien de l’école de Montréal, les États-Unis avaient affûté son caractère. Il avait pu, là-bas, éprouver plusieurs des caractéristiques qu’il valorise par ailleurs : le volontarisme, l’esprit d’entreprise, l’affirmation de soi et le goût du risque, en usant entre autres de l’anglais (Dorais et Poitras, 2021). Brunet va d’ailleurs écrire sa propre thèse de doctorat dans la langue de Shakespeare (Brunet dans Lamarre, 1993)[13], consentant ainsi à une forme d’acculturation américaine. Bien qu’il représente une barrière linguistique importante, l’anglais demeure malgré tout un « gain » ici : alors que les retours d’Europe se retrouvaient entre deux accents, soupçonnés d’arrogance ou d’inauthenticité, le retour d’Amérique gagne sur tous les fronts : il acquiert l’anglais sans perdre son français.
Figure 2
Pour sa part, Marc-Adélard Tremblay décrit ses six années passées à Cornell comme « une expérience d’apprentissage, mais aussi une confirmation du sentiment d’avoir acquis une certaine maîtrise de la pratique anthropologique ». L’expérience fut, indique-t-il, tout aussi riche sur le plan humain, par son immersion dans le climat multiconfessionnel des campus universitaires : « Nous vivions dans une communauté internationale au département d’anthropologie. Il y avait des étudiants en provenance de sept ou huit pays différents. Le baptême de notre fille aînée, Geneviève, fut un baptême interconfessionnel » (Tremblay, 1995, p. 176; p. 132). Même signal du côté de Gérard Bergeron qui, en rendant compte de son expérience à l’Université Columbia en 1946 dans les pages du journal Notre temps, évoquait avec vive admiration « ce peuple [new yorkais] multiple, multicolore, omniprésent », dont la diversité et l’audace avaient fait de la ville « la capitale [de l’]organisation pacifique » (Bergeron, 1996, p. 1). Quant à Armand Frappier, il se souvient de son séjour au Strong Memorial Hospital de Rochester, à New York, comme d’« une sortie de [sa] coque, au sens physique comme au sens psychologique et intellectuel ». « Tout me ravissait, ajoute-t-il : le nombre des chercheurs, médecins ou non-médecins, intéressés au diagnostic et aux sciences expérimentales, la diversité des travaux de diagnostic et de recherche, ordonnés en vue du soin des patients à l’hôpital » (Frappier, 2009, p. 64).
Ces quelques témoignages attestent de l’expérience largement positive du séjour américain, qui est surtout vécu comme un enrichissement personnel. Il faut dire que les universités françaises du début du 20e siècle n’ont que bien peu de choses à voir avec les universités américaines des années 1940, aussi bien en ce qui concerne le nombre d’étudiants, le nombre de disciplines, l’importance de la recherche que le financement. Forte de son implication dans l’effort de guerre mais aussi de l’appui généreux des réseaux philanthropiques, l’université américaine acquiert au mitan du siècle des moyens, une influence et une puissance d’attraction inégalés qui contribuent à l’affranchir de la norme européenne. Elle souhaite aussi s’éloigner de la vocation traditionnelle de l’université, tournée vers la formation professionnelle et appliquée, pour se consacrer d’abord à l’avancement du savoir à travers l’atteinte d’un meilleur équilibre entre la recherche et l’enseignement, le recrutement de nouveaux professeurs et l’élargissement du corps étudiant aux classes moyennes (Charle et Verger, 2012, p. 106-109). Ainsi, pour les retours d’Amérique, le séjour américain avait quelque chose de nécessairement positif et enrichissant, d’autant que la plupart eurent la chance, une fois de retour au Québec, d’intégrer un milieu universitaire en voie d’expansion et d’y transposer certaines notions acquises. Cet horizon d’attente marque une différence foncière d’avec les exotiques du début du 20e siècle formés à Paris et qui, évoluant dans un champ savant encore relativement peu institutionnalisé, n’ont à peu près pas intégré l’institution universitaire à leur retour.
Du reste, toujours selon Lacroix et Warren, le retour d’Amérique n’aurait pas vraiment engagé de « choc identitaire » ou de « remise en cause » collective à la manière des retours d’Europe. Cette dissemblance dévoilerait le rapport différencié du Québec aux deux destinations : si « les États-Unis sont une image de ce que le Québec pourrait être, […] la France, volontairement ou inconsciemment, incarne ce que le Québec devrait être ». C’est dire que contrairement à la France, les États-Unis tendraient à « l’intellectuel québécois un miroir moins méprisable de soi-même » (Lacroix et Warren, 2012, p. 60-61) favorisant, jusqu’à un certain point, sa plasticité et son ouverture à l’altérité. Constat similaire du côté de Daniel Tanguay, pour qui, « [a]ussi paradoxal que cela puisse paraître notre rapport avec la France est plus problématique que notre rapport avec les États-Unis ». C’est que « [l]a France nous rappelle par son existence même ce que notre être francophone pourrait être s’il était en pleine expansion. Elle est notre mauvaise conscience, puisqu’elle nous empêche de tenir totalement pour une vertu notre pauvreté linguistique et intellectuelle » (Tanguay, 1999). À l’inverse, l’altérisation américaine a quelque chose de sécurisant; elle permet de confirmer la différence culturelle de l’être francophone, sans pour autant nier l’ancrage nord-américain. À cet égard, le récit de voyage de Michel Brunet aux États-Unis est instructif. Il dénote, à plusieurs occasions, une mise à distance, sinon un mépris, de la culture américaine. Par exemple, réagissant aux propos d’une femme rencontrée à New York qui lui faisait remarquer que les Canadiens français étaient réactionnaires parce qu’ils s’entêtaient à demeurer français dans une modernité marchant inéluctablement vers l’anglais, Brunet fait le constat de l’abysse qui le sépare de la « conception de la vie » des Américains : « [C]omme les Romains qui appelaient barbares les autres peuples, ils ne peuvent se faire à l’idée d’une civilisation dualiste en Amérique. Un Canada bilingue est pour eux une impossibilité sinon une absurdité[14]. » Ailleurs, Brunet ne se gêne pas non plus pour critiquer le caractère très relâché des tenues vestimentaires aux États-Unis; la démocratisation trop poussée de son système universitaire; l’hubris matérielle et symbolique de ses grandes villes industrielles; ou encore la laideur des femmes par rapport à celles du Québec (Dorais et Poitras, 2021).
Il n’en reste pas moins que bon nombre des récits de séjours américains présentés ci-haut ont été écrits plusieurs années après les faits. Il s’agit, bien souvent, de reconstitutions a posteriori qui ne sont pas exemptes d’une finalité stratégique : celle d’inscrire la valeur d’une formation supérieure et l’expérience enrichissante de l’étranger dans la trame d’une carrière à succès[15]. Et pourtant, une analyse plus fine et approfondie des expériences effectives de l’Amérique donne à voir qu’elles ont, elles aussi, pu mettre en question le rapport au lieu, à la culture, au statut et à l’identité[16]. Les témoignages abondent aussi sur les chocs d’altérité qu’ont pu y vivre les étudiants québécois. À ce titre, comme l’a bien montré Jules Racine St-Jacques en étudiant la correspondance inédite entre les premiers diplômés de l’École des sciences sociales de l’Université Laval et le père Georges-Henri Lévesque, pendant leurs séjours d’études aux États-Unis au début des années 1940, l’acculturation disciplinaire des retours d’Amérique fut loin d’être aisée (Racine St-Jacques, 2015, p. 290-302). Leur plongée dans la culture disciplinaire américaine les a confrontés à un tout autre univers de pensée, qui entrait en conflit avec leur attachement à la tradition dualiste (catholique et positive) des sciences sociales québécoises. C’est le cas, par exemple, de Maurice Lamontagne qui, en séjour d’études à Harvard, perçoit dans son département d’économique « un vide essentiel, un manque d’âme » où « [l]a mentalité capitaliste y remplace la mentalité sociale : on étudie, non pour améliorer ou réformer une situation anormale, mais pour en tirer le plus d’argent possible[17] » (cité dans Ibid., p. 294). Pour Jean-Charles Falardeau, qui est à l’Université de Chicago au même moment, l’intégration au milieu universitaire américain exige « un inouï réajustement psychologique ». « Mon Père, écrit-il à G.-H. Lévesque, c’est comme si je me trouvais sur une planète nouvelle, en présence d’êtres qui au lieu d’un esprit humain auraient un microscope très précis, mais mécanique et pour qui les notions de valeur et les principes philosophiques ou éthiques seraient des étiquettes sur des fossiles d’un univers inconnu[18] » (Ibid.). Le caractère par trop mécaniste, mathématique, micrométrique, empirique et rationnel de la science sociale américaine apparaît foncièrement antithétique avec la double finalité, normative et positive, des sciences sociales canadiennes-françaises[19]. C’est pourquoi d’ailleurs Falardeau, tout influencé qu’il fût par la sociologie ethnique et moderniste de Chicago, refusera d’adopter pleinement son cadre d’analyse à son retour au Québec en continuant de l’adosser à une éthique des fins supérieures de l’Homme (catholique). En témoigne, par exemple, sa sociologie de la paroisse canadienne-française, qu’il étudiera à l’enseigne de la folk society, mais dans l’optique de sa modernisation et de son adaptation aux réalités du monde urbain afin d’en prévenir la disparition (Laniel, 2021, p. 97-98).
De la même manière, Guy Rocher souligne avoir vécu une « crise intellectuelle » à son arrivée à Harvard, crise qu’il rattache au relativisme culturel du Department of Social Relations dont les enseignements contrastaient avec l’épistémologie catholique de la Faculté des sciences sociales de Laval. L’atmosphère très interdisciplinaire du parcours de formation l’avait amené à prendre des cours de psychanalyse, qui initiaient aux puissances internes de l’inconscient, du refoulé et de l’instinctuel chez l’homme. De même, l’anthropologie sociale, notamment celle qui était enseignée par Clyde Kluckhohn, faisait voir la grande variabilité des cultures et le caractère historiquement et culturellement déterminé des règles de conduite et des valeurs. « Je revins de Harvard passablement ébranlé intellectuellement et spirituellement » (Rocher, 1974, p. 244-245), souligne Rocher, qui nous a confié retracer le début de ses doutes religieux à son séjour aux États-Unis[20].
« J’avais le sentiment que les vérités sur lesquelles je m’étais jusque-là appuyé s’étaient littéralement effritées. En cinq ans, j’avais parcouru un chemin qui me paraissait bien long, depuis les certitudes de l’Action catholique jusqu’au doute presque systématique du relativisme généralisé, en passant par le positivisme comtien et durkheimien ».
Rocher, 1974, p. 245
On voit combien le retour d’Amérique n’échappe pas complètement aux tourments de l’« exil négatif ». Cette difficile acclimatation côtoie aussi la tendance au comparatisme culturel, souvent défavorable, à l’endroit du Québec. Ces comparaisons sont le plus souvent suscitées par les différences de forme et d’étendue des campus américains qui, en particulier au lendemain de la guerre, mettent en évidence un profond décalage avec le Québec. Pour Rocher, « c’est là que m’est apparue notre infériorité, un retard énorme à rattraper dans notre enseignement supérieur universitaire[21] ». Côtoyant des étudiants plus matures et expérimentés, souvent issus de la cohorte des soldats démobilisés, il prit alors conscience de ses propres limites : « Je découvrais que non seulement j’étais ignorant, mais que je ne savais même pas travailler! » La force du choc culturel est à ce point puissante qu’elle instille de profonds doutes sur le retour. Le fait de se retrouver dans une « petite université » comme l’Université de Montréal avait été, pour Rocher, « un motif de grande tristesse », si bien qu’il eut la réelle tentation de rester aux États-Unis (Rocher, 1989, p. 28-29). Même constat chez Frappier : « J’avais devant moi des possibilités de travail dont le contraste avec la misère et la pauvreté de l’Université de Montréal, d’où j’arrivais, m’a bouleversé » (Frappier, 2009, p. 64-65). Du côté de Brunet, la visite des campus universitaires suscite ébahissement et envie. À propos de l’Université de l’Illinois, il écrit dans son journal de voyage : « Un autre endroit superbe. Quelles richesses! Et de toutes sortes! C’est à rendre jaloux. Et jaloux, je suis[22]. » À l’Université Ann Arbor, Michigan : « Toujours la même impression : richesse, force, série d’immeubles les uns plus riches que les autres[23]. » Ici aussi, l’extraordinaire perçu trouve sa contrepartie dans l’insuffisance et les lacunes du Canada français, que Brunet n’hésite pas, dans son journal, à qualifier régulièrement de « pays de fessiés », de « canayens », où l’on ne « sait pas [se] faire connaître et apprécier[24] ». Le cas le plus emblématique est peut-être celui de Pierre Trudeau, qui séjourne à Harvard au milieu des années 1940. « Dès mon arrivée, je dus me rendre compte qu’en matière intellectuelle, je sortais à peine de l’enfance », écrit-il dans ses mémoires (Trudeau, 1993, p. 45). Selon ses biographes, Max et Monique Nemni, c’est à Harvard que Trudeau aurait officialisé sa conversion à l’antinationalisme. La découverte de la grande Amérique, où il recevra entre autres les enseignements d’Heinrich Brüning, de Wassily Leontief et de Joseph Schumpeter, l’incite à s’engager dans la recherche de l’universel (Nemni et Nemni, 2011). Sur cet horizon se dépose le défi de la modernité québécoise et tout particulièrement celui de ses carences. Toujours dans ses mémoires, il ajoute :
Je me rendais compte aussi que le Québec d’alors était marginal, qu’il vivait à l’écart des temps modernes. Le contraste était saisissant entre ma province d’origine et les États-Unis, ce pays frénétique, d’une ardeur extrême, débordant d’énergie et de vitalité. À Harvard, l’ouverture sur le monde était manifeste. On se retrouvait entouré d’intellectuels qui avaient été, leur vie durant, les témoins directs de l’évolution aux quatre coins de la planète. On avait l’impression d’y vivre en symbiose avec les cinq continents. Inutile de dire que cela me changeait complètement du climat quasi paroissial que j’avais connu à Montréal.
Trudeau, 1993, p. 45
De ces nombreux témoignages, il ressort que le retour d’Amérique fait montre d’une diversité dans l’admiration et la critique. S’il n’est pas imperméable aux tourments vécus par les retours d’Europe, sa critique a désormais un sens très précis : elle porte sur les universités, leur richesse, leurs moyens, leur dynamisme et leur capacité de travail alors que la critique des retours d’Europe était plus englobante et moins précise, s’étendant jusqu’aux moeurs et à la manière de vivre. En outre, on voit bien en quoi ces diverses expériences subjectives de l’Amérique aiguisent chez les visiteurs une sorte d’hyperconscience du lieu d’origine, laquelle a pu servir de puissant adjuvant à la critique du « retard du Québec », fil conducteur de la remise en cause du traditionalisme de l’après-guerre. Force est donc de constater que le retour d’Amérique est, lui aussi, emblématique d’une culture qui s’interroge sur elle-même et s’éprouve dans une confrontation à l’écart. Cette distance ménage un espace d’indécision, d’interrogation d’où peuvent surgir les angoisses comme les propositions, les hésitations comme les reconstructions.
⁂
Ainsi renvoyés dos à dos, les retours d’Europe et d’Amérique apparaissent dans leurs similarités et leurs différences. Mais il faut voir, en dernière analyse, que ces figures de l’imaginaire canadien-français jouent les notes d’une même partition, sur laquelle on peut lire certains topos familiers de la petite nation. Bien entendu, cette portée dans l’analyse a ses limites, dans la mesure où l’expérience des « retours » recensés ici demeure systématiquement celle d’hommes lettrés, ce qui pointe la dimension genrée du phénomène à l’étude[25]. Qu’à cela ne tienne, notons que l’on y retrouve d’abord l’expression d’un rapport à la grandeur, personnifiée ici par l’exemplarité incontournable d’un savoir – français ou américain – investi d’un pouvoir de consécration universel à l’ombre duquel les pionniers de notre littérature et de notre science ont trouvé justification, autorité et légitimité. Dans le cas du retour d’Europe, cette grandeur suscite surtout un sentiment trouble, source de fascination et de remise en cause. Pour les retours d’Amérique, au contraire, la grandeur américaine, plus précisément ses capacités universitaires, est puissamment désirée, enviée. Dans un cas comme dans l’autre, il y a ici une injonction classique faite aux cultures de la marge, dont l’aspiration à l’universel s’éprouve souvent sous la forme d’une confrontation à un centre, toujours plus grand que soi et qui, par effet de retour, se double d’un « rappel autoritaire des origines » (Nardout-Lafarge, 2002, p. 137). Ainsi, nos « retours » apparaissent-ils dans l’histoire comme des figures d’incarnation, de modélisation de ce processus où se joue la difficile adéquation entre le particulier de la petitesse et la grandeur de l’universel. Difficulté d’adéquation qui implique, en vérité, la recherche inlassable d’une réconciliation et d’une médiation, pour qui choisit de rentrer au pays, d’y oeuvrer, de s’y réadapter en assumant ses fragilités et ses lacunes. Dans cette intrication toujours tensive du grand et du petit, Jacques Beauchemin perçoit un « foyer » identitaire de la petite nation canadienne-française. Reprise de diverse manière dans la culture, cette tension fait théâtre à une ambivalence constitutive de l’être québécois, entre sa prétention à la grandeur – hier messianique, aujourd’hui moderniste – et le constat de son indépassable petitesse (Beauchemin, 2015, p. 106-111). L’un des grands paris de la Révolution tranquille et, par extension, du mouvement nationaliste, consistera précisément à tenter une réconciliation des pôles de cette tension en érigeant la particularité québécoise en figure de l’universel. Ainsi, à mesure que le Québec allait recouvrer une certaine autonomie du rapport à soi, autant dans le champ scientifique que dans le champ littéraire, la figure des « retours » s’estompera progressivement dans le discours culturel, cette dernière étant davantage associée à l’imaginaire de l’incomplétude, de l’ambivalence et de la « petitesse » du Canada français, qui apparaissait plus ou moins compatible avec les velléités de plénitude et de globalité du Sujet québécois contemporain, lequel aspire désormais à agir par lui-même et pour lui-même. Mais alors, est-ce à dire que le Québec moderne ne vivrait plus à l’étranger les symptômes de la petite nation? Il nous semble que ce qui fut peut-être autrefois la règle serait désormais en voie de devenir l’exception, dans la mesure où le malaise des « retours » suppose l’acquiescement préalable à une forme de fragilité constitutive de l’identité collective. Or, justement, le ralliement d’une part grandissante de la jeunesse québécoise contemporaine à une « postnationalisation sereine », celle d’une « québécité globale franchement assumée et dégagée de ses traits de québécitude », pour reprendre les mots de Jocelyn Létourneau (2020, p. 293), répond d’une modalité sans doute plus souple, certainement moins inquiète, du processus d’ouverture sur le monde. Il faudrait aussi signaler, à ce compte, les mutations profondes du rapport des Québécois aux références française et américaine. Alors que la première pâtit d’une critique de plus en plus appuyée pour son modèle de laïcité républicaine incompatible avec la réalité pluraliste nord-américaine (Bédard, 2016), la seconde gagne en importance ce qu’elle perd en altérité, jusqu’à s’établir de plus en plus, aujourd’hui, au coeur de notre existence (Belisle, 2020).
En seconde instance, la figure des « retours » nous semble pointer une réflexion sur le rapport à l’éducation dans l’histoire des petites nations. Au Québec, l’élévation et le dépaysement associés à l’accession au savoir supérieur furent longtemps vécus comme une échappée, souvent douloureuse, hors de la culture d’appartenance. « S’instruire, c’était parler enfin et briser le silence comme une glace qu’on fend pour boire à l’eau de la rivière; c’était du même coup s’expatrier dans l’abstraction des pensées théoriques et se chasser toujours plus loin du “pays réel”. Le devoir d’instruction portait à faux du devoir de solidarité », souligne Jean-Philippe Warren (2012) au sujet des déchirements que pouvait provoquer l’accès au savoir chez les intellectuels canadiens-français d’avant 1960. L’expérience des relais étrangers, de Paris à Chicago, où le sentiment de l’exil était redoublé, est nécessairement venue accentuer cette impression. Bien entendu, il y a ici une expérience commune à nombre de parcours de scolarisation, et peut-être surtout dans le contexte des sociétés au passé colonial, où le séjour en métropole et dans les hauts lieux de savoir des grands centres mondiaux de la culture fut « une étape obligée » de l’éducation coloniale en même temps qu’un « facteur important de mobilité sociale » (Nardout-Lafarge, 2002, p. 134-135; Garnier, 2012).
Seulement voilà, dans le cas du Québec, on voit combien la rupture induite par l’éducation s’est traduite en enjeu collectif. À ce compte, l’« exil intérieur » des retours d’Europe et, dans une certaine mesure, des retours d’Amérique, pourrait être mis en relation avec d’autres parcours d’éducation qui, ensemble, dessineraient quelque chose comme une diagonale culturelle de la petite nation. Spontanément, il nous vient en tête l’exemple du « récit d’émigration » chez Fernand Dumont, formule qu’il reprendra dans le titre de son autobiographie et qui désigne cette longue traversée depuis sa culture d’origine, dans l’innocence des milieux populaires de Montmorency, vers la culture savante de la « Cité scolaire ». Cette mobilité, Dumont l’aura vécue comme une « expérience radicale de l’exil » (Dumont, 1974, p. 255) qu’il apparentait d’ailleurs au déracinement des migrations humaines :
« Ceux qui ont abandonné leur pays pour s’intégrer dans une autre contrée n’oublient jamais le déchirement de l’identité qui s’ensuivit; quitter la culture du peuple pour une autre entraîne une tragédie analogue […] toujours il m’a semblé que j’abandonnais en route quelques questions essentielles, que mon devoir était de ne pas laisser oublier ce que le savoir veut laisser à l’ombre sous prétexte d’éclairer le monde ».
Dumont, 1997, p. 11-12
Cette blessure inaugurale et ces remords, Dumont les transmutera en théorie de la culture, qui loge au coeur de son oeuvre. Cette théorie se fonde, précisément, sur l’idée d’une césure entre, d’un côté, un rapport au monde fait de relations de proximité et, de l’autre, de mise à distance de ce monde par les représentations. Comme le souligne à nouveau Serge Cantin, après Micheline Cambron, il y a bien « un trait spécifique du discours culturel québécois » (Cantin, 2008, p. XXV) dans cette inclination à faire de l’expérience intime de l’exil le lieu d’élaboration d’un savoir universel sur la culture en modernité :
Alors que, ni dans le discours culturel français ni dans le discours culturel américain, la disjonction de la parole, “l’accès d’un discours singulier à l’ordre de la distance” ne représenterait […] un enjeu collectif, le discours culturel québécois (tel qu’il se donne à lire ou à entendre, par exemple, chez Gaston Miron, Michel Tremblay ou Réjean Ducharme) aurait, quant à lui, trouvé son lieu d’ancrage dans cette disjonction même, dans la douleur de la parole, une douleur qui constitue à la fois l’objet et le moteur de l’écriture.
Cambron, 1989 dans Cantin, 2008, p. XXVI
Ce travail de transmutation explicite de la douleur personnelle de l’émigration dans les finalités de la recherche intellectuelle n’a rien de banal. Il est en lui-même exemplaire, ce nous semble, de la dimension existentielle et axiale que l’ennoblissement par l’éducation pouvait représenter chez un jeune intellectuel canadien-français des années 1950.
À travers ces récits d’éducation, ceux des « retours » et du « récit d’émigration » dumontien, se révèle peut-être une trame propre à l’histoire culturelle québécoise qui rend compte de la difficile élévation à la dignité de la culture et de l’histoire chez les petites nations. Le chemin de la connaissance s’y pose souvent comme un problème existentiel, où la culture est en proie à un divorce d’avec elle-même (et à la tâche conséquente d’une réconciliation).
Parties annexes
Note biographique
François-Olivier Dorais est professeur agrégé à l’Université du Québec à Chicoutimi où il enseigne l’histoire du Québec et du Canada aux 19e et 20e siècles, l’histoire régionale et l’épistémologie historienne. Ses recherches se partagent entre l’histoire culturelle et intellectuelle au Québec, l’historiographie, l’histoire de la culture savante et l’histoire des francophonies minoritaires au Canada. Récemment, il a fait paraître sa seconde monographie intitulée L’école historique de Québec. Une histoire intellectuelle (Boréal, 2022). Il a également codirigé l’ouvrage Profession historienne? Les femmes dans la production et la diffusion du savoir historique au Canada français, XIXe-XXe siècles (Presses de l’Université Laval, 2023). M. Dorais est aussi codirecteur de la collection « Fabrique d’histoire » aux Presses de l’Université Laval.
Notes
-
[1]
Nous tenons à remercier chaleureusement le directeur de ce numéro thématique, Jean-François Laniel, de même que les deux évaluateurs anonymes de la revue pour leur précieux conseils et commentaires sur une version antérieure de ce texte. Merci aussi à Pascal Couderc pour son minutieux travail de révision linguistique. Nos remerciements vont également au Fonds de recherche du Québec – Société et culture pour son soutien financier.
-
[2]
Bien entendu, le détour européen n’était pas une condition sine qua non pour l’accès à la vie des idées. Une proportion importante des écrivains et artistes canadiens-français ne font pas de tels séjours ou alors le font très tard dans leur carrière (p. ex. : Gaston Miron), ce qui ne les empêche pas de mener des trajectoires très réussies.
-
[3]
« Lettre de Pierre Dansereau au frère Marie-Victorin, 31 octobre 1936 », Université du Québec à Montréal, Fonds d’archives Pierre Dansereau 022P/dossier 030,01/3605; « Lettre de Marcel Trudel à Lilianne Frégault, 20 octobre 1988 », AUO, Fonds 305/boîte 42376/dossier « Frégault, Lilianne : correspondance, 1988-1991 ».
-
[4]
Divers événements concourent à une intensification de ces relations au tournant du siècle : la présence du Québec à l’Exposition universelle de Paris en 1900; les lois Combes de 1903 et 1904; le Congrès eucharistique international de Montréal de 1910; l’activisme d’Hector Fabre, représentant du Québec et du Canada en France depuis 1882; et la Première Guerre mondiale, dont la crise de la conscription fragilise la double allégeance britannico-française des Canadiens français (Lamonde, 2004, p. 230).
-
[5]
Jean-Charles Harvey cité dans Simone Routier, « La ferveur d’une débutante en poésie. Correspondance 1929 à 1941 », Écrits du Canada français, vol. 44-45, 1982, p. 252, cité dans Rajotte (2004, p. 32).
-
[6]
Nous empruntons la formule au sociologue Joseph Yvon Thériault (2003).
-
[7]
« Lettre de Marcel Trudel à Albert Tessier, 27 décembre 1945 », ASTR/Fonds Albert Tessier/cote 0014-P2-149.
-
[8]
« Lettre de Marcel Trudel à Lilianne Frégault, 20 octobre 1988 », AUO, Fonds 305/boîte 42376/dossier « Frégault, Lilianne : correspondance, 1988-1991 ».
-
[9]
Guy Frégault, « Discours d’intronisation de Marcel Trudel à l’Académie canadienne-française », 1953, Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Guy-Frégault P168, 52, 15.
-
[10]
Citations tirées de Rocher (1989, chap. 2) et d’un entretien que nous avons réalisé avec Guy Rocher le 5 mars 2020.
-
[11]
Entretien avec Guy Rocher, 5 mars 2020.
-
[12]
Notes manuscrites de Michel Brunet citées dans Lamarre, 1993, p. 399.
-
[13]
Il s’agit d’une thèse assez classique d’histoire politique portant sur la Convention constitutionnelle du Massachusetts de 1853, dont les archives étaient entreposées à proximité de l’Université Clark (Brunet, 1949, p. XXII).
-
[14]
Archives de l’Université de Montréal, Fonds Michel Brunet, P136/J2.22, « Journal de tournée américaine – du 24 avril au 16 mai 1949 ».
-
[15]
Sur la dimension stratégique de la mise en récit des excursions intellectuelles de Canadiens français à l’étranger, voir notamment Rajotte (2004).
-
[16]
D’ailleurs, Laurendeau lui-même soulignait, dans son célèbre article de 1963, que les campus américains pouvaient potentiellement générer un phénomène apparenté au retour d’Europe : « Dans ces grandes villes de haute culture – et j’imagine qu’un séjour dans certaines universités américaines provoque les mêmes réactions – vous vous sentez d’abord un petit provincial. Les exigences et les barèmes changent. Mis au pied du mur vous mesurez les lacunes de votre propre préparation » (Laurendeau, 1963, p. 3).
-
[17]
DGDAAUL, Fonds Georges-Henri Lévesque, P151/D/11 « Correspondance générale - Lamontagne, Maurice », Maurice Lamontagne à Georges-Henri Lévesque, 10 janvier 1942, cité dans Racine St-Jacques (2015, p. 294).
-
[18]
DGDAAUL, Fonds GHL, Jean-Charles Falardeau à Georges-Henri Lévesque, 17 octobre 1941, cité dans Racine St-Jacques (2015, p. 294).
-
[19]
Sur le dualisme scientifique de la sociologie québécoise, voir Warren (2003).
-
[20]
Entretien avec Guy Rocher, 5 mars 2020.
-
[21]
Ibid.
-
[22]
Archives de l’Université de Montréal (AUDM), Fonds Michel Brunet P136/J 1,5, Michel Brunet à Berthe Brunet, 13 mai 1949.
-
[23]
AUDM, Fonds Michel Brunet P136/J 2,22, Journal de tournée américaine de Michel Brunet - du 24 avril au 16 mai 1949.
-
[24]
AUDM, Fonds Michel Brunet P136/J 1,5, Michel Brunet à Berthe Brunet, 12 mai 1949.
-
[25]
L’absence relative de voix féminines dans les trajectoires des retours a bien sûr à voir avec le contexte historique étudié, où l’accès à l’éducation supérieure était encore largement le fait des jeunes hommes. Elle tient aussi à la rareté des archives disponibles pour les quelques femmes qui ont séjourné aux États-Unis durant la période qui nous intéresse (nous pensons ici, par exemple, à Marie-Ange Nichols, Ernestine Pineault-Léveillé et Shirley C. Block, qui ont réalisé des stages d’études en psychologie aux États-Unis durant la guerre, mais qui n’ont laissé aucun témoignage de ces séjours). Cela étant, dans le cadre d’une étude plus poussée sur le phénomène, il nous semblerait pertinent de s’intéresser aux rôles des épouses qui, bien souvent, accompagnaient leurs maris durant leur séjour américain et y accomplissaient diverses fonctions essentielles à son bon déroulement. Pensons notamment ici à Suzanne Cloutier-Rocher, qui a suivi Guy Rocher à Harvard durant une partie de son séjour et lui a apporté un soutien dans la réussite de ses cours, ou encore à Jacqueline Cyr, conjointe de l’anthropologue Marc-Adélard Tremblay, qui l’assistera durant ses recherches doctorales à l’Université Cornell.
Bibliographie
- Beauchemin, Jacques, 2015 La souveraineté en héritage, Montréal, Boréal.
- Beaulieu, Étienne, 2019 La pomme et l’étoile, Québec, Groupe Nota bene (Coll. Art).
- Bédard, Éric, 2016 « La réaction en héritage? Représentation de la France chez les intellectuels québécois depuis les années 1960 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, I, 129 : 13-25.
- Bélisle, Mathieu, 2020 L’empire invisible. Essai sur la métamorphose de l’Amérique, Montréal, Leméac. (Coll. Phares)
- Bergeron, Gérard, 1946 « Le corps à l’âme de New York », Notre temps, 14 septembre, p. 1.
- Boucher, Jacques L. et Joseph Yvon Thériault, 2005 « Présentation », dans : Jacques L. Boucher et Joseph-Yvon Thériault (dir.), Petites sociétés et minorités nationales. Enjeux politiques et perspectives comparées, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 1-7.
- Brunet, Michel, 1949 The Massachusetts Constitutional Convention of 1853, Thèse de doctorat d’histoire, Université Clark, Worcester, Massachusetts.
- Cambron, Micheline, 1989 Une société, un récit. Discours culturel au Québec (1967-1976), Montréal, L’Hexagone.
- Cantin, Serge, 1997 Ce pays comme un enfant, Montréal, Hexagone.
- Cantin, Serge, 2008 « Introduction générale », dans : Oeuvres complètes de Fernand Dumont. Tome 1. Philosophie et sciences de la culture I, Québec, Presses de l’Université Laval, p. XIX-XXXIII.
- Charbonneau, Robert, 1947 La France et nous. Journal d’une querelle, Montréal, Éditions de l’Arbre.
- Charle, Christophe et Jacques Verger, 2012 Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France.(Coll. Quadrige)
- Côté-Fournier, Laurence, 2010 Les poètes exotiques : du pluriel au singulier, mémoire de maîtrise (littérature française), Université McGill.
- Daunais, Isabelle, 2015 Le roman sans aventure, Montréal, Boréal.
- Desrosiers, Léo-Paul, 1922 Âmes et paysages, Montréal, Éditions du Devoir.
- Dorais, François-Olivier et Daniel Poitras, 2021 « Regards sur l’Amérique. Le séjour d’études de Michel Brunet aux États-Unis (1947-1949) », conférence Midi-CIEQ.
- Dorais, François-Olivier, Jean-François Laniel et Joseph Yvon Thériault, 2020 L’autre moitié de la modernité. Conversations avec Joseph Yvon Thériault, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Dumont, Fernand, 1974 « Itinéraire sociologique », Recherches sociographiques, XXV, 2-3, 1974 : 255-261.
- Dumont, Fernand, 1997 Récit d’une émigration. Mémoires, Montréal, Boréal., Fabre, Gérard
- Fabre, Gérard, 2017 « La tentation américaine d’Édouard Montpetit », Histoire, Économie & Société, 4 : 54-71.
- Faucher, Albert, 1972 « Allocution prononcée le 4 novembre 1972 à l’Université Laval », Ottawa, Société royale du Canada, Section des lettres et sciences humaines, p. 13-18.
- Frappier, Armand, 2009 Un rêve, une lutte. Autobiographie, Montréal, Presses de l’Université du Québec.
- Gagnon, Robert et Denis Goulet, 2011 « Les “boursiers d’Europe”, 1920-1959. La formation d’une élite scientifique au Québec », Bulletin d’histoire politique, XX, 1 : 60-71.
- Gagnon, Robert et Denis Goulet, 2020 La formation d’une élite. Les bourses d’études à l’étranger du gouvernement québécois (1920-1959), Montréal, Boréal.
- Gallichan, Gilles, 2005 « Le “bouleversement intime”. Le Québec et la France vaincue de juin 1940 », Les Cahiers des dix, 59 : 239-283.
- Garnier, Xavier, 2012 « Intellectuels africains en exil à Paris : un paradoxe colonial », dans : Xavier Garnier et Jean-Philippe Warren (dir.), Écrivains francophones en exil à Paris. Entre cosmopolitisme et marginalité, Paris, Karthala, p. 109-124. (Coll. Lettres du Sud)
- Grivel, Marie-Hélène, 2014 « Être “exotique” dans l’entre-deux-guerres : l’exemple de Robert de Roquebrune », Les Cahiers du GRELCEF, 6 : 213-234.
- Hayward, Annette, 2006 La querelle du régionalisme au Québec (1904-1931) : vers l’autonomisation de la littérature québécoise, Ottawa, Le Nordir.
- Lacroix, Michel, 2014 L’invention du retour d’Europe. Réseaux transatlantiques et transferts culturels au début du XXe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval. (Coll. Cultures québécoises)
- Lacroix, Michel et Jean-Philippe Warren, 2012 « Le “retour d’Europe”, figure autochtone d’un exilé intérieur », dans : Xavier Garnier et Jean-Philippe Warren (dir.), Écrivains francophones en exil à Paris. Entre cosmopolitisme et marginalité, Paris, Karthala, p. 49-66.
- Lamarre, Jean, 1993 Le devenir de la nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy Frégault et Michel Brunet, 1944-1969, Québec, Septentrion.
- Lamonde, Yvan, 1996 Ni avec eux ni sans eux : le Québec et les États-Unis, Montréal, Nuit blanche éditeur.
- Lamonde, Yvan, 2004 Histoire sociale des idées au Québec (1896-1929), volume 2, Montréal, Fides.
- Lamonde, Yvan, 2007 « André Laurendeau en Europe (1935-1937) : la recherche d’un nouvel ordre », Les Cahiers des dix, 61 : 215-251.
- Lamonde, Yvan, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois, 2015 Les intellectuels au Québec. Une brève histoire, Montréal, Del Busso éditeur.
- Laniel, Jean-François, 2013 « Petites sociétés, élite intellectuelle et “tradition vivante” : contribution à une sociologie des petites sociétés », dans : Mihaï Dinu Gheorghiu et Paul Arnault (dir.), Les sciences sociales et leurs publics : engagements et distanciations, Iasi (Roumanie), Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, p. 423-446.
- Laniel, Jean-François, 2021 « Le dualisme de la sociologie québécoise : besoins, aspirations, tendances et sociétés globales chez Simon Langlois », dans : Sylvie Lacombe (dir.), Les bonnes raisons sociologiques. Autour de l’oeuvre de Simon Langlois, Québec, Presses de l’Université Laval.
- Larose, Jean, 1998 L’amour du pauvre, Montréal, Boréal.
- Laurendeau, André, 1963 « Il y a l’Europe du plaisir ou celle, vécue comme un malaise des “retours d’Europe” », Le magazine Maclean, 3, 6, 1963, p. 3.
- LeMoyne, Jean, 1961 Convergences, Montréal, Éditions HMH.
- Létourneau, Jocelyn, 2020 La Condition québécoise. Une histoire dépaysante, Québec, Septentrion.
- Loyer, Emmanuelle, 2005 Paris à New York. Intellectuels et artistes français en exil, 1940-1947, Paris, Grasset.
- Major, Robert, 1996 « La création dans les marges francophones », Liaison, 85 : 19-23.
- Monière, Denis, 1983 André Laurendeauet le destin d’un peuple, Montréal, Québec/Amérique.
- Montpetit, Édouard, 1928 « Impressions », Revue trimestrielle canadienne, 15 : 113-130.
- Montpetit, Édouard, 1941 Reflets d’Amérique, Montréal, Éditions Bernard Valiquette.
- Montpetit, Édouard, 1944 Souvenirs. Tome I. Vers la vie, Montréal, Éditions de l’Arbre.
- Montpetit, Édouard, 1949 Souvenirs. Tome II. Vous avez la parole, Les Éditions Chanteclerc.
- Nardout-Lafarge, Élisabeth, 2002 « Usages de l’Europe chez André Laurendeau et Jean Le Moyne », dans : Jean-Paul Duffier et Alessandra Ferraro (dir.), L’Europe de la culture québécoise, Udine, Forum, p. 133-145.
- Nemni, Max et Monique, 2011 Trudeau, fils du Québec, père du Canada. Tome 2 - La formation d’un homme d’État, 1944-1965, Montréal, Éditions de l’homme.
- Popovic, Pierre, 1991 « Retour d’Amérique », Études françaises, XXVII, 1 : 87-102.
- Racine St-Jacques, Jules, 2015 L’engagement du père Georges-Henri Lévesque dans la modernité canadienne-française, 1932-1962. Contribution à l’histoire intellectuelle du catholicisme et de la modernité au Canada français, thèse de doctorat (histoire), Université Laval.
- Rajotte, Pierre, 2004 « Stratégies d’écrivains québécois de l’entre-deux-guerres : séjours et rencontres en France », Études littéraires, 36, 2 : 31-50,
- Ricard, François, 1996 Gabrielle Roy. Une vie, Montréal, Boréal.
- Robitaille, Antoine, 2022 « L’aire des idées - Les impasses de l’idéologie de l’américanité », Le Devoir, 8 juin.
- Rocher, Guy, 1974 « Itinéraires sociologiques », Recherches sociographiques, XV, 2-3 : 243-248.
- Rocher, Guy, 1989 Entre les rêves et l’histoire. Entretiens avec Georges Khal, Montréal, VLB Éditeur.
- Roy, Camille, 1907 « La nationalisation de la littérature canadienne (1904) », dans Essais sur la littérature canadienne, Librairie Garneau, p. 345-376.
- Savard, Pierre, 2009 Entre France rêvée et France vécue. Douze regards sur les relations franco-canadiennes aux XIXe et XXe siècles, Québec, Éditions Nota bene.
- Tanguay, Daniel, 1999 « Un retour d’Europe », Argument, I, 2. [http://www.revueargument.ca/article/1999-03-01/83-un-retour-deurope.html], consulté le 27 octobre 2022.
- Thériault, Joseph Yvon, 2003 « Le désir d’être grand », Argument, V, 2. [http://www.revueargument.ca/article/2003-03-01/225-le-desir-detre-grand.html], consulté le 27 octobre 2022.
- Tremblay, Marc-Adélard, 1995 L’anthropologie dans la peau. Trente heures d’entretiens empathiques illustrant les ressorts intérieurs et relationnels qui mènent à la connaissance scientifique et à la création (non publié).
- Trudeau, Pierre Elliott, 1993 Mémoires politiques, Montréal, Le Jour éditeur.
- Warren, Jean-Philippe, 2003 L’engagement sociologique. La tradition sociologique du Québec francophone (1886-1955), Montréal, Boréal.
- Warren, Jean-Philippe, 2012 « Culture première, culture seconde », L’Agora, 1er avril. [http://agora.qc.ca/documents/culture-premiere-culture-seconde], consulté le 27 octobre 2022.
Liste des figures
Figure 1
Figure 2

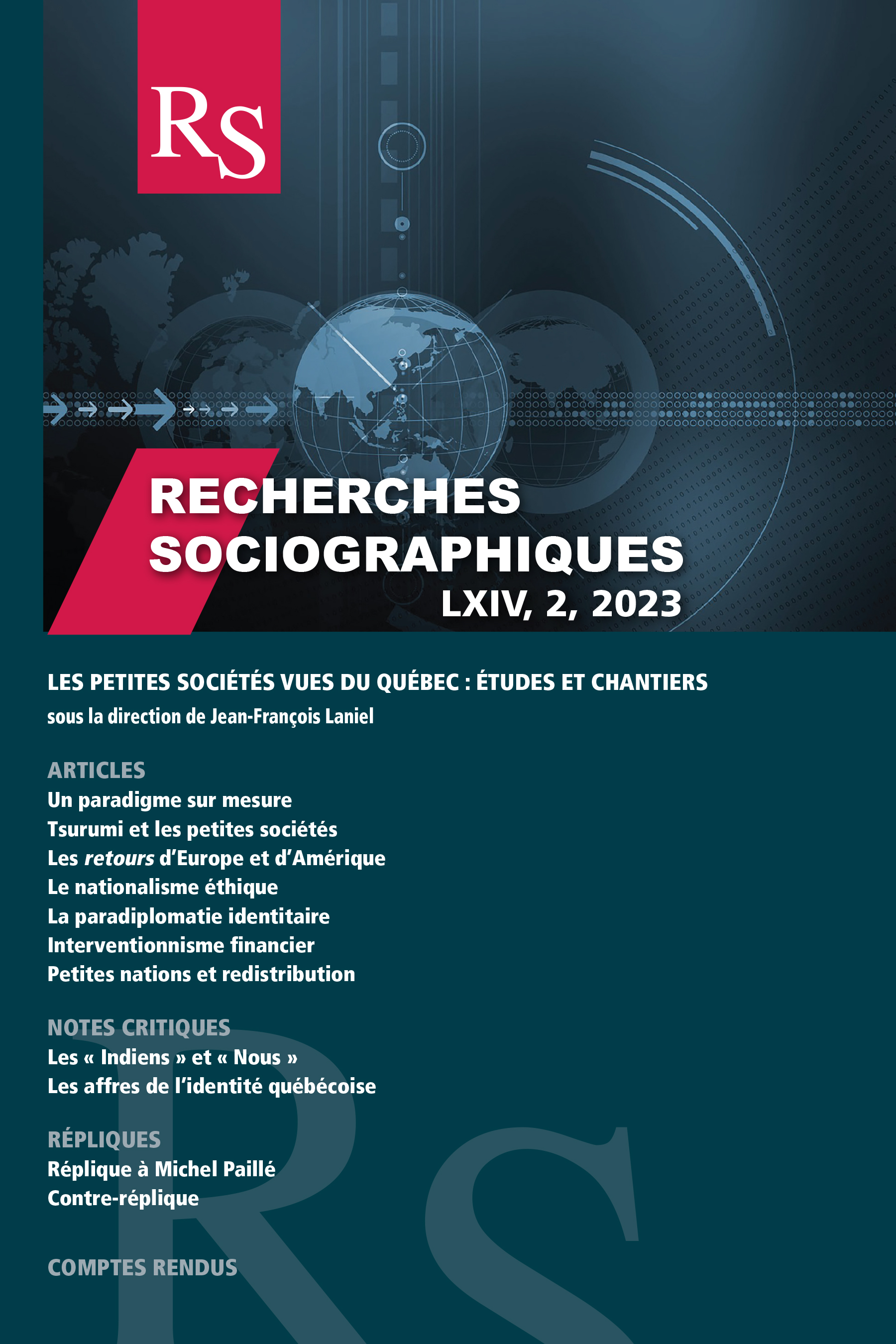


 10.7202/1055963ar
10.7202/1055963ar