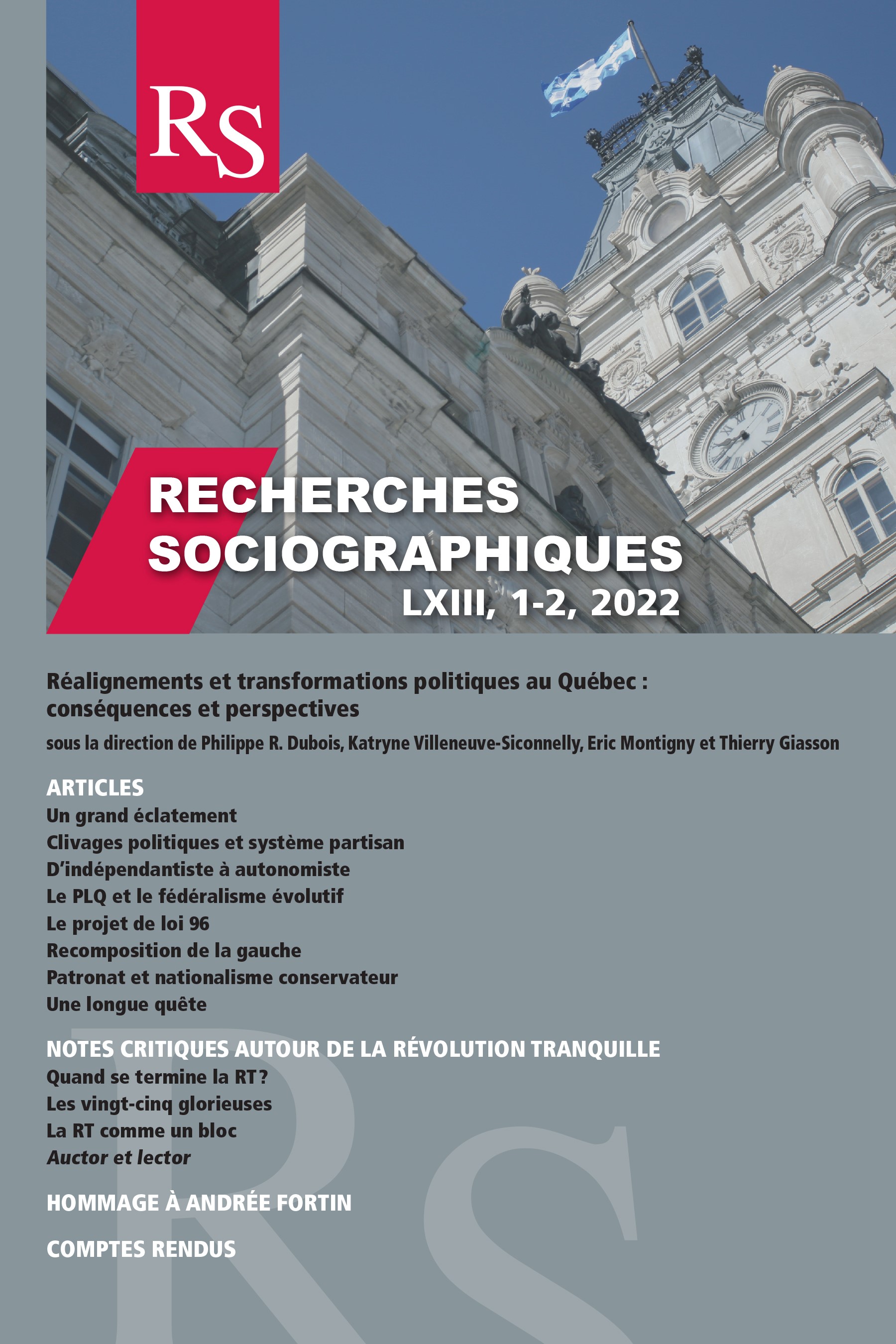L’événement de la publication de la correspondance privée de personnalités publiques est un type particulier d’acte politique. C’est aussi un genre littéraire spécial. Une adresse directe à un intime sous la forme d’une lettre suppose qu’il n’y a pas d’autre public implicite. Les auteurs des lettres n’imaginent pas un autre destinataire, mais souvent ils imaginent comment les autres pourraient les voir. La correspondance privée, c’est un peu comme se regarder dans un miroir. Vous vous regardez et imaginez comment votre interlocuteur pourrait vous imaginer. Dans la correspondance privée, les deux auteurs s’inquiètent souvent de la façon dont un démos ou un peuple tout entier pourrait percevoir ses défauts et ses allées et venues. Mais ils sont aussi engagés dans un délicat échange d’opinions et de sentiments. Quand quelqu’un de l’extérieur entre dans cette intimité, quand les lettres deviennent publiques, le destinataire impliqué est transformé. La correspondance prend alors la forme d’un antagonisme entre adversaires qui pourraient enquêter sur les détails de leur intimité comme quelque chose qui aide à expliquer la différence entre leurs deux visions du monde. Ce livre propose de présenter la correspondance entre deux meilleurs amis, l’un, un socialiste qui était aussi un important militant et un écrivain qui s'est battu pour l'indépendance du Québec, et l’autre, un libéral qui allait devenir le principal opposant à l’indépendance du Québec. L’écrivain et syndicaliste Pierre Vadeboncoeur et Pierre Elliot Trudeau auraient été inséparables de l’école primaire jusqu’à leurs années au collège classique et au-delà. Ils ont commencé leurs études en droit à l’université de Montréal en 1940. La correspondance couvre la période de 1942 à 1995. Il y a certains éléments dont l’absence semble étrange dans les 218 pages que compte cette collection de lettres qu’accompagnent une douzaine de photographies de la période. L’ouvrage comprend une longue introduction de Jean-François Nadeau, et des notes philologiques éparses de Jonathan Livernois permettent de situer les noms d’époque. Il est d’abord étrange qu’aucune lettre ne mentionne la Seconde Guerre mondiale. Comment deux intellectuels fraîchement sortis de l’école de droit et qui aiment la politique nationale et internationale, la philosophie classique, la littérature, l’art et la justice sociale pourraient-ils ne pas dire un mot sur la Seconde Guerre mondiale? D’autres lettres ont-elles simplement été perdues, comme le dit Nadeau? Se pourrait-il que certaines aient été intentionnellement exclues quelque part dans la chaîne de transmission? Peut-être est-il compréhensible que la lutte contre la conscription ait été perdue et que la plupart des intellectuels québécois de l’époque se soient sentis indifférents à la guerre. Mais comment expliquer qu’aucune de ces lettres n’en fasse mention entre 1946 et 1960? L’impression que j’en retire est que les deux épistoliers avaient une conception si abstraite et si élitiste de ce qui comptait en art et en politique qu’ils considéraient les événements en Europe comme une distraction banale qui ne valait pas la peine d’être commentée. Le principal problème est que la grande majorité de plus d’une centaine de lettres proviennent de Pierre Vadeboncoeur (PV). Seulement une quinzaine sont de Pierre E. Trudeau (PT). Le Cabinet du premier ministre conserve des archives minutieuses. L’organisateur syndical et écrivain n’avait quant à lui ni d’entourage ni d’infrastructure de secrétariat comparables à ceux d’un premier ministre canadien. Toutes les lettres de PV dans les archives du Premier ministre ont été mises à la disposition d’Alain Vadeboncoeur qui a effectué la fouille. Nous ne savons pas quelles lettres de l’un ou de l’autre pourraient manquer, ni pourquoi. Ce déséquilibre fait en sorte que nous acquérons une bien meilleure compréhension de la psychologie et des positions politiques de PV que de celles de PT. …
Pierre Elliott Trudeau et Pierre Vadeboncoeur, J’attends de toi une oeuvre de bataille. Correspondance 1942-1996, Lux Éditeur, 2021, 272 p.[Notice]
…plus d’informations
Greg Nielsen
Université de Concordia, Centre for Broadcasting Studies (CCBS)
greg.nielsen@concordia.ca