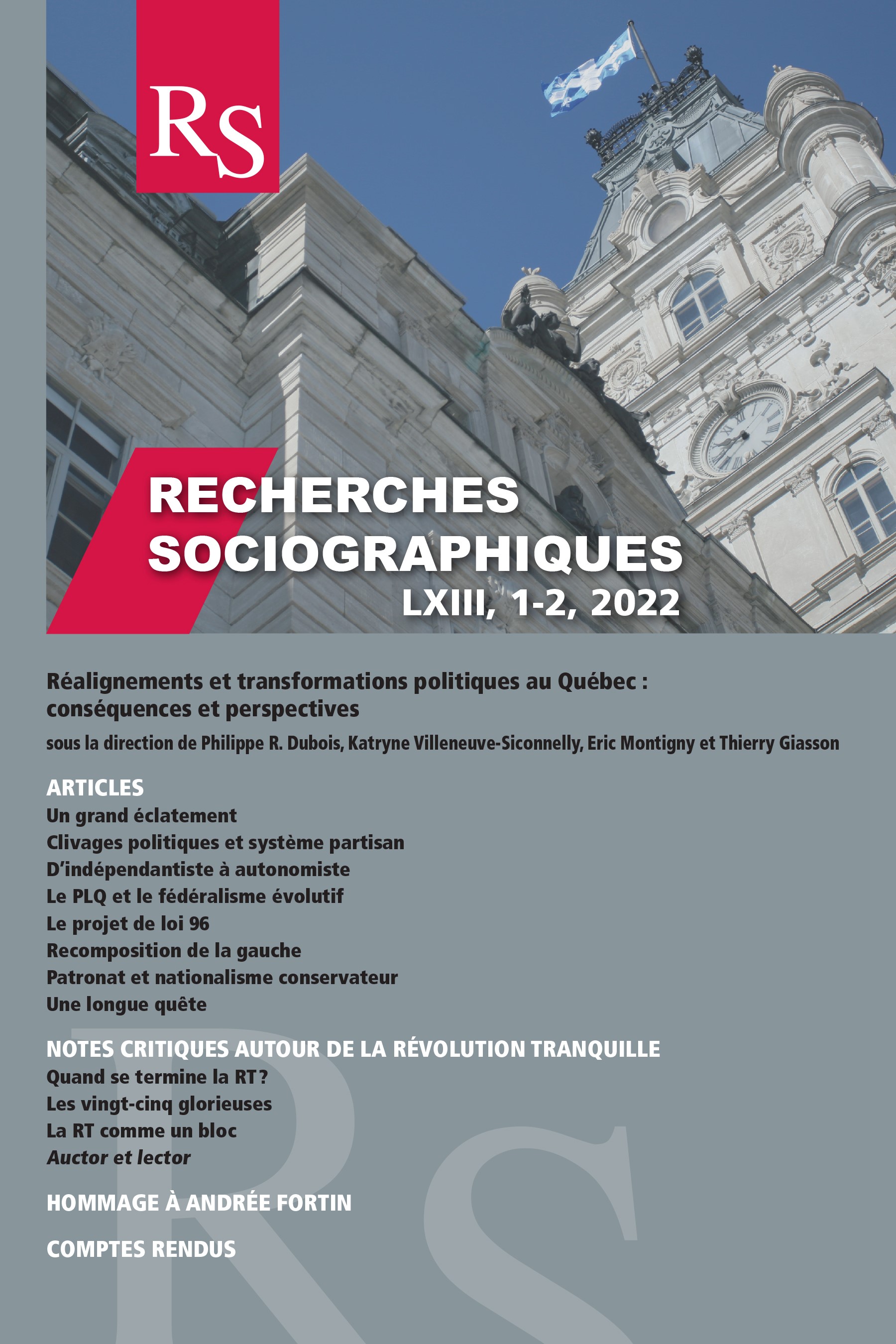D'emblée, nous tenons à remercier vivement les historiens Éric Bédard et Yvan Lamonde, ainsi que les sociologues Andrée Fortin et Dominique Morin, pour leur lecture attentive et réfléchie de notre Brève histoire de la Révolution tranquille. Nous avons aussi une pensée émue pour notre collègue Andrée Fortin, qui n’est plus parmi nous afin de prolonger notre conversation commune. Notre réponse risque de surprendre. A contrario des usages convenus de la formule éditoriale, nous n’avons pas l’intention d’applaudir ou de réfuter telle ou telle interprétation de nos lecteurs. Plutôt, notre réponse veut porter la réflexion sur un autre plan. Elle émerge de nos conceptions relatives à la lecture et au dialogue entre l’auteur et le lecteur. Notre réponse exprime également nos convictions quant à la visée des échanges scientifiques au sein de notre discipline, l’histoire. Tout d’abord, mentionnons nos conceptions relatives à la lecture d’un texte savant. Dans Lector in fabula, le sémioticien Umberto Eco explore les différentes modalités de la lecture. Il remarque d’abord qu’un auteur perd le contrôle de son texte une fois la plume déposée : tout lecteur se l’approprie désormais avec l’usage de son intelligence. Eco souligne ensuite que « la compétence du destinataire n’est pas nécessairement celle de l’émetteur » : les codes du destinataire, du lecteur, « peuvent différer, en tout ou en partie, des codes de l’émetteur » (Eco, 1985, p. 64-65). Chaque lecteur a, en effet, une expérience spécifique, à partir de laquelle il décode le texte pour en tirer une interprétation qui lui est propre. Au-delà des intentions premières de l’auteur, un texte implique ainsi la coopération du lecteur comme condition de son actualisation. Enfin, en se plaçant dans la perspective du lecteur, Eco fait une distinction entre les textes fermés, qui limitent les possibilités interprétatives, et les textes ouverts, qui aménagent un espace où la réflexion peut se déployer en établissant des associations entre éléments porteurs de sens. La conception d’Umberto Eco suppose l’adoption de principes éthiques préalables au dialogue entre l’auteur et le lecteur, ou entre l’auctor et le lector pour reprendre la typologie de Pierre Bourdieu (1997, p. 103-104). D’abord, du côté de l’auteur, cet auctor qui produit une oeuvre originale, doit concevoir un lecteur modèle, le lector. Le lector partage avec l’auctor un univers de sens, une certaine connivence, des codes communs pour que l’essentiel du message transmis par le texte puisse être saisi et compris. Un poète n’a pas le même lectorat que le rédacteur d’un manuel scolaire ou un essayiste : non seulement les intentions sous-tendant l’acte d’écriture divergent, mais les destinataires du texte ne sont pas les mêmes. Du fait de leur altérité constitutive, l’auteur doit donc admettre que son lecteur possède une compétence qui ne lui appartient pas, en raison de ses attentes, de ses sensibilités, de sa perspective, de son expérience. En toute bonne foi, il reconnaît au lecteur la pleine capacité d’un sujet réfléchissant et autonome. Ensuite, du côté du lecteur, l’interprétation et l’appropriation du sens d’un texte ne sont pas échevelées ou psychédéliques, pour reprendre le qualificatif d’Umberto Eco. Elles doivent s’ancrer dans le texte en obéissant à certaines dispositions de lecture : celles de la fidélité au propos, du respect de son authenticité et de son intégrité, de la compréhension du contexte d’énonciation et des objectifs énoncés. Elles assument aussi la reconnaissance de l’autorité subjective de l’auteur – le terme auctor en latin renvoie à celui d’autorité en français – dans le champ de sa compétence. La reconnaissance de cette autorité n’est pas une obédience; elle participe d’un dialogue, le plus souvent …
Parties annexes
Bibliographie
- Angenot, Marc, 2008 Dialogues de sourds. Traité de rhétorique antilogique, Paris, Mille et une nuits.
- Bourdieu, Pierre, 1997 Méditations pascaliennes, Paris, Seuil.
- Bourdieu, Pierre, 2022 Retour sur la réflexivité, Paris, EHESS.
- Eco, Umberto, 1985 [1979] Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset.
- Gingras, Yves (dir.), 2014 Controverses. Accords et désaccords en sciences humaines et sociales, Paris, CNRS éditions.
- Pâquet, Martin et Stéphane Savard, 2021 Brève histoire de la Révolution tranquille, Montréal, Boréal.